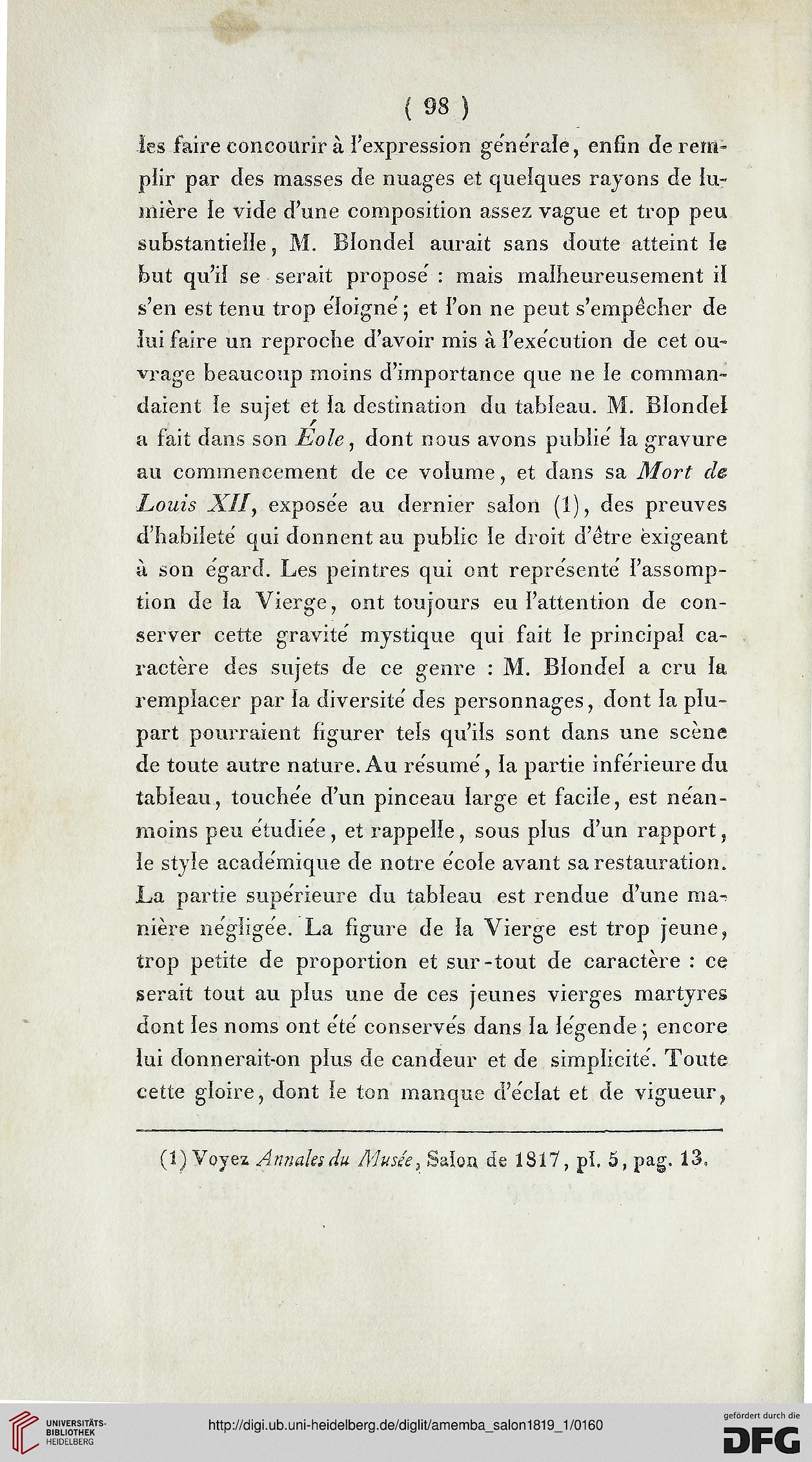les faire concourir à l'expression generale, enfin de rem*
piir par des masses de nuages et quelques rayons de lu-
mière le vide d’une composition assez vague et trop peu
substantielle, M. Blondel aurait sans doute atteint le
but qu’il se serait propose : mais malheureusement il
s’en est tenu trop éloigné' ; et l’on ne peut s’empêcher de
lui faire un reproche d’avoir mis à l’execution de cet ou-
vrage beaucoup moins d’importance que ne le comman-
daient le sujet et la destination du tableau. M. Blondel
a fait dans son Idole, dont nous avons publie' la gravure
au commencement de ce volume, et dans sa Mort de
Louis XII, expose'e au dernier salon (1), des preuves
d’habileté qui donnent au public le droit d’être exigeant
à son égard. Les peintres qui ont représenté l’assomp-
tion de la Vierge, ont toujours eu l’attention de con-
server cette gravité mystique qui fait le principal ca-
ractère des sujets de ce genre : M. Blondel a cru la
remplacer par la diversité des personnages, dont la plu-
part pourraient figurer tels qu’ils sont dans une scène
de toute autre nature. Au résumé, la partie inférieure du
tableau, touchée d’un pinceau large et facile, est néan-
moins peu étudiée, et rappelle, sous plus d’un rapport,
le style académique de notre école avant sa restauration.
La partie supérieure du tableau est rendue d’une ma-
nière négligée. La figure de la Vierge est trop jeune,
trop petite de proportion et sur-tout de caractère : ce
serait tout au plus une de ces jeunes vierges martyres
dont les noms ont été conservés dans la légende ; encore
lui donnerait-on plus de candeur et de simplicité. Toute
cette gloire, dont le ton manque d’éclat et de vigueur,
(1) Voyez Annales du Musée, Salon de 1817, pï. 5, pag. 13,
piir par des masses de nuages et quelques rayons de lu-
mière le vide d’une composition assez vague et trop peu
substantielle, M. Blondel aurait sans doute atteint le
but qu’il se serait propose : mais malheureusement il
s’en est tenu trop éloigné' ; et l’on ne peut s’empêcher de
lui faire un reproche d’avoir mis à l’execution de cet ou-
vrage beaucoup moins d’importance que ne le comman-
daient le sujet et la destination du tableau. M. Blondel
a fait dans son Idole, dont nous avons publie' la gravure
au commencement de ce volume, et dans sa Mort de
Louis XII, expose'e au dernier salon (1), des preuves
d’habileté qui donnent au public le droit d’être exigeant
à son égard. Les peintres qui ont représenté l’assomp-
tion de la Vierge, ont toujours eu l’attention de con-
server cette gravité mystique qui fait le principal ca-
ractère des sujets de ce genre : M. Blondel a cru la
remplacer par la diversité des personnages, dont la plu-
part pourraient figurer tels qu’ils sont dans une scène
de toute autre nature. Au résumé, la partie inférieure du
tableau, touchée d’un pinceau large et facile, est néan-
moins peu étudiée, et rappelle, sous plus d’un rapport,
le style académique de notre école avant sa restauration.
La partie supérieure du tableau est rendue d’une ma-
nière négligée. La figure de la Vierge est trop jeune,
trop petite de proportion et sur-tout de caractère : ce
serait tout au plus une de ces jeunes vierges martyres
dont les noms ont été conservés dans la légende ; encore
lui donnerait-on plus de candeur et de simplicité. Toute
cette gloire, dont le ton manque d’éclat et de vigueur,
(1) Voyez Annales du Musée, Salon de 1817, pï. 5, pag. 13,