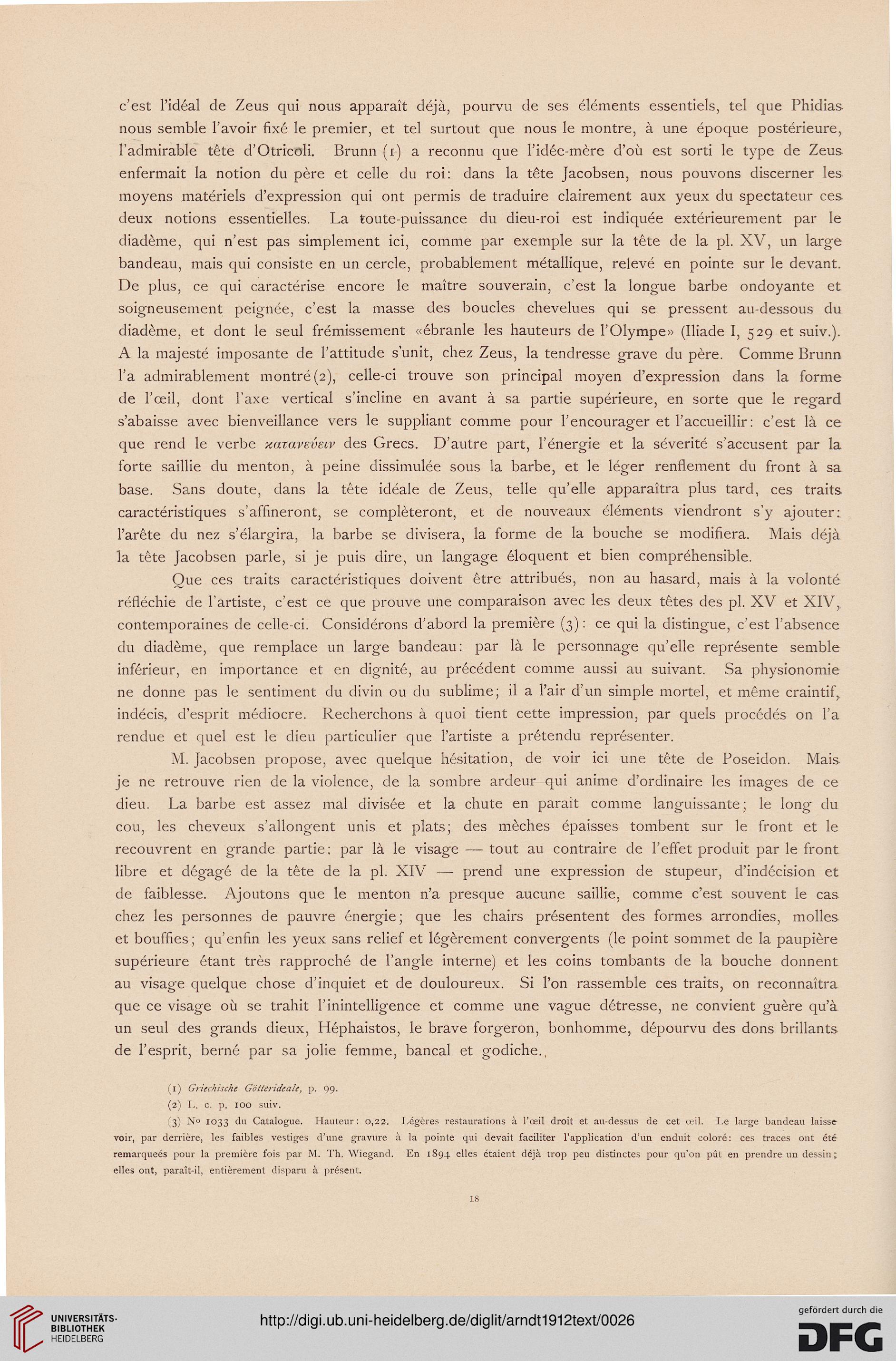c'est l'idéal de Zeus qui nous apparaît déjà, pourvu de ses éléments essentiels, tel que Phidias,
nous semble l'avoir fixé le premier, et tel surtout que nous le montre, à une époque postérieure,
l'admirable tête d'Otricoli. Brunn (i) a reconnu que l'idée-mère d'où est sorti le type de Zeus
enfermait la notion du père et celle du roi: dans la tête Jacobsen, nous pouvons discerner les
moyens matériels d'expression qui ont permis de traduire clairement aux yeux du spectateur ces
deux notions essentielles. La toute-puissance du dieu-roi est indiquée extérieurement par le
diadème, qui n'est pas simplement ici, comme par exemple sur la tête de la pi. XV, un large
bandeau, mais qui consiste en un cercle, probablement métallique, relevé en pointe sur le devant.
De plus, ce qui caractérise encore le maître souverain, c'est la longue barbe ondoyante et
soigneusement peignée, c'est la masse des boucles chevelues qui se pressent au-dessous du
diadème, et dont le seul frémissement «ébranle les hauteurs de l'Olympe» (Iliade I, 529 et suiv.).
A la majesté imposante de l'attitude s'unit, chez Zeus, la tendresse grave du père. Comme Brunn
l'a admirablement montré (2), celle-ci trouve son principal moyen d'expression dans la forme
de l'œil, dont l'axe vertical s'incline en avant à sa partie supérieure, en sorte que le regard
s'abaisse avec bienveillance vers le suppliant comme pour l'encourager et l'accueillir : c'est là ce
que rend le verbe xaraveùeiv des Grecs. D'autre part, l'énergie et la sévérité s'accusent par la
forte saillie du menton, à peine dissimulée sous la barbe, et le léger renflement du front à sa
base. Sans doute, dans la tête idéale de Zeus, telle qu'elle apparaîtra plus tard, ces traits
caractéristiques s'affineront, se compléteront, et de nouveaux éléments viendront s'y ajouter:
l'arête du nez s'élargira, la barbe se divisera, la forme de la bouche se modifiera. Mais déjà
la tête Jacobsen parle, si je puis dire, un langage éloquent et bien compréhensible.
Que ces traits caractéristiques doivent être attribués, non au hasard, mais à la volonté
réfléchie de l'artiste, c'est ce (pie prouve une comparaison avec les deux têtes des pi. XV et XIV,
contemporaines de celle-ci. Considérons d'abord la première (3) : ce qui la distingue, c'est l'absence
du diadème, que remplace un large bandeau: par là le personnage qu'elle représente semble
inférieur, en importance et en dignité, au précédent comme aussi au suivant. Sa physionomie
ne donne pas le sentiment du divin ou du sublime; il a l'air d'un simple mortel, et même craintif,
indécis, d'esprit médiocre. Recherchons à quoi tient cette impression, par quels procédés on l'a
rendue et quel est le dieu particulier que l'artiste a prétendu représenter.
M. Jacobsen propose, avec quelque hésitation, de voir ici une tête de Poséidon. Mais
je ne retrouve rien de la violence, de la sombre ardeur qui anime d'ordinaire les images de ce
dieu. La barbe est assez mal divisée et la chute en parait comme languissante; le long du
cou, les cheveux s'allongent unis et plats; des mèches épaisses tombent sur le front et le
recouvrent en grande partie; par là le visage — tout au contraire de l'effet produit par le front
libre et dégagé de la tête de la pi. XIV — prend une expression de stupeur, d'indécision et
de faiblesse. Ajoutons que le menton n'a presque aucune saillie, comme c'est souvent le cas
chez les personnes de pauvre énergie; que les chairs présentent des formes arrondies, molles
et bouffies; qu'enfin les yeux sans relief et légèrement convergents (le point sommet de la paupière
supérieure étant très rapproché de l'angle interne) et les coins tombants de la bouche donnent
au visage quelque chose d'inquiet et de douloureux. Si l'on rassemble ces traits, on reconnaîtra
que ce visage où se trahit l'inintelligence et comme une vague détresse, ne convient guère qu'à
un seul des grands dieux, Héphaistos, le brave forgeron, bonhomme, dépourvu des dons brillants
de l'esprit, berné par sa jolie femme, bancal et godiche.,
(1) Griechischt GbtterideaU, p. 99.
(2) L. c. ]). IOO suiv.
3) N° 1033 du Catalogue. Hauteur: 0,22. Légères restaurations à l'œil droit et au-dessus de cet œil. Le large bandeau laisse
voir, par derrière, les faibles vestiges d'une gravure à la pointe qui devait faciliter l'application d'un enduit coloré: ces traces ont été
remarquées pour la première fois par M. Th. Wiegand. En 1894 elles étaient déjà trop peu distinctes pour qu'on pût en prendre un dessin ;
elles ont, paraît-il, entièrement disparu à présent.
18
nous semble l'avoir fixé le premier, et tel surtout que nous le montre, à une époque postérieure,
l'admirable tête d'Otricoli. Brunn (i) a reconnu que l'idée-mère d'où est sorti le type de Zeus
enfermait la notion du père et celle du roi: dans la tête Jacobsen, nous pouvons discerner les
moyens matériels d'expression qui ont permis de traduire clairement aux yeux du spectateur ces
deux notions essentielles. La toute-puissance du dieu-roi est indiquée extérieurement par le
diadème, qui n'est pas simplement ici, comme par exemple sur la tête de la pi. XV, un large
bandeau, mais qui consiste en un cercle, probablement métallique, relevé en pointe sur le devant.
De plus, ce qui caractérise encore le maître souverain, c'est la longue barbe ondoyante et
soigneusement peignée, c'est la masse des boucles chevelues qui se pressent au-dessous du
diadème, et dont le seul frémissement «ébranle les hauteurs de l'Olympe» (Iliade I, 529 et suiv.).
A la majesté imposante de l'attitude s'unit, chez Zeus, la tendresse grave du père. Comme Brunn
l'a admirablement montré (2), celle-ci trouve son principal moyen d'expression dans la forme
de l'œil, dont l'axe vertical s'incline en avant à sa partie supérieure, en sorte que le regard
s'abaisse avec bienveillance vers le suppliant comme pour l'encourager et l'accueillir : c'est là ce
que rend le verbe xaraveùeiv des Grecs. D'autre part, l'énergie et la sévérité s'accusent par la
forte saillie du menton, à peine dissimulée sous la barbe, et le léger renflement du front à sa
base. Sans doute, dans la tête idéale de Zeus, telle qu'elle apparaîtra plus tard, ces traits
caractéristiques s'affineront, se compléteront, et de nouveaux éléments viendront s'y ajouter:
l'arête du nez s'élargira, la barbe se divisera, la forme de la bouche se modifiera. Mais déjà
la tête Jacobsen parle, si je puis dire, un langage éloquent et bien compréhensible.
Que ces traits caractéristiques doivent être attribués, non au hasard, mais à la volonté
réfléchie de l'artiste, c'est ce (pie prouve une comparaison avec les deux têtes des pi. XV et XIV,
contemporaines de celle-ci. Considérons d'abord la première (3) : ce qui la distingue, c'est l'absence
du diadème, que remplace un large bandeau: par là le personnage qu'elle représente semble
inférieur, en importance et en dignité, au précédent comme aussi au suivant. Sa physionomie
ne donne pas le sentiment du divin ou du sublime; il a l'air d'un simple mortel, et même craintif,
indécis, d'esprit médiocre. Recherchons à quoi tient cette impression, par quels procédés on l'a
rendue et quel est le dieu particulier que l'artiste a prétendu représenter.
M. Jacobsen propose, avec quelque hésitation, de voir ici une tête de Poséidon. Mais
je ne retrouve rien de la violence, de la sombre ardeur qui anime d'ordinaire les images de ce
dieu. La barbe est assez mal divisée et la chute en parait comme languissante; le long du
cou, les cheveux s'allongent unis et plats; des mèches épaisses tombent sur le front et le
recouvrent en grande partie; par là le visage — tout au contraire de l'effet produit par le front
libre et dégagé de la tête de la pi. XIV — prend une expression de stupeur, d'indécision et
de faiblesse. Ajoutons que le menton n'a presque aucune saillie, comme c'est souvent le cas
chez les personnes de pauvre énergie; que les chairs présentent des formes arrondies, molles
et bouffies; qu'enfin les yeux sans relief et légèrement convergents (le point sommet de la paupière
supérieure étant très rapproché de l'angle interne) et les coins tombants de la bouche donnent
au visage quelque chose d'inquiet et de douloureux. Si l'on rassemble ces traits, on reconnaîtra
que ce visage où se trahit l'inintelligence et comme une vague détresse, ne convient guère qu'à
un seul des grands dieux, Héphaistos, le brave forgeron, bonhomme, dépourvu des dons brillants
de l'esprit, berné par sa jolie femme, bancal et godiche.,
(1) Griechischt GbtterideaU, p. 99.
(2) L. c. ]). IOO suiv.
3) N° 1033 du Catalogue. Hauteur: 0,22. Légères restaurations à l'œil droit et au-dessus de cet œil. Le large bandeau laisse
voir, par derrière, les faibles vestiges d'une gravure à la pointe qui devait faciliter l'application d'un enduit coloré: ces traces ont été
remarquées pour la première fois par M. Th. Wiegand. En 1894 elles étaient déjà trop peu distinctes pour qu'on pût en prendre un dessin ;
elles ont, paraît-il, entièrement disparu à présent.
18