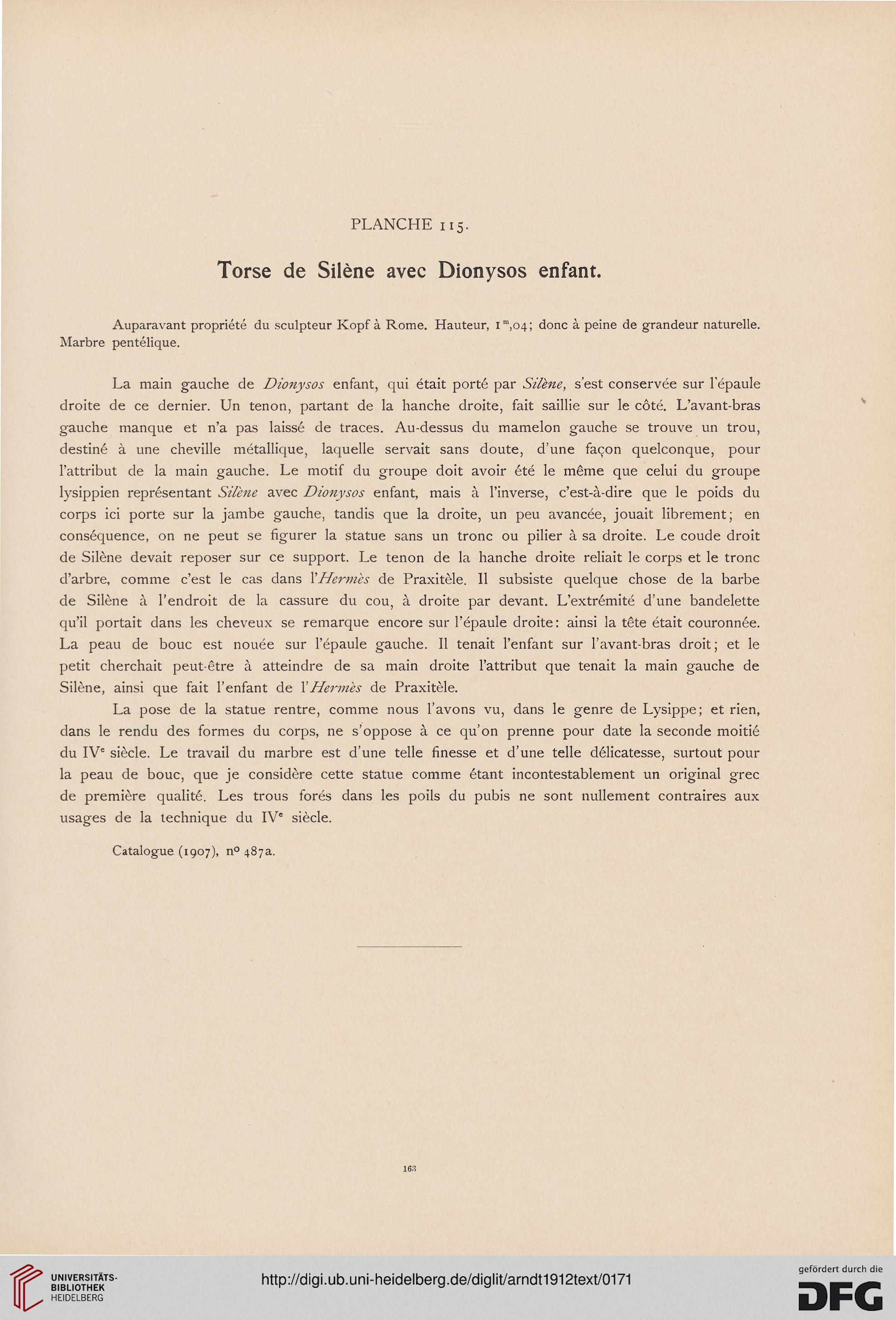PLANCHE 115.
Torse de Silène avec Dionysos enfant.
Auparavant propriété du sculpteur Kopf à Rome. Hauteur, i"\o4; donc à peine de grandeur naturelle.
Marbre pentélique.
La main gauche de Dionysos enfant, qui était porté par Silène, s'est conservée sur l'épaule
droite de ce dernier. Un tenon, partant de la hanche droite, fait saillie sur le côté. L'avant-bras
gauche manque et n'a pas laissé de traces. Au-dessus du mamelon gauche se trouve un trou,
destiné à une cheville métallique, laquelle servait sans doute, d'une façon quelconque, pour
l'attribut de la main gauche. Le motif du groupe doit avoir été le même que celui du groupe
lysippien représentant Silène avec Dionysos enfant, mais à l'inverse, c'est-à-dire que le poids du
corps ici porte sur la jambe gauche, tandis que la droite, un peu avancée, jouait librement; en
conséquence, on ne peut se figurer la statue sans un tronc ou pilier à sa droite. Le coude droit
de Silène devait reposer sur ce support. Le tenon de la hanche droite reliait le corps et le tronc
d'arbre, comme c'est le cas dans l'Hermès de Praxitèle. Il subsiste quelque chose de la barbe
de Silène à l'endroit de la cassure du cou, à droite par devant. L'extrémité d'une bandelette
qu'il portait dans les cheveux se remarque encore sur l'épaule droite: ainsi la tête était couronnée.
La peau de bouc est nouée sur l'épaule gauche. Il tenait l'enfant sur l'avant-bras droit; et le
petit cherchait peut-être à atteindre de sa main droite l'attribut que tenait la main gauche de
Silène, ainsi que fait l'enfant de l'Hermès de Praxitèle.
La pose de la statue rentre, comme nous l'avons vu, dans le genre de Lysippe; et rien,
dans le rendu des formes du corps, ne s'oppose à ce qu'on prenne pour date la seconde moitié
du IVe siècle. Le travail du marbre est d'une telle finesse et d'une telle délicatesse, surtout pour
la peau de bouc, que je considère cette statue comme étant incontestablement un original grec
de première qualité. Les trous forés dans les poils du pubis ne sont nullement contraires aux
usages de la technique du IVe siècle.
Catalogue (1907), n° 487a.
163
Torse de Silène avec Dionysos enfant.
Auparavant propriété du sculpteur Kopf à Rome. Hauteur, i"\o4; donc à peine de grandeur naturelle.
Marbre pentélique.
La main gauche de Dionysos enfant, qui était porté par Silène, s'est conservée sur l'épaule
droite de ce dernier. Un tenon, partant de la hanche droite, fait saillie sur le côté. L'avant-bras
gauche manque et n'a pas laissé de traces. Au-dessus du mamelon gauche se trouve un trou,
destiné à une cheville métallique, laquelle servait sans doute, d'une façon quelconque, pour
l'attribut de la main gauche. Le motif du groupe doit avoir été le même que celui du groupe
lysippien représentant Silène avec Dionysos enfant, mais à l'inverse, c'est-à-dire que le poids du
corps ici porte sur la jambe gauche, tandis que la droite, un peu avancée, jouait librement; en
conséquence, on ne peut se figurer la statue sans un tronc ou pilier à sa droite. Le coude droit
de Silène devait reposer sur ce support. Le tenon de la hanche droite reliait le corps et le tronc
d'arbre, comme c'est le cas dans l'Hermès de Praxitèle. Il subsiste quelque chose de la barbe
de Silène à l'endroit de la cassure du cou, à droite par devant. L'extrémité d'une bandelette
qu'il portait dans les cheveux se remarque encore sur l'épaule droite: ainsi la tête était couronnée.
La peau de bouc est nouée sur l'épaule gauche. Il tenait l'enfant sur l'avant-bras droit; et le
petit cherchait peut-être à atteindre de sa main droite l'attribut que tenait la main gauche de
Silène, ainsi que fait l'enfant de l'Hermès de Praxitèle.
La pose de la statue rentre, comme nous l'avons vu, dans le genre de Lysippe; et rien,
dans le rendu des formes du corps, ne s'oppose à ce qu'on prenne pour date la seconde moitié
du IVe siècle. Le travail du marbre est d'une telle finesse et d'une telle délicatesse, surtout pour
la peau de bouc, que je considère cette statue comme étant incontestablement un original grec
de première qualité. Les trous forés dans les poils du pubis ne sont nullement contraires aux
usages de la technique du IVe siècle.
Catalogue (1907), n° 487a.
163