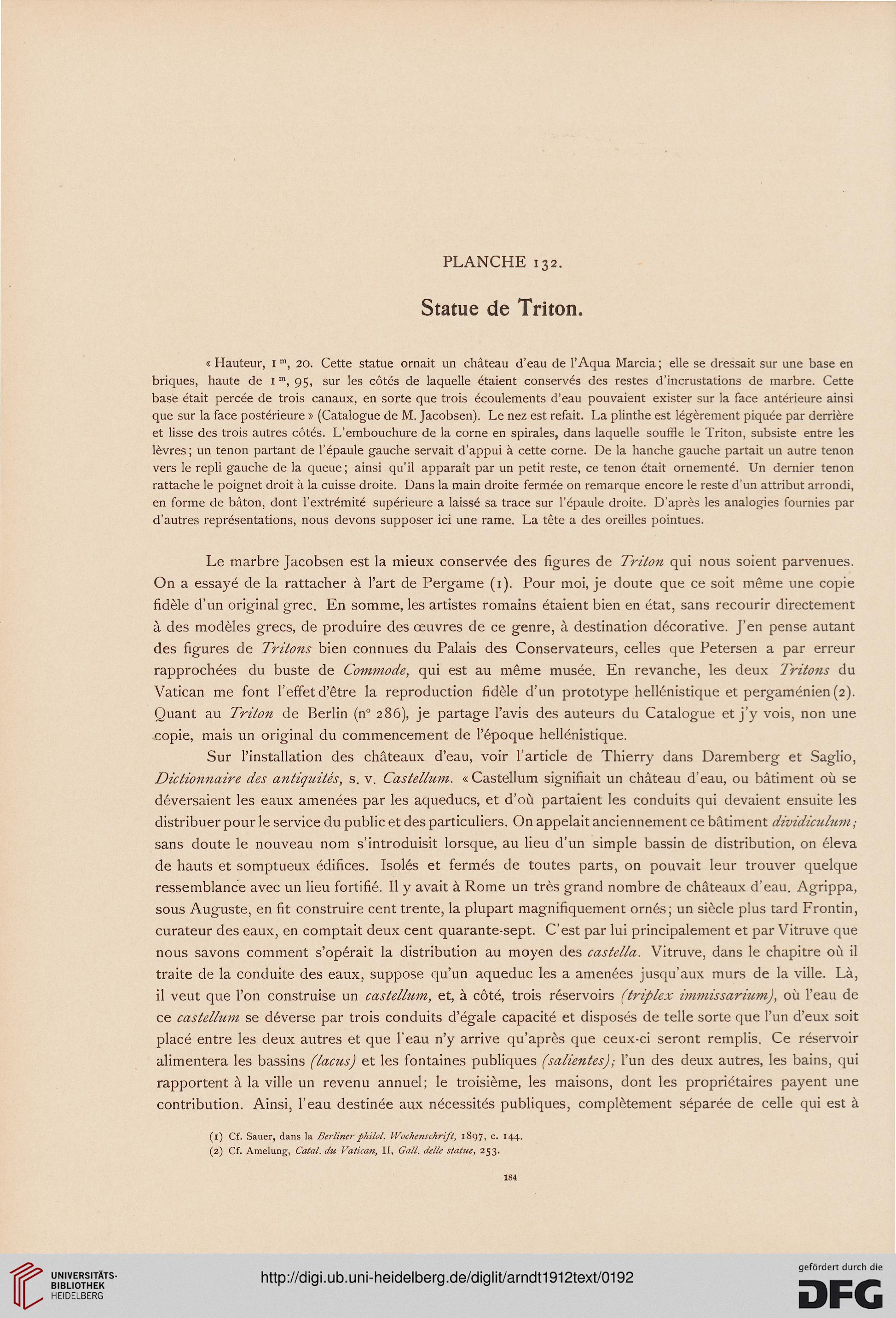PLANCHE 132.
Statue de Triton.
« Hauteur, 1 m, 20. Cette statue ornait un château d'eau de l'Aqua Marcia ; elle se dressait sur une base en
briques, haute de 1 m, 95, sur les côtés de laquelle étaient conservés des restes d'incrustations de marbre. Cette
base était percée de trois canaux, en sorte que trois écoulements d'eau pouvaient exister sur la face antérieure ainsi
que sur la face postérieure » (Catalogue de M. Jacobsen). Le nez est refait. La plinthe est légèrement piquée par derrière
et lisse des trois autres côtés. L'embouchure de la corne en spirales, dans laquelle souffle le Triton, subsiste entre les
lèvres; un tenon partant de l'épaule gauche servait d'appui à cette corne. De la hanche gauche partait un autre tenon
vers le repli gauche de la queue; ainsi qu'il apparaît par un petit reste, ce tenon était ornementé. Un dernier tenon
rattache le poignet droit à la cuisse droite. Dans la main droite fermée on remarque encore le reste d'un attribut arrondi,
en forme de bâton, dont l'extrémité supérieure a laissé sa trace sur l'épaule droite. D'après les analogies fournies par
d'autres représentations, nous devons supposer ici une rame. La tête a des oreilles pointues.
Le marbre Jacobsen est la mieux conservée des figures de Triton qui nous soient parvenues.
On a essayé de la rattacher à l'art de Pergame (1). Pour moi, je doute que ce soit même une copie
fidèle d'un original grec. En somme, les artistes romains étaient bien en état, sans recourir directement
à des modèles grecs, de produire des œuvres de ce genre, à destination décorative. J'en pense autant
des figures de Tritons bien connues du Palais des Conservateurs, celles que Petersen a par erreur
rapprochées du buste de Commode, qui est au même musée. En revanche, les deux Tritons du
Vatican me font l'effet d'être la reproduction fidèle d'un prototype hellénistique et pergaménien (2).
Quant au Triton de Berlin (n° 286), je partage l'avis des auteurs du Catalogue et j'y vois, non une
copie, mais un original du commencement de l'époque hellénistique.
Sur l'installation des châteaux d'eau, voir l'article de Thierry dans Daremberg et Saglio,
Dictionnaire des antiquités, s. v. Castellum. « Castellum signifiait un château d'eau, ou bâtiment où se
déversaient les eaux amenées par les aqueducs, et d'où partaient les conduits qui devaient ensuite les
distribuer pour le service du public et des particuliers. On appelait anciennement ce bâtiment dividiculum;
sans doute le nouveau nom s'introduisit lorsque, au lieu d'un simple bassin de distribution, on éleva
de hauts et somptueux édifices. Isolés et fermés de toutes parts, on pouvait leur trouver quelque
ressemblance avec un lieu fortifié. Il y avait à Rome un très grand nombre de châteaux d'eau. Agrippa,
sous Auguste, en fit construire cent trente, la plupart magnifiquement ornés; un siècle plus tard Frontin,
curateur des eaux, en comptait deux cent quarante-sept. C'est par lui principalement et par Vitruve que
nous savons comment s'opérait la distribution au moyen des castella. Vitruve, dans le chapitre où il
traite de la conduite des eaux, suppose qu'un aqueduc les a amenées jusqu'aux murs de la ville. Là,
il veut que l'on construise un castellum, et, à côté, trois réservoirs (triplex immissarium), où l'eau de
ce castellum se déverse par trois conduits d'égale capacité et disposés de telle sorte que l'un d'eux soit
placé entre les deux autres et que l'eau n'y arrive qu'après que ceux-ci seront remplis. Ce réservoir
alimentera les bassins flacusj et les fontaines publiques (salientes),• l'un des deux autres, les bains, qui
rapportent à la ville un revenu annuel; le troisième, les maisons, dont les propriétaires payent une
contribution. Ainsi, l'eau destinée aux nécessités publiques, complètement séparée de celle qui est à
(1) Cf. Sauer, dans la Berliner philol. Wochenschrift, 1897, c. 144.
(2) Cf. Amelung, Catal. du Vatican, II, Gall. délie statue, 253.
184
Statue de Triton.
« Hauteur, 1 m, 20. Cette statue ornait un château d'eau de l'Aqua Marcia ; elle se dressait sur une base en
briques, haute de 1 m, 95, sur les côtés de laquelle étaient conservés des restes d'incrustations de marbre. Cette
base était percée de trois canaux, en sorte que trois écoulements d'eau pouvaient exister sur la face antérieure ainsi
que sur la face postérieure » (Catalogue de M. Jacobsen). Le nez est refait. La plinthe est légèrement piquée par derrière
et lisse des trois autres côtés. L'embouchure de la corne en spirales, dans laquelle souffle le Triton, subsiste entre les
lèvres; un tenon partant de l'épaule gauche servait d'appui à cette corne. De la hanche gauche partait un autre tenon
vers le repli gauche de la queue; ainsi qu'il apparaît par un petit reste, ce tenon était ornementé. Un dernier tenon
rattache le poignet droit à la cuisse droite. Dans la main droite fermée on remarque encore le reste d'un attribut arrondi,
en forme de bâton, dont l'extrémité supérieure a laissé sa trace sur l'épaule droite. D'après les analogies fournies par
d'autres représentations, nous devons supposer ici une rame. La tête a des oreilles pointues.
Le marbre Jacobsen est la mieux conservée des figures de Triton qui nous soient parvenues.
On a essayé de la rattacher à l'art de Pergame (1). Pour moi, je doute que ce soit même une copie
fidèle d'un original grec. En somme, les artistes romains étaient bien en état, sans recourir directement
à des modèles grecs, de produire des œuvres de ce genre, à destination décorative. J'en pense autant
des figures de Tritons bien connues du Palais des Conservateurs, celles que Petersen a par erreur
rapprochées du buste de Commode, qui est au même musée. En revanche, les deux Tritons du
Vatican me font l'effet d'être la reproduction fidèle d'un prototype hellénistique et pergaménien (2).
Quant au Triton de Berlin (n° 286), je partage l'avis des auteurs du Catalogue et j'y vois, non une
copie, mais un original du commencement de l'époque hellénistique.
Sur l'installation des châteaux d'eau, voir l'article de Thierry dans Daremberg et Saglio,
Dictionnaire des antiquités, s. v. Castellum. « Castellum signifiait un château d'eau, ou bâtiment où se
déversaient les eaux amenées par les aqueducs, et d'où partaient les conduits qui devaient ensuite les
distribuer pour le service du public et des particuliers. On appelait anciennement ce bâtiment dividiculum;
sans doute le nouveau nom s'introduisit lorsque, au lieu d'un simple bassin de distribution, on éleva
de hauts et somptueux édifices. Isolés et fermés de toutes parts, on pouvait leur trouver quelque
ressemblance avec un lieu fortifié. Il y avait à Rome un très grand nombre de châteaux d'eau. Agrippa,
sous Auguste, en fit construire cent trente, la plupart magnifiquement ornés; un siècle plus tard Frontin,
curateur des eaux, en comptait deux cent quarante-sept. C'est par lui principalement et par Vitruve que
nous savons comment s'opérait la distribution au moyen des castella. Vitruve, dans le chapitre où il
traite de la conduite des eaux, suppose qu'un aqueduc les a amenées jusqu'aux murs de la ville. Là,
il veut que l'on construise un castellum, et, à côté, trois réservoirs (triplex immissarium), où l'eau de
ce castellum se déverse par trois conduits d'égale capacité et disposés de telle sorte que l'un d'eux soit
placé entre les deux autres et que l'eau n'y arrive qu'après que ceux-ci seront remplis. Ce réservoir
alimentera les bassins flacusj et les fontaines publiques (salientes),• l'un des deux autres, les bains, qui
rapportent à la ville un revenu annuel; le troisième, les maisons, dont les propriétaires payent une
contribution. Ainsi, l'eau destinée aux nécessités publiques, complètement séparée de celle qui est à
(1) Cf. Sauer, dans la Berliner philol. Wochenschrift, 1897, c. 144.
(2) Cf. Amelung, Catal. du Vatican, II, Gall. délie statue, 253.
184