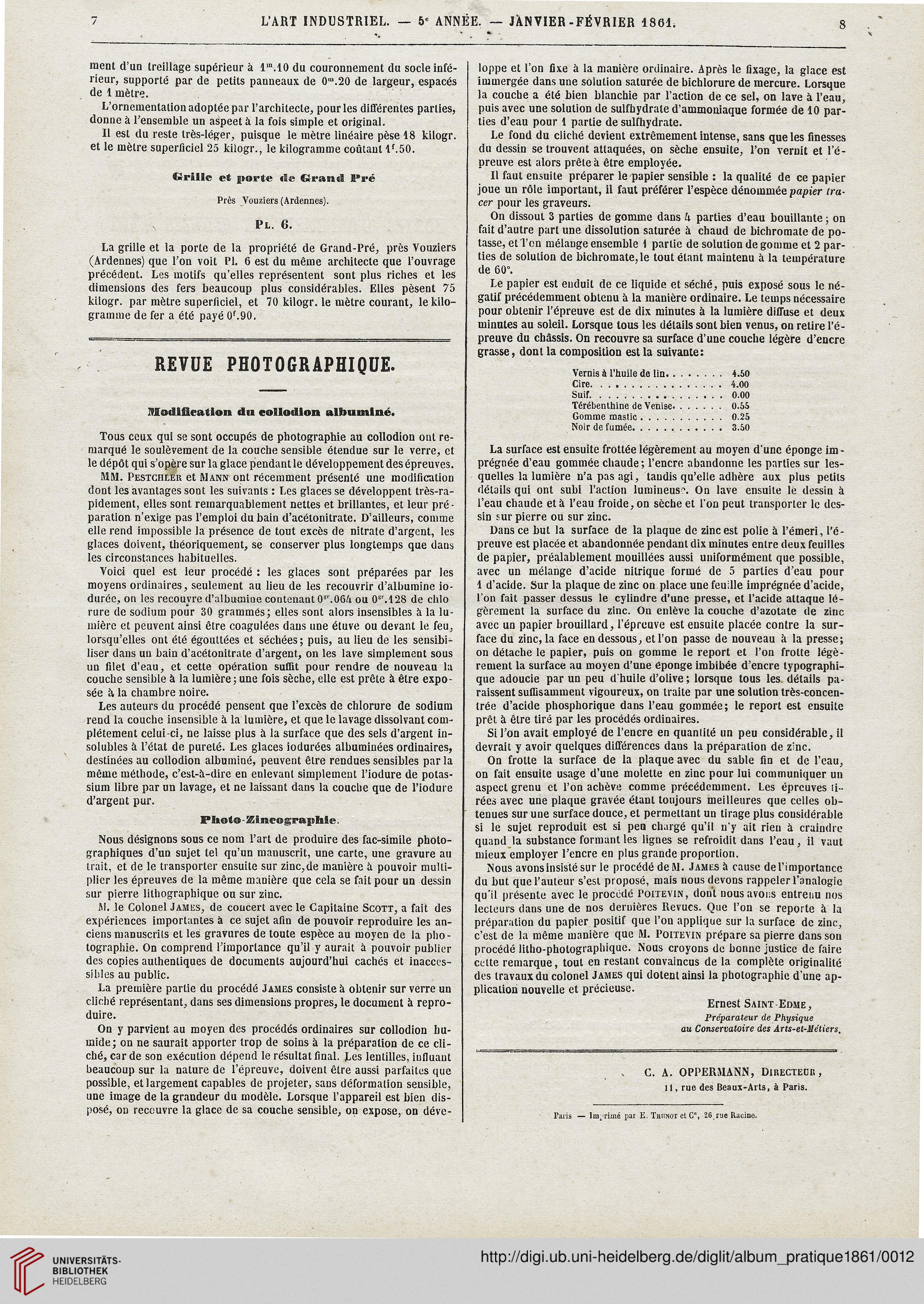8
L’ART INDUSTRIEL. — 5° ANNÉE. — JANVIER -FÉVRIER 1861.
ment d’un treillage supérieur à lin.10 du couronnement du socle infé-
rieur, supporté par de petits panneaux de 0m.20 de largeur, espacés
de 1 mètre.
L’ornementation adoptée par l’architecte, pour les différentes parties,
donne à l’ensemble un aSpeet à la fois simple et original.
U est du reste très-léger, puisque le mètre linéaire pèse 18 kilogr.
et le mètre superficiel 25 kilogr., le kilogramme coûtant lf.50.
Grille et porte «le Grand I*rc
Près Vouziers (Ardennes).
PL. 6.
La grille et la porte de la propriété de Grand-Pré, près Vouziers
(Ardennes) que l’on voit PI. 6 est du même architecte que l’ouvrage
précédent. Les motifs qu’elles représentent sont plus riches et les
dimensions des fers beaucoup plus considérables. Elles pèsent 75
kilogr. par mètre superficiel, et 70 kilogr. le mètre courant, le kilo-
gramme de fer a été payé 0f.90.
REVUE PHOTOGRAPHIQUE.
Modification du collodion albuminé.
Tous ceux qui se sont occupés de photographie au collodion ont re-
marqué le soulèvement de la couche sensible étendue sur le verre, et
le dépôt qui s’opère sur la glace pendant le développement des épreuves.
MM. Pestchler et Mann ont récemment présenté une modification
dont les avantages sont les suivants : Les glaces se développent très-ra-
pidement, elles sont remarquablement nettes et brillantes, et leur pré-
paration n’exige pas l’emploi du bain d’acétonitrate. D’ailleurs, comme
elle rend impossible la présence de tout excès de nitrate d’argent, les
glaces doivent, théoriquement, se conserver plus longtemps que dans
les circonstances habituelles.
Voici quel est leur procédé : les glaces sont préparées par les
moyens ordinaires, seulement au lieu de les recouvrir d’albumine io-
duréc, on les recouvre d'albumine contenant 0er.06A ou 0S‘.128 de clilo
rure de sodium pour 30 grammes; elles sont alors insensibles à la lu-
mière et peuvent ainsi être coagulées dans une étuve ou devant le feu,
lorsqu’elles ont été égouttées et séchées; puis, au lieu de les sensibi-
liser dans uu bain d’acétonitrate d’argent, on les lave simplement sous
un filet d’eau, et cette opération suffit pour rendre de nouveau la
couche sensible à la lumière; une fois sèche, elle est prête à être expo-
sée à la chambre noire.
Les auteurs du procédé pensent que l’excès de chlorure de sodium
rend la couche insensible à la lumière, et que le lavage dissolvant com-
plètement celui-ci, ne laisse plus à la surface que des sels d’argent in-
solubles à l’état de pureté. Les glaces iodurées albuminées ordinaires,
destinées au collodion albuminé, peuvent être rendues sensibles par la
même méthode, c’est-à-dire en enlevant simplement l’iodure de potas-
sium libre par un lavage, et ne laissant dans la couche que de l’iodure
d’argent pur.
Photo- Kincographlc.
Nous désignons sous ce nom l’art de produire des fac-similé photo-
graphiques d’un sujet tel qu’un manuscrit, une carte, une gravure au
trait, et de le transporter ensuite sur zinc,de manière à pouvoir multi-
plier les épreuves de la même manière que cela se fait pour un dessin
sur pierre lithographique ou sur zinc.
M. le Colonel James, de concert avec le Capitaine Scott, a fait des
expériences importantes à ce sujet afin de pouvoir reproduire les an-
ciens manuscrits et les gravures de toute espèce au moyen de la pho-
tographie. On comprend l’importance qu’il y aurait à pouvoir publier
des copies authentiques de documents aujourd’hui cachés et inacces-
sibles au public.
La première partie du procédé James consiste à obtenir sur verre un
cliché représentant, dans ses dimensions propres, le document à repro-
duire.
On y parvient au moyen des procédés ordinaires sur collodion hu-
mide; on ne saurait apporter trop de soins à la préparation de ce cli-
ché, carde son exécution dépend le résultat final. Les lentilles, influant
beaucoup sur la nature de l’épreuve, doivent être aussi parfaites que
possible, et largement capables de projeter, sans déformation sensible,
une image de la grandeur du modèle. Lorsque l’appareil est bien dis-
posé, ou recouvre la glace de sa couche sensible, on expose, on déve-
loppe et l’on fixe à la manière ordinaire. Après le fixage, la glace est
immergée dans une solution saturée de bichlorure de mercure. Lorsque
la couche a été bien blanchie par l’action de ce sel, on lave à l’eau,
puis avec une solution de sulfhydrale d’ammoniaque formée de 10 par-
ties d’eau pour 1 partie de sulfhydrate.
Le fond du cliché devient extrêmement intense, sans que les finesses
du dessin se trouvent attaquées, on sèche ensuite, Ton vernit et l’é-
preuve est alors prête à être employée.
Il faut ensuite préparer le papier sensible : la qualité de ce papier
joue un rôle important, il faut préférer l’espèce dénommée papier tra-
cer pour les graveurs.
On dissout 3 parties de gomme dans k parties d’eau bouillante ; on
fait d’autre part une dissolution saturée à chaud de bichromate de po-
tasse, et Ton mélange ensemble \ partie de solution de gomme et 2 par-
ties de solution de bichromate, le tout étant maintenu à la température
de 60°.
Le papier est enduit de ce liquide et séché, puis exposé sous le né-
gatif précédemment obtenu à la manière ordinaire. Le temps nécessaire
pour obtenir l’épreuve est de dix minutes à la lumière diffuse et deux
minutes au soleil. Lorsque tous les détails sont bien venus, on relire l’é-
preuve du châssis. On recouvre sa surface d’une couche légère d’encre
grasse, dont la composition est la suivante:
Vernis à l’huile de lin. 4.50
Cire.4.00
Suif.0.00
Térébenthine de Venise. 0.55
Gomme mastic.0.25
Noir de fumée.3.50
La surface est ensuite frottée légèrement au moyen d'une éponge im-
prégnée d’eau gommée chaude ; l’encre abandonne les parties sur les-
quelles la lumière n’a pas agi, taudis qu’elle adhère aux plus petits
détails qui ont subi l’action lumineuse. On lave ensuite le dessin à
l’eau chaude et à l’eau froide, on sèche et l’on peut transporter le des-
sin sur pierre ou sur zinc.
Dans ce but la surface de la plaque de zinc est polie à l’émeri, l’é-
preuve est placée et abandonnée pendant dix minutes entre deux feuilles
de papier, préalablement mouillées aussi uniformément que possible,
avec un mélange d’acide nitrique formé de 5 parties d’eau pour
1 d’acide. Sur la plaque de zinc on place une feuille imprégnée d’acide,
Ton fait passer dessus le cylindre d’une presse, et l’acide attaque lé-
gèrement la surface du zinc. On enlève la couche d’azotate de zinc
avec un papier brouillard, l’épreuve est ensuite placée contre la sur-
face du zinc, la face en dessous, et Ton passe de nouveau à la presse;
on détache le papier, puis on gomme le report et Ton frotte légè-
rement la surface au moyen d’une éponge imbibée d’encre typographi-
que adoucie par un peu d'huile d’olive; lorsque tous les détails pa-
raissent suffisamment vigoureux, on traite par une solution très-concen-
trée d’acide phosphorique dans l’eau gommée; le report est ensuite
prêt à être tiré par les procédés ordinaires.
Si Ton avait employé de l’encre en quantité un peu considérable, il
devrait y avoir quelques différences dans la préparation de zinc.
On frotte la surface de la plaque avec du sable fin et de l’eau,
on fait ensuite usage d’une molette en zinc pour lui communiquer un
aspect grenu et Ton achève comme précédemment. Les épreuves ti-
rées avec une plaque gravée étant toujours meilleures que celles ob-
tenues sur une surface douce, et permettant un tirage plus considérable
si le sujet reproduit est si pea chargé qu’il n'y ait rien à craindre
quand la substance formant les lignes se refroidit dans l’eau, il vaut
mieux employer l’encre en plus grande proportion.
Nous avons insisté sur le procédé deM. James à cause deTimporlancc
du but que l’auteur s’est proposé, mais nous devons rappeler l’analogie
qu’il présente avec le procédé Poitevin, dont nous avons entreuu nos
lecteurs dans une de nos dernières Revues. Que Ton se reporte à la
préparation du papier positif que Ton applique sur la surface de zinc,
c’est de la même manière que M. Poitevin prépare sa pierre dans sou
procédé litho-photographique. Nous croyons de bonne justice de faire
celte remarque, tout en restant convaincus de la complète originalité
des travaux du colonel James qui dotent ainsi la photographie d une ap-
plication nouvelle et précieuse.
Ernest Saint-Edme,
Préparateur de Physique
au Conservatoire des Arts-et-JIe'licrs.
C. A. OPTERMANN, Directeur ,
Il, rue des Beaux-Arts, à Paris.
Paris — Imprimé par E. Thiinot et C', 26,rue Racine.
L’ART INDUSTRIEL. — 5° ANNÉE. — JANVIER -FÉVRIER 1861.
ment d’un treillage supérieur à lin.10 du couronnement du socle infé-
rieur, supporté par de petits panneaux de 0m.20 de largeur, espacés
de 1 mètre.
L’ornementation adoptée par l’architecte, pour les différentes parties,
donne à l’ensemble un aSpeet à la fois simple et original.
U est du reste très-léger, puisque le mètre linéaire pèse 18 kilogr.
et le mètre superficiel 25 kilogr., le kilogramme coûtant lf.50.
Grille et porte «le Grand I*rc
Près Vouziers (Ardennes).
PL. 6.
La grille et la porte de la propriété de Grand-Pré, près Vouziers
(Ardennes) que l’on voit PI. 6 est du même architecte que l’ouvrage
précédent. Les motifs qu’elles représentent sont plus riches et les
dimensions des fers beaucoup plus considérables. Elles pèsent 75
kilogr. par mètre superficiel, et 70 kilogr. le mètre courant, le kilo-
gramme de fer a été payé 0f.90.
REVUE PHOTOGRAPHIQUE.
Modification du collodion albuminé.
Tous ceux qui se sont occupés de photographie au collodion ont re-
marqué le soulèvement de la couche sensible étendue sur le verre, et
le dépôt qui s’opère sur la glace pendant le développement des épreuves.
MM. Pestchler et Mann ont récemment présenté une modification
dont les avantages sont les suivants : Les glaces se développent très-ra-
pidement, elles sont remarquablement nettes et brillantes, et leur pré-
paration n’exige pas l’emploi du bain d’acétonitrate. D’ailleurs, comme
elle rend impossible la présence de tout excès de nitrate d’argent, les
glaces doivent, théoriquement, se conserver plus longtemps que dans
les circonstances habituelles.
Voici quel est leur procédé : les glaces sont préparées par les
moyens ordinaires, seulement au lieu de les recouvrir d’albumine io-
duréc, on les recouvre d'albumine contenant 0er.06A ou 0S‘.128 de clilo
rure de sodium pour 30 grammes; elles sont alors insensibles à la lu-
mière et peuvent ainsi être coagulées dans une étuve ou devant le feu,
lorsqu’elles ont été égouttées et séchées; puis, au lieu de les sensibi-
liser dans uu bain d’acétonitrate d’argent, on les lave simplement sous
un filet d’eau, et cette opération suffit pour rendre de nouveau la
couche sensible à la lumière; une fois sèche, elle est prête à être expo-
sée à la chambre noire.
Les auteurs du procédé pensent que l’excès de chlorure de sodium
rend la couche insensible à la lumière, et que le lavage dissolvant com-
plètement celui-ci, ne laisse plus à la surface que des sels d’argent in-
solubles à l’état de pureté. Les glaces iodurées albuminées ordinaires,
destinées au collodion albuminé, peuvent être rendues sensibles par la
même méthode, c’est-à-dire en enlevant simplement l’iodure de potas-
sium libre par un lavage, et ne laissant dans la couche que de l’iodure
d’argent pur.
Photo- Kincographlc.
Nous désignons sous ce nom l’art de produire des fac-similé photo-
graphiques d’un sujet tel qu’un manuscrit, une carte, une gravure au
trait, et de le transporter ensuite sur zinc,de manière à pouvoir multi-
plier les épreuves de la même manière que cela se fait pour un dessin
sur pierre lithographique ou sur zinc.
M. le Colonel James, de concert avec le Capitaine Scott, a fait des
expériences importantes à ce sujet afin de pouvoir reproduire les an-
ciens manuscrits et les gravures de toute espèce au moyen de la pho-
tographie. On comprend l’importance qu’il y aurait à pouvoir publier
des copies authentiques de documents aujourd’hui cachés et inacces-
sibles au public.
La première partie du procédé James consiste à obtenir sur verre un
cliché représentant, dans ses dimensions propres, le document à repro-
duire.
On y parvient au moyen des procédés ordinaires sur collodion hu-
mide; on ne saurait apporter trop de soins à la préparation de ce cli-
ché, carde son exécution dépend le résultat final. Les lentilles, influant
beaucoup sur la nature de l’épreuve, doivent être aussi parfaites que
possible, et largement capables de projeter, sans déformation sensible,
une image de la grandeur du modèle. Lorsque l’appareil est bien dis-
posé, ou recouvre la glace de sa couche sensible, on expose, on déve-
loppe et l’on fixe à la manière ordinaire. Après le fixage, la glace est
immergée dans une solution saturée de bichlorure de mercure. Lorsque
la couche a été bien blanchie par l’action de ce sel, on lave à l’eau,
puis avec une solution de sulfhydrale d’ammoniaque formée de 10 par-
ties d’eau pour 1 partie de sulfhydrate.
Le fond du cliché devient extrêmement intense, sans que les finesses
du dessin se trouvent attaquées, on sèche ensuite, Ton vernit et l’é-
preuve est alors prête à être employée.
Il faut ensuite préparer le papier sensible : la qualité de ce papier
joue un rôle important, il faut préférer l’espèce dénommée papier tra-
cer pour les graveurs.
On dissout 3 parties de gomme dans k parties d’eau bouillante ; on
fait d’autre part une dissolution saturée à chaud de bichromate de po-
tasse, et Ton mélange ensemble \ partie de solution de gomme et 2 par-
ties de solution de bichromate, le tout étant maintenu à la température
de 60°.
Le papier est enduit de ce liquide et séché, puis exposé sous le né-
gatif précédemment obtenu à la manière ordinaire. Le temps nécessaire
pour obtenir l’épreuve est de dix minutes à la lumière diffuse et deux
minutes au soleil. Lorsque tous les détails sont bien venus, on relire l’é-
preuve du châssis. On recouvre sa surface d’une couche légère d’encre
grasse, dont la composition est la suivante:
Vernis à l’huile de lin. 4.50
Cire.4.00
Suif.0.00
Térébenthine de Venise. 0.55
Gomme mastic.0.25
Noir de fumée.3.50
La surface est ensuite frottée légèrement au moyen d'une éponge im-
prégnée d’eau gommée chaude ; l’encre abandonne les parties sur les-
quelles la lumière n’a pas agi, taudis qu’elle adhère aux plus petits
détails qui ont subi l’action lumineuse. On lave ensuite le dessin à
l’eau chaude et à l’eau froide, on sèche et l’on peut transporter le des-
sin sur pierre ou sur zinc.
Dans ce but la surface de la plaque de zinc est polie à l’émeri, l’é-
preuve est placée et abandonnée pendant dix minutes entre deux feuilles
de papier, préalablement mouillées aussi uniformément que possible,
avec un mélange d’acide nitrique formé de 5 parties d’eau pour
1 d’acide. Sur la plaque de zinc on place une feuille imprégnée d’acide,
Ton fait passer dessus le cylindre d’une presse, et l’acide attaque lé-
gèrement la surface du zinc. On enlève la couche d’azotate de zinc
avec un papier brouillard, l’épreuve est ensuite placée contre la sur-
face du zinc, la face en dessous, et Ton passe de nouveau à la presse;
on détache le papier, puis on gomme le report et Ton frotte légè-
rement la surface au moyen d’une éponge imbibée d’encre typographi-
que adoucie par un peu d'huile d’olive; lorsque tous les détails pa-
raissent suffisamment vigoureux, on traite par une solution très-concen-
trée d’acide phosphorique dans l’eau gommée; le report est ensuite
prêt à être tiré par les procédés ordinaires.
Si Ton avait employé de l’encre en quantité un peu considérable, il
devrait y avoir quelques différences dans la préparation de zinc.
On frotte la surface de la plaque avec du sable fin et de l’eau,
on fait ensuite usage d’une molette en zinc pour lui communiquer un
aspect grenu et Ton achève comme précédemment. Les épreuves ti-
rées avec une plaque gravée étant toujours meilleures que celles ob-
tenues sur une surface douce, et permettant un tirage plus considérable
si le sujet reproduit est si pea chargé qu’il n'y ait rien à craindre
quand la substance formant les lignes se refroidit dans l’eau, il vaut
mieux employer l’encre en plus grande proportion.
Nous avons insisté sur le procédé deM. James à cause deTimporlancc
du but que l’auteur s’est proposé, mais nous devons rappeler l’analogie
qu’il présente avec le procédé Poitevin, dont nous avons entreuu nos
lecteurs dans une de nos dernières Revues. Que Ton se reporte à la
préparation du papier positif que Ton applique sur la surface de zinc,
c’est de la même manière que M. Poitevin prépare sa pierre dans sou
procédé litho-photographique. Nous croyons de bonne justice de faire
celte remarque, tout en restant convaincus de la complète originalité
des travaux du colonel James qui dotent ainsi la photographie d une ap-
plication nouvelle et précieuse.
Ernest Saint-Edme,
Préparateur de Physique
au Conservatoire des Arts-et-JIe'licrs.
C. A. OPTERMANN, Directeur ,
Il, rue des Beaux-Arts, à Paris.
Paris — Imprimé par E. Thiinot et C', 26,rue Racine.