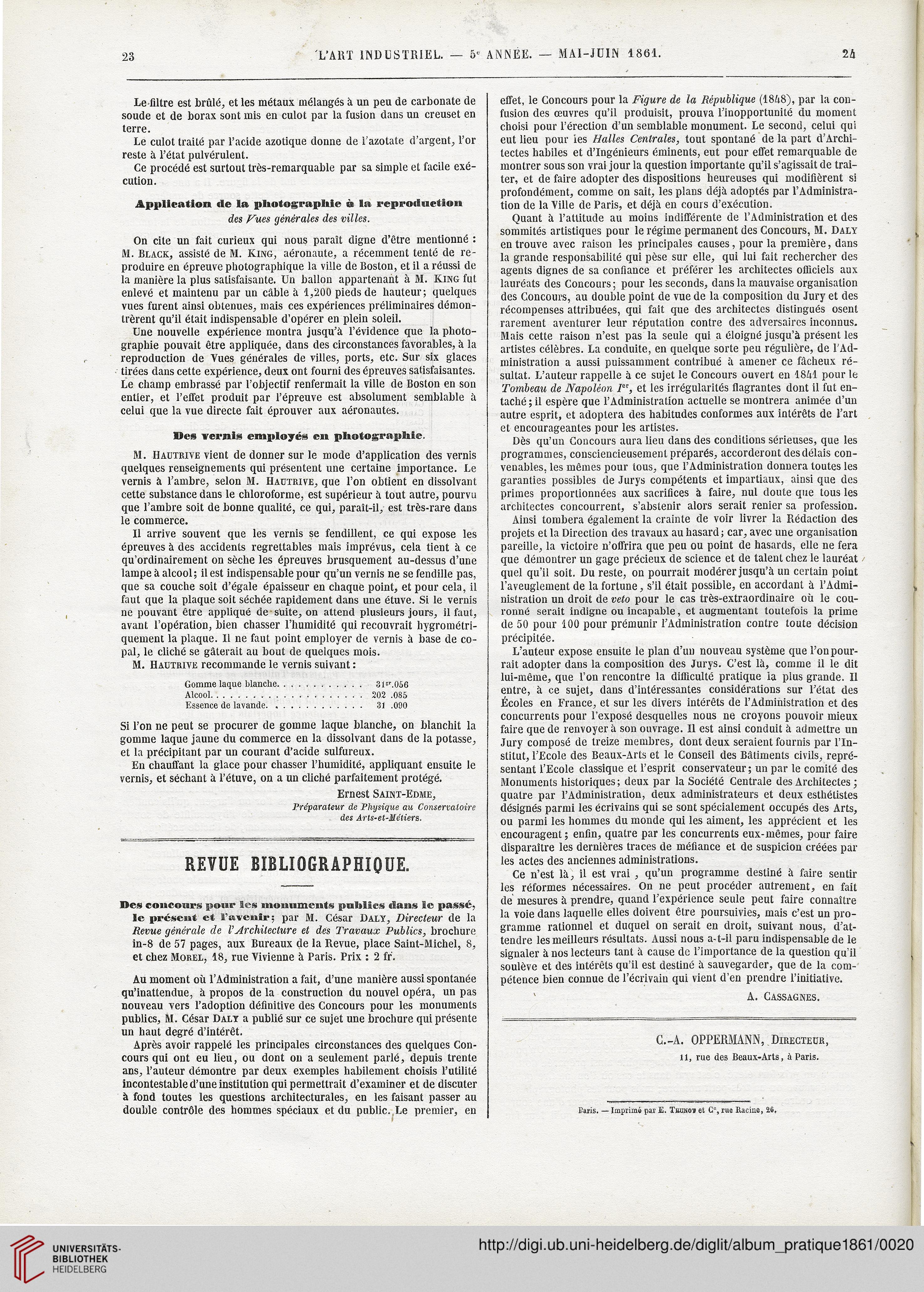23
L’ART INDUSTRIEL.
5e ANNEE. — MAI-JUIN 1861.
2A
Le-filtre est brûlé, et les métaux mélangés à un peu de carbonate de
soude et de borax sont mis en culot par la fusion dans un creuset en
terre.
Le culot traité par l’acide azotique donne de l’azotate d’argent, l’or
reste à l’état pulvérulent.
Ce procédé est surtout très-remarquable par sa simple et facile exé-
cution.
Application de la photographie à ta reproduction
des Vues générales des villes.
On cite un fait curieux qui nous paraît digne d’être mentionné :
M. Black, assisté de M. King, aéronaute, a récemment tenté de re-
produire en épreuve photographique la ville de Boston, et il a réussi de
la manière la plus satisfaisante. Un ballon appartenant à M. King fut
enlevé et maintenu par un câble à 1,200 pieds de hauteur; quelques
vues furent ainsi obtenues, mais ces expériences préliminaires démon-
trèrent qu’il était indispensable d’opérer en plein soleil.
Une nouvelle expérience montra jusqu’à l’évidence que la photo-
graphie pouvait être appliquée, dans des circonstances favorables, à la
reproduction de Vues générales de villes, ports, etc. Sur six glaces
tirées dans cette expérience, deux ont fourni des épreuves satisfaisantes.
Le champ embrassé par l’objectif renfermait la ville de Boston en son
entier, et l’effet produit par l’épreuve est absolument semblable à
celui que la vue directe fait éprouver aux aéronautes.
Des vernis employés en photographie.
M. Hautrive vient de donner sur le mode d’application des vernis
quelques renseignements qui présentent une certaine importance. Le
vernis à l’ambre, selon M. Hautrive, que l’on obtient en dissolvant
cette substance dans le chloroforme, est supérieur à tout autre, pourvu
que l’ambre soit de bonne qualité, ce qui, paraît-il, est très-rare dans
le commerce.
Il arrive souvent que les vernis se fendillent, ce qui expose les
épreuves à des accidents regrettables mais imprévus, cela tient à ce
qu’ordinairement on sèche les épreuves brusquement au-dessus d’une
lampe à alcool; il est indispensable pour qu’un vernis ne se fendille pas,
que sa couche soit d’égale épaisseur en chaque point, et pour cela, il
faut que la plaque soit séchée rapidement dans une étuve. Si le vernis
ne pouvant être appliqué de suite, on attend plusieurs jours, il faut,
avant l’opération, bien chasser l’humidité qui recouvrait hygrométri-
quement la plaque. Il ne faut point employer de vernis à base de co-
pal, le cliché se gâterait au bout de quelques mois.
M. Hautrive recommande le vernis suivant :
Gomme laque blanche. 81«'.056
Alcool. 202 .085
Essence de lavande. 31 .000
Si Ton ne peut se procurer de gomme laque blanche, on blanchit la
gomme laque jaune du commerce en la dissolvant dans de la potasse,
et la précipitant par un courant d’acide sulfureux.
En chauffant la glace pour chasser l’humidité, appliquant ensuite le
vernis, et séchant à l’étuve, on a un cliché parfaitement protégé.
Ernest Saint-Edme,
Préparateur de Physique au Conservatoire
des Arts-et-Métiers.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
Des concours pour Ses monuments publics dans le passé,
le présent et l’avenir; par M. César Daly, Directeur de la
Revue générale de l’Architecture et des Travaux Publics, brochure
in-8 de 57 pages, aux Bureaux de la Revue, place Saint-Michel, 8,
et chez Morel, 18, rue Yivienne à Paris. Prix : 2 fr.
Au moment où l’Administration a fait, d’une manière aussi spontanée
qu’inattendue, à propos de la construction du nouvel opéra, un pas
nouveau vers l’adoption définitive des Concours pour les monuments
publics, M. César Daly a publié sur ce sujet une brochure qui présente
un haut degré d’intérêt.
Après avoir rappelé les principales circonstances des quelques Con-
cours qui ont eu lieu, ou dont on a seulement parlé, depuis trente
ans, l’auteur démontre par deux exemples habilement choisis l’utilité
incontestable d’une institution qui permettrait d’examiner et de discuter
à fond toutes les questions architecturales, en les faisant passer au
double contrôle des hommes spéciaux et du public. Le premier, en
effet, le Concours pour la Figure de la République (1848), par la con-
fusion des œuvres qu’il produisit, prouva l’inopportunité du moment
choisi pour l’érection d’un semblable monument. Le second, celui qui
eut lieu pour les Halles Centrales, tout spontané de la part d’Archi-
tectes habiles et d’ingénieurs éminents, eut pour effet remarquable de
montrer sous son vrai jour la question importante qu’il s’agissait de trai-
ter, et de faire adopter des dispositions heureuses qui modifièrent si
profondément, comme on sait, les plans déjà adoptés par l’Administra-
tion de la Ville de Paris, et déjà en cours d’exécution.
Quant à l’attitude au moins indifférente de l’Administration et des
sommités artistiques pour le régime permanent des Concours, M. Daly
en trouve avec raison les principales causes, pour la première, dans
la grande responsabilité qui pèse sur elle, qui lui fait rechercher des
agents dignes de sa confiance et préférer les architectes officiels aux
lauréats des Concours; pour les seconds, dans la mauvaise organisation
des Concours, au double point de vue de la composition du Jury et des
récompenses attribuées, qui fait que des architectes distingués osent
rarement aventurer leur réputation contre des adversaires inconnus.
Mais cette raison n’est pas la seule qui a éloigné jusqu’à présent les
artistes célèbres. La conduite, en quelque sorte peu régulière, de l'Ad-
ministration a aussi puissamment contribué à amener ce fâcheux ré-
sultat. L’auteur rappelle à ce sujet le Concours ouvert en 1841 pour le
Tombeau de Napoléon F’, et les irrégularités flagrantes dont il fut en-
taché ; il espère que l’Administration actuelle se montrera animée d’un
autre esprit, et adoptera des habitudes conformes aux intérêts de Part
et encourageantes pour les artistes.
Dès qu’un Concours aura lieu dans des conditions sérieuses, que les
programmes, consciencieusement préparés, accorderont des délais con-
venables, les mêmes pour tous, que l’Administration donnera toutes les
garanties possibles de Jurys compétents et impartiaux, ainsi que des
primes proportionnées aux sacrifices à faire, nul doute que tous les
architectes concourrent, s’abstenir alors serait renier sa profession.
Ainsi tombera également la crainte de voir livrer la Rédaction des
projets et la Direction des travaux au hasard ; car, avec une organisation
pareille, la victoire n’offrira que peu ou point de hasards, elle ne fera
que démontrer un gage précieux de science et de talent chez le lauréat
quel qu’il soit. Du reste, on pourrait modérer jusqu’à un certain point
l'aveuglement de la fortune, s’il était possible, en accordant à l’Admi-
nistration un droit de veto pour le cas très-extraordinaire où le cou-
ronné serait indigne ou incapable, et augmentant toutefois la prime
de 50 pour 100 pour prémunir l’Administration contre toute décision
précipitée.
L’auteur expose ensuite le plan d’un nouveau système que Ton pour-
rait adopter dans la composition des Jurys. C’est là, comme il le dit
lui-même, que Ton rencontre la difficulté pratique ia plus grande. Il
entre, à ce sujet, dans d’intéressantes considérations sur l’état des
Écoles en France, et sur les divers intérêts de l’Administration et des
concurrents pour l’exposé desquelles nous ne croyons pouvoir mieux
faire que de renvoyer à son ouvrage. Il est ainsi conduit à admettre un
Jury composé de treize membres, dont deux seraient fournis par l’In-
stitut, l’Ecole des Beaux-Arts et le Conseil des Bâtiments civils, repré-
sentant l’Ecole classique et l’esprit conservateur; un par le comité des
Monuments historiques ; deux par la Société Centrale des Architectes ;
quatre par l’Administration, deux administrateurs et deux esthétistes
désignés parmi les écrivains qui se sont spécialement occupés des Arts,
ou parmi les hommes du monde qui les aiment, les apprécient et les
encouragent ; enfin, quatre par les concurrents eux-mêmes, pour faire
disparaître les dernières traces de méfiance et de suspicion créées pâl-
ies actes des anciennes administrations.
Ce n’est là, il est vrai , qu’un programme destiné à faire sentir
les réformes nécessaires. On ne peut procéder autrement, en fait
de mesures à prendre, quand l’expérience seule peut faire connaître
la voie dans laquelle elles doivent être poursuivies, mais c’est un pro-
gramme rationnel et duquel on serait en droit, suivant nous, d’at-
tendre les meilleurs résultats. Aussi nous a-t-il paru indispensable de le
signaler à nos lecteurs tant à cause de l’importance de la question qu’il
soulève et des intérêts qu’il est destiné à sauvegarder, que de la com-
pétence bien connue de l’écrivain qui vient d’en prendre l’initiative.
v A. Cassagnes.
C.-A. OPPERMANN, Directeur,
il, rue des Beaux-Arts, à Paris.
Baris. — Imprima par E. Tuumoï et C% rue Racine, 26.
L’ART INDUSTRIEL.
5e ANNEE. — MAI-JUIN 1861.
2A
Le-filtre est brûlé, et les métaux mélangés à un peu de carbonate de
soude et de borax sont mis en culot par la fusion dans un creuset en
terre.
Le culot traité par l’acide azotique donne de l’azotate d’argent, l’or
reste à l’état pulvérulent.
Ce procédé est surtout très-remarquable par sa simple et facile exé-
cution.
Application de la photographie à ta reproduction
des Vues générales des villes.
On cite un fait curieux qui nous paraît digne d’être mentionné :
M. Black, assisté de M. King, aéronaute, a récemment tenté de re-
produire en épreuve photographique la ville de Boston, et il a réussi de
la manière la plus satisfaisante. Un ballon appartenant à M. King fut
enlevé et maintenu par un câble à 1,200 pieds de hauteur; quelques
vues furent ainsi obtenues, mais ces expériences préliminaires démon-
trèrent qu’il était indispensable d’opérer en plein soleil.
Une nouvelle expérience montra jusqu’à l’évidence que la photo-
graphie pouvait être appliquée, dans des circonstances favorables, à la
reproduction de Vues générales de villes, ports, etc. Sur six glaces
tirées dans cette expérience, deux ont fourni des épreuves satisfaisantes.
Le champ embrassé par l’objectif renfermait la ville de Boston en son
entier, et l’effet produit par l’épreuve est absolument semblable à
celui que la vue directe fait éprouver aux aéronautes.
Des vernis employés en photographie.
M. Hautrive vient de donner sur le mode d’application des vernis
quelques renseignements qui présentent une certaine importance. Le
vernis à l’ambre, selon M. Hautrive, que l’on obtient en dissolvant
cette substance dans le chloroforme, est supérieur à tout autre, pourvu
que l’ambre soit de bonne qualité, ce qui, paraît-il, est très-rare dans
le commerce.
Il arrive souvent que les vernis se fendillent, ce qui expose les
épreuves à des accidents regrettables mais imprévus, cela tient à ce
qu’ordinairement on sèche les épreuves brusquement au-dessus d’une
lampe à alcool; il est indispensable pour qu’un vernis ne se fendille pas,
que sa couche soit d’égale épaisseur en chaque point, et pour cela, il
faut que la plaque soit séchée rapidement dans une étuve. Si le vernis
ne pouvant être appliqué de suite, on attend plusieurs jours, il faut,
avant l’opération, bien chasser l’humidité qui recouvrait hygrométri-
quement la plaque. Il ne faut point employer de vernis à base de co-
pal, le cliché se gâterait au bout de quelques mois.
M. Hautrive recommande le vernis suivant :
Gomme laque blanche. 81«'.056
Alcool. 202 .085
Essence de lavande. 31 .000
Si Ton ne peut se procurer de gomme laque blanche, on blanchit la
gomme laque jaune du commerce en la dissolvant dans de la potasse,
et la précipitant par un courant d’acide sulfureux.
En chauffant la glace pour chasser l’humidité, appliquant ensuite le
vernis, et séchant à l’étuve, on a un cliché parfaitement protégé.
Ernest Saint-Edme,
Préparateur de Physique au Conservatoire
des Arts-et-Métiers.
REVUE BIBLIOGRAPHIQUE.
Des concours pour Ses monuments publics dans le passé,
le présent et l’avenir; par M. César Daly, Directeur de la
Revue générale de l’Architecture et des Travaux Publics, brochure
in-8 de 57 pages, aux Bureaux de la Revue, place Saint-Michel, 8,
et chez Morel, 18, rue Yivienne à Paris. Prix : 2 fr.
Au moment où l’Administration a fait, d’une manière aussi spontanée
qu’inattendue, à propos de la construction du nouvel opéra, un pas
nouveau vers l’adoption définitive des Concours pour les monuments
publics, M. César Daly a publié sur ce sujet une brochure qui présente
un haut degré d’intérêt.
Après avoir rappelé les principales circonstances des quelques Con-
cours qui ont eu lieu, ou dont on a seulement parlé, depuis trente
ans, l’auteur démontre par deux exemples habilement choisis l’utilité
incontestable d’une institution qui permettrait d’examiner et de discuter
à fond toutes les questions architecturales, en les faisant passer au
double contrôle des hommes spéciaux et du public. Le premier, en
effet, le Concours pour la Figure de la République (1848), par la con-
fusion des œuvres qu’il produisit, prouva l’inopportunité du moment
choisi pour l’érection d’un semblable monument. Le second, celui qui
eut lieu pour les Halles Centrales, tout spontané de la part d’Archi-
tectes habiles et d’ingénieurs éminents, eut pour effet remarquable de
montrer sous son vrai jour la question importante qu’il s’agissait de trai-
ter, et de faire adopter des dispositions heureuses qui modifièrent si
profondément, comme on sait, les plans déjà adoptés par l’Administra-
tion de la Ville de Paris, et déjà en cours d’exécution.
Quant à l’attitude au moins indifférente de l’Administration et des
sommités artistiques pour le régime permanent des Concours, M. Daly
en trouve avec raison les principales causes, pour la première, dans
la grande responsabilité qui pèse sur elle, qui lui fait rechercher des
agents dignes de sa confiance et préférer les architectes officiels aux
lauréats des Concours; pour les seconds, dans la mauvaise organisation
des Concours, au double point de vue de la composition du Jury et des
récompenses attribuées, qui fait que des architectes distingués osent
rarement aventurer leur réputation contre des adversaires inconnus.
Mais cette raison n’est pas la seule qui a éloigné jusqu’à présent les
artistes célèbres. La conduite, en quelque sorte peu régulière, de l'Ad-
ministration a aussi puissamment contribué à amener ce fâcheux ré-
sultat. L’auteur rappelle à ce sujet le Concours ouvert en 1841 pour le
Tombeau de Napoléon F’, et les irrégularités flagrantes dont il fut en-
taché ; il espère que l’Administration actuelle se montrera animée d’un
autre esprit, et adoptera des habitudes conformes aux intérêts de Part
et encourageantes pour les artistes.
Dès qu’un Concours aura lieu dans des conditions sérieuses, que les
programmes, consciencieusement préparés, accorderont des délais con-
venables, les mêmes pour tous, que l’Administration donnera toutes les
garanties possibles de Jurys compétents et impartiaux, ainsi que des
primes proportionnées aux sacrifices à faire, nul doute que tous les
architectes concourrent, s’abstenir alors serait renier sa profession.
Ainsi tombera également la crainte de voir livrer la Rédaction des
projets et la Direction des travaux au hasard ; car, avec une organisation
pareille, la victoire n’offrira que peu ou point de hasards, elle ne fera
que démontrer un gage précieux de science et de talent chez le lauréat
quel qu’il soit. Du reste, on pourrait modérer jusqu’à un certain point
l'aveuglement de la fortune, s’il était possible, en accordant à l’Admi-
nistration un droit de veto pour le cas très-extraordinaire où le cou-
ronné serait indigne ou incapable, et augmentant toutefois la prime
de 50 pour 100 pour prémunir l’Administration contre toute décision
précipitée.
L’auteur expose ensuite le plan d’un nouveau système que Ton pour-
rait adopter dans la composition des Jurys. C’est là, comme il le dit
lui-même, que Ton rencontre la difficulté pratique ia plus grande. Il
entre, à ce sujet, dans d’intéressantes considérations sur l’état des
Écoles en France, et sur les divers intérêts de l’Administration et des
concurrents pour l’exposé desquelles nous ne croyons pouvoir mieux
faire que de renvoyer à son ouvrage. Il est ainsi conduit à admettre un
Jury composé de treize membres, dont deux seraient fournis par l’In-
stitut, l’Ecole des Beaux-Arts et le Conseil des Bâtiments civils, repré-
sentant l’Ecole classique et l’esprit conservateur; un par le comité des
Monuments historiques ; deux par la Société Centrale des Architectes ;
quatre par l’Administration, deux administrateurs et deux esthétistes
désignés parmi les écrivains qui se sont spécialement occupés des Arts,
ou parmi les hommes du monde qui les aiment, les apprécient et les
encouragent ; enfin, quatre par les concurrents eux-mêmes, pour faire
disparaître les dernières traces de méfiance et de suspicion créées pâl-
ies actes des anciennes administrations.
Ce n’est là, il est vrai , qu’un programme destiné à faire sentir
les réformes nécessaires. On ne peut procéder autrement, en fait
de mesures à prendre, quand l’expérience seule peut faire connaître
la voie dans laquelle elles doivent être poursuivies, mais c’est un pro-
gramme rationnel et duquel on serait en droit, suivant nous, d’at-
tendre les meilleurs résultats. Aussi nous a-t-il paru indispensable de le
signaler à nos lecteurs tant à cause de l’importance de la question qu’il
soulève et des intérêts qu’il est destiné à sauvegarder, que de la com-
pétence bien connue de l’écrivain qui vient d’en prendre l’initiative.
v A. Cassagnes.
C.-A. OPPERMANN, Directeur,
il, rue des Beaux-Arts, à Paris.
Baris. — Imprima par E. Tuumoï et C% rue Racine, 26.