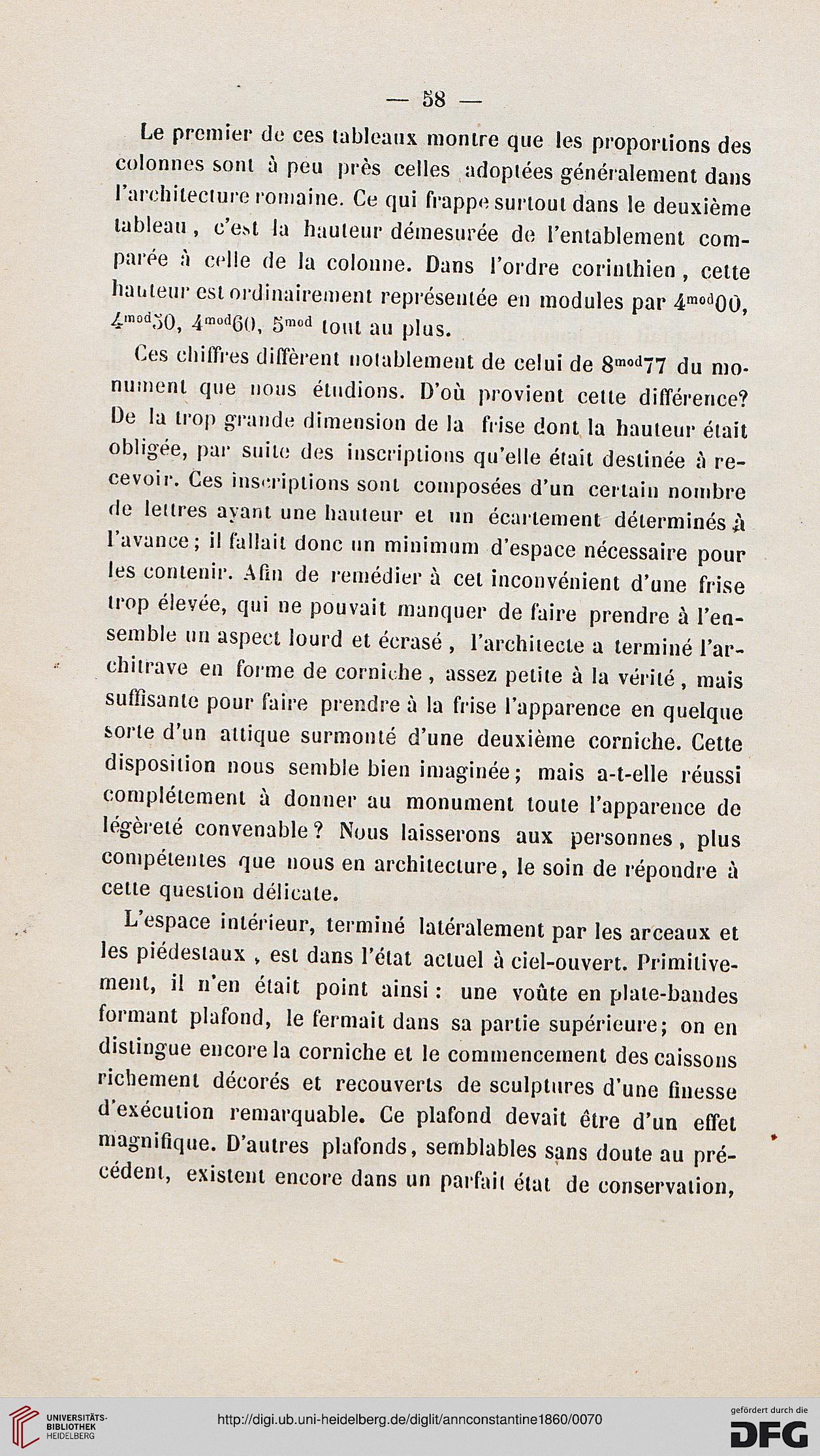Le premier de ces tableaux montre que les proportions des
colonnes sont à peu près celles adoptées généralement dans
l'architecture romaine. Ce qui frappe surtout dans le deuxième
tableau , e'e.sl lu hauteur démesurée de l'entablement com-
parée à celle de la colonne. Dans l'ordre corinthien , cette
hauteur est ordinairement représentée en modules par 4m<">00,
^■""TiO, 4mod60, 5rai,d tout au plus.
Ces chiffres diffèrent notablement de celui de 8moJ77 du mo-
nument que nous étudions. D'où provient celle différence?
De la trop grande dimension de la frise dont la hauteur était
obligée, par suite; des inscriptions qu'elle était destinée à re-
cevoir. Ces inscriptions sont composées d'un certain nombre
de lettres ayant une hauteur et un écartement déterminés ;i
l'avance; il fallait donc un minimum d'espace nécessaire pour
les contenir. Afin de remédier à cet inconvénient d'une frise
trop élevée, qui ne pouvait manquer de faire prendre à l'en-
semble un aspect lourd et écrasé , l'architecte a terminé l'ar-
chitrave en forme de corniche , assez petite à la vérité , mais
suffisante pour faire prendre à la frise l'apparence en quelque
borle d'un attique surmonté d'une deuxième corniche. Cette
disposition nous semble bien imaginée; mais a-t-elle réussi
complètement à donner au monument toute l'apparence de
légèreté convenable ? Nous laisserons aux personnes, plus
compétentes que nous en architecture, le soin de répondre à
celte question délicale.
L'espace intérieur, terminé latéralement par les arceaux et
les piédestaux » esl dans l'état actuel à ciel-ouvert. Primitive-
ment, il n'en était point ainsi : une voûte en plaie-bandes
formant plafond, le fermait dans sa partie supérieure; on en
dislingue encore la corniche et le commencement des caissons
richement décorés et recouverts de sculptures d'une finesse
d'exécution remarquable. Ce plafond devait être d'un effet
magnifique. D'autres plafonds, semblables sans doute au pré-
cédent, existent encore dans un parfait étal de conservation,
colonnes sont à peu près celles adoptées généralement dans
l'architecture romaine. Ce qui frappe surtout dans le deuxième
tableau , e'e.sl lu hauteur démesurée de l'entablement com-
parée à celle de la colonne. Dans l'ordre corinthien , cette
hauteur est ordinairement représentée en modules par 4m<">00,
^■""TiO, 4mod60, 5rai,d tout au plus.
Ces chiffres diffèrent notablement de celui de 8moJ77 du mo-
nument que nous étudions. D'où provient celle différence?
De la trop grande dimension de la frise dont la hauteur était
obligée, par suite; des inscriptions qu'elle était destinée à re-
cevoir. Ces inscriptions sont composées d'un certain nombre
de lettres ayant une hauteur et un écartement déterminés ;i
l'avance; il fallait donc un minimum d'espace nécessaire pour
les contenir. Afin de remédier à cet inconvénient d'une frise
trop élevée, qui ne pouvait manquer de faire prendre à l'en-
semble un aspect lourd et écrasé , l'architecte a terminé l'ar-
chitrave en forme de corniche , assez petite à la vérité , mais
suffisante pour faire prendre à la frise l'apparence en quelque
borle d'un attique surmonté d'une deuxième corniche. Cette
disposition nous semble bien imaginée; mais a-t-elle réussi
complètement à donner au monument toute l'apparence de
légèreté convenable ? Nous laisserons aux personnes, plus
compétentes que nous en architecture, le soin de répondre à
celte question délicale.
L'espace intérieur, terminé latéralement par les arceaux et
les piédestaux » esl dans l'état actuel à ciel-ouvert. Primitive-
ment, il n'en était point ainsi : une voûte en plaie-bandes
formant plafond, le fermait dans sa partie supérieure; on en
dislingue encore la corniche et le commencement des caissons
richement décorés et recouverts de sculptures d'une finesse
d'exécution remarquable. Ce plafond devait être d'un effet
magnifique. D'autres plafonds, semblables sans doute au pré-
cédent, existent encore dans un parfait étal de conservation,