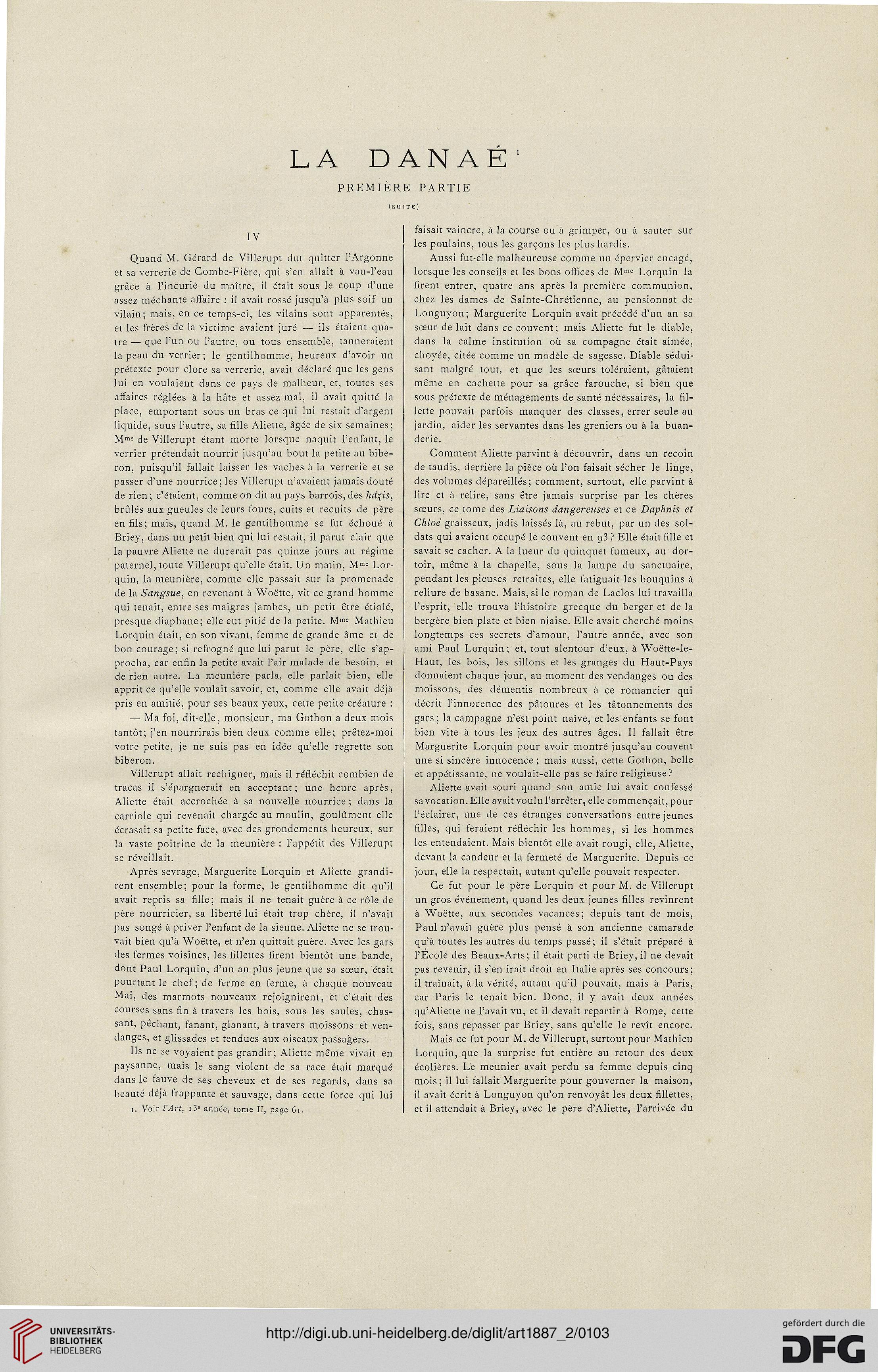I
LA DANAÉ
PREMIÈRE PARTIE
(SUITE)
IV
Quand M. Gérard de Villerupt dut quitter l’Argonne
et sa verrerie de Combe-Fière, qui s’en allait à vau-l’eau
grâce à l’incurie du maître, il était sous le coup d’une
assez méchante affaire : il avait rossé jusqu’à plus soif un
vilain; mais, en ce temps-ci, les vilains sont apparentés,
et les frères de la victime avaient juré — ils étaient qua-
tre — que l’un ou l’autre, ou tous ensemble, tanneraient
la peau du verrier; le gentilhomme, heureux d’avoir un
prétexte pour clore sa verrerie, avait déclaré que les gens
lui en voulaient dans ce pays de malheur, et, toutes ses
affaires réglées à la hâte et assez mal, il avait quitté la
place, emportant sous un bras ce qui lui restait d’argent
liquide, sous l’autre, sa fille Aliette, âgée de six semaines;
Mm= je Villerupt étant morte lorsque naquit l’enfant, le
verrier prétendait nourrir jusqu’au bout la petite au bibe-
ron, puisqu’il fallait laisser les vaches à la verrerie et se
passer d’une nourrice ; les Villerupt n’avaient jamais douté
de rien ; c’étaient, comme on dit au pays barrois, des liâ^is,
brûlés aux gueules de leurs fours, cuits et recuits de père
en fils; mais, quand M. le gentilhomme se fut échoué à
Briey, dans un petit bien qui lui restait, il parut clair que
la pauvre Aliette ne durerait pas quinze jours au régime
paternel, toute Villerupt qu’elle était. Un matin, Mme Lor-
quin, la meunière, comme elle passait sur la promenade
de la Sangsue, en revenant à Woëtte, vit ce grand homme
qui tenait, entre ses maigres jambes, un petit être étiolé,
presque diaphane; elle eut pitié de la petite. Mme Mathieu
Lorquin était, en son vivant, femme de grande âme et de
bon courage; si refrogné que lui parut le père, elle s’ap-
procha, car enfin la petite avait l’air malade de besoin, et
de rien autre. La meunière parla, elle parlait bien, elle
apprit ce qu’elle voulait savoir, et, comme elle avait déjà
pris en amitié, pour ses beaux yeux, cette petite créature :
—• Ma foi, dit-elle, monsieur, ma Gothon a deux mois
tantôt; j’en nourrirais bien deux comme elle; prêtez-moi
votre petite, je ne suis pas en idée qu’elle regrette son
biberon.
Villerupt allait rechigner, mais il réfléchit combien de
tracas il s’épargnerait en acceptant; une heure après,
Aliette était accrochée à sa nouvelle nourrice ; dans la
carriole qui revenait chargée au moulin, goulûment elle
écrasait sa petite face, avec des grondements heureux, sur
la vaste poitrine de la meunière : l’appétit des Villerupt
se réveillait.
Après sevrage, Marguerite Lorquin et Aliette grandi-
rent ensemble; pour la forme, le gentilhomme dit qu’il
avait repris sa fille; mais il ne tenait guère à ce rôle de
père nourricier, sa liberté lui était trop chère, il n’avait
pas songé à priver l’enfant de la sienne. Aliette ne se trou-
vait bien qu’à Woëtte, et n’en quittait guère. Avec les gars
des fermes voisines, les fillettes firent bientôt une bande,
dont Paul Lorquin, d’un an plus jeune que sa sœur, était
pourtant le chef ; de ferme en ferme, à chaque nouveau
Mai, des marmots nouveaux rejoignirent, et c’était des
courses sans fin à travers les bois, sous les saules, chas-
sant, pêchant, fanant, glanant, à travers moissons et ven-
danges, et glissades et tendues aux oiseaux passagers.
Ils ne se voyaient pas grandir; Aliette même vivait en
paysanne, mais le sang violent de sa race était marqué
dans le fauve de ses cheveux et de ses regards, dans sa
beauté déjà frappante et sauvage, dans cette force qui lui
[. Voir l’Art, i3« année, tome II, page 61.
faisait vaincre, à la course ou à grimper, ou à sauter sur
les poulains, tous les garçons les plus hardis.
Aussi fut-elle malheureuse comme un épervier encagé,
lorsque les conseils et les bons offices de Mmc Lorquin la
firent entrer, quatre ans après la première communion,
chez les dames de Sainte-Chrétienne, au pensionnat de
Longuyon; Marguerite Lorquin avait précédé d’un an sa
sœur de lait dans ce couvent ; mais Aliette fut le diable,
dans la calme institution où sa compagne était aimée,
choyée, citée comme un modèle de sagesse. Diable sédui-
sant malgré tout, et que les sœurs toléraient, gâtaient
même en cachette pour sa grâce farouche, si bien que
sous prétexte de ménagements de santé nécessaires, la fil-
lette pouvait parfois manquer des classes, errer seule au
jardin, aider les servantes dans les greniers ou à la buan-
derie.
Comment Aliette parvint à découvrir, dans un recoin
de taudis, derrière la pièce où l’on faisait sécher le linge,
des volumes dépareillés; comment, surtout, elle parvint à
lire et à relire, sans être jamais surprise par les chères
sœurs, ce tome des Liaisons dangereuses et ce Daphnis et
Chloé graisseux, jadis laissés là, au rebut, par un des sol-
dats qui avaient occupé le couvent en 93 ? Elle était fille et
savait se cacher. A la lueur du quinquet fumeux, au dor-
toir, même à la chapelle, sous la lampe du sanctuaire,
pendant les pieuses retraites, elle fatiguait les bouquins à
reliure de basane. Mais, si le roman de Laclos lui travailla
l’esprit, elle trouva l’histoire grecque du berger et de la
bergère bien plate et bien niaise. Elle avait cherché moins
longtemps ces secrets d’amour, l’autre année, avec son
ami Paul Lorquin ; et, tout alentour d’eux, à Woëtte-le-
Haut, les bois, les sillons et les granges du Haut-Pays
donnaient chaque jour, au moment des vendanges ou des
moissons, des démentis nombreux à ce romancier qui
décrit l’innocence des pâtoures et les tâtonnements des
gars ; la campagne n’est point naïve, et les enfants se font
bien vite à tous les jeux des autres âges. Il fallait être
Marguerite Lorquin pour avoir montré jusqu’au couvent
une si sincère innocence ; mais aussi, cette Gothon, belle
et appétissante, ne voulait-elle pas se faire religieuse?
Aliette avait souri quand son amie lui avait confessé
sa vocation. Elle avait voulu l’arrêter, elle commençait, pour
l’éclairer, une de ces étranges conversations entre jeunes
filles, qui feraient réfléchir les hommes, si les hommes
les entendaient. Mais bientôt elle avait rougi, elle, Aliette,
devant la candeur et la fermeté de Marguerite. Depuis ce
jour, elle la respectait, autant qu’elle pouvait respecter.
Ce fut pour le père Lorquin et pour M. de Villerupt
un gros événement, quand les deux jeunes filles revinrent
à Woëtte, aux secondes vacances; depuis tant de mois,
Paul n’avait guère plus pensé à son ancienne camarade
qu’à toutes les autres du temps passé; il s’était préparé à
l’École des Beaux-Arts; il était parti de Briey, il ne devait
pas revenir, il s'en irait droit en Italie après ses concours;
il traînait, à la vérité, autant qu'il pouvait, mais à Paris,
car Paris le tenait bien. Donc, il y avait deux années
qu’Aliette ne l’avait vu, et il devait repartir à Rome, cette
fois, sans repasser par Briey, sans qu’elle le revît encore.
Mais ce fut pour M. de Villerupt, surtout pour Mathieu
Lorquin, que la surprise fut entière au retour des deux
écolières. Le meunier avait perdu sa femme depuis cinq
mois; il lui fallait Marguerite pour gouverner la maison,
il avait écrit à Longuyon qu’on renvoyât les deux fillettes,
et il attendait à Briey, avec le père d’Aliette, l’arrivée du
LA DANAÉ
PREMIÈRE PARTIE
(SUITE)
IV
Quand M. Gérard de Villerupt dut quitter l’Argonne
et sa verrerie de Combe-Fière, qui s’en allait à vau-l’eau
grâce à l’incurie du maître, il était sous le coup d’une
assez méchante affaire : il avait rossé jusqu’à plus soif un
vilain; mais, en ce temps-ci, les vilains sont apparentés,
et les frères de la victime avaient juré — ils étaient qua-
tre — que l’un ou l’autre, ou tous ensemble, tanneraient
la peau du verrier; le gentilhomme, heureux d’avoir un
prétexte pour clore sa verrerie, avait déclaré que les gens
lui en voulaient dans ce pays de malheur, et, toutes ses
affaires réglées à la hâte et assez mal, il avait quitté la
place, emportant sous un bras ce qui lui restait d’argent
liquide, sous l’autre, sa fille Aliette, âgée de six semaines;
Mm= je Villerupt étant morte lorsque naquit l’enfant, le
verrier prétendait nourrir jusqu’au bout la petite au bibe-
ron, puisqu’il fallait laisser les vaches à la verrerie et se
passer d’une nourrice ; les Villerupt n’avaient jamais douté
de rien ; c’étaient, comme on dit au pays barrois, des liâ^is,
brûlés aux gueules de leurs fours, cuits et recuits de père
en fils; mais, quand M. le gentilhomme se fut échoué à
Briey, dans un petit bien qui lui restait, il parut clair que
la pauvre Aliette ne durerait pas quinze jours au régime
paternel, toute Villerupt qu’elle était. Un matin, Mme Lor-
quin, la meunière, comme elle passait sur la promenade
de la Sangsue, en revenant à Woëtte, vit ce grand homme
qui tenait, entre ses maigres jambes, un petit être étiolé,
presque diaphane; elle eut pitié de la petite. Mme Mathieu
Lorquin était, en son vivant, femme de grande âme et de
bon courage; si refrogné que lui parut le père, elle s’ap-
procha, car enfin la petite avait l’air malade de besoin, et
de rien autre. La meunière parla, elle parlait bien, elle
apprit ce qu’elle voulait savoir, et, comme elle avait déjà
pris en amitié, pour ses beaux yeux, cette petite créature :
—• Ma foi, dit-elle, monsieur, ma Gothon a deux mois
tantôt; j’en nourrirais bien deux comme elle; prêtez-moi
votre petite, je ne suis pas en idée qu’elle regrette son
biberon.
Villerupt allait rechigner, mais il réfléchit combien de
tracas il s’épargnerait en acceptant; une heure après,
Aliette était accrochée à sa nouvelle nourrice ; dans la
carriole qui revenait chargée au moulin, goulûment elle
écrasait sa petite face, avec des grondements heureux, sur
la vaste poitrine de la meunière : l’appétit des Villerupt
se réveillait.
Après sevrage, Marguerite Lorquin et Aliette grandi-
rent ensemble; pour la forme, le gentilhomme dit qu’il
avait repris sa fille; mais il ne tenait guère à ce rôle de
père nourricier, sa liberté lui était trop chère, il n’avait
pas songé à priver l’enfant de la sienne. Aliette ne se trou-
vait bien qu’à Woëtte, et n’en quittait guère. Avec les gars
des fermes voisines, les fillettes firent bientôt une bande,
dont Paul Lorquin, d’un an plus jeune que sa sœur, était
pourtant le chef ; de ferme en ferme, à chaque nouveau
Mai, des marmots nouveaux rejoignirent, et c’était des
courses sans fin à travers les bois, sous les saules, chas-
sant, pêchant, fanant, glanant, à travers moissons et ven-
danges, et glissades et tendues aux oiseaux passagers.
Ils ne se voyaient pas grandir; Aliette même vivait en
paysanne, mais le sang violent de sa race était marqué
dans le fauve de ses cheveux et de ses regards, dans sa
beauté déjà frappante et sauvage, dans cette force qui lui
[. Voir l’Art, i3« année, tome II, page 61.
faisait vaincre, à la course ou à grimper, ou à sauter sur
les poulains, tous les garçons les plus hardis.
Aussi fut-elle malheureuse comme un épervier encagé,
lorsque les conseils et les bons offices de Mmc Lorquin la
firent entrer, quatre ans après la première communion,
chez les dames de Sainte-Chrétienne, au pensionnat de
Longuyon; Marguerite Lorquin avait précédé d’un an sa
sœur de lait dans ce couvent ; mais Aliette fut le diable,
dans la calme institution où sa compagne était aimée,
choyée, citée comme un modèle de sagesse. Diable sédui-
sant malgré tout, et que les sœurs toléraient, gâtaient
même en cachette pour sa grâce farouche, si bien que
sous prétexte de ménagements de santé nécessaires, la fil-
lette pouvait parfois manquer des classes, errer seule au
jardin, aider les servantes dans les greniers ou à la buan-
derie.
Comment Aliette parvint à découvrir, dans un recoin
de taudis, derrière la pièce où l’on faisait sécher le linge,
des volumes dépareillés; comment, surtout, elle parvint à
lire et à relire, sans être jamais surprise par les chères
sœurs, ce tome des Liaisons dangereuses et ce Daphnis et
Chloé graisseux, jadis laissés là, au rebut, par un des sol-
dats qui avaient occupé le couvent en 93 ? Elle était fille et
savait se cacher. A la lueur du quinquet fumeux, au dor-
toir, même à la chapelle, sous la lampe du sanctuaire,
pendant les pieuses retraites, elle fatiguait les bouquins à
reliure de basane. Mais, si le roman de Laclos lui travailla
l’esprit, elle trouva l’histoire grecque du berger et de la
bergère bien plate et bien niaise. Elle avait cherché moins
longtemps ces secrets d’amour, l’autre année, avec son
ami Paul Lorquin ; et, tout alentour d’eux, à Woëtte-le-
Haut, les bois, les sillons et les granges du Haut-Pays
donnaient chaque jour, au moment des vendanges ou des
moissons, des démentis nombreux à ce romancier qui
décrit l’innocence des pâtoures et les tâtonnements des
gars ; la campagne n’est point naïve, et les enfants se font
bien vite à tous les jeux des autres âges. Il fallait être
Marguerite Lorquin pour avoir montré jusqu’au couvent
une si sincère innocence ; mais aussi, cette Gothon, belle
et appétissante, ne voulait-elle pas se faire religieuse?
Aliette avait souri quand son amie lui avait confessé
sa vocation. Elle avait voulu l’arrêter, elle commençait, pour
l’éclairer, une de ces étranges conversations entre jeunes
filles, qui feraient réfléchir les hommes, si les hommes
les entendaient. Mais bientôt elle avait rougi, elle, Aliette,
devant la candeur et la fermeté de Marguerite. Depuis ce
jour, elle la respectait, autant qu’elle pouvait respecter.
Ce fut pour le père Lorquin et pour M. de Villerupt
un gros événement, quand les deux jeunes filles revinrent
à Woëtte, aux secondes vacances; depuis tant de mois,
Paul n’avait guère plus pensé à son ancienne camarade
qu’à toutes les autres du temps passé; il s’était préparé à
l’École des Beaux-Arts; il était parti de Briey, il ne devait
pas revenir, il s'en irait droit en Italie après ses concours;
il traînait, à la vérité, autant qu'il pouvait, mais à Paris,
car Paris le tenait bien. Donc, il y avait deux années
qu’Aliette ne l’avait vu, et il devait repartir à Rome, cette
fois, sans repasser par Briey, sans qu’elle le revît encore.
Mais ce fut pour M. de Villerupt, surtout pour Mathieu
Lorquin, que la surprise fut entière au retour des deux
écolières. Le meunier avait perdu sa femme depuis cinq
mois; il lui fallait Marguerite pour gouverner la maison,
il avait écrit à Longuyon qu’on renvoyât les deux fillettes,
et il attendait à Briey, avec le père d’Aliette, l’arrivée du