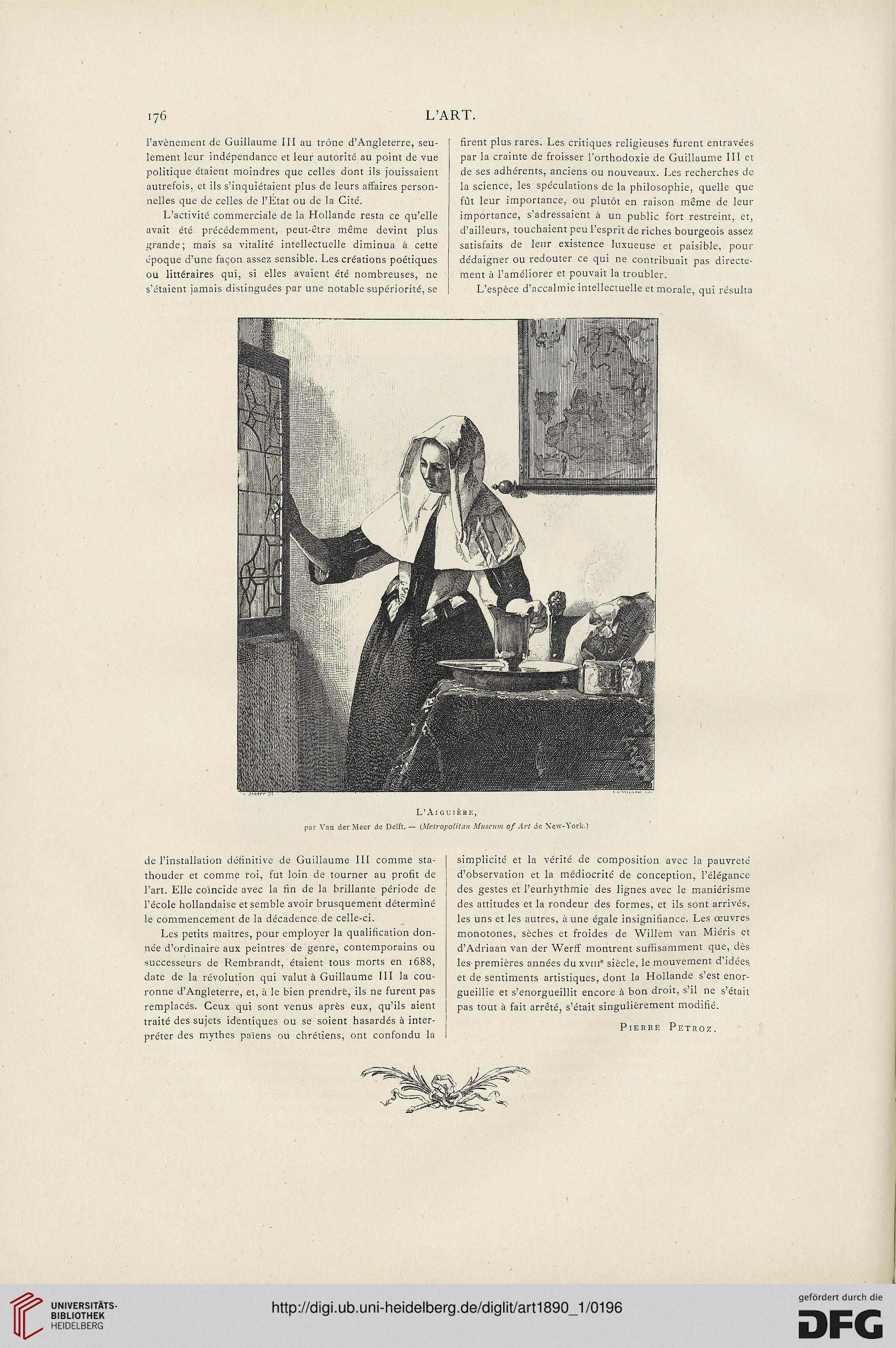176
L’ART.
l’avènement de Guillaume III au trône d’Angleterre, seu-
lement leur indépendance et leur autorité au point de vue
politique étaient moindres que celles dont ils jouissaient
autrefois, et ils s’inquiétaient plus de leurs affaires person-
nelles que de celles de l’Etat ou de la Cité.
L’activité commerciale de la Hollande resta ce qu’elle
avait été précédemment, peut-être même devint plus
grande; mais sa vitalité intellectuelle diminua à cette
époque d’une façon assez sensible. Les créations poétiques
ou littéraires qui, si elles avaient été nombreuses, ne
s’étaient jamais distinguées par une notable supériorité, se
firent plus rares. Les critiques religieuses furent entravées
par la crainte de froisser l’orthodoxie de Guillaume III et
de ses adhérents, anciens ou nouveaux. Les recherches de
la science, les spéculations de la philosophie, quelle que
fût leur importance, ou plutôt en raison même de leur
importance, s’adressaient à un public fort restreint, et,
d’ailleurs, touchaient peu l’esprit de riches bourgeois assez
satisfaits de leur existence luxueuse et paisible, pour
dédaigner ou redouter ce qui ne contribuait pas directe-
ment à l’améliorer et pouvait la troubler.
L’espèce d’accalmie intellectuelle et morale, qui résulta
L’Aiguière,
par Van der Meer de Delft. — (Metropolitan Muséum of Art de New-York.)
de l’installation définitive de Guillaume III comme sta-
thouder et comme roi, fut loin de tourner au profit de
l’art. Elle coïncide avec la fin de la brillante période de
l’école hollandaise et semble avoir brusquement déterminé
le commencement de la décadence de celle-ci.
Les petits maîtres, pour employer la qualification don-
née d’ordinaire aux peintres de genre, contemporains ou
successeurs de Rembrandt, étaient tous morts en 1688,
date de la révolution qui valut à Guillaume III la cou-
ronne d’Angleterre, et, à le bien prendre, ils ne furent pas
remplacés. Ceux qui sont venus après eux, qu’ils aient
traité des sujets identiques ou se soient hasardés à inter-
préter des mythes païens ou chrétiens, ont confondu la
simplicité et la vérité de composition avec la pauvreté
d’observation et la médiocrité de conception, l’élégance
des gestes et l’eurhythmie des lignes avec le maniérisme
des attitudes et la rondeur des formes, et ils sont arrivés,
les uns et les autres, à une égale insignifiance. Les œuvres
monotones, sèches et froides de Willem van Miéris et
d’Adriaan van der Werif montrent suffisamment que, dès
les premières années du xvnie siècle, le mouvement d’idées
et de sentiments artistiques, dont la Hollande s’est enor-
gueillie et s’enorgueillit encore à bon droit, s'il ne s’était
pas tout à fait arrêté, s’était singulièrement modifié.
Pierre Petroz.
L’ART.
l’avènement de Guillaume III au trône d’Angleterre, seu-
lement leur indépendance et leur autorité au point de vue
politique étaient moindres que celles dont ils jouissaient
autrefois, et ils s’inquiétaient plus de leurs affaires person-
nelles que de celles de l’Etat ou de la Cité.
L’activité commerciale de la Hollande resta ce qu’elle
avait été précédemment, peut-être même devint plus
grande; mais sa vitalité intellectuelle diminua à cette
époque d’une façon assez sensible. Les créations poétiques
ou littéraires qui, si elles avaient été nombreuses, ne
s’étaient jamais distinguées par une notable supériorité, se
firent plus rares. Les critiques religieuses furent entravées
par la crainte de froisser l’orthodoxie de Guillaume III et
de ses adhérents, anciens ou nouveaux. Les recherches de
la science, les spéculations de la philosophie, quelle que
fût leur importance, ou plutôt en raison même de leur
importance, s’adressaient à un public fort restreint, et,
d’ailleurs, touchaient peu l’esprit de riches bourgeois assez
satisfaits de leur existence luxueuse et paisible, pour
dédaigner ou redouter ce qui ne contribuait pas directe-
ment à l’améliorer et pouvait la troubler.
L’espèce d’accalmie intellectuelle et morale, qui résulta
L’Aiguière,
par Van der Meer de Delft. — (Metropolitan Muséum of Art de New-York.)
de l’installation définitive de Guillaume III comme sta-
thouder et comme roi, fut loin de tourner au profit de
l’art. Elle coïncide avec la fin de la brillante période de
l’école hollandaise et semble avoir brusquement déterminé
le commencement de la décadence de celle-ci.
Les petits maîtres, pour employer la qualification don-
née d’ordinaire aux peintres de genre, contemporains ou
successeurs de Rembrandt, étaient tous morts en 1688,
date de la révolution qui valut à Guillaume III la cou-
ronne d’Angleterre, et, à le bien prendre, ils ne furent pas
remplacés. Ceux qui sont venus après eux, qu’ils aient
traité des sujets identiques ou se soient hasardés à inter-
préter des mythes païens ou chrétiens, ont confondu la
simplicité et la vérité de composition avec la pauvreté
d’observation et la médiocrité de conception, l’élégance
des gestes et l’eurhythmie des lignes avec le maniérisme
des attitudes et la rondeur des formes, et ils sont arrivés,
les uns et les autres, à une égale insignifiance. Les œuvres
monotones, sèches et froides de Willem van Miéris et
d’Adriaan van der Werif montrent suffisamment que, dès
les premières années du xvnie siècle, le mouvement d’idées
et de sentiments artistiques, dont la Hollande s’est enor-
gueillie et s’enorgueillit encore à bon droit, s'il ne s’était
pas tout à fait arrêté, s’était singulièrement modifié.
Pierre Petroz.