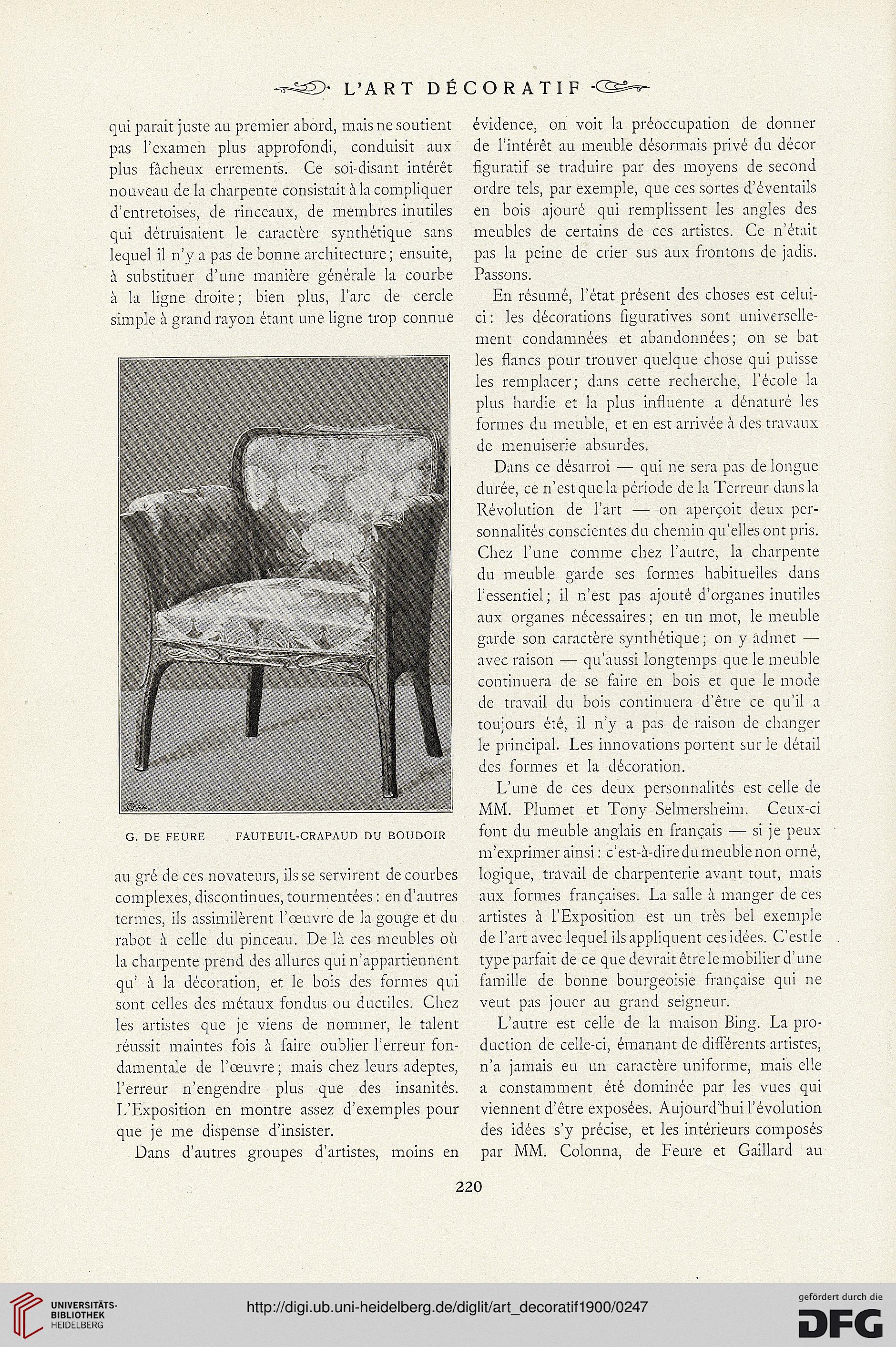L'ART DÉCORATIF -(5ë^
qui paraît juste au premier abord, mais ne soutient
pas l'examen plus approfondi, conduisit aux
plus fâcheux errements. Ce soi-disant intérêt
nouveau de la charpente consistait à la compliquer
d'entretoises, de rinceaux, de membres inutiles
qui détruisaient le caractère synthétique sans
lequel il n'y a pas de bonne architecture ; ensuite,
à substituer d'une manière générale la courbe
à la ligne droite; bien plus, l'arc de cercle
simple à grand rayon étant une ligne trop connue
G. DE FEURE FAUTELUL-CRAPAUD DU BOUDOtR
au gré de ces novateurs, ils se servirent de courbes
complexes, discontinues, tourmentées : en d'autres
termes, ils assimilèrent l'œuvre de la gouge et du
rabot à celle du pinceau. De là ces meubles où
la charpente prend des allures qui n'appartiennent
qu' à la décoration, et le bois des formes qui
sont celles des métaux fondus ou ductiles. Chez
les artistes que je viens de nommer, le talent
réussit maintes fois à faire oublier l'erreur fon-
damentale de l'œuvre ; mais chez leurs adeptes,
l'erreur n'engendre plus que des insanités.
L'Exposition en montre assez d'exemples pour
que je me dispense d'insister.
Dans d'autres groupes d'artistes, moins en
évidence, on voit la préoccupation de donner
de l'intérêt au meuble désormais privé du décor
figuratif se traduire par des moyens de second
ordre tels, par exemple, que ces sortes d'éventails
en bois ajouré qui remplissent les angles des
meubles de certains de ces artistes. Ce n'était
pas la peine de crier sus aux frontons de jadis.
Passons.
En résumé, l'état présent des choses est celui-
ci: les décorations figuratives sont universelle-
ment condamnées et abandonnées; on se bat
les flancs pour trouver quelque chose qui puisse
les remplacer; dans cette recherche, l'école la
plus hardie et la plus influente a dénaturé les
formes du meuble, et en est arrivée à des travaux
de menuiserie absurdes.
Dans ce désarroi — qui ne sera pas de longue
durée, ce n'est que la période de la Terreur dans la
Révolution de l'art — on aperçoit deux per-
sonnalités conscientes du chemin qu'elles ont pris.
Chez l'une comme chez l'autre, la charpente
du meuble garde ses formes habituelles dans
l'essentiel ; il n'est pas ajouté d'organes inutiles
aux organes nécessaires; en un mot, le meuble
garde son caractère synthétique; on y admet —
avec raison — qu'aussi longtemps que le meuble
continuera de se faire en bois et que le mode
de travail du bois continuera d'être ce qu'il a
toujours été, il n'y a pas de raison de changer
le principal. Les innovations portent sur le détail
des formes et la décoration.
L'une de ces deux personnalités est celle de
MM. Plumet et Tony Selmersheim. Ceux-ci
font du meuble anglais en français — si je peux
m'exprimer ainsi : c'est-à-diredumeublenon orné,
logique, travail de charpenterie avant tout, mais
aux formes françaises. La salle à manger de ces
artistes à l'Exposition est un très bel exemple
de l'art avec lequel ils appliquent ces idées. C'est le
type parfait de ce que devrait être le mobilier d'une
famille de bonne bourgeoisie française qui ne
veut pas jouer au grand seigneur.
L'autre est celle de la maison Bing. La pro-
duction de celle-ci, émanant de différents artistes,
n'a jamais eu un caractère uniforme, mais elle
a constamment été dominée par les vues qui
viennent d'être exposées. Aujourd'hui l'évolution
des idées s'y précise, et les intérieurs composés
par MM. Colonna, de Feure et Gaillard au
220
qui paraît juste au premier abord, mais ne soutient
pas l'examen plus approfondi, conduisit aux
plus fâcheux errements. Ce soi-disant intérêt
nouveau de la charpente consistait à la compliquer
d'entretoises, de rinceaux, de membres inutiles
qui détruisaient le caractère synthétique sans
lequel il n'y a pas de bonne architecture ; ensuite,
à substituer d'une manière générale la courbe
à la ligne droite; bien plus, l'arc de cercle
simple à grand rayon étant une ligne trop connue
G. DE FEURE FAUTELUL-CRAPAUD DU BOUDOtR
au gré de ces novateurs, ils se servirent de courbes
complexes, discontinues, tourmentées : en d'autres
termes, ils assimilèrent l'œuvre de la gouge et du
rabot à celle du pinceau. De là ces meubles où
la charpente prend des allures qui n'appartiennent
qu' à la décoration, et le bois des formes qui
sont celles des métaux fondus ou ductiles. Chez
les artistes que je viens de nommer, le talent
réussit maintes fois à faire oublier l'erreur fon-
damentale de l'œuvre ; mais chez leurs adeptes,
l'erreur n'engendre plus que des insanités.
L'Exposition en montre assez d'exemples pour
que je me dispense d'insister.
Dans d'autres groupes d'artistes, moins en
évidence, on voit la préoccupation de donner
de l'intérêt au meuble désormais privé du décor
figuratif se traduire par des moyens de second
ordre tels, par exemple, que ces sortes d'éventails
en bois ajouré qui remplissent les angles des
meubles de certains de ces artistes. Ce n'était
pas la peine de crier sus aux frontons de jadis.
Passons.
En résumé, l'état présent des choses est celui-
ci: les décorations figuratives sont universelle-
ment condamnées et abandonnées; on se bat
les flancs pour trouver quelque chose qui puisse
les remplacer; dans cette recherche, l'école la
plus hardie et la plus influente a dénaturé les
formes du meuble, et en est arrivée à des travaux
de menuiserie absurdes.
Dans ce désarroi — qui ne sera pas de longue
durée, ce n'est que la période de la Terreur dans la
Révolution de l'art — on aperçoit deux per-
sonnalités conscientes du chemin qu'elles ont pris.
Chez l'une comme chez l'autre, la charpente
du meuble garde ses formes habituelles dans
l'essentiel ; il n'est pas ajouté d'organes inutiles
aux organes nécessaires; en un mot, le meuble
garde son caractère synthétique; on y admet —
avec raison — qu'aussi longtemps que le meuble
continuera de se faire en bois et que le mode
de travail du bois continuera d'être ce qu'il a
toujours été, il n'y a pas de raison de changer
le principal. Les innovations portent sur le détail
des formes et la décoration.
L'une de ces deux personnalités est celle de
MM. Plumet et Tony Selmersheim. Ceux-ci
font du meuble anglais en français — si je peux
m'exprimer ainsi : c'est-à-diredumeublenon orné,
logique, travail de charpenterie avant tout, mais
aux formes françaises. La salle à manger de ces
artistes à l'Exposition est un très bel exemple
de l'art avec lequel ils appliquent ces idées. C'est le
type parfait de ce que devrait être le mobilier d'une
famille de bonne bourgeoisie française qui ne
veut pas jouer au grand seigneur.
L'autre est celle de la maison Bing. La pro-
duction de celle-ci, émanant de différents artistes,
n'a jamais eu un caractère uniforme, mais elle
a constamment été dominée par les vues qui
viennent d'être exposées. Aujourd'hui l'évolution
des idées s'y précise, et les intérieurs composés
par MM. Colonna, de Feure et Gaillard au
220