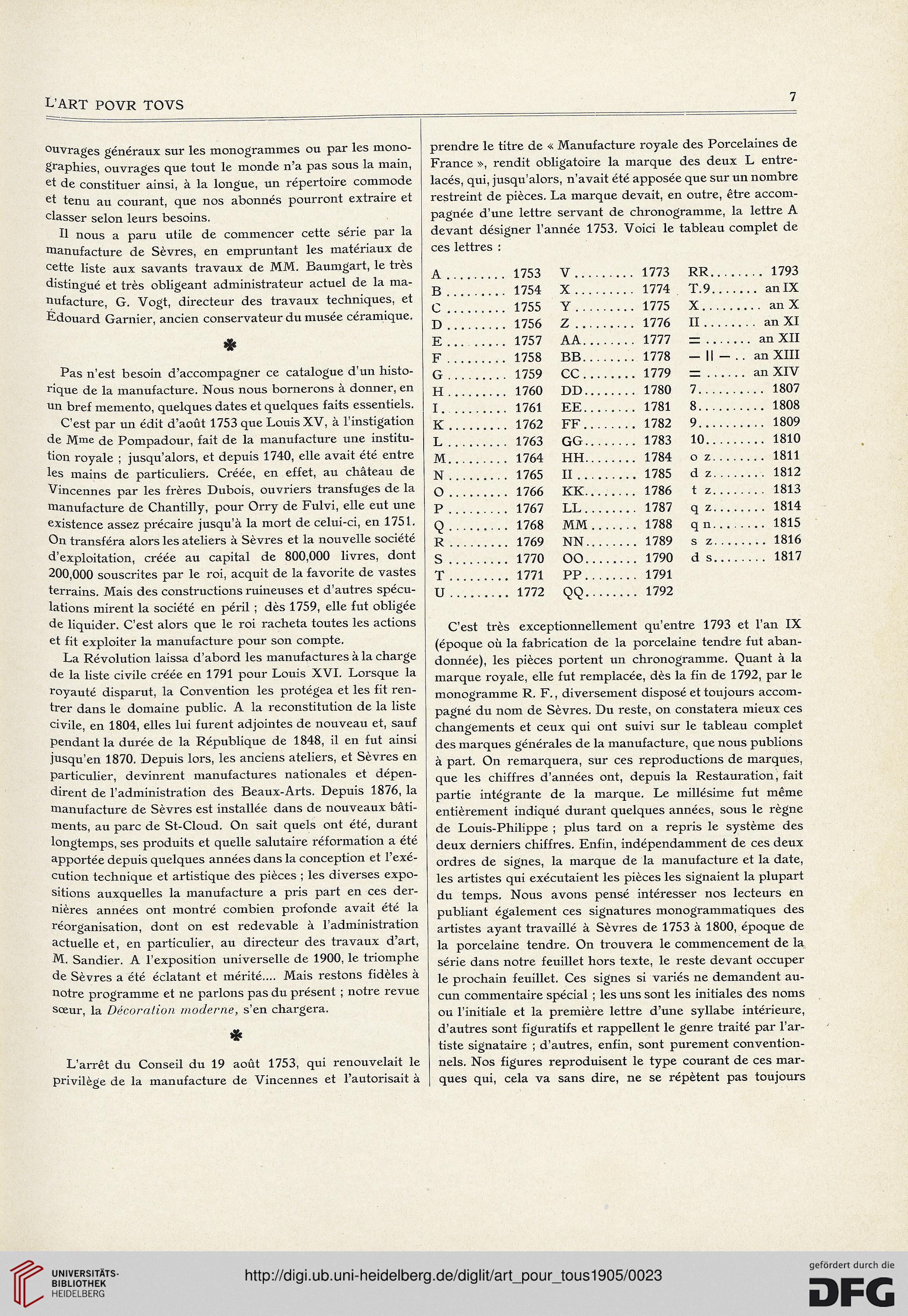L'ART POVR TOVS
ouvrages généraux sur les monogrammes ou par les mono-
graphies, ouvrages que tout le monde n'a pas sous la main,
et de constituer ainsi, à la longue, un répertoire commode
et tenu au courant, que nos abonnés pourront extraire et
classer selon leurs besoins.
Il nous a paru utile de commencer cette série par la
manufacture de Sèvres, en empruntant les matériaux de
cette liste aux savants travaux de MM. Baumgart, le très
distingué et très obligeant administrateur actuel de la ma-
nufacture, G. Vogt, directeur des travaux techniques, et
Edouard Garnier, ancien conservateur du musée céramique.
*
Pas n'est besoin d'accompagner ce catalogue d'un histo-
rique de la manufacture. Nous nous bornerons à donner, en
un bref mémento, quelques dates et quelques faits essentiels.
C'est par un édit d'août 1753 que Louis XV, à l'instigation
de Mme de Pompadour, fait de la manufacture une institu-
tion royale ; jusqu'alors, et depuis 1740, elle avait été entre
les mains de particuliers. Créée, en effet, au château de
Vincennes par les frères Dubois, ouvriers transfuges de la
manufacture de Chantilly, pour Orry de Fulvi, elle eut une
existence assez précaire jusqu'à la mort de celui-ci, en 1751.
On transféra alors les ateliers à Sèvres et la nouvelle société
d'exploitation, créée au capital de 800,000 livres, dont
200,000 souscrites par le roi, acquit de la favorite de vastes
terrains. Mais des constructions ruineuses et d'autres spécu-
lations mirent la société en péril ; dès 1759, elle fut obligée
de liquider. C'est alors que le roi racheta toutes les actions
et fit exploiter la manufacture pour son compte.
La Révolution laissa d'abord les manufactures à la charge
de la liste civile créée en 1791 pour Louis XVI. Lorsque la
royauté disparut, la Convention les protégea et les fit ren-
trer dans le domaine public. A la reconstitution de la liste
civile, en 1804, elles lui furent adjointes de nouveau et, sauf
pendant la durée de la République de 1848, il en fut ainsi
jusqu'en 1870. Depuis lors, les anciens ateliers, et Sèvres en
particulier, devinrent manufactures nationales et dépen-
dirent de l'administration des Beaux-Arts. Depuis 1876, la
manufacture de Sèvres est installée dans de nouveaux bâti-
ments, au parc de St-Cloud. On sait quels ont été, durant
longtemps, ses produits et quelle salutaire réformation a été
apportée depuis quelques années dans la conception et l'exé-
cution technique et artistique des pièces ; les diverses expo-
sitions auxquelles la manufacture a pris part en ces der-
nières années ont montré combien profonde avait été la
réorganisation, dont on est redevable à l'administration
actuelle et, en particulier, au directeur des travaux d'art,
M. Sandier. A l'exposition universelle de 1900, le triomphe
de Sèvres a été éclatant et mérité.... Mais restons fidèles à
notre programme et ne parlons pas du présent ; notre revue
sœur, la Décoration moderne, s'en chargera.
*
L'arrêt du Conseil du 19 août 1753, qui renouvelait le
privilège de la manufacture de Vincennes et l'autorisait à
7
prendre le titre de « Manufacture royale des Porcelaines de
France », rendit obligatoire la marque des deux L entre-
lacés, qui, jusqu'alors, n'avait été apposée que sur un nombre
restreint de pièces. La marque devait, en outre, être accom-
pagnée d'une lettre servant de chronogramme, la lettre A
devant désigner l'année 1753. Voici le tableau complet de
ces lettres :
A
1753
V......
1773
RR
1793
B
1754
X......
1774
T. 9
c
1755
Y......
1775
X......
D
1756
Z......
1776
II
E ..
1757
AA
1777
an XII
F
1758
BB
1778
- Il - .
. an XIII
G
1759
ce
1779
an XIV
H
1760
DD
1780
7......
1807
I
1761
EE
1781
8......
1808
K
1762
FF
1782
9......
1809
L
1763
GG
1783
10
1810
M
1764
HH
1784
1811
N
1765
II......
1785
d z
1812
o
1766
KK
1786
t z
1813
P
1767
LL
1787
1814
Q
1768
MM
1788
1815
R
1769
NN
1789
1816
S
1770
OO
1790
d s
1817
T
1771
PP
1791
U
1772
QQ.....
1792
C'est très exceptionnellement qu'entre 1793 et l'an IX
(époque où la fabrication de la porcelaine tendre fut aban-
donnée), les pièces portent un chronogramme. Quant à la
marque royale, elle fut remplacée, dès la fin de 1792, par le
monogramme R. F., diversement disposé et toujours accom-
pagné du nom de Sèvres. Du reste, on constatera mieux ces
changements et ceux qui ont suivi sur le tableau complet
des marques générales de la manufacture, que nous publions
à part. On remarquera, sur ces reproductions de marques,
que les chiffres d'années ont, depuis la Restauration, fait
partie intégrante de la marque. Le millésime fut même
entièrement indiqué durant quelques années, sous le règne
de Louis-Philippe ; plus tard on a repris le système des
deux derniers chiffres. Enfin, indépendamment de ces deux
ordres de signes, la marque de la manufacture et la date,
les artistes qui exécutaient les pièces les signaient la plupart
du temps. Nous avons pensé intéresser nos lecteurs en
publiant également ces signatures monogrammatiques des
artistes ayant travaillé à Sèvres de 1753 à 1800, époque de
la porcelaine tendre. On trouvera le commencement de la
série dans notre feuillet hors texte, le reste devant occuper
le prochain feuillet. Ces signes si variés ne demandent au-
cun commentaire spécial ; les uns sont les initiales des noms
ou l'initiale et la première lettre d'une syllabe intérieure,
d'autres sont figuratifs et rappellent le genre traité par l'ar-
tiste signataire ; d'autres, enfin, sont purement convention-
nels. Nos figures reproduisent le type courant de ces mar-
ques qui, cela va sans dire, ne se répètent pas toujours
ouvrages généraux sur les monogrammes ou par les mono-
graphies, ouvrages que tout le monde n'a pas sous la main,
et de constituer ainsi, à la longue, un répertoire commode
et tenu au courant, que nos abonnés pourront extraire et
classer selon leurs besoins.
Il nous a paru utile de commencer cette série par la
manufacture de Sèvres, en empruntant les matériaux de
cette liste aux savants travaux de MM. Baumgart, le très
distingué et très obligeant administrateur actuel de la ma-
nufacture, G. Vogt, directeur des travaux techniques, et
Edouard Garnier, ancien conservateur du musée céramique.
*
Pas n'est besoin d'accompagner ce catalogue d'un histo-
rique de la manufacture. Nous nous bornerons à donner, en
un bref mémento, quelques dates et quelques faits essentiels.
C'est par un édit d'août 1753 que Louis XV, à l'instigation
de Mme de Pompadour, fait de la manufacture une institu-
tion royale ; jusqu'alors, et depuis 1740, elle avait été entre
les mains de particuliers. Créée, en effet, au château de
Vincennes par les frères Dubois, ouvriers transfuges de la
manufacture de Chantilly, pour Orry de Fulvi, elle eut une
existence assez précaire jusqu'à la mort de celui-ci, en 1751.
On transféra alors les ateliers à Sèvres et la nouvelle société
d'exploitation, créée au capital de 800,000 livres, dont
200,000 souscrites par le roi, acquit de la favorite de vastes
terrains. Mais des constructions ruineuses et d'autres spécu-
lations mirent la société en péril ; dès 1759, elle fut obligée
de liquider. C'est alors que le roi racheta toutes les actions
et fit exploiter la manufacture pour son compte.
La Révolution laissa d'abord les manufactures à la charge
de la liste civile créée en 1791 pour Louis XVI. Lorsque la
royauté disparut, la Convention les protégea et les fit ren-
trer dans le domaine public. A la reconstitution de la liste
civile, en 1804, elles lui furent adjointes de nouveau et, sauf
pendant la durée de la République de 1848, il en fut ainsi
jusqu'en 1870. Depuis lors, les anciens ateliers, et Sèvres en
particulier, devinrent manufactures nationales et dépen-
dirent de l'administration des Beaux-Arts. Depuis 1876, la
manufacture de Sèvres est installée dans de nouveaux bâti-
ments, au parc de St-Cloud. On sait quels ont été, durant
longtemps, ses produits et quelle salutaire réformation a été
apportée depuis quelques années dans la conception et l'exé-
cution technique et artistique des pièces ; les diverses expo-
sitions auxquelles la manufacture a pris part en ces der-
nières années ont montré combien profonde avait été la
réorganisation, dont on est redevable à l'administration
actuelle et, en particulier, au directeur des travaux d'art,
M. Sandier. A l'exposition universelle de 1900, le triomphe
de Sèvres a été éclatant et mérité.... Mais restons fidèles à
notre programme et ne parlons pas du présent ; notre revue
sœur, la Décoration moderne, s'en chargera.
*
L'arrêt du Conseil du 19 août 1753, qui renouvelait le
privilège de la manufacture de Vincennes et l'autorisait à
7
prendre le titre de « Manufacture royale des Porcelaines de
France », rendit obligatoire la marque des deux L entre-
lacés, qui, jusqu'alors, n'avait été apposée que sur un nombre
restreint de pièces. La marque devait, en outre, être accom-
pagnée d'une lettre servant de chronogramme, la lettre A
devant désigner l'année 1753. Voici le tableau complet de
ces lettres :
A
1753
V......
1773
RR
1793
B
1754
X......
1774
T. 9
c
1755
Y......
1775
X......
D
1756
Z......
1776
II
E ..
1757
AA
1777
an XII
F
1758
BB
1778
- Il - .
. an XIII
G
1759
ce
1779
an XIV
H
1760
DD
1780
7......
1807
I
1761
EE
1781
8......
1808
K
1762
FF
1782
9......
1809
L
1763
GG
1783
10
1810
M
1764
HH
1784
1811
N
1765
II......
1785
d z
1812
o
1766
KK
1786
t z
1813
P
1767
LL
1787
1814
Q
1768
MM
1788
1815
R
1769
NN
1789
1816
S
1770
OO
1790
d s
1817
T
1771
PP
1791
U
1772
QQ.....
1792
C'est très exceptionnellement qu'entre 1793 et l'an IX
(époque où la fabrication de la porcelaine tendre fut aban-
donnée), les pièces portent un chronogramme. Quant à la
marque royale, elle fut remplacée, dès la fin de 1792, par le
monogramme R. F., diversement disposé et toujours accom-
pagné du nom de Sèvres. Du reste, on constatera mieux ces
changements et ceux qui ont suivi sur le tableau complet
des marques générales de la manufacture, que nous publions
à part. On remarquera, sur ces reproductions de marques,
que les chiffres d'années ont, depuis la Restauration, fait
partie intégrante de la marque. Le millésime fut même
entièrement indiqué durant quelques années, sous le règne
de Louis-Philippe ; plus tard on a repris le système des
deux derniers chiffres. Enfin, indépendamment de ces deux
ordres de signes, la marque de la manufacture et la date,
les artistes qui exécutaient les pièces les signaient la plupart
du temps. Nous avons pensé intéresser nos lecteurs en
publiant également ces signatures monogrammatiques des
artistes ayant travaillé à Sèvres de 1753 à 1800, époque de
la porcelaine tendre. On trouvera le commencement de la
série dans notre feuillet hors texte, le reste devant occuper
le prochain feuillet. Ces signes si variés ne demandent au-
cun commentaire spécial ; les uns sont les initiales des noms
ou l'initiale et la première lettre d'une syllabe intérieure,
d'autres sont figuratifs et rappellent le genre traité par l'ar-
tiste signataire ; d'autres, enfin, sont purement convention-
nels. Nos figures reproduisent le type courant de ces mar-
ques qui, cela va sans dire, ne se répètent pas toujours