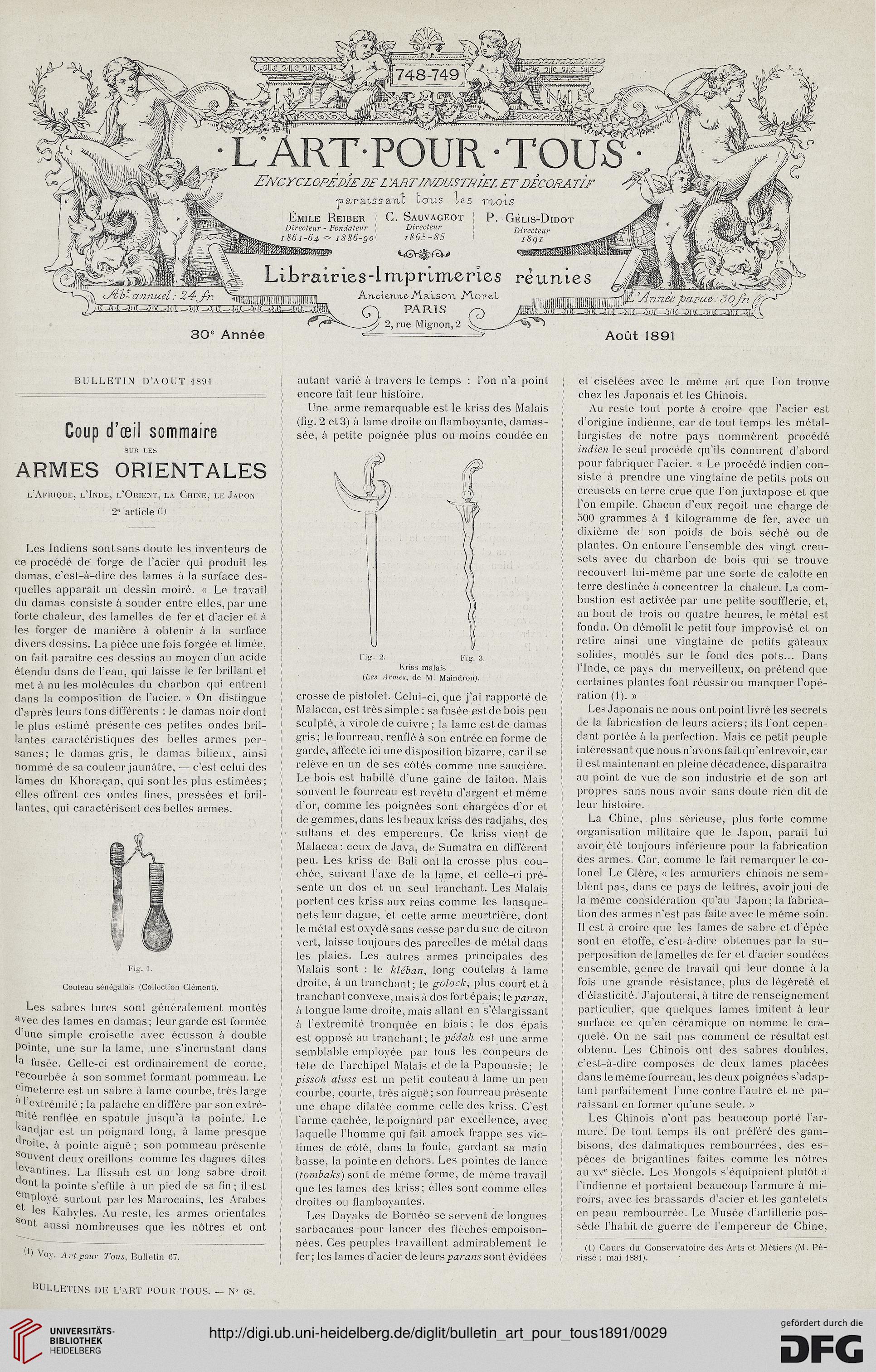LARTPOUR-TOUS
Encyclopédie de eart/neusteiel et decoeatif
•paraissait tcrus les mots
Emile Reiber j G. Sauvageot j P. Gélis-Didot
Directeur - Fondateur Directeur Directeur
1861-64 o iS86-go\ i865-85 ) i8gi
Litratries-Imprimeries réunies
^ <AU annuel: 24Jr. ^Mfllffl||l||ilillll|||||||l|||l|lllL. Ancienn.*Maison Moral
»i jii 1 Jiui-.y*^ 1 ^.m ^i\x^uj^>AC^j)\^i>ittM PARIS
<d*?=*^_^/ 2, rue Mignon, 2
30e Année-----Août 1891
TJf^nc^Tïï^^)f^or.-'iîi<^ii(-.,>ii.(.--i-iîr3îît:
BULLETIN D'AOUT 1891
Coup d'œil sommaire
SUR LES
ARMES ORIENTALES
l'Afrique, l'Inde, l'Orient, la Chine, le Japon
2e article 0)
Les Indiens sont, sans doute les inventeurs de
ce procédé de forge de l'acier qui produit les
damas, c'est-à-dire des lames à la surface des-
quelles apparaît un dessin moiré. « Le travail
du damas consiste à souder entre elles, par une
forte chaleur, des lamelles de fer et d'acier et à
les forger de manière à obtenir à la surface
divers dessins. La pièce une fois forgée et limée,
on fait paraître ces dessins au moyen d'un acide
étendu dans de l'eau, qui laisse le fer brillant et
met à nu les molécules du charbon qui entrent
dans la composition de l'acier. » On distingue
d'après leurs Ions différents : le damas noir dont
le plus estimé présente ces petites ondes bril-
lantes caractéristiques des belles armes per-
sanes; le damas gris, le damas bilieux, ainsi
nommé de sa couleur jaunâtre, — c'est celui des
lames du Khoraçan, qui sont les plus estimées;
elles offrent ces ondes fines, pressées et bril-
lantes, qui caractérisent ces belles armes.
Fig. 1.
Couteau sénégalais (Collection Clément).
Les sabres turcs sont généralement montés
avec des lames en damas; leur garde est formée
d'une simple croisétte avec écusson à double
Pointe, une sur la lame, une s'incrustant dans
'a fusée. Celle-ci est ordinairement de corne,
''ecourbée à son sommet formant pommeau. Le
Ç'meterre est un sabre à lame courbe, très large
a ' extrémité ; la palache en diffère par son extré-
mité renflée en spatule jusqu'à la pointe. Le
*andjar est un poignard long, à lame presque
droite, à pointe aiguë ; son pommeau présente
ouvent deux oreillons comme les dagues dites
famines. La flissah est un long sabre droit
°nl la pointe s'effile à un pied de sa fin; il est
e,î1ployé surtout par les Marocains, les Arabes
el 'es Kabyles. Au reste, les armes orientales j
s°"t, aussi nombreuses que les nôtres et ont
(1) Voy. Art pour Tous, Bulletin 07.
autant varié à travers le temps : l'on n'a point
encore fait leur histoire.
Une arme remarquable est le kriss des Malais
(fig. 2 et3) à lame droite ou flamboyante, damas-
sée, à petite poignée plus ou moins coudée en
Fig- 2. Fig. 3.
Kriss malais
(tes Amies, de M. Maindron).
crosse de pistolet. Celui-ci, que j'ai rapporté de
Malacca, est très simple : sa fusée est de bois peu
sculpté, à virole de cuivre ; la lame est de damas
gris; le fourreau, renflé à son entrée en forme de
garde, affecte ici une disposition bizarre, car il se
relève en un de ses côtés comme une saucière.
Le bois est habillé d'une gaine de laiton. Mais
souvent le fourreau est revêtu d'argent et même
d'or, comme les poignées sont chargées d'or et
de gemmes, dans les beaux kriss des radjahs, des
sultans et des empereurs. Ce kriss vient de
Malacca: ceux de Java, de Sumatra en diffèrent
peu. Les kriss de Bali ont la crosse plus cou-
chée, suivant l'axe de la lame, et celle-ci pré-
sente un dos et un seul tranchant. Les Malais
portent ces kriss aux reins comme les lansque-
nets leur dague, et cette arme meurtrière, dont
le métal est oxydé sans cesse par du suc de citron
vert, laisse toujours des parcelles de métal dans
les plaies. Les autres armes principales des
Malais sont : le kléban, long coutelas à lame
droite, à un tranchant; le golock, plus court et à
tranchant convexe, mais à dos fort épais; le paran,
à longue lame droite, mais allant en s'élargissant
à l'extrémité tronquée en biais ; le dos épais
est opposé au tranchant; le pédah est une arme
semblable employée par lotis les coupeurs de
tôle de l'archipel Malais et de la Papouasie; le
pissoh aluss est un petit couteau à lame un peu
courbe, courte, très aiguë; son fourreau présente
une chape dilatée comme celle des kriss. C'est
l'arme cachée, le poignard par excellence, avec
laquelle l'homme qui fait amock frappe ses vic-
times de côté, dans la foule, gardant sa main
basse, la pointe en dehors. Les pointes de lance
(tombâtes) sont de même forme, de même travail
que les lames des kriss; elles sont comme elles
droites ou flamboyantes.
Les Dayaks de Bornéo se servent de longues
sarbacanes pour lancer des flèches empoison-
nées. Ces peuples travaillent admirablement le
fer; les lames d'acier de leurs par ans sont évidées
j et ciselées avec le même art que l'on trouve
j chez les Japonais et les Chinois.
Au reste tout porte à croire que l'acier est
d'origine indienne, car de tout temps les métal-
lurgistes de notre pays nommèrent procédé
indien le seul procédé qu'ils connurent d'abord
pour fabriquer l'acier. « Le procédé indien con-
siste à prendre une vingtaine de petits pots ou
creusets en terre crue que l'on juxtapose et que
l'on empile. Chacun d'eux reçoit une charge de
500 grammes à 1 kilogramme de fer, avec un
dixième de son poids de bois séché ou de
plantes. On entoure l'ensemble des vingt creu-
sets avec du charbon de bois qui se trouve
recouvert lui-même par une sorte de calotte en
terre destinée à concentrer la chaleur. La com-
buslion est activée par une petite soufflerie, et,
au bout de trois ou quatre heures, le métal est
fondu. On démolit le petit four improvisé el on
retire ainsi une vingtaine de petits gâteaux
solides, moulés sur le fond des pois... Dans
l'Inde, ce pays du merveilleux, on prétend que
certaines plantes font réussir ou manquer l'opé-
i ration (1). »
Les Japonais ne nous ont point livré les secrels
de la fabrication de leurs aciers; ils l'ont cepen-
dant portée à la perfection. Mais ce petit peuple
intéressant que nous n'avons fait qu'entrevoir, car
il est maintenant en pleine décadence, disparaîtra
au point de vue de son industrie et de son art
propres sans nous avoir sans doute rien dit de
leur histoire.
La Chine, plus sérieuse, plus forte comme
organisation militaire que le Japon, paraît lui
avoir été toujours inférieure pour la fabrication
des armes. Car, comme le fait remarquer le co-
j lonel Le Clère, « les armuriers chinois ne sem-
i blent pas, dans ce pays de lettrés, avoir joui de
la même considération qu'au Japon ; la fabrica-
tion des armes n'est pas faite avec le même soin.
Il est à croire que les lames de sabre et d'épée
sont en étoffe, c'est-à-dire obtenues par la su-
perposition de lamelles de fer et d'acier soudées
j ensemble, genre de travail qui leur donne à la
( fois une grande résistance, plus de légèreté et
j d'élasticité. J'ajouterai, à litre de renseignement
particulier; que quelques lames imilent à leur
surface ce qu'en céramique on nomme le cra-
quelé. On ne sait pas comment ce résultat esl
obtenu. Les Chinois ont des sabres doubles,
c'est-à-dire composés de deux lames placées
dans le même fourreau, les deux poignées s'adap-
tant parfailement l'une contre l'autre et ne pa-
raissant en former qu'une seule. »
Les Chinois n'ont pas beaucoup porté l'ar-
mure. De tout temps ils ont préféré des gam-
I bisons, des dalmatiques rembourrées, des es-
pèces de brigantines faites comme les noires
j au xve siècle. Les Mongols s'équipaient plutôt à
l'indienne et portaient beaucoup l'armure à mi-
roirs, avec les brassards d'acier et les gantelets
en peau rembourrée. Le Musée d'arlillerie pos-
sède l'habit de guerre de l'empereur de Chine,
(1) Cours du Conservatoire des Arts et Métiers (M. Pè-i
; rissé : mai 1881 ).
BULLETINS DE L'ART POUR TOUS. — N° 68.
Encyclopédie de eart/neusteiel et decoeatif
•paraissait tcrus les mots
Emile Reiber j G. Sauvageot j P. Gélis-Didot
Directeur - Fondateur Directeur Directeur
1861-64 o iS86-go\ i865-85 ) i8gi
Litratries-Imprimeries réunies
^ <AU annuel: 24Jr. ^Mfllffl||l||ilillll|||||||l|||l|lllL. Ancienn.*Maison Moral
»i jii 1 Jiui-.y*^ 1 ^.m ^i\x^uj^>AC^j)\^i>ittM PARIS
<d*?=*^_^/ 2, rue Mignon, 2
30e Année-----Août 1891
TJf^nc^Tïï^^)f^or.-'iîi<^ii(-.,>ii.(.--i-iîr3îît:
BULLETIN D'AOUT 1891
Coup d'œil sommaire
SUR LES
ARMES ORIENTALES
l'Afrique, l'Inde, l'Orient, la Chine, le Japon
2e article 0)
Les Indiens sont, sans doute les inventeurs de
ce procédé de forge de l'acier qui produit les
damas, c'est-à-dire des lames à la surface des-
quelles apparaît un dessin moiré. « Le travail
du damas consiste à souder entre elles, par une
forte chaleur, des lamelles de fer et d'acier et à
les forger de manière à obtenir à la surface
divers dessins. La pièce une fois forgée et limée,
on fait paraître ces dessins au moyen d'un acide
étendu dans de l'eau, qui laisse le fer brillant et
met à nu les molécules du charbon qui entrent
dans la composition de l'acier. » On distingue
d'après leurs Ions différents : le damas noir dont
le plus estimé présente ces petites ondes bril-
lantes caractéristiques des belles armes per-
sanes; le damas gris, le damas bilieux, ainsi
nommé de sa couleur jaunâtre, — c'est celui des
lames du Khoraçan, qui sont les plus estimées;
elles offrent ces ondes fines, pressées et bril-
lantes, qui caractérisent ces belles armes.
Fig. 1.
Couteau sénégalais (Collection Clément).
Les sabres turcs sont généralement montés
avec des lames en damas; leur garde est formée
d'une simple croisétte avec écusson à double
Pointe, une sur la lame, une s'incrustant dans
'a fusée. Celle-ci est ordinairement de corne,
''ecourbée à son sommet formant pommeau. Le
Ç'meterre est un sabre à lame courbe, très large
a ' extrémité ; la palache en diffère par son extré-
mité renflée en spatule jusqu'à la pointe. Le
*andjar est un poignard long, à lame presque
droite, à pointe aiguë ; son pommeau présente
ouvent deux oreillons comme les dagues dites
famines. La flissah est un long sabre droit
°nl la pointe s'effile à un pied de sa fin; il est
e,î1ployé surtout par les Marocains, les Arabes
el 'es Kabyles. Au reste, les armes orientales j
s°"t, aussi nombreuses que les nôtres et ont
(1) Voy. Art pour Tous, Bulletin 07.
autant varié à travers le temps : l'on n'a point
encore fait leur histoire.
Une arme remarquable est le kriss des Malais
(fig. 2 et3) à lame droite ou flamboyante, damas-
sée, à petite poignée plus ou moins coudée en
Fig- 2. Fig. 3.
Kriss malais
(tes Amies, de M. Maindron).
crosse de pistolet. Celui-ci, que j'ai rapporté de
Malacca, est très simple : sa fusée est de bois peu
sculpté, à virole de cuivre ; la lame est de damas
gris; le fourreau, renflé à son entrée en forme de
garde, affecte ici une disposition bizarre, car il se
relève en un de ses côtés comme une saucière.
Le bois est habillé d'une gaine de laiton. Mais
souvent le fourreau est revêtu d'argent et même
d'or, comme les poignées sont chargées d'or et
de gemmes, dans les beaux kriss des radjahs, des
sultans et des empereurs. Ce kriss vient de
Malacca: ceux de Java, de Sumatra en diffèrent
peu. Les kriss de Bali ont la crosse plus cou-
chée, suivant l'axe de la lame, et celle-ci pré-
sente un dos et un seul tranchant. Les Malais
portent ces kriss aux reins comme les lansque-
nets leur dague, et cette arme meurtrière, dont
le métal est oxydé sans cesse par du suc de citron
vert, laisse toujours des parcelles de métal dans
les plaies. Les autres armes principales des
Malais sont : le kléban, long coutelas à lame
droite, à un tranchant; le golock, plus court et à
tranchant convexe, mais à dos fort épais; le paran,
à longue lame droite, mais allant en s'élargissant
à l'extrémité tronquée en biais ; le dos épais
est opposé au tranchant; le pédah est une arme
semblable employée par lotis les coupeurs de
tôle de l'archipel Malais et de la Papouasie; le
pissoh aluss est un petit couteau à lame un peu
courbe, courte, très aiguë; son fourreau présente
une chape dilatée comme celle des kriss. C'est
l'arme cachée, le poignard par excellence, avec
laquelle l'homme qui fait amock frappe ses vic-
times de côté, dans la foule, gardant sa main
basse, la pointe en dehors. Les pointes de lance
(tombâtes) sont de même forme, de même travail
que les lames des kriss; elles sont comme elles
droites ou flamboyantes.
Les Dayaks de Bornéo se servent de longues
sarbacanes pour lancer des flèches empoison-
nées. Ces peuples travaillent admirablement le
fer; les lames d'acier de leurs par ans sont évidées
j et ciselées avec le même art que l'on trouve
j chez les Japonais et les Chinois.
Au reste tout porte à croire que l'acier est
d'origine indienne, car de tout temps les métal-
lurgistes de notre pays nommèrent procédé
indien le seul procédé qu'ils connurent d'abord
pour fabriquer l'acier. « Le procédé indien con-
siste à prendre une vingtaine de petits pots ou
creusets en terre crue que l'on juxtapose et que
l'on empile. Chacun d'eux reçoit une charge de
500 grammes à 1 kilogramme de fer, avec un
dixième de son poids de bois séché ou de
plantes. On entoure l'ensemble des vingt creu-
sets avec du charbon de bois qui se trouve
recouvert lui-même par une sorte de calotte en
terre destinée à concentrer la chaleur. La com-
buslion est activée par une petite soufflerie, et,
au bout de trois ou quatre heures, le métal est
fondu. On démolit le petit four improvisé el on
retire ainsi une vingtaine de petits gâteaux
solides, moulés sur le fond des pois... Dans
l'Inde, ce pays du merveilleux, on prétend que
certaines plantes font réussir ou manquer l'opé-
i ration (1). »
Les Japonais ne nous ont point livré les secrels
de la fabrication de leurs aciers; ils l'ont cepen-
dant portée à la perfection. Mais ce petit peuple
intéressant que nous n'avons fait qu'entrevoir, car
il est maintenant en pleine décadence, disparaîtra
au point de vue de son industrie et de son art
propres sans nous avoir sans doute rien dit de
leur histoire.
La Chine, plus sérieuse, plus forte comme
organisation militaire que le Japon, paraît lui
avoir été toujours inférieure pour la fabrication
des armes. Car, comme le fait remarquer le co-
j lonel Le Clère, « les armuriers chinois ne sem-
i blent pas, dans ce pays de lettrés, avoir joui de
la même considération qu'au Japon ; la fabrica-
tion des armes n'est pas faite avec le même soin.
Il est à croire que les lames de sabre et d'épée
sont en étoffe, c'est-à-dire obtenues par la su-
perposition de lamelles de fer et d'acier soudées
j ensemble, genre de travail qui leur donne à la
( fois une grande résistance, plus de légèreté et
j d'élasticité. J'ajouterai, à litre de renseignement
particulier; que quelques lames imilent à leur
surface ce qu'en céramique on nomme le cra-
quelé. On ne sait pas comment ce résultat esl
obtenu. Les Chinois ont des sabres doubles,
c'est-à-dire composés de deux lames placées
dans le même fourreau, les deux poignées s'adap-
tant parfailement l'une contre l'autre et ne pa-
raissant en former qu'une seule. »
Les Chinois n'ont pas beaucoup porté l'ar-
mure. De tout temps ils ont préféré des gam-
I bisons, des dalmatiques rembourrées, des es-
pèces de brigantines faites comme les noires
j au xve siècle. Les Mongols s'équipaient plutôt à
l'indienne et portaient beaucoup l'armure à mi-
roirs, avec les brassards d'acier et les gantelets
en peau rembourrée. Le Musée d'arlillerie pos-
sède l'habit de guerre de l'empereur de Chine,
(1) Cours du Conservatoire des Arts et Métiers (M. Pè-i
; rissé : mai 1881 ).
BULLETINS DE L'ART POUR TOUS. — N° 68.