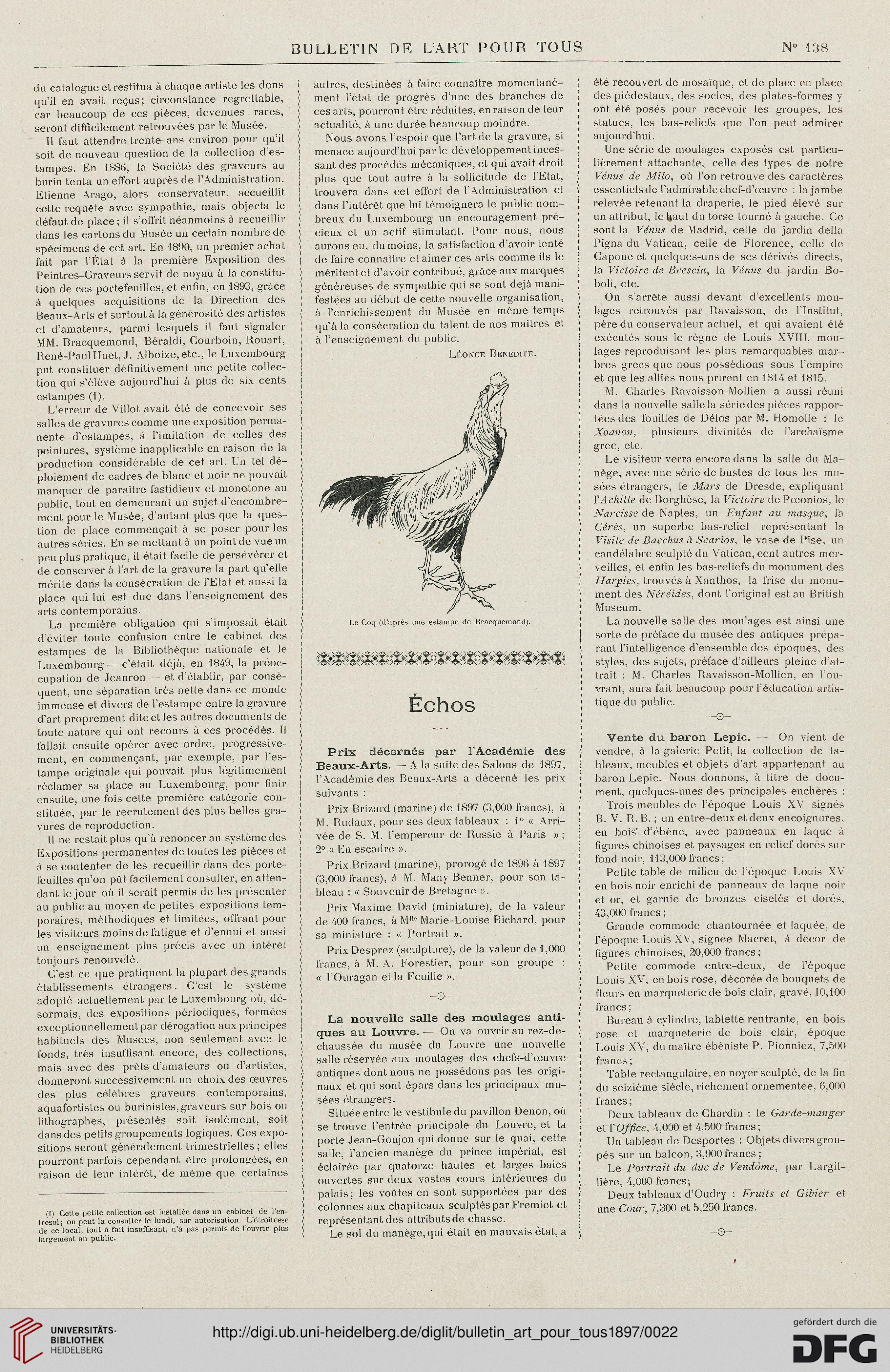BULLETIN DR L'ART POUR TOUS
N° 138
du catalogue et restitua à chaque artiste les dons
qu'il en avait reçus; circonstance regrettable,
car beaucoup de ces pièces, devenues rares,
seront difficilement retrouvées par le Musée.
Il faut attendre trente ans environ pour qu'il
soit de nouveau question de la collection d'es-
tampes. En 1886, la Société des graveurs au
burin tenta un effort auprès de l'Administration.
Etienne Arago, alors conservateur, accueillit
cette requête avec sympathie, mais objecta le
défaut de place ; il s'offrit néanmoins à recueillir
dans les cartons du Musée un certain nombre de
spécimens de cet art. En 1890, un premier achat
fait par l'État à la première Exposition des
Peintres-Graveurs servit de noyau à la constitu-
tion de ces portefeuilles, et enfin, en 1893, grâce
à quelques acquisitions de la Direction des
Beaux-Arts et surtout à la générosité des artistes
et d'amateurs, parmi lesquels il faut signaler
MM. Bracquemond, Béraldi, Courboin, Rouart,
René-PaulHuet, J. Alboize, etc., le Luxembourg
put constituer définitivement une petite collec-
tion qui s'élève aujourd'hui à plus de six cents
estampes (1).
L'erreur de Villot avait été de concevoir ses
salles de gravures comme une exposition perma-
nente d'estampes, à l'imitation de celles des
peintures, système inapplicable en raison de la
production considérable de cet art. Un tel dé-
ploiement de cadres de blanc et noir ne pouvait
manquer de paraître fastidieux et monotone au
public, tout en demeurant un sujet d'encombre-
ment pour le Musée, d'autant plus que la ques-
tion de place commençait à se poser pour les
autres séries. En se mettant à un point de vue un
peu plus pratique, il était facile de persévérer et
de conserver à l'art de la gravure la part qu'elle
mérite dans la consécration de l'Etat et aussi la
place qui lui est due dans l'enseignement des
arts contemporains.
La première obligation qui s'imposait était
d'éviter toute confusion entre le cabinet des
estampes de la Bibliothèque nationale et le
Luxembourg — c'était déjà, en 1849, la préoc-
cupation de Jeanron — et d'établir, par consé-
quent, une séparation très nette dans ce monde
immense et divers de l'estampe entre la gravure
d'art proprement dite et les autres documents de
toute nature qui ont recours à ces procédés. Il
fallait ensuite opérer avec ordre, progressive-
ment, en commençant, par exemple, par l'es-
tampe originale qui pouvait plus légitimement
réclamer sa place au Luxembourg, pour finir
ensuite, une fois cette première catégorie con-
stituée, par le recrutement des plus belles gra-
vures de reproduction.
Il ne restait plus qu'à renoncer au système des
Expositions permanentes de toutes les pièces et
à se contenter de les recueillir dans des porte-
feuilles qu'on pût facilement consulter, en atten-
dant le jour où il serait permis de les présenter
au public au moyen de petites expositions tem-
poraires, méthodiques et limitées, offrant pour
les visiteurs moins de fatigue et d'ennui et aussi
un enseignement plus précis avec un intérêt
toujours renouvelé.
C'est ce que pratiquent la plupart des grands
établissements étrangers. C'est le système
adopté actuellement par le Luxembourg où, dé-
sormais, des expositions périodiques, formées
exceptionnellement par dérogation aux principes
habituels des Musées, non seulement avec le
fonds, très insuffisant encore, des collections,
mais avec des prêts d'amateurs ou d'artistes,
donneront successivement un choix des œuvres
des plus célèbres graveurs contemporains,
aquafortistes ou burinistes, graveurs sur bois ou
lithographes, présentés soit isolément, soit
dans des petits groupements logiques. Ces expo-
sitions seront généralement trimestrielles ; elles
pourront parfois cependant être prolongées, en
raison de leur intérêt, de même que certaines
(1) Cette petite collection est installée dans un cabinet de l'en-
tresol; on peut la consulter le lundi, sur autorisation. L'étroitesse
de ce local, tout à fait insuffisant, n'a pas permis de l'ouvrir plus
largement au public.
autres, destinées à faire connaître momentané-
ment l'état de progrès d'une des branches de
ces arts, pourront être réduites, en raison de leur
actualité, à une durée beaucoup moindre.
Nous avons l'espoir que l'art de la gravure, si
menacé aujourd'hui par le développement inces-
sant des procédés mécaniques, et qui avait droit
plus que tout autre à la sollicitude de l'Etat,
trouvera dans cet effort de l'Administration et
dans l'intérêt que lui témoignera le public nom-
breux du Luxembourg un encouragement pré-
cieux et un actif stimulant. Pour nous, nous
aurons eu, du moins, la satisfaction d'avoir tenté
de faire connaître et aimer ces arts comme ils le
méritent et d'avoir contribué, grâce aux marques
généreuses de sympathie qui se sont déjà mani-
festées au début de cette nouvelle organisation,
à l'enrichissement du Musée en même temps
qu'à la consécration du talent de nos maîtres et
à l'enseignement du public.
Léonce Benedite.
Échos
Prix décernés par l'Académie des
Beaux-Arts. — A la suite des Salons de 1897,
l'Académie des Beaux-Arts a décerné les prix
suivants :
Prix Brizard (marine) de 1897 (3,000 francs), à
M. Rudaux, pour ses deux tableaux : 1° « Arri-
vée de S. M. l'empereur de Russie à Paris » ;
2° « En escadre ».
Prix Brizard (marine), prorogé de 1896 à 1897
(3,000 francs), à M. Many Benner, pour son ta-
bleau : « Souvenir de Bretagne ».
Prix Maxime David (miniature), de la valeur
de 400 francs, à Mllc Marie-Louise Richard, pour
sa miniature : « Portrait ».
Prix Desprez (sculpture), de la valeur de 1,000
francs, à M. A. Forestier, pour son groupe :
« l'Ouragan et la Feuille ».
-O-
La nouvelle salle des moulages anti-
ques au Louvre. — On va ouvrir au rez-de-
chaussée du musée du Louvre une nouvelle
salle réservée aux moulages des chefs-d'œuvre
antiques dont nous ne possédons pas les origi-
naux et qui sont épars dans les principaux mu-
sées étrangers.
Située entre le vestibule du pavillon Denon, où
se trouve l'entrée principale du Louvre, et la
porte Jean-Goujon qui donne sur le quai, cette
salle, l'ancien manège du prince impérial, est
éclairée par quatorze hautes et larges baies
ouvertes sur deux vastes cours intérieures du
palais; les voûtes en sont supportées par des
colonnes aux chapiteaux sculptés par Fremiet et
représentant des attributs de chasse.
Le sol du manège, qui était en mauvais état, a
été recouvert de mosaïque, et de place en place
des piédestaux, des socles, des plates-formes y
ont été posés pour recevoir les groupes, les
statues, les bas-reliefs que l'on peut admirer
aujourd'hui.
Une série de moulages exposés est particu-
lièrement attachante, celle des types de notre
Vénus de Milo, où l'on retrouve des caractères
essentiels de l'admirable chef-d'œuvre : la jambe
relevée retenant la draperie, le pied élevé sur
un attribut, le baut du torse tourné à gauche. Ce
sont la Vénus de Madrid, celle du jardin délia
Pigna du Vatican, celle de Florence, celle de
Capoue et quelques-uns de ses dérivés directs,
la Victoire de Brescia, la Vénus du jardin Bo-
boli, etc.
On s'arrête aussi devant d'excellents mou-
lages retrouvés par Ravaisson, de l'Institut,
père du conservateur actuel, et qui avaient été
exécutés sous le règne de Louis XVIII, mou-
lages reproduisant les plus remarquables mar-
bres grecs que nous possédions sous l'empire
et que les alliés nous prirent en 1814 et 1815.
M. Charles Ravaisson-Mollien a aussi réuni
dans la nouvelle salle la série des pièces rappor-
tées des fouilles de Délos par M. Homolle : le
Xoanon, plusieurs divinités de l'archaïsme
grec, etc.
Le visiteur verra encore dans la salle du Ma-
nège, avec une série de bustes de tous les mu-
sées étrangers, le Mars de Dresde, expliquant
VAchille de Borghèse, la Victoire de Pœonios, le
Narcisse de Naples, un Enfant au masque, la
Cérès, un superbe bas-relief représentant la
Visite de Bacchus à Scarios, le vase de Pise, un
candélabre sculpté du Vatican, cent autres mer-
veilles, et enfin les bas-reliefs du monument des
Harpies, trouvés à Xanthos, la frise du monu-
ment des Néréides, dont l'original est au British
Muséum.
La nouvelle salle des moulages est ainsi une
sorte de préface du musée des antiques prépa-
rant l'intelligence d'ensemble des époques, des
styles, des sujets, préface d'ailleurs pleine d'at-
trait : M. Charles R avaisson-Mollien, en l'ou-
vrant, aura fait beaucoup pour l'éducation artis-
tique du public.
-O-
Vente du baron Lepic. — On vient de
vendre, à la galerie Petit, la collection de ta-
bleaux, meubles et objets d'art appartenant au
baron Lepic. Nous donnons, à titre de docu-
ment, quelques-unes des principales enchères :
Trois meubles de l'époque Louis XV signés
B. V. R.B. ; un entre-deux et deux encoignures,
en bois' d'ébène, avec panneaux en laque à
figures chinoises et paysages en relief dorés sur
fond noir, 113,000 francs ;
Petite table de milieu de l'époque Louis XV
en bois noir enrichi de panneaux de laque noir
et or, et garnie de bronzes ciselés et dorés,
43,000 francs ;
Grande commode chantournée et laquée, de
l'époque Louis XV, signée Macret, à décor de
figures chinoises, 20,000 francs ;
Petile commode entre-deux, de l'époque
Louis XV, en bois rose, décorée de bouquets de
fleurs en marqueterie de bois clair, gravé, 10,100
francs;
Bureau à cylindre, tablette rentrante, en bois
rose et marqueterie de bois clair, époque
Louis XV, du maître ébéniste P. Pionniez, 7,500
francs ;
Table rectangulaire, en noyer sculpté, de la fin
du seizième siècle, richement ornementée, 6,000
francs;
Deux tableaux de Chardin : le Garde-manger
et Y Office, 4,000 et 4,500 francs;
Un tableau de Desportes : Objets divers grou-
pés sur un balcon, 3,900francs;
Le Portrait du duc de Vendôme, par Largil-
lière, 4,000 francs;
Deux tableaux d'Oudry : Fruits et Gibier et
une Cour, 7,300 et 5,250 francs.
-O-
Le Coq (d'après une estampe de Bracquemond).
N° 138
du catalogue et restitua à chaque artiste les dons
qu'il en avait reçus; circonstance regrettable,
car beaucoup de ces pièces, devenues rares,
seront difficilement retrouvées par le Musée.
Il faut attendre trente ans environ pour qu'il
soit de nouveau question de la collection d'es-
tampes. En 1886, la Société des graveurs au
burin tenta un effort auprès de l'Administration.
Etienne Arago, alors conservateur, accueillit
cette requête avec sympathie, mais objecta le
défaut de place ; il s'offrit néanmoins à recueillir
dans les cartons du Musée un certain nombre de
spécimens de cet art. En 1890, un premier achat
fait par l'État à la première Exposition des
Peintres-Graveurs servit de noyau à la constitu-
tion de ces portefeuilles, et enfin, en 1893, grâce
à quelques acquisitions de la Direction des
Beaux-Arts et surtout à la générosité des artistes
et d'amateurs, parmi lesquels il faut signaler
MM. Bracquemond, Béraldi, Courboin, Rouart,
René-PaulHuet, J. Alboize, etc., le Luxembourg
put constituer définitivement une petite collec-
tion qui s'élève aujourd'hui à plus de six cents
estampes (1).
L'erreur de Villot avait été de concevoir ses
salles de gravures comme une exposition perma-
nente d'estampes, à l'imitation de celles des
peintures, système inapplicable en raison de la
production considérable de cet art. Un tel dé-
ploiement de cadres de blanc et noir ne pouvait
manquer de paraître fastidieux et monotone au
public, tout en demeurant un sujet d'encombre-
ment pour le Musée, d'autant plus que la ques-
tion de place commençait à se poser pour les
autres séries. En se mettant à un point de vue un
peu plus pratique, il était facile de persévérer et
de conserver à l'art de la gravure la part qu'elle
mérite dans la consécration de l'Etat et aussi la
place qui lui est due dans l'enseignement des
arts contemporains.
La première obligation qui s'imposait était
d'éviter toute confusion entre le cabinet des
estampes de la Bibliothèque nationale et le
Luxembourg — c'était déjà, en 1849, la préoc-
cupation de Jeanron — et d'établir, par consé-
quent, une séparation très nette dans ce monde
immense et divers de l'estampe entre la gravure
d'art proprement dite et les autres documents de
toute nature qui ont recours à ces procédés. Il
fallait ensuite opérer avec ordre, progressive-
ment, en commençant, par exemple, par l'es-
tampe originale qui pouvait plus légitimement
réclamer sa place au Luxembourg, pour finir
ensuite, une fois cette première catégorie con-
stituée, par le recrutement des plus belles gra-
vures de reproduction.
Il ne restait plus qu'à renoncer au système des
Expositions permanentes de toutes les pièces et
à se contenter de les recueillir dans des porte-
feuilles qu'on pût facilement consulter, en atten-
dant le jour où il serait permis de les présenter
au public au moyen de petites expositions tem-
poraires, méthodiques et limitées, offrant pour
les visiteurs moins de fatigue et d'ennui et aussi
un enseignement plus précis avec un intérêt
toujours renouvelé.
C'est ce que pratiquent la plupart des grands
établissements étrangers. C'est le système
adopté actuellement par le Luxembourg où, dé-
sormais, des expositions périodiques, formées
exceptionnellement par dérogation aux principes
habituels des Musées, non seulement avec le
fonds, très insuffisant encore, des collections,
mais avec des prêts d'amateurs ou d'artistes,
donneront successivement un choix des œuvres
des plus célèbres graveurs contemporains,
aquafortistes ou burinistes, graveurs sur bois ou
lithographes, présentés soit isolément, soit
dans des petits groupements logiques. Ces expo-
sitions seront généralement trimestrielles ; elles
pourront parfois cependant être prolongées, en
raison de leur intérêt, de même que certaines
(1) Cette petite collection est installée dans un cabinet de l'en-
tresol; on peut la consulter le lundi, sur autorisation. L'étroitesse
de ce local, tout à fait insuffisant, n'a pas permis de l'ouvrir plus
largement au public.
autres, destinées à faire connaître momentané-
ment l'état de progrès d'une des branches de
ces arts, pourront être réduites, en raison de leur
actualité, à une durée beaucoup moindre.
Nous avons l'espoir que l'art de la gravure, si
menacé aujourd'hui par le développement inces-
sant des procédés mécaniques, et qui avait droit
plus que tout autre à la sollicitude de l'Etat,
trouvera dans cet effort de l'Administration et
dans l'intérêt que lui témoignera le public nom-
breux du Luxembourg un encouragement pré-
cieux et un actif stimulant. Pour nous, nous
aurons eu, du moins, la satisfaction d'avoir tenté
de faire connaître et aimer ces arts comme ils le
méritent et d'avoir contribué, grâce aux marques
généreuses de sympathie qui se sont déjà mani-
festées au début de cette nouvelle organisation,
à l'enrichissement du Musée en même temps
qu'à la consécration du talent de nos maîtres et
à l'enseignement du public.
Léonce Benedite.
Échos
Prix décernés par l'Académie des
Beaux-Arts. — A la suite des Salons de 1897,
l'Académie des Beaux-Arts a décerné les prix
suivants :
Prix Brizard (marine) de 1897 (3,000 francs), à
M. Rudaux, pour ses deux tableaux : 1° « Arri-
vée de S. M. l'empereur de Russie à Paris » ;
2° « En escadre ».
Prix Brizard (marine), prorogé de 1896 à 1897
(3,000 francs), à M. Many Benner, pour son ta-
bleau : « Souvenir de Bretagne ».
Prix Maxime David (miniature), de la valeur
de 400 francs, à Mllc Marie-Louise Richard, pour
sa miniature : « Portrait ».
Prix Desprez (sculpture), de la valeur de 1,000
francs, à M. A. Forestier, pour son groupe :
« l'Ouragan et la Feuille ».
-O-
La nouvelle salle des moulages anti-
ques au Louvre. — On va ouvrir au rez-de-
chaussée du musée du Louvre une nouvelle
salle réservée aux moulages des chefs-d'œuvre
antiques dont nous ne possédons pas les origi-
naux et qui sont épars dans les principaux mu-
sées étrangers.
Située entre le vestibule du pavillon Denon, où
se trouve l'entrée principale du Louvre, et la
porte Jean-Goujon qui donne sur le quai, cette
salle, l'ancien manège du prince impérial, est
éclairée par quatorze hautes et larges baies
ouvertes sur deux vastes cours intérieures du
palais; les voûtes en sont supportées par des
colonnes aux chapiteaux sculptés par Fremiet et
représentant des attributs de chasse.
Le sol du manège, qui était en mauvais état, a
été recouvert de mosaïque, et de place en place
des piédestaux, des socles, des plates-formes y
ont été posés pour recevoir les groupes, les
statues, les bas-reliefs que l'on peut admirer
aujourd'hui.
Une série de moulages exposés est particu-
lièrement attachante, celle des types de notre
Vénus de Milo, où l'on retrouve des caractères
essentiels de l'admirable chef-d'œuvre : la jambe
relevée retenant la draperie, le pied élevé sur
un attribut, le baut du torse tourné à gauche. Ce
sont la Vénus de Madrid, celle du jardin délia
Pigna du Vatican, celle de Florence, celle de
Capoue et quelques-uns de ses dérivés directs,
la Victoire de Brescia, la Vénus du jardin Bo-
boli, etc.
On s'arrête aussi devant d'excellents mou-
lages retrouvés par Ravaisson, de l'Institut,
père du conservateur actuel, et qui avaient été
exécutés sous le règne de Louis XVIII, mou-
lages reproduisant les plus remarquables mar-
bres grecs que nous possédions sous l'empire
et que les alliés nous prirent en 1814 et 1815.
M. Charles Ravaisson-Mollien a aussi réuni
dans la nouvelle salle la série des pièces rappor-
tées des fouilles de Délos par M. Homolle : le
Xoanon, plusieurs divinités de l'archaïsme
grec, etc.
Le visiteur verra encore dans la salle du Ma-
nège, avec une série de bustes de tous les mu-
sées étrangers, le Mars de Dresde, expliquant
VAchille de Borghèse, la Victoire de Pœonios, le
Narcisse de Naples, un Enfant au masque, la
Cérès, un superbe bas-relief représentant la
Visite de Bacchus à Scarios, le vase de Pise, un
candélabre sculpté du Vatican, cent autres mer-
veilles, et enfin les bas-reliefs du monument des
Harpies, trouvés à Xanthos, la frise du monu-
ment des Néréides, dont l'original est au British
Muséum.
La nouvelle salle des moulages est ainsi une
sorte de préface du musée des antiques prépa-
rant l'intelligence d'ensemble des époques, des
styles, des sujets, préface d'ailleurs pleine d'at-
trait : M. Charles R avaisson-Mollien, en l'ou-
vrant, aura fait beaucoup pour l'éducation artis-
tique du public.
-O-
Vente du baron Lepic. — On vient de
vendre, à la galerie Petit, la collection de ta-
bleaux, meubles et objets d'art appartenant au
baron Lepic. Nous donnons, à titre de docu-
ment, quelques-unes des principales enchères :
Trois meubles de l'époque Louis XV signés
B. V. R.B. ; un entre-deux et deux encoignures,
en bois' d'ébène, avec panneaux en laque à
figures chinoises et paysages en relief dorés sur
fond noir, 113,000 francs ;
Petite table de milieu de l'époque Louis XV
en bois noir enrichi de panneaux de laque noir
et or, et garnie de bronzes ciselés et dorés,
43,000 francs ;
Grande commode chantournée et laquée, de
l'époque Louis XV, signée Macret, à décor de
figures chinoises, 20,000 francs ;
Petile commode entre-deux, de l'époque
Louis XV, en bois rose, décorée de bouquets de
fleurs en marqueterie de bois clair, gravé, 10,100
francs;
Bureau à cylindre, tablette rentrante, en bois
rose et marqueterie de bois clair, époque
Louis XV, du maître ébéniste P. Pionniez, 7,500
francs ;
Table rectangulaire, en noyer sculpté, de la fin
du seizième siècle, richement ornementée, 6,000
francs;
Deux tableaux de Chardin : le Garde-manger
et Y Office, 4,000 et 4,500 francs;
Un tableau de Desportes : Objets divers grou-
pés sur un balcon, 3,900francs;
Le Portrait du duc de Vendôme, par Largil-
lière, 4,000 francs;
Deux tableaux d'Oudry : Fruits et Gibier et
une Cour, 7,300 et 5,250 francs.
-O-
Le Coq (d'après une estampe de Bracquemond).