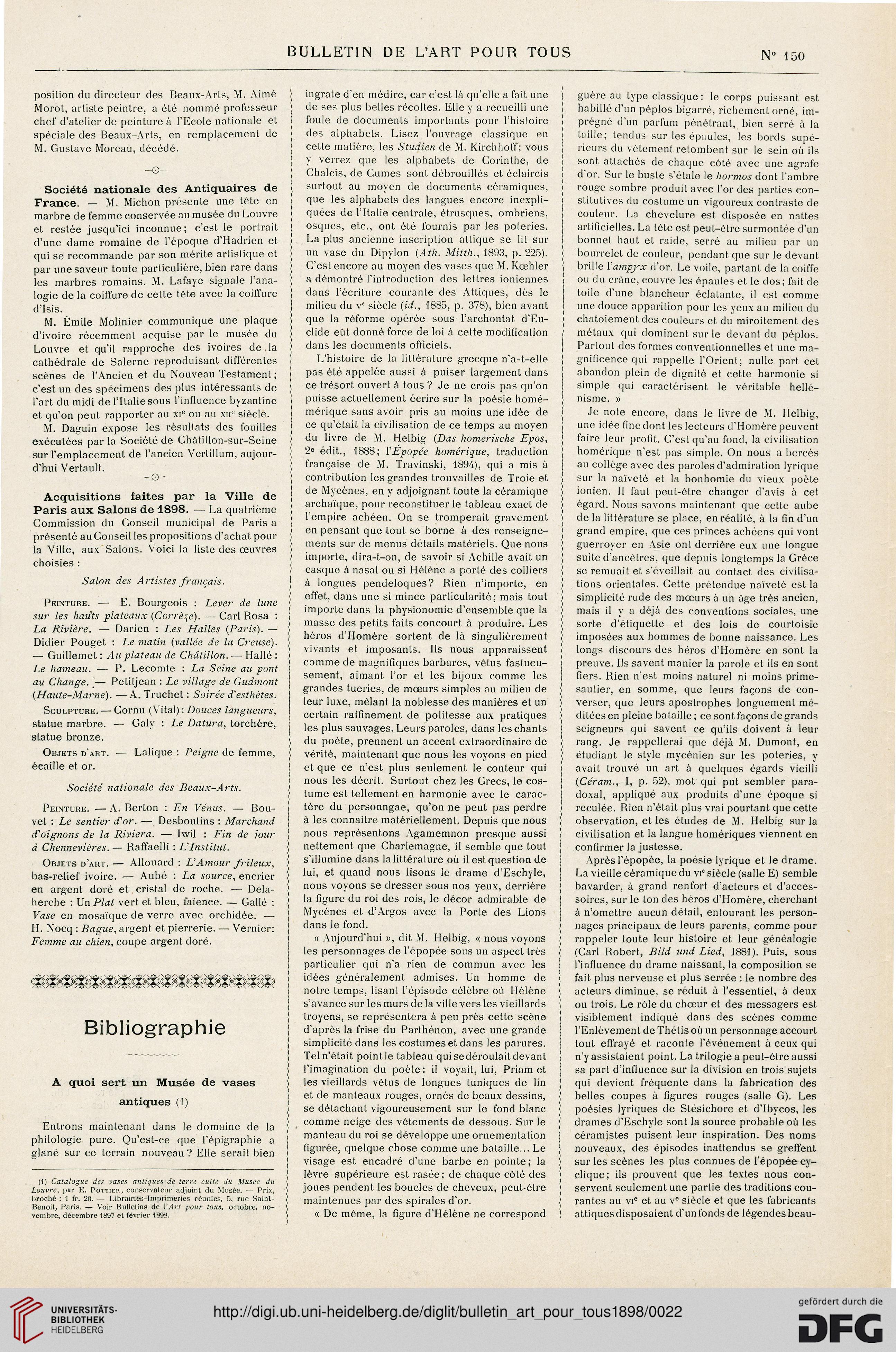BULLETIN DE L'ART POUR TOUS
N° 150
position du directeur des Beaux-Arls, M. Aimé
Morot, artiste peintre, a été nommé professeur
chef d'atelier de peinture à l'Ecole nationale et
spéciale des Beaux-Arts, en remplacement de
M. Gustave Moreau, décédé.
-©-
Société nationale des Antiquaires de
France. — M. Michon présente une téle en
marbre de femme conservée au musée du Louvre
et restée jusqu'ici inconnue; c'est le portrait
d'une dame romaine de l'époque d'Hadrien et
qui se recommande par son mérite artistique et
par une saveur toute particulière, bien rare dans
les marbres romains. M. Lafaye signale l'ana-
logie de la coiffure de cette tête avec la coiffure
d'Isis.
M. Èmile Molinier communique une plaque
d'ivoire récemment acquise par le musée du
Louvre et qu'il rapproche des ivoires de.la
cathédrale de Salerne reproduisant différentes
scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament ;
c'est un des spécimens des plus intéressants de
l'art du midi de l'Italie sous l'influence byzantine
et qu'on peut rapporter au xie ou au xn° siècle.
M. Daguin expose les résullats des fouilles
exécutées parla Société de Chatillon-sur-Seine
sur l'emplacement de l'ancien Verlillum, aujour-
d'hui Vertault.
-O -
Acquisitions faites par la Ville de
Paris aux Salons de 4898. — La quatrième
Commission du Conseil municipal de Paris a
présenté au Conseil les propositions d'achat pour
la Ville, aux Salons. Voici la liste des œuvres
choisies :
Salon des Artistes français.
Peinture. — E. Bourgeois : Lever de lune
sur les haiits plateaux (Corrè^e). — Cari Bosa :
La Rivière. — Darien : Les Halles (Paris). —
Didier Pouget : Le matin (vallée de la Creuse).
— Guillemet : Au plateau de Châtillon. — Ilallé :
Le hameau. — P. Lecomte : La Seine au pont
au Change. '— Petiljean : Le village de Gudmont
(Haute-Marne). —A.Truchet: Soirée d'esthètes.
Sculpture. — Cornu (Vital) : Douces langueurs,
statue marbre. — Galy : Le Datura, torchère,
statue bronze.
Objets d'art. — Lalique : Peigne de femme,
écaille et or.
Société nationale des Beaux-Arts.
Peinture. — A. Berton : En Vénus. — Bou-
vet : Le sentier d'or. — Desboulins : Marchand
d'oignons de la Riviera. — Ivvil : Fin de iour
à Chennevières. — Baffaelli : LInstitut.
Objets d'art. — Allouard : L'Amour frileux,
bas-relief ivoire. — Aubé : La source, encrier \
en argent doré et. cristal de roche. — Delà- -
herche : Un Plat vert et bleu, faïence. — Gallé :
Vase en mosaïque de verre avec orchidée. —
II. Nocq : Bague, argent et pierrerie. — Vernicr:
Femme au chien, coupe argent doré.
Bibliographie
A quoi sert un Musée de vases
antiques (1)
Entrons maintenant dans le domaine de la
philologie pure. Qu'est-ce que l'épigraphie a
glané sur ce terrain nouveau? Elle serait bien
(1) Catalogue des vases antiques de terre cuite du Musée du
Louvre, par E. Potheii, conservateur adjoint du Musée. — Prix,
broche : 1 fr. 20. — Librairies-Imprimeries réunies, 5, rue Sainl-
Bcnoit, Paris. — Voir Bulletins de Y Art pour tous, octobre, no-
vembre, décembre 1807 et février 1898.
ingrate d'en médire, car c'est là qu'elle a fait une
de ses plus belles récolles. Elle y a recueilli une
foule de documents importants pour l'hisloire
des alphabets. Lisez l'ouvrage classique en
cette matière, les Studien de M. Kirchhoff; vous
y verrez que les alphabets de Corinthe, de
Chalcis, de Cumes sont débrouillés et éclaircis
surtout au moyen de documents céramiques,
que les alphabets des langues encore inexpli-
quées de l'Italie centrale, étrusques, ombriens,
osques, etc., ont élé fournis par les poleries.
La plus ancienne inscription altique se lit sur
un vase du Dipylon (Ath. Mitth., 1893, p. 225).
C'est encore au moyen des vases que M. Kœhler
a démontré l'introduction des lettres ioniennes
dans l'écriture courante des Attiques, dès le
milieu du v" siècle (id., 1885, p. 378), bien avant
que la réforme opérée sous l'archontat d'Eu-
clide eût donné force de loi à cette modification
dans les documents officiels.
L'histoire de la littérature grecque n'a-t-ellc
pas été appelée aussi à puiser largement dans
ce trésort ouvert à tous ? Je ne crois pas qu'on
puisse actuellement écrire sur la poésie homé-
mérique sans avoir pris au moins une idée de
ce qu'était la civilisation de ce temps au moyen
du livre de M. Helbig (Das homerische Epos,
2e édit., 1888; l'Epopée homérique, traduction
française de M. Travinski, 1894), qui a mis à
contribution les grandes trouvailles de Troie et
de Mycènes, en y adjoignant toute la céramique
archaïque, pour reconstituer le tableau exact de
l'empire achéen. On se tromperait gravement
en pensant que tout se borne à des renseigne-
ments sur de menus détails matériels. Que nous
importe, dira-t-on, de savoir si Achille avait un
casque à nasal ou si Hélène a porté des colliers
à longues pendeloques? Bien n'importe, en
effet, dans une si mince particularité; mais tout
importe dans la physionomie d'ensemble que la
masse des petits faits concourt à produire. Les
héros d'Homère sortent de là singulièrement
vivants et imposants. Ils nous apparaissent
comme de magnifiques barbares, vêlus faslueu-
sement, aimant l'or et les bijoux comme les
grandes tueries, de mœurs simples au milieu de
leur luxe, mêlant la noblesse des manières et un
certain raffinement de politesse aux pratiques
les plus sauvages. Leurs paroles, dans les chants
du poète, prennent un accent extraordinaire de
vérité, maintenant que nous les voyons en pied
et que ce n'est plus seulement le conteur qui
nous les décrit. Surtout chez les Grecs, le cos-
tume est tellement en harmonie avec le carac-
tère du personngae, qu'on ne peut pas perdre
à les connaître matériellement. Depuis que nous
nous représentons Agamemnon presque aussi
nettement que Charlemagne, il semble que tout
s'illumine dans la littérature où il est question de
lui, et quand nous lisons le drame d'Eschyle,
nous voyons se dresser sous nos yeux, derrière
la figure du roi des rois, le décor admirable de
Mycènes et d'Argos avec la Porte des Lions
dans le fond.
« Aujourd'hui », dit M. Helbig, « nous voyons
les personnages de l'épopée sous un aspect très
particulier qui n'a rien de commun avec les
idées généralement admises. Un homme de
notre temps, lisant l'épisode célèbre où Hélène
s'avance sur les murs de la ville vers les vieillards
troyens, se représentera à peu près cette scène
d'après la frise du Parlhénon, avec une grande
simplicité dans les costumes et dans les parures.
Teln'était pointle tableau quisedéroulaitdevant
l'imagination du poète: il voyait, lui, Priam et
les vieillards vêtus de longues tuniques de lin
et de manteaux rouges, ornés de beaux dessins,
se détachant vigoureusement sur le fond blanc
comme neige des vêtements de dessous. Sur le
manteau du roi se développe une ornementation
figurée, quelque chose comme une bataille... Le
visage est encadré d'une barbe en pointe; la
lèvre supérieure est rasée; de chaque côté des
joues pendent les boucles de cheveux, peut-être
maintenues par des spirales d'or.
« De même, la figure d'Hélène ne correspond
guère au type classique : le corps puissant est
habillé d'un péplos bigarré, richement orné, im-
prégné d'un parfum pénétrant, bien serré à la
taille; tendus sur les épaules, les bords supé-
rieurs du vêtemenl retombent sur le sein où ils
sont attachés de chaque côté avec une agrafe
d'or. Sur le buste s'étale le hormos dont l'ambre
rouge sombre produit avec l'or des parties con-
stitutives du costume un vigoureux contraste de
couleur. La chevelure est disposée en nattes
artificielles. La tête est peut-être surmontée d'un
bonnet haut et raide, serré au milieu par un
bourrelet de couleur, pendant que sur le devant
brille Xampyx d'or. Le voile, partant de la coiffe
ou du crâne, couvre les épaules et le dos; fait de
toile d'une blancheur éclatante, il est comme
une douce apparition pour les yeux au milieu du
chatoiement des couleurs et du miroitement des
métaux qui dominent sur le devant du péplos.
Partout des formes conventionnelles et une ma-
gnificence qui rappelle l'Orient; nulle part cet
abandon plein de dignité et cette harmonie si
; simple qui caractérisent le véritable hellé-
nisme. »
Je note encore, dans le livre de M. Helbig,
une idée fine dont les lecteurs d'Homère peuvent
faire leur profit. C'est qu'au fond, la civilisation
homérique n'est pas simple. On nous a bercés
au collège avec des paroles d'admiration lyrique
sur la naïveté et la bonhomie du vieux poète
ionien. Il faut peut-être changer d'avis à cet
égard. Nous savons maintenant que cette aube
de la littérature se place, en réalité, à la fin d'un
grand empire, que ces princes achéens qui vont
guerroyer en Asie ont derrière eux une longue
suite d'ancêtres, que depuis longtemps la Grèce
se remuait et s'éveillait au contact des civilisa-
tions orientales. Cette prétendue naïveté est la
simplicité rude des mœurs à un âge très ancien,
\ mais il y a déjà des conventions sociales, une
sorte d'étiquette et des lois de courtoisie
imposées aux hommes de bonne naissance. Les
' longs discours des héros d'Homère en sont la
preuve. Ils savent manier la parole et ils en sont
; fiers. Bien n'est moins naturel ni moins prime-
sauLier, en somme, que leurs façons de con-
verser, que leurs apostrophes longuement mé-
ditées en pleine bataille; ce sont façons de grands
seigneurs qui savent ce qu'ils doivent à leur
rang. Je rappellerai que déjà M. Dumont, en
étudiant le style mycénien sur les poteries, y
avait trouvé un art à quelques égards vieilli
(Céram., I, p. 52), mot qui put sembler para-
doxal, appliqué aux produits d'une époque si
; reculée. Bien n'était plus vrai pourtant que cette
observation, et les études de M. Helbig sur la
civilisation et la langue homériques viennent en
i; confirmer la justesse.
Après l'épopée, la poésie lyrique et le drame.
La vieille céramique du vi° siècle (salle E) semble
bavarder, à grand renfort d'acteurs et d'acces-
soires, sur le ton des héros d'Homère, cherchant
à n'omettre aucun détail, entourant les person-
! nages principaux de leurs parents, comme pour
rappeler toute leur histoire et leur généalogie
j (Cari Robert, Bild und Lied, 1881). Puis, sous
| l'influence du drame naissant, la composition se
j fait plus nerveuse et plus serrée : le nombre des
acteurs diminue, se réduit à l'essentiel, à deux
ou trois. Le rôle du chœur et des messagers est
; visiblement indiqué dans des scènes comme
l'Enlèvement de Thétis où un personnage accourt
tout effrayé et raconte l'événement à ceux qui
n'y assistaient point. La trilogie a peut-être aussi
sa part d'influence sur la division en trois sujets
qui devient fréquente dans la fabrication des
belles coupes à figures rouges (salle G). Les
poésies lyriques de Stésichore et d'Ibycos, les
drames d'Eschyle sont la source probable où les
céramistes puisent leur inspiration. Des noms
nouveaux, des épisodes inattendus se greffent
sur les scènes les plus connues de l'épopée cy-
clique; ils prouvent que les textes nous con-
servent seulement une partie des traditions cou-
rantes au vie et au ve siècle et que les fabricants
attiques disposaient d'un fonds de légendes beau-
N° 150
position du directeur des Beaux-Arls, M. Aimé
Morot, artiste peintre, a été nommé professeur
chef d'atelier de peinture à l'Ecole nationale et
spéciale des Beaux-Arts, en remplacement de
M. Gustave Moreau, décédé.
-©-
Société nationale des Antiquaires de
France. — M. Michon présente une téle en
marbre de femme conservée au musée du Louvre
et restée jusqu'ici inconnue; c'est le portrait
d'une dame romaine de l'époque d'Hadrien et
qui se recommande par son mérite artistique et
par une saveur toute particulière, bien rare dans
les marbres romains. M. Lafaye signale l'ana-
logie de la coiffure de cette tête avec la coiffure
d'Isis.
M. Èmile Molinier communique une plaque
d'ivoire récemment acquise par le musée du
Louvre et qu'il rapproche des ivoires de.la
cathédrale de Salerne reproduisant différentes
scènes de l'Ancien et du Nouveau Testament ;
c'est un des spécimens des plus intéressants de
l'art du midi de l'Italie sous l'influence byzantine
et qu'on peut rapporter au xie ou au xn° siècle.
M. Daguin expose les résullats des fouilles
exécutées parla Société de Chatillon-sur-Seine
sur l'emplacement de l'ancien Verlillum, aujour-
d'hui Vertault.
-O -
Acquisitions faites par la Ville de
Paris aux Salons de 4898. — La quatrième
Commission du Conseil municipal de Paris a
présenté au Conseil les propositions d'achat pour
la Ville, aux Salons. Voici la liste des œuvres
choisies :
Salon des Artistes français.
Peinture. — E. Bourgeois : Lever de lune
sur les haiits plateaux (Corrè^e). — Cari Bosa :
La Rivière. — Darien : Les Halles (Paris). —
Didier Pouget : Le matin (vallée de la Creuse).
— Guillemet : Au plateau de Châtillon. — Ilallé :
Le hameau. — P. Lecomte : La Seine au pont
au Change. '— Petiljean : Le village de Gudmont
(Haute-Marne). —A.Truchet: Soirée d'esthètes.
Sculpture. — Cornu (Vital) : Douces langueurs,
statue marbre. — Galy : Le Datura, torchère,
statue bronze.
Objets d'art. — Lalique : Peigne de femme,
écaille et or.
Société nationale des Beaux-Arts.
Peinture. — A. Berton : En Vénus. — Bou-
vet : Le sentier d'or. — Desboulins : Marchand
d'oignons de la Riviera. — Ivvil : Fin de iour
à Chennevières. — Baffaelli : LInstitut.
Objets d'art. — Allouard : L'Amour frileux,
bas-relief ivoire. — Aubé : La source, encrier \
en argent doré et. cristal de roche. — Delà- -
herche : Un Plat vert et bleu, faïence. — Gallé :
Vase en mosaïque de verre avec orchidée. —
II. Nocq : Bague, argent et pierrerie. — Vernicr:
Femme au chien, coupe argent doré.
Bibliographie
A quoi sert un Musée de vases
antiques (1)
Entrons maintenant dans le domaine de la
philologie pure. Qu'est-ce que l'épigraphie a
glané sur ce terrain nouveau? Elle serait bien
(1) Catalogue des vases antiques de terre cuite du Musée du
Louvre, par E. Potheii, conservateur adjoint du Musée. — Prix,
broche : 1 fr. 20. — Librairies-Imprimeries réunies, 5, rue Sainl-
Bcnoit, Paris. — Voir Bulletins de Y Art pour tous, octobre, no-
vembre, décembre 1807 et février 1898.
ingrate d'en médire, car c'est là qu'elle a fait une
de ses plus belles récolles. Elle y a recueilli une
foule de documents importants pour l'hisloire
des alphabets. Lisez l'ouvrage classique en
cette matière, les Studien de M. Kirchhoff; vous
y verrez que les alphabets de Corinthe, de
Chalcis, de Cumes sont débrouillés et éclaircis
surtout au moyen de documents céramiques,
que les alphabets des langues encore inexpli-
quées de l'Italie centrale, étrusques, ombriens,
osques, etc., ont élé fournis par les poleries.
La plus ancienne inscription altique se lit sur
un vase du Dipylon (Ath. Mitth., 1893, p. 225).
C'est encore au moyen des vases que M. Kœhler
a démontré l'introduction des lettres ioniennes
dans l'écriture courante des Attiques, dès le
milieu du v" siècle (id., 1885, p. 378), bien avant
que la réforme opérée sous l'archontat d'Eu-
clide eût donné force de loi à cette modification
dans les documents officiels.
L'histoire de la littérature grecque n'a-t-ellc
pas été appelée aussi à puiser largement dans
ce trésort ouvert à tous ? Je ne crois pas qu'on
puisse actuellement écrire sur la poésie homé-
mérique sans avoir pris au moins une idée de
ce qu'était la civilisation de ce temps au moyen
du livre de M. Helbig (Das homerische Epos,
2e édit., 1888; l'Epopée homérique, traduction
française de M. Travinski, 1894), qui a mis à
contribution les grandes trouvailles de Troie et
de Mycènes, en y adjoignant toute la céramique
archaïque, pour reconstituer le tableau exact de
l'empire achéen. On se tromperait gravement
en pensant que tout se borne à des renseigne-
ments sur de menus détails matériels. Que nous
importe, dira-t-on, de savoir si Achille avait un
casque à nasal ou si Hélène a porté des colliers
à longues pendeloques? Bien n'importe, en
effet, dans une si mince particularité; mais tout
importe dans la physionomie d'ensemble que la
masse des petits faits concourt à produire. Les
héros d'Homère sortent de là singulièrement
vivants et imposants. Ils nous apparaissent
comme de magnifiques barbares, vêlus faslueu-
sement, aimant l'or et les bijoux comme les
grandes tueries, de mœurs simples au milieu de
leur luxe, mêlant la noblesse des manières et un
certain raffinement de politesse aux pratiques
les plus sauvages. Leurs paroles, dans les chants
du poète, prennent un accent extraordinaire de
vérité, maintenant que nous les voyons en pied
et que ce n'est plus seulement le conteur qui
nous les décrit. Surtout chez les Grecs, le cos-
tume est tellement en harmonie avec le carac-
tère du personngae, qu'on ne peut pas perdre
à les connaître matériellement. Depuis que nous
nous représentons Agamemnon presque aussi
nettement que Charlemagne, il semble que tout
s'illumine dans la littérature où il est question de
lui, et quand nous lisons le drame d'Eschyle,
nous voyons se dresser sous nos yeux, derrière
la figure du roi des rois, le décor admirable de
Mycènes et d'Argos avec la Porte des Lions
dans le fond.
« Aujourd'hui », dit M. Helbig, « nous voyons
les personnages de l'épopée sous un aspect très
particulier qui n'a rien de commun avec les
idées généralement admises. Un homme de
notre temps, lisant l'épisode célèbre où Hélène
s'avance sur les murs de la ville vers les vieillards
troyens, se représentera à peu près cette scène
d'après la frise du Parlhénon, avec une grande
simplicité dans les costumes et dans les parures.
Teln'était pointle tableau quisedéroulaitdevant
l'imagination du poète: il voyait, lui, Priam et
les vieillards vêtus de longues tuniques de lin
et de manteaux rouges, ornés de beaux dessins,
se détachant vigoureusement sur le fond blanc
comme neige des vêtements de dessous. Sur le
manteau du roi se développe une ornementation
figurée, quelque chose comme une bataille... Le
visage est encadré d'une barbe en pointe; la
lèvre supérieure est rasée; de chaque côté des
joues pendent les boucles de cheveux, peut-être
maintenues par des spirales d'or.
« De même, la figure d'Hélène ne correspond
guère au type classique : le corps puissant est
habillé d'un péplos bigarré, richement orné, im-
prégné d'un parfum pénétrant, bien serré à la
taille; tendus sur les épaules, les bords supé-
rieurs du vêtemenl retombent sur le sein où ils
sont attachés de chaque côté avec une agrafe
d'or. Sur le buste s'étale le hormos dont l'ambre
rouge sombre produit avec l'or des parties con-
stitutives du costume un vigoureux contraste de
couleur. La chevelure est disposée en nattes
artificielles. La tête est peut-être surmontée d'un
bonnet haut et raide, serré au milieu par un
bourrelet de couleur, pendant que sur le devant
brille Xampyx d'or. Le voile, partant de la coiffe
ou du crâne, couvre les épaules et le dos; fait de
toile d'une blancheur éclatante, il est comme
une douce apparition pour les yeux au milieu du
chatoiement des couleurs et du miroitement des
métaux qui dominent sur le devant du péplos.
Partout des formes conventionnelles et une ma-
gnificence qui rappelle l'Orient; nulle part cet
abandon plein de dignité et cette harmonie si
; simple qui caractérisent le véritable hellé-
nisme. »
Je note encore, dans le livre de M. Helbig,
une idée fine dont les lecteurs d'Homère peuvent
faire leur profit. C'est qu'au fond, la civilisation
homérique n'est pas simple. On nous a bercés
au collège avec des paroles d'admiration lyrique
sur la naïveté et la bonhomie du vieux poète
ionien. Il faut peut-être changer d'avis à cet
égard. Nous savons maintenant que cette aube
de la littérature se place, en réalité, à la fin d'un
grand empire, que ces princes achéens qui vont
guerroyer en Asie ont derrière eux une longue
suite d'ancêtres, que depuis longtemps la Grèce
se remuait et s'éveillait au contact des civilisa-
tions orientales. Cette prétendue naïveté est la
simplicité rude des mœurs à un âge très ancien,
\ mais il y a déjà des conventions sociales, une
sorte d'étiquette et des lois de courtoisie
imposées aux hommes de bonne naissance. Les
' longs discours des héros d'Homère en sont la
preuve. Ils savent manier la parole et ils en sont
; fiers. Bien n'est moins naturel ni moins prime-
sauLier, en somme, que leurs façons de con-
verser, que leurs apostrophes longuement mé-
ditées en pleine bataille; ce sont façons de grands
seigneurs qui savent ce qu'ils doivent à leur
rang. Je rappellerai que déjà M. Dumont, en
étudiant le style mycénien sur les poteries, y
avait trouvé un art à quelques égards vieilli
(Céram., I, p. 52), mot qui put sembler para-
doxal, appliqué aux produits d'une époque si
; reculée. Bien n'était plus vrai pourtant que cette
observation, et les études de M. Helbig sur la
civilisation et la langue homériques viennent en
i; confirmer la justesse.
Après l'épopée, la poésie lyrique et le drame.
La vieille céramique du vi° siècle (salle E) semble
bavarder, à grand renfort d'acteurs et d'acces-
soires, sur le ton des héros d'Homère, cherchant
à n'omettre aucun détail, entourant les person-
! nages principaux de leurs parents, comme pour
rappeler toute leur histoire et leur généalogie
j (Cari Robert, Bild und Lied, 1881). Puis, sous
| l'influence du drame naissant, la composition se
j fait plus nerveuse et plus serrée : le nombre des
acteurs diminue, se réduit à l'essentiel, à deux
ou trois. Le rôle du chœur et des messagers est
; visiblement indiqué dans des scènes comme
l'Enlèvement de Thétis où un personnage accourt
tout effrayé et raconte l'événement à ceux qui
n'y assistaient point. La trilogie a peut-être aussi
sa part d'influence sur la division en trois sujets
qui devient fréquente dans la fabrication des
belles coupes à figures rouges (salle G). Les
poésies lyriques de Stésichore et d'Ibycos, les
drames d'Eschyle sont la source probable où les
céramistes puisent leur inspiration. Des noms
nouveaux, des épisodes inattendus se greffent
sur les scènes les plus connues de l'épopée cy-
clique; ils prouvent que les textes nous con-
servent seulement une partie des traditions cou-
rantes au vie et au ve siècle et que les fabricants
attiques disposaient d'un fonds de légendes beau-