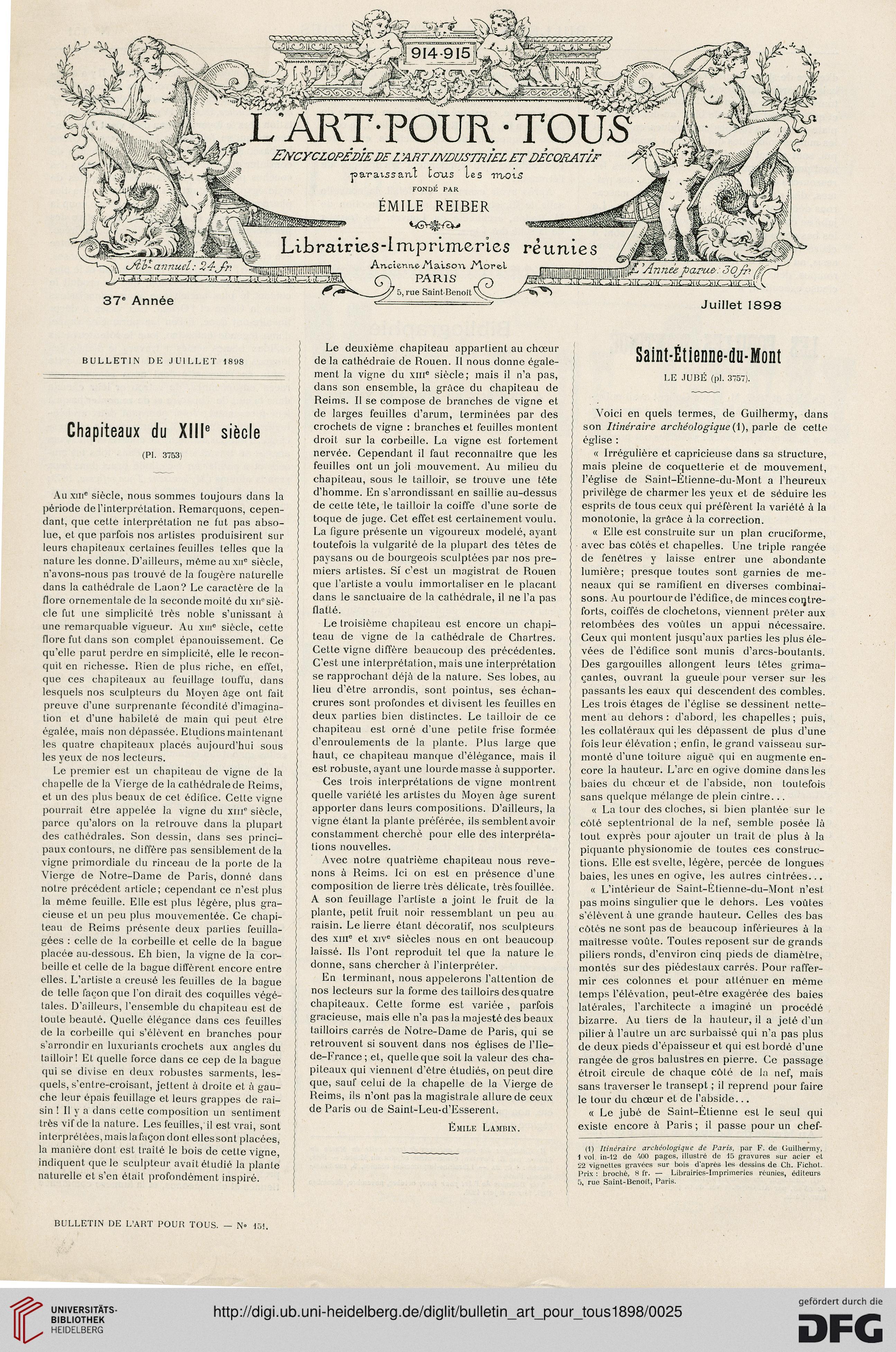4. JF
L"ART-POUR - TOUS
SNCyCLOPEDIE EF L "ARTINDUSTRIEL ET DECORA TIF
par atssav
FONDÉ PAR
ÉMILE REIBER
Litrairics-lmprimerics réunies
^annuel 24 Jr. ^^j^MpL ^i.nao^aUou nor.L J^^p^ 'Annéeparu,: oOjh
1 5, rue Saint Benoîtv
37e Année ^ —^ Juillet 1898
BULLETIN DE JUILLET 18US
Chapiteaux du XIIIe siècle
(Pl. 3753)
Au xme siècle, nous sommes toujours dans la
période de l'interprétation. Remarquons, cepen-
dant, que cette interprétation ne fut pas abso-
lue, et que parfois nos artistes produisirent sur
leurs chapiteaux certaines feuilles telles que la
nature les donne. D'ailleurs, môme au xne siècle,
n'avons-nous pas trouvé de la fougère naturelle
dans la cathédrale de Laon? Le caractère de la j
flore ornementale de la seconde moilé du xn°siè-
cle fut une simplicité très noble s'unissant à
une remarquable vigueur. Au xme siècle, cette
flore fut dans son complet épanouissement. Ce
qu'elle parut perdre en simplicité, elle le recon-
quit en richesse. Rien de plus riche, en effet,
que ces chapiteaux au feuillage touffu, dans
lesquels nos sculpteurs du Moyen âge ont fait
preuve d'une surprenante fécondité d'imagina-
tion et d'une habileté de main qui peut être
égalée, mais non dépassée. Eludions maintenant
les quatre chapiteaux placés aujourd'hui sous
les yeux de nos lecteurs.
Le premier est un chapiteau de vigne de la
chapelle de la Vierge de la cathédrale de Reims,
et un des plus beaux de cet édifice. Cette vigne
pourrait être appelée la vigne du xme siècle,
parce qu'alors on la retrouve dans la plupart
des cathédrales. Son dessin, dans ses princi-
paux contours, ne diffère pas sensiblement de la
vigne primordiale du rinceau de la porte de la
Vierge de Notre-Dame de Paris, donné dans
notre précédent article; cependant ce n'est plus
la même feuille. Elle est plus légère, plus gra-
cieuse et un peu plus mouvementée. Ce chapi-
teau de Reims présente deux parties feuilla-
gées : celle de la corbeille et celle de la bague
placée au-dessous. Eh bien, la vigne de la cor-
beille et celle de la bague diffèrent encore entre j
elles. L'artiste a creusé les feuilles de la bague j
de telle façon que l'on dirait des coquilles végé-
tales. D'ailleurs, l'ensemble du chapiteau est de
toute beauté. Quelle élégance dans ces feuilles
de la corbeille qui s'élèvent en branches pour
s'arrondir en luxuriants crochets aux angles du
tailloir! Et quelle force dans ce cep de la bague
qui se divise en deux robustes sarments, les-
quels, s'entre-croisant, jettent à droite et à gau-
che leur épais feuillage et leurs grappes de rai-
sin ! Il y a dans celte composition un sentiment
très vif de la nature. Les feuilles, il est vrai, sont
interprétées, mais la façon dont elles sont placées,
la manière dont est traité le bois de celle vigne,
indiquent que le sculpteur avait étudié la plante
naturelle et s'en élail profondément inspiré.
Le deuxième chapiteau appartient au chœur
de la cathédraie de Rouen. Il nous donne égale-
ment la vigne du xme siècle; mais il n'a pas,
dans son ensemble, la grâce du chapiteau de
Reims. II se compose de branches de vigne et
de larges feuilles d'arum, terminées par des
crochets de vigne : branches et feuilles montent
droit sur la corbeille. La vigne est fortement
nervéc. Cependant il faut reconnaître que les
feuilles ont un joli mouvement. Au milieu du
chapiteau, sous le tailloir, se trouve une tête
d'homme. En s'arrondissanl en saillie au-dessus
de cette tête, le tailloir la coiffe d'une sorte de
toque de juge. Cet effet est certainement voulu.
La figure présente un vigoureux modelé, ayant
toutefois la vulgarité de la plupart des têtes de
paysans ou de bourgeois sculptées par nos pre-
miers arlistes. Si c'est un magistrat de Rouen
que l'artiste a voulu immortaliser en le plaçant
dans le sanctuaire de la cathédrale, il ne l'a pas
flatté.
Le troisième chapiteau est encore un chapi-
teau de vigne de la cathédrale de Chartres.
Cette vigne diffère beaucoup des précédentes.
C'est une interprétation, mais une interprétation
se rapprochant déjà de la nature. Ses lobes, au
lieu d'être arrondis, sont pointus, ses échan-
crures sont profondes et divisent les feuilles en
deux parties bien distinctes. Le tailloir de ce
chapiteau est orné d'une petite frise formée
d'enroulements de la plante. Plus large que
haut, ce chapiteau manque d'élégance, mais il
est robuste, ayant une lourde masse à supporter.
Ces trois interprétations de vigne montrent
quelle variété les arlistes du Moyen âge surent
apporter dans leurs compositions. D'ailleurs, la
vigne élant la plante préférée, ils semblent avoir
constamment cherché pour elle des interpréta-
tions nouvelles.
Avec notre quatrième chapiteau nous reve-
nons à Reims. Ici on est en présence d'une
composition de lierre très délicate, très fouillée.
A son feuillage l'artiste a joint le fruit de la
plante, petit fruit noir ressemblant un peu au
raisin. Le lierre étant décoratif, nos sculpteurs
des xme et xive siècles nous en ont beaucoup
laissé. Ils l'ont reproduit tel que la nature le
donne, sans chercher à l'interpréter.
En terminant, nous appelerons l'attention de
nos lecteurs sur la forme des tailloirs desquatre
chapiteaux. Celte forme est variée , parfois
gracieuse, mais elle n'a pas la majesté des beaux
tailloirs carrés de Notre-Dame de Paris, qui se
retrouvent si souvent dans nos églises de l'Ile-
de-France ; et, quelle que soit la valeur des cha-
piteaux qui viennent d'être éludiés, on peut dire
que, sauf celui de la chapelle de la Vierge de
Reims, ils n'ont pas la magistrale allure de ceux
de Paris ou de Saint-Leu-d'Esserent.
Emile Lambin.
Saint-Étienne-du-Mont
LE JUBÉ (pl. 3757).
Voici en quels termes, de Cuilhermy, dans
son Itinéraire archéologique(\), parle de celle
église :
« Irrégulière et capricieuse dans sa structure,
mais pleine de coquetterie et de mouvement,
l'église de Saint-Étienne-du-Mont a l'heureux
privilège de charmer les yeux et de séduire les
esprits de tous ceux qui préfèrent la variété à la
j monotonie, la grâce à la correction.
« Elle est construite sur un plan cruciforme,
avec bas côtés et chapelles. Une triple rangée
de fenêtres y laisse entrer une abondante
lumière; presque toutes sont garnies de me-
neaux qui se ramifient en diverses combinai-
sons. Au pourlourde l'édifice, de minces contre-
forts, coiffés de clochetons, viennent prêter aux
retombées des voùles un appui nécessaire.
Ceux qui montent jusqu'aux parties les plus éle-
vées de l'édifice sont munis d'arcs-boulanls.
Des gargouilles allongent leurs têtes grima-
çantes, ouvrant la gueule pour verser sur les
passants les eaux qui descendent des combles.
Les trois étages de l'église se dessinent nette-
ment au dehors: d'abord, les chapelles; puis,
les collatéraux qui les dépassent de plus d'une
fois leur élévation ; enfin, le grand vaisseau sur-
monté d'une toiture aiguë qui en augmente en-
core la hauteur. L'arc en ogive domine dans les
baies du chœur et de l'abside, non toutefois
! sans quelque mélange de plein cintre...
« La tour des cloches, si bien plantée sur le
côté septentrional de la nef, semble posée là
tout exprès pour ajouter un Irait de plus à la
piquante physionomie de toutes ces construc-
tions. Elle est svelte, légère, percée de longues
baies, les unes en ogive, les autres cintrées...
« L'intérieur de Saint-Étienne-du-Mont n'est
pas moins singulier que le dehors. Les voûtes
s'élèvent à une grande hauteur. Celles des bas
côtés ne sont pas de beaucoup inférieures à la
maîtresse voûte. Toutes reposent sur de grands
piliers ronds, d'environ cinq pieds de diamètre,
montés sur des piédestaux carrés. Pour raffer-
mir ces colonnes et pour atténuer en même
temps l'élévation, peut-être exagérée des baies
latérales, l'architecte a imaginé un procédé
bizarre. Au tiers de la hauteur, il a jeté d'un
pilier à l'autre un arc surbaissé qui n'a pas plus
de deux pieds d'épaisseur et qui est bordé d'une
rangée de gros balustres en pierre. Ce passage
étroit circule de chaque côté de la nef, mais
sans traverser le transept ; il reprend pour faire
le tour du chœur et de l'abside...
« Le jubé de Saint-Etienne est le seul qui
existe encore à Paris ; il passe pour un chef-
(1) Itinéraire archéologique de Paris, par F. de Guilhermy,
j 1 vol in-12 de 400 pages, illustre de 15 gravures sur acier et
) 22 vigncltcs gravées sur bois d'après les dessins de Ch. Fichol.
Prix : broché, H l'r. — Librairies-Imprimeries réunies, édileurs
j 5, rue Saint-Bcnoil, Paris.
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS. — N° 13!.
L"ART-POUR - TOUS
SNCyCLOPEDIE EF L "ARTINDUSTRIEL ET DECORA TIF
par atssav
FONDÉ PAR
ÉMILE REIBER
Litrairics-lmprimerics réunies
^annuel 24 Jr. ^^j^MpL ^i.nao^aUou nor.L J^^p^ 'Annéeparu,: oOjh
1 5, rue Saint Benoîtv
37e Année ^ —^ Juillet 1898
BULLETIN DE JUILLET 18US
Chapiteaux du XIIIe siècle
(Pl. 3753)
Au xme siècle, nous sommes toujours dans la
période de l'interprétation. Remarquons, cepen-
dant, que cette interprétation ne fut pas abso-
lue, et que parfois nos artistes produisirent sur
leurs chapiteaux certaines feuilles telles que la
nature les donne. D'ailleurs, môme au xne siècle,
n'avons-nous pas trouvé de la fougère naturelle
dans la cathédrale de Laon? Le caractère de la j
flore ornementale de la seconde moilé du xn°siè-
cle fut une simplicité très noble s'unissant à
une remarquable vigueur. Au xme siècle, cette
flore fut dans son complet épanouissement. Ce
qu'elle parut perdre en simplicité, elle le recon-
quit en richesse. Rien de plus riche, en effet,
que ces chapiteaux au feuillage touffu, dans
lesquels nos sculpteurs du Moyen âge ont fait
preuve d'une surprenante fécondité d'imagina-
tion et d'une habileté de main qui peut être
égalée, mais non dépassée. Eludions maintenant
les quatre chapiteaux placés aujourd'hui sous
les yeux de nos lecteurs.
Le premier est un chapiteau de vigne de la
chapelle de la Vierge de la cathédrale de Reims,
et un des plus beaux de cet édifice. Cette vigne
pourrait être appelée la vigne du xme siècle,
parce qu'alors on la retrouve dans la plupart
des cathédrales. Son dessin, dans ses princi-
paux contours, ne diffère pas sensiblement de la
vigne primordiale du rinceau de la porte de la
Vierge de Notre-Dame de Paris, donné dans
notre précédent article; cependant ce n'est plus
la même feuille. Elle est plus légère, plus gra-
cieuse et un peu plus mouvementée. Ce chapi-
teau de Reims présente deux parties feuilla-
gées : celle de la corbeille et celle de la bague
placée au-dessous. Eh bien, la vigne de la cor-
beille et celle de la bague diffèrent encore entre j
elles. L'artiste a creusé les feuilles de la bague j
de telle façon que l'on dirait des coquilles végé-
tales. D'ailleurs, l'ensemble du chapiteau est de
toute beauté. Quelle élégance dans ces feuilles
de la corbeille qui s'élèvent en branches pour
s'arrondir en luxuriants crochets aux angles du
tailloir! Et quelle force dans ce cep de la bague
qui se divise en deux robustes sarments, les-
quels, s'entre-croisant, jettent à droite et à gau-
che leur épais feuillage et leurs grappes de rai-
sin ! Il y a dans celte composition un sentiment
très vif de la nature. Les feuilles, il est vrai, sont
interprétées, mais la façon dont elles sont placées,
la manière dont est traité le bois de celle vigne,
indiquent que le sculpteur avait étudié la plante
naturelle et s'en élail profondément inspiré.
Le deuxième chapiteau appartient au chœur
de la cathédraie de Rouen. Il nous donne égale-
ment la vigne du xme siècle; mais il n'a pas,
dans son ensemble, la grâce du chapiteau de
Reims. II se compose de branches de vigne et
de larges feuilles d'arum, terminées par des
crochets de vigne : branches et feuilles montent
droit sur la corbeille. La vigne est fortement
nervéc. Cependant il faut reconnaître que les
feuilles ont un joli mouvement. Au milieu du
chapiteau, sous le tailloir, se trouve une tête
d'homme. En s'arrondissanl en saillie au-dessus
de cette tête, le tailloir la coiffe d'une sorte de
toque de juge. Cet effet est certainement voulu.
La figure présente un vigoureux modelé, ayant
toutefois la vulgarité de la plupart des têtes de
paysans ou de bourgeois sculptées par nos pre-
miers arlistes. Si c'est un magistrat de Rouen
que l'artiste a voulu immortaliser en le plaçant
dans le sanctuaire de la cathédrale, il ne l'a pas
flatté.
Le troisième chapiteau est encore un chapi-
teau de vigne de la cathédrale de Chartres.
Cette vigne diffère beaucoup des précédentes.
C'est une interprétation, mais une interprétation
se rapprochant déjà de la nature. Ses lobes, au
lieu d'être arrondis, sont pointus, ses échan-
crures sont profondes et divisent les feuilles en
deux parties bien distinctes. Le tailloir de ce
chapiteau est orné d'une petite frise formée
d'enroulements de la plante. Plus large que
haut, ce chapiteau manque d'élégance, mais il
est robuste, ayant une lourde masse à supporter.
Ces trois interprétations de vigne montrent
quelle variété les arlistes du Moyen âge surent
apporter dans leurs compositions. D'ailleurs, la
vigne élant la plante préférée, ils semblent avoir
constamment cherché pour elle des interpréta-
tions nouvelles.
Avec notre quatrième chapiteau nous reve-
nons à Reims. Ici on est en présence d'une
composition de lierre très délicate, très fouillée.
A son feuillage l'artiste a joint le fruit de la
plante, petit fruit noir ressemblant un peu au
raisin. Le lierre étant décoratif, nos sculpteurs
des xme et xive siècles nous en ont beaucoup
laissé. Ils l'ont reproduit tel que la nature le
donne, sans chercher à l'interpréter.
En terminant, nous appelerons l'attention de
nos lecteurs sur la forme des tailloirs desquatre
chapiteaux. Celte forme est variée , parfois
gracieuse, mais elle n'a pas la majesté des beaux
tailloirs carrés de Notre-Dame de Paris, qui se
retrouvent si souvent dans nos églises de l'Ile-
de-France ; et, quelle que soit la valeur des cha-
piteaux qui viennent d'être éludiés, on peut dire
que, sauf celui de la chapelle de la Vierge de
Reims, ils n'ont pas la magistrale allure de ceux
de Paris ou de Saint-Leu-d'Esserent.
Emile Lambin.
Saint-Étienne-du-Mont
LE JUBÉ (pl. 3757).
Voici en quels termes, de Cuilhermy, dans
son Itinéraire archéologique(\), parle de celle
église :
« Irrégulière et capricieuse dans sa structure,
mais pleine de coquetterie et de mouvement,
l'église de Saint-Étienne-du-Mont a l'heureux
privilège de charmer les yeux et de séduire les
esprits de tous ceux qui préfèrent la variété à la
j monotonie, la grâce à la correction.
« Elle est construite sur un plan cruciforme,
avec bas côtés et chapelles. Une triple rangée
de fenêtres y laisse entrer une abondante
lumière; presque toutes sont garnies de me-
neaux qui se ramifient en diverses combinai-
sons. Au pourlourde l'édifice, de minces contre-
forts, coiffés de clochetons, viennent prêter aux
retombées des voùles un appui nécessaire.
Ceux qui montent jusqu'aux parties les plus éle-
vées de l'édifice sont munis d'arcs-boulanls.
Des gargouilles allongent leurs têtes grima-
çantes, ouvrant la gueule pour verser sur les
passants les eaux qui descendent des combles.
Les trois étages de l'église se dessinent nette-
ment au dehors: d'abord, les chapelles; puis,
les collatéraux qui les dépassent de plus d'une
fois leur élévation ; enfin, le grand vaisseau sur-
monté d'une toiture aiguë qui en augmente en-
core la hauteur. L'arc en ogive domine dans les
baies du chœur et de l'abside, non toutefois
! sans quelque mélange de plein cintre...
« La tour des cloches, si bien plantée sur le
côté septentrional de la nef, semble posée là
tout exprès pour ajouter un Irait de plus à la
piquante physionomie de toutes ces construc-
tions. Elle est svelte, légère, percée de longues
baies, les unes en ogive, les autres cintrées...
« L'intérieur de Saint-Étienne-du-Mont n'est
pas moins singulier que le dehors. Les voûtes
s'élèvent à une grande hauteur. Celles des bas
côtés ne sont pas de beaucoup inférieures à la
maîtresse voûte. Toutes reposent sur de grands
piliers ronds, d'environ cinq pieds de diamètre,
montés sur des piédestaux carrés. Pour raffer-
mir ces colonnes et pour atténuer en même
temps l'élévation, peut-être exagérée des baies
latérales, l'architecte a imaginé un procédé
bizarre. Au tiers de la hauteur, il a jeté d'un
pilier à l'autre un arc surbaissé qui n'a pas plus
de deux pieds d'épaisseur et qui est bordé d'une
rangée de gros balustres en pierre. Ce passage
étroit circule de chaque côté de la nef, mais
sans traverser le transept ; il reprend pour faire
le tour du chœur et de l'abside...
« Le jubé de Saint-Etienne est le seul qui
existe encore à Paris ; il passe pour un chef-
(1) Itinéraire archéologique de Paris, par F. de Guilhermy,
j 1 vol in-12 de 400 pages, illustre de 15 gravures sur acier et
) 22 vigncltcs gravées sur bois d'après les dessins de Ch. Fichol.
Prix : broché, H l'r. — Librairies-Imprimeries réunies, édileurs
j 5, rue Saint-Bcnoil, Paris.
BULLETIN DE L'ART POUR TOUS. — N° 13!.