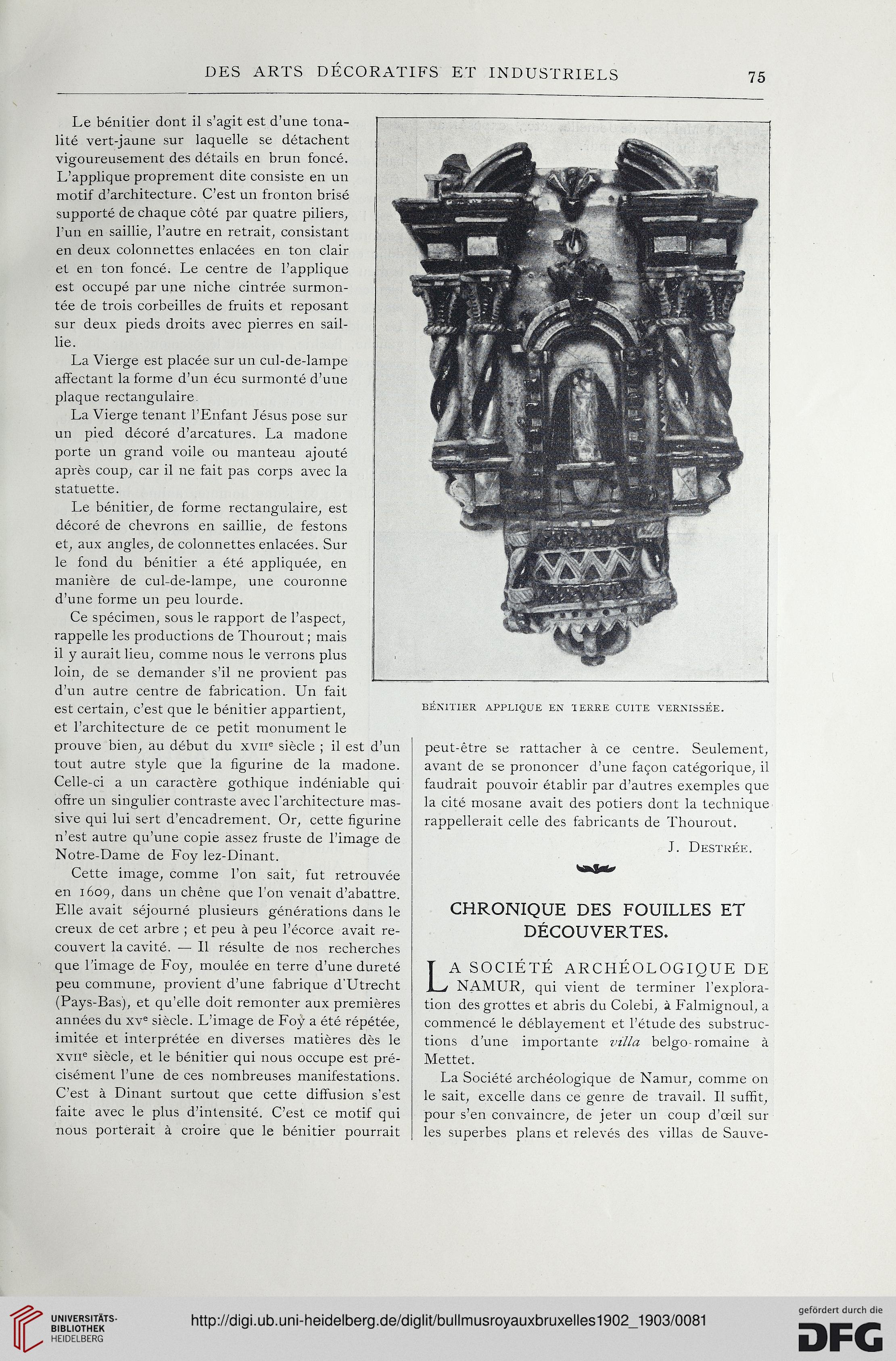DES ARTS DÉCORATIFS ET INDUSTRIELS
75
BÉNITIER APPLIQUE EN TERRE CUITE VERNISSÉE.
Le bénitier dont il s’agit est d’une tona-
lité vert-jaune sur laquelle se détachent
vigoureusement des détails en brun foncé.
L’applique proprement dite consiste en un
motif d’architecture. C’est un fronton brisé
supporté de chaque côté par quatre piliers,
l’un en saillie, l’autre en retrait, consistant
en deux colonnettes enlacées en ton clair
et en ton foncé. Le centre de l’applique
est occupé par une niche cintrée surmon-
tée de trois corbeilles de fruits et reposant
sur deux pieds droits avec pierres en sail-
lie.
La Vierge est placée sur un cul-de-lampe
affectant la forme d’un écu surmonté d’une
plaque rectangulaire
La Vierge tenant l’Enfant Jésus pose sur
un pied décoré d’arcatures. La madone
porte un grand voile ou manteau ajouté
après coup, car il ne fait pas corps avec la
statuette.
Le bénitier, de forme rectangulaire, est
décoré de chevrons en saillie, de festons
et, aux angles, de colonnettes enlacées. Sur
le fond du bénitier a été appliquée, en
manière de cul-de-lampe, une couronne
d’une forme un peu lourde.
Ce spécimen, sous le rapport de l’aspect,
rappelle les productions de Thourout ; mais
il y aurait lieu, comme nous le verrons plus
loin, de se demander s’il ne provient pas
d’un autre centre de fabrication. Un fait
est certain, c’est que le bénitier appartient,
et l’architecture de ce petit monument le
prouve bien, au début du xvne siècle ; il est d’un
tout autre style que la figurine de la madone.
Celle-ci a un caractère gothique indéniable qui
offre un singulier contraste avec l'architecture mas-
sive qui lui sert d’encadrement. Or, cette figurine
n’est autre qu’une copie assez fruste de l’image de
Notre-Dame de Foy lez-Dinant.
Cette image, comme l’on sait, fut retrouvée
en 1609, dans un chêne que l’on venait d’abattre.
Elle avait séjourné plusieurs générations dans le
creux de cet arbre ; et peu à peu l’écorce avait re-
couvert la cavité. — Il résulte de nos recherches
que l’image de Foy, moulée en terre d’une dureté
peu commune, provient d’une fabrique d'Utrecht
(Pays-Bas), et qu’elle doit remonter aux premières
années du xve siècle. L’image de Foy a été répétée,
imitée et interprétée en diverses matières dès le
xvne siècle, et le bénitier qui nous occupe est pré-
cisément l’une de ces nombreuses manifestations.
C’est à Dinant surtout que cette diffusion s’est
faite avec le plus d’intensité. C’est ce motif qui
nous porterait à croire que le bénitier pourrait
peut-être se rattacher à ce centre. Seulement,
avant de se prononcer d’une façon catégorique, il
faudrait pouvoir établir par d’autres exemples que
la cité mosane avait des potiers dont la technique
rappellerait celle des fabricants de Thourout.
J. Destrée.
CHRONIQUE DES FOUILLES ET
DÉCOUVERTES.
La société archéologique de
NAMUR, qui vient de terminer l’explora-
tion des grottes et abris du Colebi, à Falmignoul, a
commencé le déblayement et l’étude des substruc-
tions d’une importante villa belgo-romaine à
Mettet.
La Société archéologique de Namur, comme on
le sait, excelle dans ce genre de travail. Il suffit,
pour s’en convaincre, de jeter un coup d’œil sur
les superbes plans et relevés des villas de Sauve-
75
BÉNITIER APPLIQUE EN TERRE CUITE VERNISSÉE.
Le bénitier dont il s’agit est d’une tona-
lité vert-jaune sur laquelle se détachent
vigoureusement des détails en brun foncé.
L’applique proprement dite consiste en un
motif d’architecture. C’est un fronton brisé
supporté de chaque côté par quatre piliers,
l’un en saillie, l’autre en retrait, consistant
en deux colonnettes enlacées en ton clair
et en ton foncé. Le centre de l’applique
est occupé par une niche cintrée surmon-
tée de trois corbeilles de fruits et reposant
sur deux pieds droits avec pierres en sail-
lie.
La Vierge est placée sur un cul-de-lampe
affectant la forme d’un écu surmonté d’une
plaque rectangulaire
La Vierge tenant l’Enfant Jésus pose sur
un pied décoré d’arcatures. La madone
porte un grand voile ou manteau ajouté
après coup, car il ne fait pas corps avec la
statuette.
Le bénitier, de forme rectangulaire, est
décoré de chevrons en saillie, de festons
et, aux angles, de colonnettes enlacées. Sur
le fond du bénitier a été appliquée, en
manière de cul-de-lampe, une couronne
d’une forme un peu lourde.
Ce spécimen, sous le rapport de l’aspect,
rappelle les productions de Thourout ; mais
il y aurait lieu, comme nous le verrons plus
loin, de se demander s’il ne provient pas
d’un autre centre de fabrication. Un fait
est certain, c’est que le bénitier appartient,
et l’architecture de ce petit monument le
prouve bien, au début du xvne siècle ; il est d’un
tout autre style que la figurine de la madone.
Celle-ci a un caractère gothique indéniable qui
offre un singulier contraste avec l'architecture mas-
sive qui lui sert d’encadrement. Or, cette figurine
n’est autre qu’une copie assez fruste de l’image de
Notre-Dame de Foy lez-Dinant.
Cette image, comme l’on sait, fut retrouvée
en 1609, dans un chêne que l’on venait d’abattre.
Elle avait séjourné plusieurs générations dans le
creux de cet arbre ; et peu à peu l’écorce avait re-
couvert la cavité. — Il résulte de nos recherches
que l’image de Foy, moulée en terre d’une dureté
peu commune, provient d’une fabrique d'Utrecht
(Pays-Bas), et qu’elle doit remonter aux premières
années du xve siècle. L’image de Foy a été répétée,
imitée et interprétée en diverses matières dès le
xvne siècle, et le bénitier qui nous occupe est pré-
cisément l’une de ces nombreuses manifestations.
C’est à Dinant surtout que cette diffusion s’est
faite avec le plus d’intensité. C’est ce motif qui
nous porterait à croire que le bénitier pourrait
peut-être se rattacher à ce centre. Seulement,
avant de se prononcer d’une façon catégorique, il
faudrait pouvoir établir par d’autres exemples que
la cité mosane avait des potiers dont la technique
rappellerait celle des fabricants de Thourout.
J. Destrée.
CHRONIQUE DES FOUILLES ET
DÉCOUVERTES.
La société archéologique de
NAMUR, qui vient de terminer l’explora-
tion des grottes et abris du Colebi, à Falmignoul, a
commencé le déblayement et l’étude des substruc-
tions d’une importante villa belgo-romaine à
Mettet.
La Société archéologique de Namur, comme on
le sait, excelle dans ce genre de travail. Il suffit,
pour s’en convaincre, de jeter un coup d’œil sur
les superbes plans et relevés des villas de Sauve-