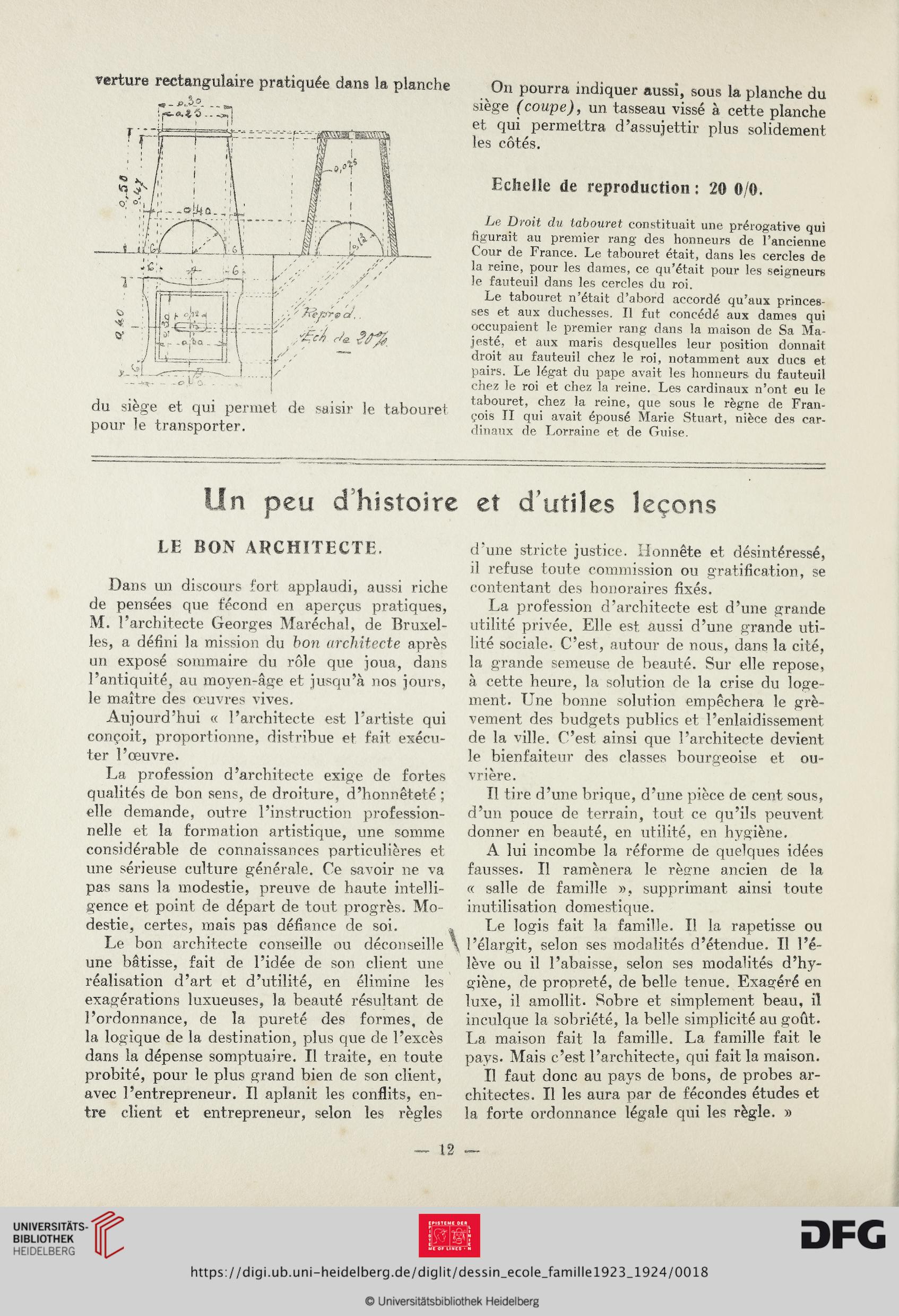verture rectangulaire pratiquée dans la planche
du siège et qui permet de saisir le tabouret
pour le transporter.
On pourra indiquer aussi, sous la planche du
siège {coupe), un tasseau vissé à cette planche
et qui permettra d’assujettir plus solidement
les côtés.
Echelle de reproduction : 20 0/0.
Le Droit du tabouret constituait une prérogative qui
figurait au premier rang des honneurs de l’ancienne
Cour de France. Le tabouret était, dans les cercles de
la reine, pour les dames, ce qu’était pour les seigneurs
le fauteuil dans les cercles du roi.
Le tabouret n’était d’abord accordé qu’aux princes-
ses et aux duchesses. Il fut concédé aux dames qui
occupaient le premier rang dans la maison de Sa Ma-
jesté, et aux maris desquelles leur position donnait
droit au fauteuil chez le roi, notamment aux ducs et
pairs. Le légat du pape avait les honneurs du fauteuil
chez le roi et chez la reine. Les cardinaux n’ont eu le
tabouret, chez la reine, que sous le règne de Fran-
çois II qui avait épousé Marie Stuart, nièce des car-
dinaux de Lorraine et de Guise.
Un peu d histoire
LE BON ARCHITECTE.
Dans un discours fort applaudi, aussi riche
de pensées que fécond en aperçus pratiques,
M. l’architecte Georges Maréchal, de Bruxel-
les, a défini la mission du bon architecte après
un exposé sommaire du rôle que joua, dans
l’antiquité, au moyen-âge et jusqu’à nos jours,
le maître des œuvres vives.
Aujourd’hui « l’architecte est l’artiste qui
conçoit, proportionne, distribue et fait exécu-
ter l’œuvre.
La profession d’architecte exige de fortes
qualités de bon sens, de droiture, d’honnêteté ;
elle demande, outre l’instruction profession-
nelle et la formation artistique, une somme
considérable de connaissances particulières et
une sérieuse culture générale. Ce savoir ne va
pas sans la modestie, preuve de haute intelli-
gence et point de départ de tout progrès. Mo-
destie, certes, mais pas défiance de soi.
Le bon architecte conseille ou déconseille
une bâtisse, fait de l’idée de son client une
réalisation d’art et d’utilité, en élimine les
exagérations luxueuses, la beauté résultant de
l’ordonnance, de la pureté des formes, de
la logique de la destination, plus que de l’excès
dans la dépense somptuaire. Il traite, en toute
probité, pour le plus grand bien de son client,
avec l’entrepreneur. Il aplanit les conflits, en-
tre client et entrepreneur, selon les règles
et d’utiles leçons
d’une stricte justice. Honnête et désintéressé,
il refuse toute commission ou gratification, se
contentant des honoraires fixés.
La profession d’architecte est d’une grande
utilité privée. Elle est aussi d’une grande uti-
lité sociale. C’est, autour de nous, dans la cité,
la grande semeuse de beauté. Sur elle repose,
à cette heure, la solution de la crise du loge-
ment. Une bonne solution empêchera le grè-
vement des budgets publics et l’enlaidissement
de la ville. C’est ainsi que l’architecte devient
le bienfaiteur des classes bourgeoise et ou-
vrière.
Il tire d’une brique, d’une pièce de cent sous,
d’un pouce de terrain, tout ce qu’ils peuvent
donner en beauté, en utilité, en hygiène.
A lui incombe la réforme de quelques idées
fausses. Il ramènera le rèame ancien de la
« salle de famille », supprimant ainsi toute
inutilisation domestique.
Le logis fait la famille. Il la rapetisse ou
l’élargit, selon ses modalités d’étendue. Il l’é-
lève ou il l’abaisse, selon ses modalités d’hy-
giène, de propreté, de belle tenue. Exagéré en
luxe, il amollit. Sobre et simplement beau, il
inculque la sobriété, la belle simplicité au goût.
La maison fait la famille. La famille fait le
pays. Mais c’est l’architecte, qui fait la maison.
Il faut donc au pays de bons, de probes ar-
chitectes. Il les aura par de fécondes études et
la forte ordonnance légale qui les règle. »
du siège et qui permet de saisir le tabouret
pour le transporter.
On pourra indiquer aussi, sous la planche du
siège {coupe), un tasseau vissé à cette planche
et qui permettra d’assujettir plus solidement
les côtés.
Echelle de reproduction : 20 0/0.
Le Droit du tabouret constituait une prérogative qui
figurait au premier rang des honneurs de l’ancienne
Cour de France. Le tabouret était, dans les cercles de
la reine, pour les dames, ce qu’était pour les seigneurs
le fauteuil dans les cercles du roi.
Le tabouret n’était d’abord accordé qu’aux princes-
ses et aux duchesses. Il fut concédé aux dames qui
occupaient le premier rang dans la maison de Sa Ma-
jesté, et aux maris desquelles leur position donnait
droit au fauteuil chez le roi, notamment aux ducs et
pairs. Le légat du pape avait les honneurs du fauteuil
chez le roi et chez la reine. Les cardinaux n’ont eu le
tabouret, chez la reine, que sous le règne de Fran-
çois II qui avait épousé Marie Stuart, nièce des car-
dinaux de Lorraine et de Guise.
Un peu d histoire
LE BON ARCHITECTE.
Dans un discours fort applaudi, aussi riche
de pensées que fécond en aperçus pratiques,
M. l’architecte Georges Maréchal, de Bruxel-
les, a défini la mission du bon architecte après
un exposé sommaire du rôle que joua, dans
l’antiquité, au moyen-âge et jusqu’à nos jours,
le maître des œuvres vives.
Aujourd’hui « l’architecte est l’artiste qui
conçoit, proportionne, distribue et fait exécu-
ter l’œuvre.
La profession d’architecte exige de fortes
qualités de bon sens, de droiture, d’honnêteté ;
elle demande, outre l’instruction profession-
nelle et la formation artistique, une somme
considérable de connaissances particulières et
une sérieuse culture générale. Ce savoir ne va
pas sans la modestie, preuve de haute intelli-
gence et point de départ de tout progrès. Mo-
destie, certes, mais pas défiance de soi.
Le bon architecte conseille ou déconseille
une bâtisse, fait de l’idée de son client une
réalisation d’art et d’utilité, en élimine les
exagérations luxueuses, la beauté résultant de
l’ordonnance, de la pureté des formes, de
la logique de la destination, plus que de l’excès
dans la dépense somptuaire. Il traite, en toute
probité, pour le plus grand bien de son client,
avec l’entrepreneur. Il aplanit les conflits, en-
tre client et entrepreneur, selon les règles
et d’utiles leçons
d’une stricte justice. Honnête et désintéressé,
il refuse toute commission ou gratification, se
contentant des honoraires fixés.
La profession d’architecte est d’une grande
utilité privée. Elle est aussi d’une grande uti-
lité sociale. C’est, autour de nous, dans la cité,
la grande semeuse de beauté. Sur elle repose,
à cette heure, la solution de la crise du loge-
ment. Une bonne solution empêchera le grè-
vement des budgets publics et l’enlaidissement
de la ville. C’est ainsi que l’architecte devient
le bienfaiteur des classes bourgeoise et ou-
vrière.
Il tire d’une brique, d’une pièce de cent sous,
d’un pouce de terrain, tout ce qu’ils peuvent
donner en beauté, en utilité, en hygiène.
A lui incombe la réforme de quelques idées
fausses. Il ramènera le rèame ancien de la
« salle de famille », supprimant ainsi toute
inutilisation domestique.
Le logis fait la famille. Il la rapetisse ou
l’élargit, selon ses modalités d’étendue. Il l’é-
lève ou il l’abaisse, selon ses modalités d’hy-
giène, de propreté, de belle tenue. Exagéré en
luxe, il amollit. Sobre et simplement beau, il
inculque la sobriété, la belle simplicité au goût.
La maison fait la famille. La famille fait le
pays. Mais c’est l’architecte, qui fait la maison.
Il faut donc au pays de bons, de probes ar-
chitectes. Il les aura par de fécondes études et
la forte ordonnance légale qui les règle. »