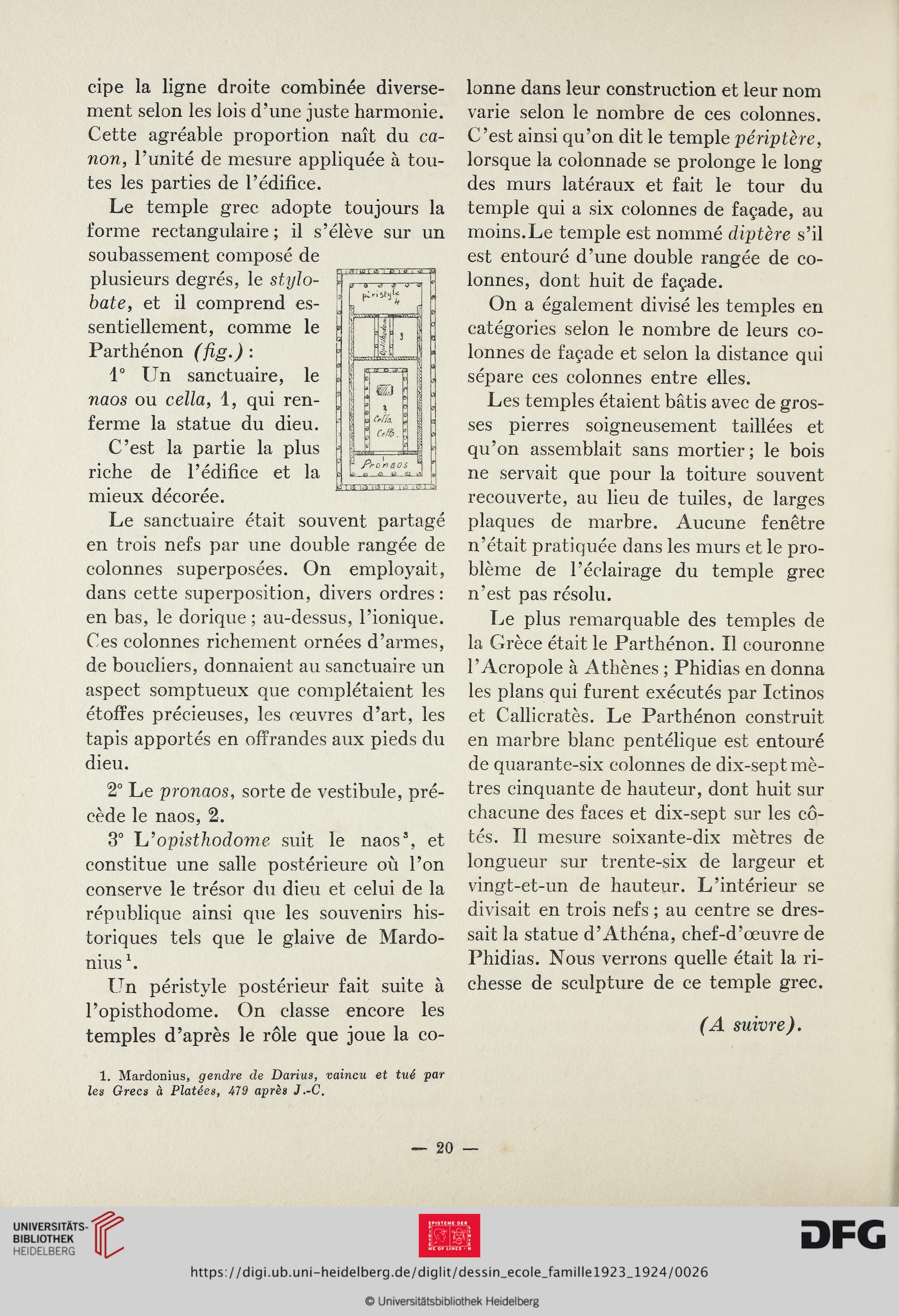cipe la ligne droite combinée diverse-
ment selon les lois d’une juste harmonie.
Cette agréable proportion naît du ca-
non, l’unité de mesure appliquée à tou-
tes les parties de l’édifice.
Le temple grec adopte toujours la
forme rectangulaire; il s’élève sur un
soubassement composé de
plusieurs degrés, le stylo-
bate, et il comprend es-
sentiellement, comme le
Parthénon (fig.) :
1° Un sanctuaire, le
naos ou cella, 1, qui ren-
ferme la statue du dieu.
C’est la partie la plus
riche de l’édifice et la
mieux décorée.
Le sanctuaire était souvent partagé
en trois nefs par une double rangée de
colonnes superposées. On employait,
dans cette superposition, divers ordres :
en bas, le dorique ; au-dessus, l’ionique.
Ces colonnes richement ornées d’armes,
de boucliers, donnaient au sanctuaire un
aspect somptueux que complétaient les
étoffes précieuses, les œuvres d’art, les
tapis apportés en offrandes aux pieds du
dieu.
2° Le pronaos, sorte de vestibule, pré-
cède le naos, 2.
3° L’opisthodom.e suit le naos3, et
constitue une salle postérieure où l’on
conserve le trésor du dieu et celui de la
république ainsi que les souvenirs his-
toriques tels que le glaive de Mardo-
nius h
Un péristyle postérieur fait suite à
l’opisthodome. On classe encore les
temples d’après le rôle que joue la co-
1. Mardonius, gendre de Darius, vaincu et tué par
les Grecs à Platées, 479 après J.-C.
lonne dans leur construction et leur nom
varie selon le nombre de ces colonnes.
C’est ainsi qu’on dit le temple périptère,
lorsque la colonnade se prolonge le long
des murs latéraux et fait le tour du
temple qui a six colonnes de façade, au
moins.Le temple est nommé diptère s’il
est entouré d’une double rangée de co-
lonnes, dont huit de façade.
On a également divisé les temples en
catégories selon le nombre de leurs co-
lonnes de façade et selon la distance qui
sépare ces colonnes entre elles.
Les temples étaient bâtis avec de gros-
ses pierres soigneusement taillées et
qu’on assemblait sans mortier; le bois
ne servait que pour la toiture souvent
recouverte, au lieu de tuiles, de larges
plaques de marbre. Aucune fenêtre
n’était pratiquée dans les murs et le pro-
blème de l’éclairage du temple grec
n’est pas résolu.
Le plus remarquable des temples de
la Grèce était le Parthénon. Il couronne
l’Acropole à Athènes ; Phidias en donna
les plans qui furent exécutés par Ictinos
et Callicratès. Le Parthénon construit
en marbre blanc pentélique est entouré
de quarante-six colonnes de dix-sept mè-
tres cinquante de hauteur, dont huit sur
chacune des faces et dix-sept sur les cô-
tés. Il mesure soixante-dix mètres de
longueur sur trente-six de largeur et
vingt-et-un de hauteur. L’intérieur se
divisait en trois nefs ; au centre se dres-
sait la statue d’Athéna, chef-d’œuvre de
Phidias. Nous verrons quelle était la ri-
chesse de sculpture de ce temple grec.
(A suivre).
— 20 —
ment selon les lois d’une juste harmonie.
Cette agréable proportion naît du ca-
non, l’unité de mesure appliquée à tou-
tes les parties de l’édifice.
Le temple grec adopte toujours la
forme rectangulaire; il s’élève sur un
soubassement composé de
plusieurs degrés, le stylo-
bate, et il comprend es-
sentiellement, comme le
Parthénon (fig.) :
1° Un sanctuaire, le
naos ou cella, 1, qui ren-
ferme la statue du dieu.
C’est la partie la plus
riche de l’édifice et la
mieux décorée.
Le sanctuaire était souvent partagé
en trois nefs par une double rangée de
colonnes superposées. On employait,
dans cette superposition, divers ordres :
en bas, le dorique ; au-dessus, l’ionique.
Ces colonnes richement ornées d’armes,
de boucliers, donnaient au sanctuaire un
aspect somptueux que complétaient les
étoffes précieuses, les œuvres d’art, les
tapis apportés en offrandes aux pieds du
dieu.
2° Le pronaos, sorte de vestibule, pré-
cède le naos, 2.
3° L’opisthodom.e suit le naos3, et
constitue une salle postérieure où l’on
conserve le trésor du dieu et celui de la
république ainsi que les souvenirs his-
toriques tels que le glaive de Mardo-
nius h
Un péristyle postérieur fait suite à
l’opisthodome. On classe encore les
temples d’après le rôle que joue la co-
1. Mardonius, gendre de Darius, vaincu et tué par
les Grecs à Platées, 479 après J.-C.
lonne dans leur construction et leur nom
varie selon le nombre de ces colonnes.
C’est ainsi qu’on dit le temple périptère,
lorsque la colonnade se prolonge le long
des murs latéraux et fait le tour du
temple qui a six colonnes de façade, au
moins.Le temple est nommé diptère s’il
est entouré d’une double rangée de co-
lonnes, dont huit de façade.
On a également divisé les temples en
catégories selon le nombre de leurs co-
lonnes de façade et selon la distance qui
sépare ces colonnes entre elles.
Les temples étaient bâtis avec de gros-
ses pierres soigneusement taillées et
qu’on assemblait sans mortier; le bois
ne servait que pour la toiture souvent
recouverte, au lieu de tuiles, de larges
plaques de marbre. Aucune fenêtre
n’était pratiquée dans les murs et le pro-
blème de l’éclairage du temple grec
n’est pas résolu.
Le plus remarquable des temples de
la Grèce était le Parthénon. Il couronne
l’Acropole à Athènes ; Phidias en donna
les plans qui furent exécutés par Ictinos
et Callicratès. Le Parthénon construit
en marbre blanc pentélique est entouré
de quarante-six colonnes de dix-sept mè-
tres cinquante de hauteur, dont huit sur
chacune des faces et dix-sept sur les cô-
tés. Il mesure soixante-dix mètres de
longueur sur trente-six de largeur et
vingt-et-un de hauteur. L’intérieur se
divisait en trois nefs ; au centre se dres-
sait la statue d’Athéna, chef-d’œuvre de
Phidias. Nous verrons quelle était la ri-
chesse de sculpture de ce temple grec.
(A suivre).
— 20 —