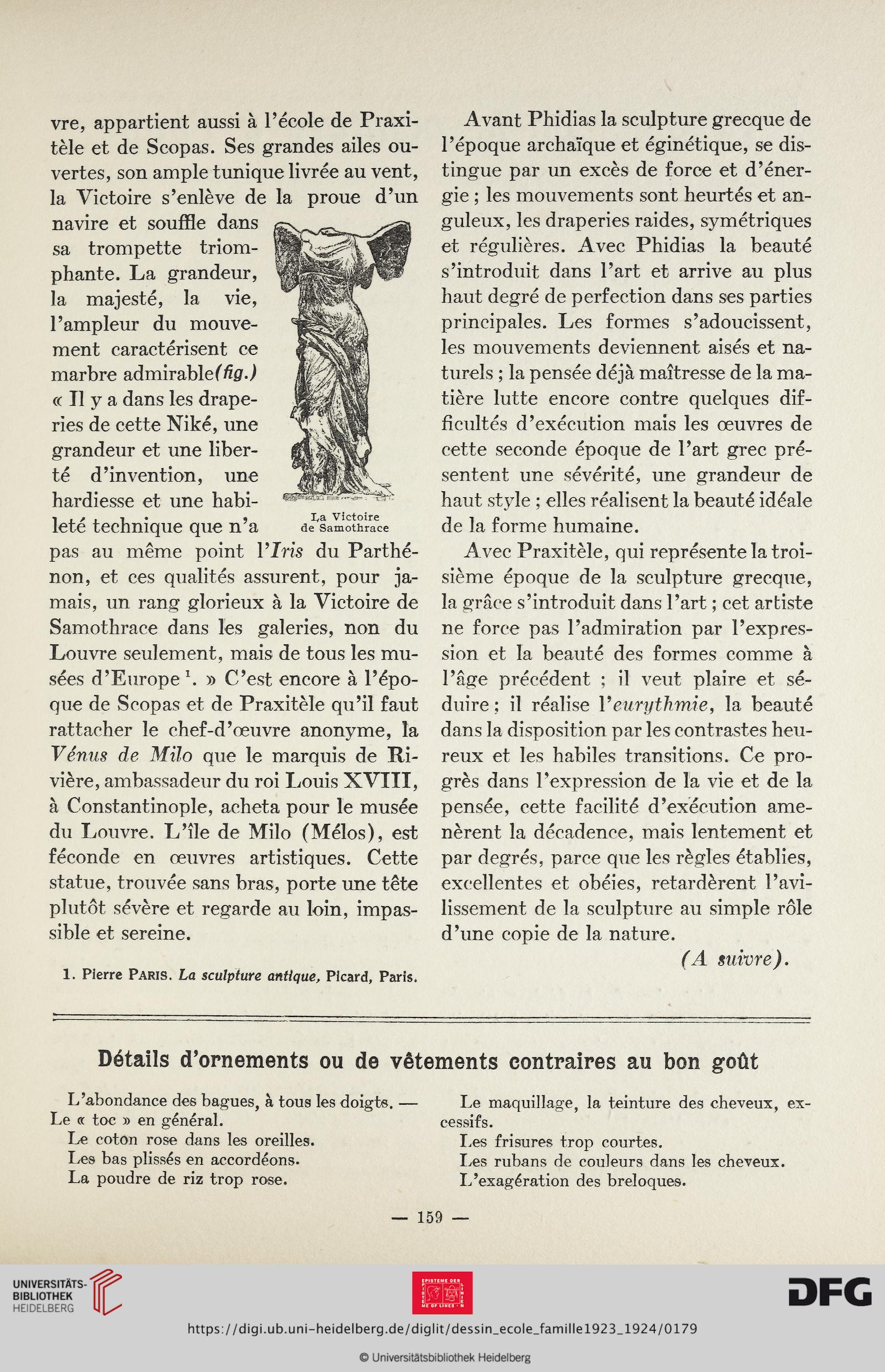vre, appartient aussi à l’école de Praxi-
tèle et de Scopas. Ses grandes ailes ou-
vertes, son ample tunique livrée au vent,
la Victoire s’enlève de la proue d’un
navire et souffle dans
sa trompette triom-
phante. La grandeur,
la majesté, la vie,
l’ampleur du mouve-
ment caractérisent ce
marbre admirable(üg.)
ce II y a dans les drape-
ries de cette Niké, une
grandeur et une liber-
té d’invention, une
hardiesse et une habi-
leté technique que n’a
pas au même point Vins du Parthé-
non, et ces qualités assurent, pour ja-
mais, un rang glorieux à la Victoire de
Samothrace dans les galeries, non du
Louvre seulement, mais de tous les mu-
sées d’Europe 1. » C’est encore à l’épo-
que de Scopas et de Praxitèle qu’il faut
rattacher le chef-d’œuvre anonyme, la
Vénus de Milo que le marquis de Ri-
vière, ambassadeur du roi Louis XVIII,
à Constantinople, acheta pour le musée
du Louvre. L’île de Milo (Mélos), est
féconde en œuvres artistiques. Cette
statue, trouvée sans bras, porte une tête
plutôt sévère et regarde au loin, impas-
sible et sereine.
1. Pierre Paris. La sculpture antique. Picard, Paris.
Avant Phidias la sculpture grecque de
l’époque archaïque et éginétique, se dis-
tingue par un excès de force et d’éner-
gie ; les mouvements sont heurtés et an-
guleux, les draperies raides, symétriques
et régulières. Avec Phidias la beauté
s’introduit dans l’art et arrive au plus
haut degré de perfection dans ses parties
principales. Les formes s’adoucissent,
les mouvements deviennent aisés et na-
turels ; la pensée déjà maîtresse de la ma-
tière lutte encore contre quelques dif-
ficultés d’exécution mais les œuvres de
cette seconde époque de l’art grec pré-
sentent une sévérité, une grandeur de
haut style ; elles réalisent la beauté idéale
de la forme humaine.
Avec Praxitèle, qui représente la troi-
sième époque de la sculpture grecque,
la grâce s’introduit dans l’art ; cet artiste
ne force pas l’admiration par l’expres-
sion et la beauté des formes comme à
l’âge précédent ; il veut plaire et sé-
duire ; il réalise Y eurythmie, la beauté
dans la disposition par les contrastes heu-
reux et les habiles transitions. Ce pro-
grès dans l’expression de la vie et de la
pensée, cette facilité d’exécution ame-
nèrent la décadence, mais lentement et
par degrés, parce que les règles établies,
excellentes et obéies, retardèrent l’avi-
lissement de la sculpture au simple rôle
d’une copie de la nature.
(A suivre).
I,a Victoire
de Samothrace
Détails d’ornements ou de vêtements contraires au bon goût
L’abondance des bagues, à tous les doigts. —
Le « toc » en général.
Le coton rose dans les oreilles.
Les bas plissés en accordéons.
La poudre de riz trop rose.
Le maquillage, la teinture des cheveux, ex-
cessifs.
Les frisures trop courtes.
Les rubans de couleurs dans les cheveux.
L’exagération des breloques.
159 —
tèle et de Scopas. Ses grandes ailes ou-
vertes, son ample tunique livrée au vent,
la Victoire s’enlève de la proue d’un
navire et souffle dans
sa trompette triom-
phante. La grandeur,
la majesté, la vie,
l’ampleur du mouve-
ment caractérisent ce
marbre admirable(üg.)
ce II y a dans les drape-
ries de cette Niké, une
grandeur et une liber-
té d’invention, une
hardiesse et une habi-
leté technique que n’a
pas au même point Vins du Parthé-
non, et ces qualités assurent, pour ja-
mais, un rang glorieux à la Victoire de
Samothrace dans les galeries, non du
Louvre seulement, mais de tous les mu-
sées d’Europe 1. » C’est encore à l’épo-
que de Scopas et de Praxitèle qu’il faut
rattacher le chef-d’œuvre anonyme, la
Vénus de Milo que le marquis de Ri-
vière, ambassadeur du roi Louis XVIII,
à Constantinople, acheta pour le musée
du Louvre. L’île de Milo (Mélos), est
féconde en œuvres artistiques. Cette
statue, trouvée sans bras, porte une tête
plutôt sévère et regarde au loin, impas-
sible et sereine.
1. Pierre Paris. La sculpture antique. Picard, Paris.
Avant Phidias la sculpture grecque de
l’époque archaïque et éginétique, se dis-
tingue par un excès de force et d’éner-
gie ; les mouvements sont heurtés et an-
guleux, les draperies raides, symétriques
et régulières. Avec Phidias la beauté
s’introduit dans l’art et arrive au plus
haut degré de perfection dans ses parties
principales. Les formes s’adoucissent,
les mouvements deviennent aisés et na-
turels ; la pensée déjà maîtresse de la ma-
tière lutte encore contre quelques dif-
ficultés d’exécution mais les œuvres de
cette seconde époque de l’art grec pré-
sentent une sévérité, une grandeur de
haut style ; elles réalisent la beauté idéale
de la forme humaine.
Avec Praxitèle, qui représente la troi-
sième époque de la sculpture grecque,
la grâce s’introduit dans l’art ; cet artiste
ne force pas l’admiration par l’expres-
sion et la beauté des formes comme à
l’âge précédent ; il veut plaire et sé-
duire ; il réalise Y eurythmie, la beauté
dans la disposition par les contrastes heu-
reux et les habiles transitions. Ce pro-
grès dans l’expression de la vie et de la
pensée, cette facilité d’exécution ame-
nèrent la décadence, mais lentement et
par degrés, parce que les règles établies,
excellentes et obéies, retardèrent l’avi-
lissement de la sculpture au simple rôle
d’une copie de la nature.
(A suivre).
I,a Victoire
de Samothrace
Détails d’ornements ou de vêtements contraires au bon goût
L’abondance des bagues, à tous les doigts. —
Le « toc » en général.
Le coton rose dans les oreilles.
Les bas plissés en accordéons.
La poudre de riz trop rose.
Le maquillage, la teinture des cheveux, ex-
cessifs.
Les frisures trop courtes.
Les rubans de couleurs dans les cheveux.
L’exagération des breloques.
159 —