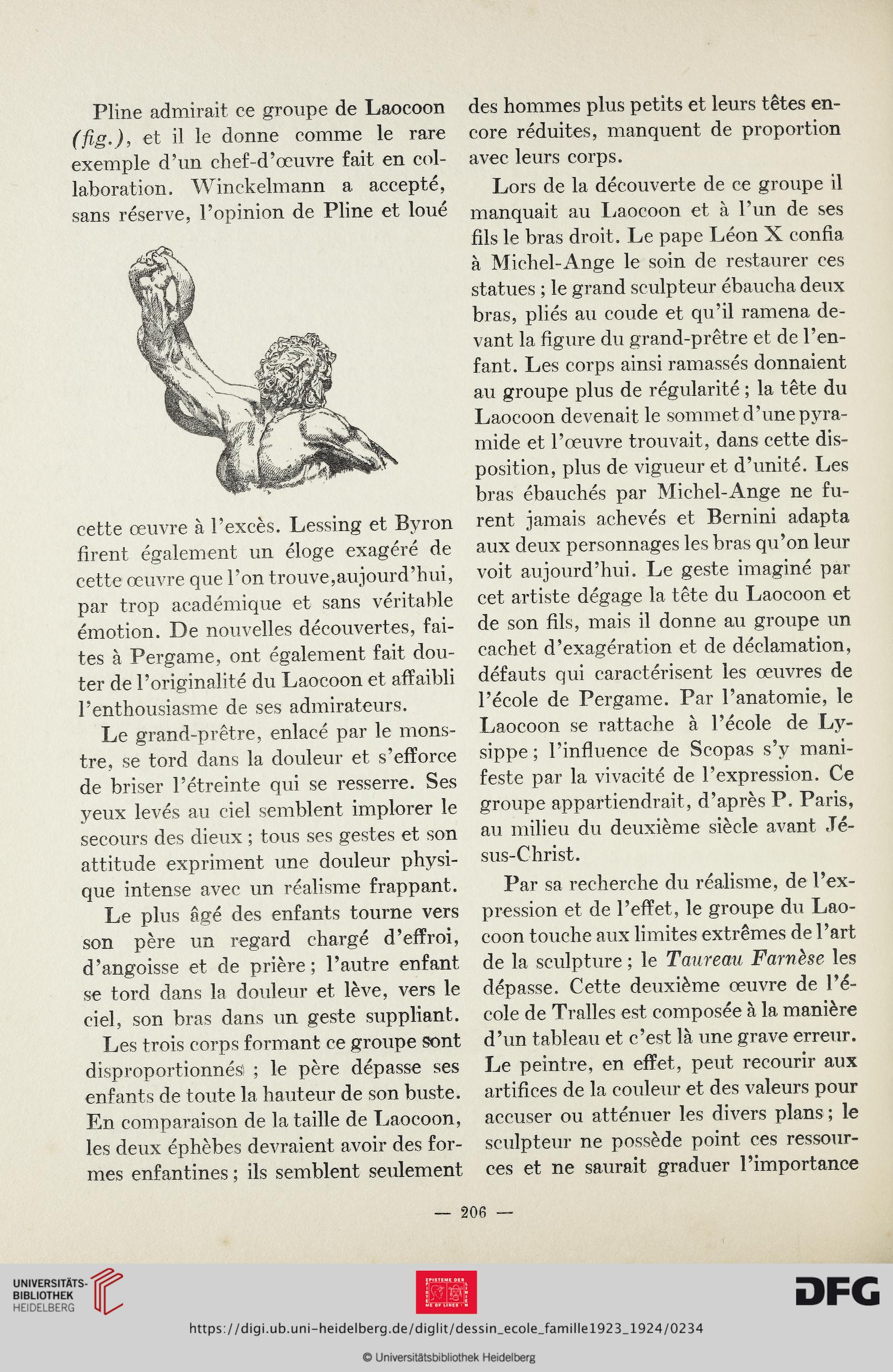Pline admirait ce groupe de Laocoon
(fig.), et il le donne comme le rare
exemple d’un chef-d’œuvre fait en col-
laboration. Winckelmann a accepté,
sans réserve, l’opinion de Pline et loué
cette œuvre à l’excès. Lessing et Byron
firent également un éloge exagéré de
cette œuvre que l’on trouve,aujourd’hui,
par trop académique et sans véritable
émotion. De nouvelles découvertes, fai-
tes à Pergame, ont également fait dou-
ter de l’originalité du Laocoon et affaibli
l’enthousiasme de ses admirateurs.
Le grand-prêtre, enlacé par le mons-
tre, se tord dans la douleur et s’efforce
de briser l’étreinte qui se resserre. Ses
yeux levés au ciel semblent implorer le
secours des dieux ; tous ses gestes et son
attitude expriment une douleur physi-
que intense avec un réalisme frappant.
Le plus âgé des enfants tourne vers
son père un regard chargé d’effroi,
d’angoisse et de prière; l’autre enfant
se tord dans la douleur et lève, vers le
ciel, son bras dans un geste suppliant.
Les trois corps formant ce groupe sont
disproportionnés! ; le père dépasse ses
enfants de toute la hauteur de son buste.
En comparaison de la taille de Laocoon,
les deux éphèbes devraient avoir des for-
mes enfantines ; ils semblent seulement
des hommes plus petits et leurs têtes en-
core réduites, manquent de proportion
avec leurs corps.
Lors de la découverte de ce groupe il
manquait au Laocoon et à l’un de ses
fils le bras droit. Le pape Léon X confia
à Michel-Ange le soin de restaurer ees
statues ; le grand sculpteur ébaucha deux
bras, pliés au coude et qu’il ramena de-
vant la figure du grand-prêtre et de l’en-
fant. Les corps ainsi ramassés donnaient
au groupe plus de régularité ; la tête du
Laocoon devenait le sommet d’une pyra-
mide et l’œuvre trouvait, dans cette dis-
position, plus de vigueur et d’unité. Les
bras ébauchés par Michel-Ange ne fu-
rent jamais achevés et Bernini adapta
aux deux personnages les bras qu’on leur
voit aujourd’hui. Le geste imaginé par
cet artiste dégage la tête du Laocoon et
de son fils, mais il donne au groupe un
cachet d’exagération et de déclamation,
défauts qui caractérisent les œuvres de
l’école de Pergame. Par l’anatomie, le
Laocoon se rattache à l’école de Ly-
sippe ; l’influence de Scopas s’y mani-
feste par la vivacité de l’expression. Ce
groupe appartiendrait, d’après P. Paris,
au milieu du deuxième siècle avant Jé-
sus-Christ.
Par sa recherche du réalisme, de l’ex-
pression et de l’effet, le groupe du Lao-
coon touche aux limites extrêmes de l’art
de la sculpture ; le Taureau Farnèse les
dépasse. Cette deuxième œuvre de l’é-
cole de Tralles est composée à la manière
d’un tableau et c’est là une grave erreur.
Le peintre, en effet, peut recourir aux
artifices de la couleur et des valeurs pour
accuser ou atténuer les divers plans ; le
sculpteur ne possède point ces ressour-
ces et ne saurait graduer l’importance
— 206
(fig.), et il le donne comme le rare
exemple d’un chef-d’œuvre fait en col-
laboration. Winckelmann a accepté,
sans réserve, l’opinion de Pline et loué
cette œuvre à l’excès. Lessing et Byron
firent également un éloge exagéré de
cette œuvre que l’on trouve,aujourd’hui,
par trop académique et sans véritable
émotion. De nouvelles découvertes, fai-
tes à Pergame, ont également fait dou-
ter de l’originalité du Laocoon et affaibli
l’enthousiasme de ses admirateurs.
Le grand-prêtre, enlacé par le mons-
tre, se tord dans la douleur et s’efforce
de briser l’étreinte qui se resserre. Ses
yeux levés au ciel semblent implorer le
secours des dieux ; tous ses gestes et son
attitude expriment une douleur physi-
que intense avec un réalisme frappant.
Le plus âgé des enfants tourne vers
son père un regard chargé d’effroi,
d’angoisse et de prière; l’autre enfant
se tord dans la douleur et lève, vers le
ciel, son bras dans un geste suppliant.
Les trois corps formant ce groupe sont
disproportionnés! ; le père dépasse ses
enfants de toute la hauteur de son buste.
En comparaison de la taille de Laocoon,
les deux éphèbes devraient avoir des for-
mes enfantines ; ils semblent seulement
des hommes plus petits et leurs têtes en-
core réduites, manquent de proportion
avec leurs corps.
Lors de la découverte de ce groupe il
manquait au Laocoon et à l’un de ses
fils le bras droit. Le pape Léon X confia
à Michel-Ange le soin de restaurer ees
statues ; le grand sculpteur ébaucha deux
bras, pliés au coude et qu’il ramena de-
vant la figure du grand-prêtre et de l’en-
fant. Les corps ainsi ramassés donnaient
au groupe plus de régularité ; la tête du
Laocoon devenait le sommet d’une pyra-
mide et l’œuvre trouvait, dans cette dis-
position, plus de vigueur et d’unité. Les
bras ébauchés par Michel-Ange ne fu-
rent jamais achevés et Bernini adapta
aux deux personnages les bras qu’on leur
voit aujourd’hui. Le geste imaginé par
cet artiste dégage la tête du Laocoon et
de son fils, mais il donne au groupe un
cachet d’exagération et de déclamation,
défauts qui caractérisent les œuvres de
l’école de Pergame. Par l’anatomie, le
Laocoon se rattache à l’école de Ly-
sippe ; l’influence de Scopas s’y mani-
feste par la vivacité de l’expression. Ce
groupe appartiendrait, d’après P. Paris,
au milieu du deuxième siècle avant Jé-
sus-Christ.
Par sa recherche du réalisme, de l’ex-
pression et de l’effet, le groupe du Lao-
coon touche aux limites extrêmes de l’art
de la sculpture ; le Taureau Farnèse les
dépasse. Cette deuxième œuvre de l’é-
cole de Tralles est composée à la manière
d’un tableau et c’est là une grave erreur.
Le peintre, en effet, peut recourir aux
artifices de la couleur et des valeurs pour
accuser ou atténuer les divers plans ; le
sculpteur ne possède point ces ressour-
ces et ne saurait graduer l’importance
— 206