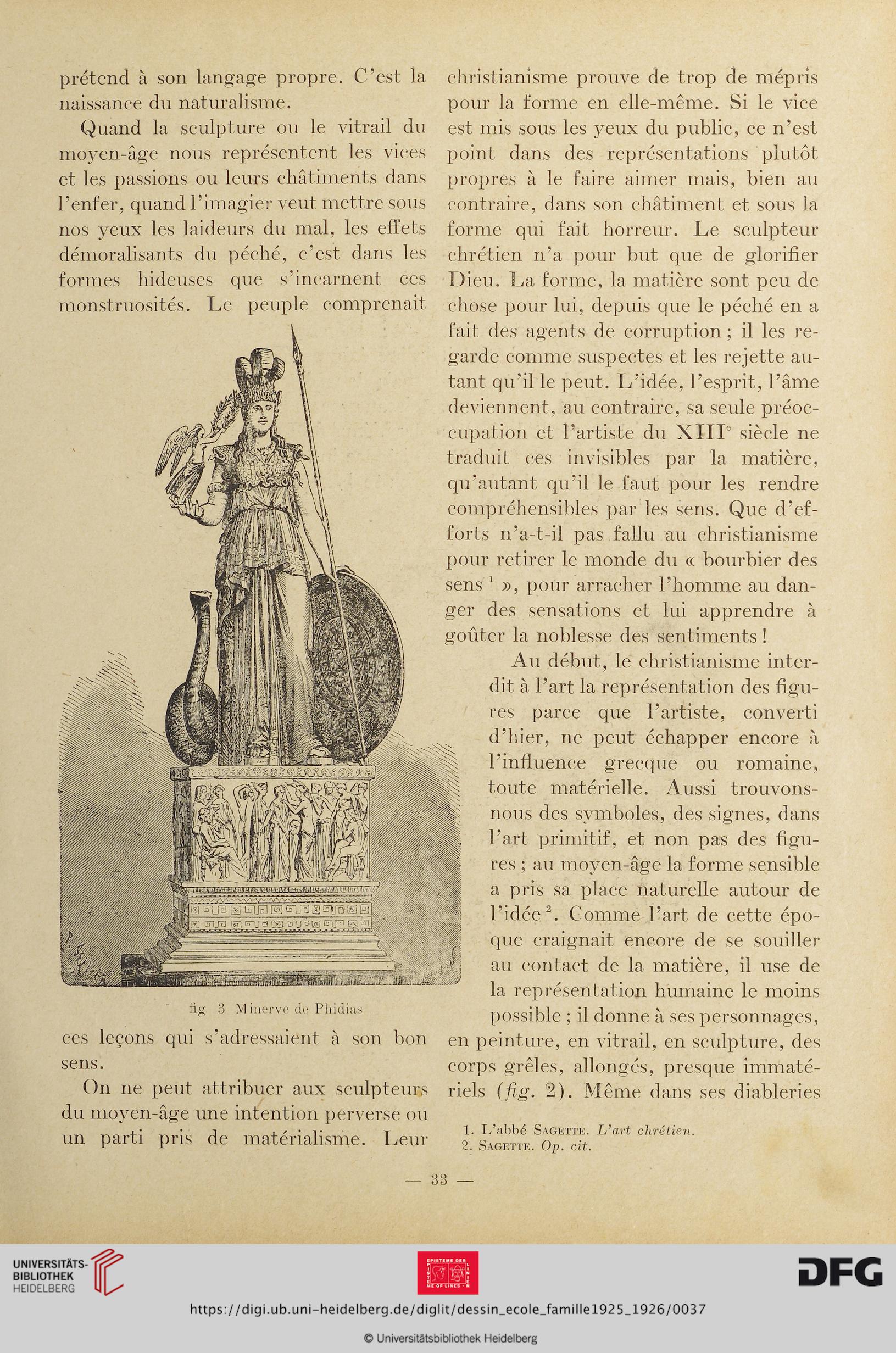prétend à son langage propre. C’est la
naissance du naturalisme.
Quand la sculpture ou le vitrail du
moyen-âge nous représentent les vices
et les passions ou leurs châtiments dans
l’enfer, quand l’imagier veut mettre sous
nos yeux les laideurs du mal, les effets
démoralisants du péché, c’est dans les
formes hideuses que s’incarnent ces
monstruosités. Le peuple comprenait
fi g 3 Minerve de Phidias
ces leçons qui s’adressaient à son bon
sens.
On ne peut attribuer aux sculpteurs
du moyen-âge une intention perverse ou
un parti pris de matérialisme. Leur
christianisme prouve de trop de mépris
pour la forme en elle-même. Si le vice
est mis sous les yeux du public, ce n’est
point dans des représentations plutôt
propres à le faire aimer mais, bien au
contraire, dans son châtiment et sous la
forme qui fait horreur. Le sculpteur
chrétien n’a pour but que de glorifier
Dieu. La forme, la matière sont peu de
chose pour lui, depuis que le péché en a
fait des agents de corruption ; il les re-
garde comme suspectes et les rejette au-
tant qu’il le peut. L’idée, l’esprit, l’âme
deviennent, au contraire, sa seule préoc-
cupation et l’artiste du XIIIe siècle ne
traduit ces invisibles par la matière,
qu’autant qu’il le faut pour les rendre
compréhensibles par les sens. Que d’ef-
forts n’a-t-il pas fallu au christianisme
pour retirer le monde du ce bourbier des
sens 1 », pour arracher l’homme au dan-
ger des sensations et lui apprendre à
goûter la noblesse des sentiments !
Au début, le christianisme inter-
dit à l’art la représentation des figu-
res parce que l’artiste, converti
d’hier, ne peut échapper encore à
l’influence grecque ou romaine,
toute matérielle. Aussi trouvons-
nous des symboles, des signes, dans
l’art primitif, et non pas des figu-
res ; au moyen-âge la forme sensible
a pris sa place naturelle autour de
l'idée2. Comme l’art de cette épo-
que craignait encore de se souiller
au contact de la matière, il use de
la représentation humaine le moins
possible ; il donne à ses personnages,
en peinture, en vitrail, en sculpture, des
corps grêles, allongés, presque immaté-
riels (fi,g. 2). Même dans ses diableries
1. L’abbé Sagette. L’art chrétien.
2. Sagette. Op. cit.
33