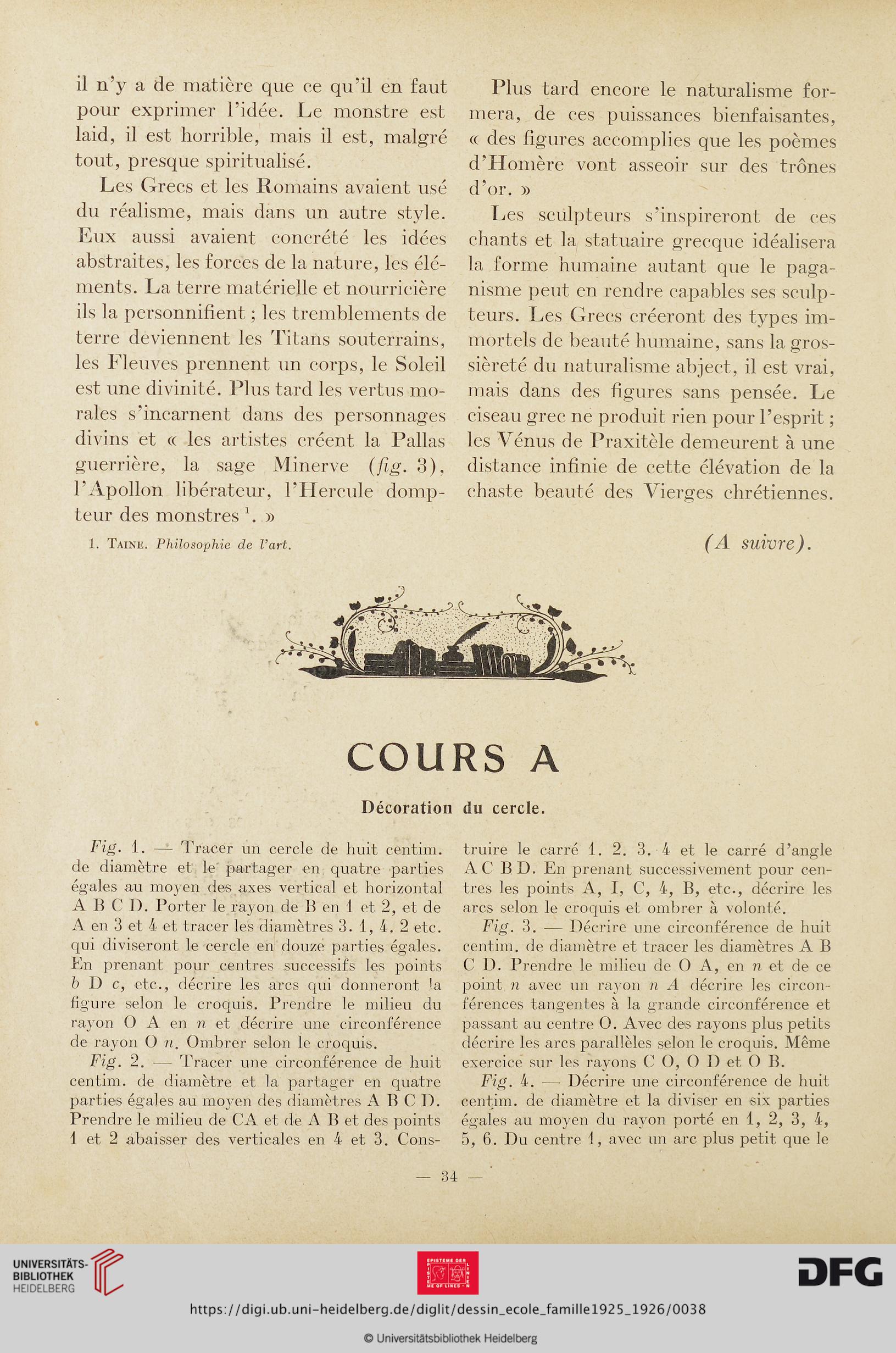il n’y a de matière que ce qu’il en faut
pour exprimer l'idée. Le monstre est
laid, il est horrible, mais il est, malgré
tout, presque spiritualisé.
Les Grecs et les Romains avaient usé
du réalisme, mais dans un autre style.
Eux aussi avaient concrété les idées
abstraites, les forces de la nature, les élé-
ments. La terre matérielle et nourricière
ils la personnifient ; les tremblements de
terre deviennent les Titans souterrains,
les Fleuves prennent un corps, le Soleil
est une divinité. Plus tard les vertus mo-
rales s’incarnent dans des personnages
divins et ce les artistes créent la Pallas
guerrière, la sage Minerve (fig. 3),
l’Apollon libérateur, l’Hercule domp-
teur des monstres \ »
1. Taine. Philosophie de l’art.
Plus tard encore le naturalisme for-
mera, de ees puissances bienfaisantes,
ce des figures accomplies que les poèmes
d’Homère vont asseoir sur des trônes
d’or. »
Les sculpteurs s’inspireront de ces
chants et la statuaire grecque idéalisera
la forme humaine autant que le paga-
nisme peut en rendre capables ses sculp-
teurs. Les Grecs créeront des types im-
mortels de beauté humaine, sans la gros-
sièreté du naturalisme abject, il est vrai,
mais dans des figures sans pensée. Le
ciseau grec ne produit rien pour l’esprit ;
les Vénus de Praxitèle demeurent à une
distance infinie de cette élévation de la
chaste beauté des Vierges chrétiennes.
(A suivre).
COURS A
Décoration du cercle.
Fig. 1. — Tracer un cercle de huit centim.
de diamètre et le partager en quatre parties
égales au mcq-en des axes vertical et horizontal
A B C D. Porter le rayon de B en 1 et 2, et de
A en 3 et 4 et tracer les diamètres 3. 1, 4. 2 etc.
qui diviseront le cercle en douze parties égales.
En prenant pour centres successifs les points
b D c, etc., décrire les arcs qui donneront !a
figure selon le croquis. Prendre le milieu du
rayon O A en n et décrire une circonférence
de rayon O n. Ombrer selon le croquis.
Fig. 2. — Tracer une circonférence de huit
centim. de diamètre et la partager en quatre
parties égales au moyen des diamètres A B C D.
Prendre le milieu de CA et de A B et des points
1 et 2 abaisser des verticales en 4 et 3. Cons-
truire le carré 1. 2. 3. 4 et le carré d’angle
AC BD. En prenant successivement pour cen-
tres les points A, I, C, 4, B, etc., décrire les
arcs selon le croquis et ombrer à volonté.
Fig. 3. — Décrire une circonférence de huit
centim. de diamètre et tracer les diamètres A B
C D. Prendre le milieu de O A, en n et de ce
point n avec un rayon n A décrire les circon-
férences tangentes à la grande circonférence et
passant au centre O. Avec des rayons plus petits
décrire les arcs parallèles selon le croquis. Même
exercice sur les rayons C O, O D et O B.
Fig. 4. — Décrire une circonférence de huit
centim. de diamètre et la diviser en six parties
égales au moyen du rayon porté en 1, 2, 3, 4,
5, 6. Du centre 1, avec un arc plus petit que le
34
pour exprimer l'idée. Le monstre est
laid, il est horrible, mais il est, malgré
tout, presque spiritualisé.
Les Grecs et les Romains avaient usé
du réalisme, mais dans un autre style.
Eux aussi avaient concrété les idées
abstraites, les forces de la nature, les élé-
ments. La terre matérielle et nourricière
ils la personnifient ; les tremblements de
terre deviennent les Titans souterrains,
les Fleuves prennent un corps, le Soleil
est une divinité. Plus tard les vertus mo-
rales s’incarnent dans des personnages
divins et ce les artistes créent la Pallas
guerrière, la sage Minerve (fig. 3),
l’Apollon libérateur, l’Hercule domp-
teur des monstres \ »
1. Taine. Philosophie de l’art.
Plus tard encore le naturalisme for-
mera, de ees puissances bienfaisantes,
ce des figures accomplies que les poèmes
d’Homère vont asseoir sur des trônes
d’or. »
Les sculpteurs s’inspireront de ces
chants et la statuaire grecque idéalisera
la forme humaine autant que le paga-
nisme peut en rendre capables ses sculp-
teurs. Les Grecs créeront des types im-
mortels de beauté humaine, sans la gros-
sièreté du naturalisme abject, il est vrai,
mais dans des figures sans pensée. Le
ciseau grec ne produit rien pour l’esprit ;
les Vénus de Praxitèle demeurent à une
distance infinie de cette élévation de la
chaste beauté des Vierges chrétiennes.
(A suivre).
COURS A
Décoration du cercle.
Fig. 1. — Tracer un cercle de huit centim.
de diamètre et le partager en quatre parties
égales au mcq-en des axes vertical et horizontal
A B C D. Porter le rayon de B en 1 et 2, et de
A en 3 et 4 et tracer les diamètres 3. 1, 4. 2 etc.
qui diviseront le cercle en douze parties égales.
En prenant pour centres successifs les points
b D c, etc., décrire les arcs qui donneront !a
figure selon le croquis. Prendre le milieu du
rayon O A en n et décrire une circonférence
de rayon O n. Ombrer selon le croquis.
Fig. 2. — Tracer une circonférence de huit
centim. de diamètre et la partager en quatre
parties égales au moyen des diamètres A B C D.
Prendre le milieu de CA et de A B et des points
1 et 2 abaisser des verticales en 4 et 3. Cons-
truire le carré 1. 2. 3. 4 et le carré d’angle
AC BD. En prenant successivement pour cen-
tres les points A, I, C, 4, B, etc., décrire les
arcs selon le croquis et ombrer à volonté.
Fig. 3. — Décrire une circonférence de huit
centim. de diamètre et tracer les diamètres A B
C D. Prendre le milieu de O A, en n et de ce
point n avec un rayon n A décrire les circon-
férences tangentes à la grande circonférence et
passant au centre O. Avec des rayons plus petits
décrire les arcs parallèles selon le croquis. Même
exercice sur les rayons C O, O D et O B.
Fig. 4. — Décrire une circonférence de huit
centim. de diamètre et la diviser en six parties
égales au moyen du rayon porté en 1, 2, 3, 4,
5, 6. Du centre 1, avec un arc plus petit que le
34