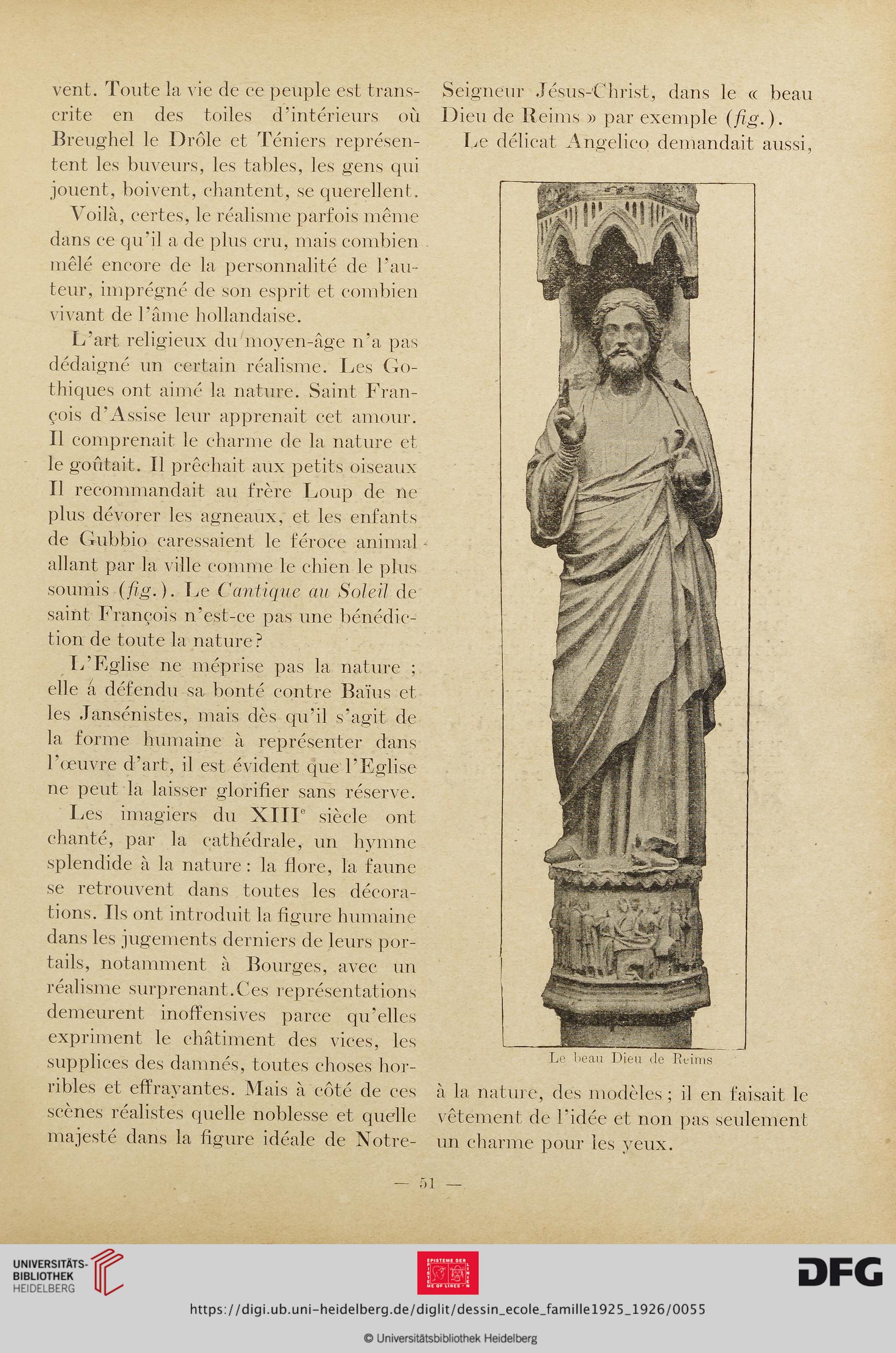vent. Toute la vie de ce peuple est trans-
crite en des toiles d’intérieurs où
Breughel le Drôle et Téniers représen-
tent les buveurs, les tables, les gens qui
jouent, boivent, chantent, se querellent.
Voilà, certes, le réalisme parfois même
dans ce qu’il a de plus cru, mais combien
mêlé encore de la personnalité de l’au-
teur, imprégné de son esprit et combien
vivant de l’âme hollandaise.
L’art religieux du moyen-âge n’a pas
dédaigné un certain réalisme. Les Go-
thiques ont aimé la nature. Saint Fran-
çois d’Assise leur apprenait eet amour.
Il comprenait le charme de la nature et
le goûtait. Il prêchait aux petits oiseaux
Il recommandait au frère Loup de ne
plus dévorer les agneaux, et les enfants
de Gubbio caressaient le féroce animal
allant par la ville comme le chien le plus
soumis (jûg.). Le Cantique au Soleil de
saint François n’est-ce pas une bénédic-
tion de toute la nature?
L’Eglise ne méprise pas la nature ;
elle â défendu sa bonté contre Baïus et
les Jansénistes, mais dès qu’il s’agit de
la forme humaine à représenter dans
l’œuvre d’art, il est évident que l'Eglise
ne peut la laisser glorifier sans réserve.
Les imagiers du XIIIe siècle ont
chanté, par la cathédrale, un hymne
splendide à la nature : la flore, la faune
se retrouvent dans toutes les décora-
tions. Ils ont introduit la figure humaine
dans les jugements derniers de leurs por-
tails, notamment à Bourges, avec un
réalisme surprenant.Ces représentations
demeurent inoffensives parce qu’elles
expriment le châtiment des vices, les
supplices des damnés, toutes choses hor-
ribles et effrayantes. Mais à côté de ces
scènes réalistes quelle noblesse et quelle
majesté dans la figure idéale de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, dans le « beau
Dieu de Reims » par exemple (fig.).
Le délicat Angelico demandait aussi,
Le beau Dieu de Reims
à la nature, des modèles ; il en faisait le
vêtement de l'idée et non pas seulement
un charme pour les yeux.
— 51 —
crite en des toiles d’intérieurs où
Breughel le Drôle et Téniers représen-
tent les buveurs, les tables, les gens qui
jouent, boivent, chantent, se querellent.
Voilà, certes, le réalisme parfois même
dans ce qu’il a de plus cru, mais combien
mêlé encore de la personnalité de l’au-
teur, imprégné de son esprit et combien
vivant de l’âme hollandaise.
L’art religieux du moyen-âge n’a pas
dédaigné un certain réalisme. Les Go-
thiques ont aimé la nature. Saint Fran-
çois d’Assise leur apprenait eet amour.
Il comprenait le charme de la nature et
le goûtait. Il prêchait aux petits oiseaux
Il recommandait au frère Loup de ne
plus dévorer les agneaux, et les enfants
de Gubbio caressaient le féroce animal
allant par la ville comme le chien le plus
soumis (jûg.). Le Cantique au Soleil de
saint François n’est-ce pas une bénédic-
tion de toute la nature?
L’Eglise ne méprise pas la nature ;
elle â défendu sa bonté contre Baïus et
les Jansénistes, mais dès qu’il s’agit de
la forme humaine à représenter dans
l’œuvre d’art, il est évident que l'Eglise
ne peut la laisser glorifier sans réserve.
Les imagiers du XIIIe siècle ont
chanté, par la cathédrale, un hymne
splendide à la nature : la flore, la faune
se retrouvent dans toutes les décora-
tions. Ils ont introduit la figure humaine
dans les jugements derniers de leurs por-
tails, notamment à Bourges, avec un
réalisme surprenant.Ces représentations
demeurent inoffensives parce qu’elles
expriment le châtiment des vices, les
supplices des damnés, toutes choses hor-
ribles et effrayantes. Mais à côté de ces
scènes réalistes quelle noblesse et quelle
majesté dans la figure idéale de Notre-
Seigneur Jésus-Christ, dans le « beau
Dieu de Reims » par exemple (fig.).
Le délicat Angelico demandait aussi,
Le beau Dieu de Reims
à la nature, des modèles ; il en faisait le
vêtement de l'idée et non pas seulement
un charme pour les yeux.
— 51 —