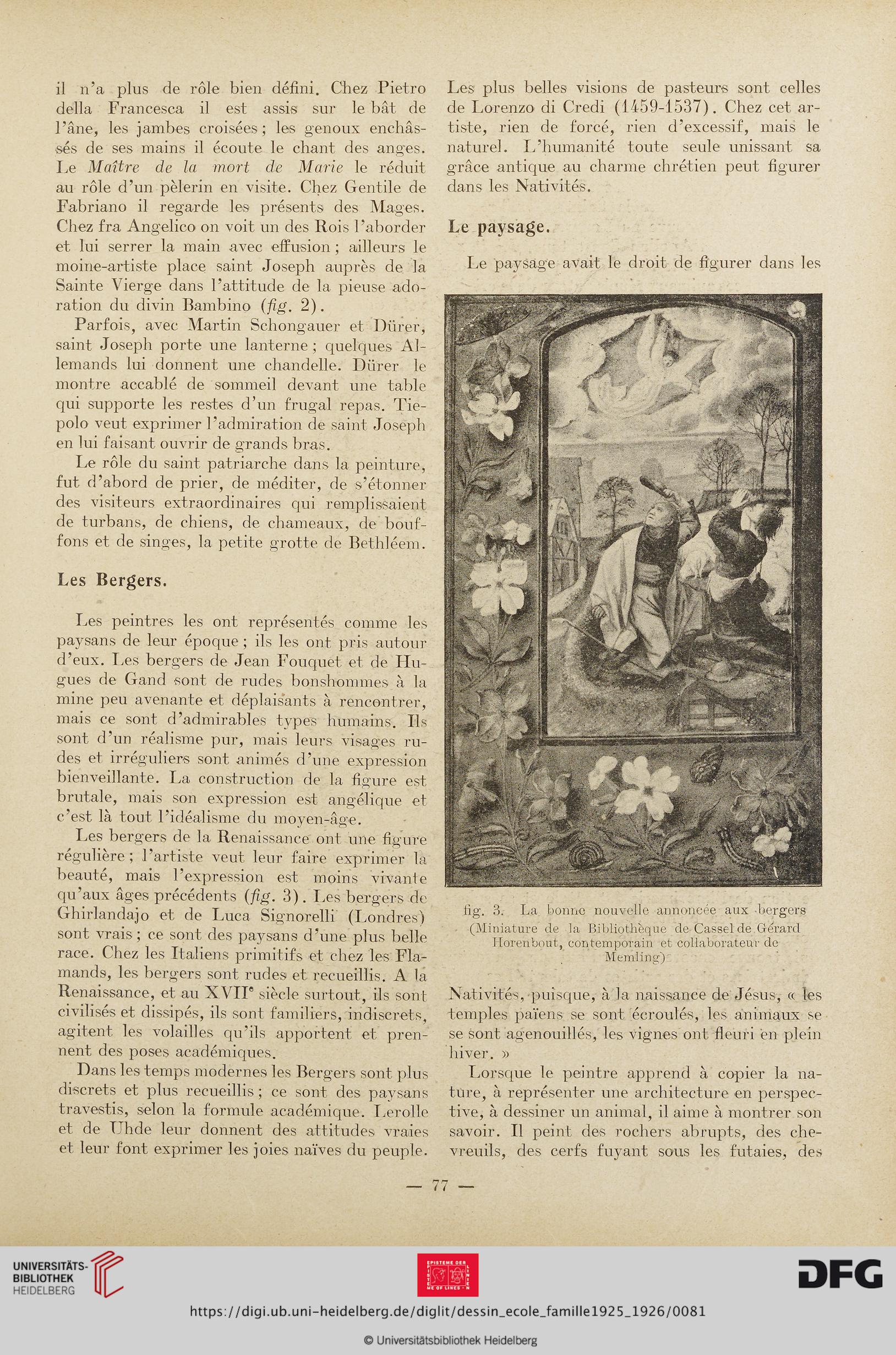il n’a. plus de rôle bien défini. Chez Pietro
délia Francesca il est assis sur le bât de
l’âne, les jambes croisées; les genoux enchâs-
sés de ses mains il écoute le chant des anges.
Le Maître de la mort de Marie le réduit
au rôle d’un pèlerin en visite. Chez Gentile de
Fabriano il regarde les présents des Mages.
Chez fra Angelico on voit un des Rois l’aborder
et lui serrer la main avec effusion ; ailleurs le
moine-artiste place saint Joseph auprès de la
Sainte Vierge dans l’attitude de la pieuse ado-
ration du divin Bambino (fig. 2).
Parfois, avec Martin Schongauer et Dürer,
saint Joseph porte une lanterne; quelques Al-
lemands lui donnent une chandelle. Dürer le
montre accablé de sommeil devant une table
qui supporte les restes d’un frugal repas, Tie-
polo veut exprimer l’admiration de saint Joseph
en lui faisant ouvrir de grands bras.
Le rôle du saint patriarche dans la peinture,
fut d’abord de prier, de méditer, de s’étonner
des visiteurs extraordinaires qui remplissaient
de turbans, de chiens, de chameaux, de bouf-
fons et de singes, la petite grotte de Bethléem.
Les Bergers.
Les peintres les ont représentés comme les
paysans de leur époque ; ils les ont pris autour
d’eux. Les bergers de Jean Fouquet et de Hu-
gues de Gand sont de rudes bonshommes à la
mine peu avenante et déplaisants à rencontrer,
mais ce sont d’admirables types humains. Ils
sont d’un réalisme pur, mais leurs visages ru-
des et irréguliers sont animés d’une expression
bienveillante. La construction de 1a. figure est
brutale, mais son expression est angélique et
c’est là tout l’idéalisme du moyen-âge.
Les bergers de la Renaissance ont une figure
régulière ; l’artiste veut leur faire exprimer la
beauté, mais l’expression est moins vivante
qu’aux âges précédents (fig. 3). Les bergers de
Ghirlandajo et de Luca Signorelli (Londres)
sont vrais ; ce sont des paysans d’une plus belle
race. Chez les Italiens primitifs et chez les Fla-
mands, les bergers sont rudes et recueillis. A la
Renaissance, et au XVII9 siècle surtout, ils sont
civilisés et dissipés, ils sont familiers, indiscrets,
agitent les volailles qu’ils apportent et pren-
nent des poses académiques.
Dans les temps modernes les Bergers sont plus
discrets et plus recueillis ; ce sont des paysans
travestis, selon la formule académique. Lerolle
et de IJhde leur donnent des attitudes vraies
et leur font exprimer les joies naïves du peuple.
Les plus belles visions de pasteurs sont celles
de Lorenzo di Credi (1459-1537). Chez cet ar-
tiste, rien de forcé, rien d’excessif, mais le
naturel. L’humanité toute seule unissant sa
grâce antique au charme chrétien peut figurer
dans les Nativités.
Le paysage.
Le paysage avait le droit de figurer dans les
fig. 3. La. bonne nouvelle annoncée aux -bergers
(Miniature de la Bibliothèque de Cassel de.Gérard
Horenbout, contemporain et collaborateur de
Memling)
Nativités, puisque, à la naissance de Jésus, « les
temples païens se sont écroulés, les animaux se
se sont, agenouillés, les vignes ont fleuri en plein
hiver. »
Lorsque le peintre apprend à copier la na-
ture, à représenter une architecture en perspec-
tive, à dessiner un animal, il aime à montrer son
savoir. Il peint des rochers abrupts, des che-
vreuils, des cerfs fuyant sous les futaies, des
77 —
délia Francesca il est assis sur le bât de
l’âne, les jambes croisées; les genoux enchâs-
sés de ses mains il écoute le chant des anges.
Le Maître de la mort de Marie le réduit
au rôle d’un pèlerin en visite. Chez Gentile de
Fabriano il regarde les présents des Mages.
Chez fra Angelico on voit un des Rois l’aborder
et lui serrer la main avec effusion ; ailleurs le
moine-artiste place saint Joseph auprès de la
Sainte Vierge dans l’attitude de la pieuse ado-
ration du divin Bambino (fig. 2).
Parfois, avec Martin Schongauer et Dürer,
saint Joseph porte une lanterne; quelques Al-
lemands lui donnent une chandelle. Dürer le
montre accablé de sommeil devant une table
qui supporte les restes d’un frugal repas, Tie-
polo veut exprimer l’admiration de saint Joseph
en lui faisant ouvrir de grands bras.
Le rôle du saint patriarche dans la peinture,
fut d’abord de prier, de méditer, de s’étonner
des visiteurs extraordinaires qui remplissaient
de turbans, de chiens, de chameaux, de bouf-
fons et de singes, la petite grotte de Bethléem.
Les Bergers.
Les peintres les ont représentés comme les
paysans de leur époque ; ils les ont pris autour
d’eux. Les bergers de Jean Fouquet et de Hu-
gues de Gand sont de rudes bonshommes à la
mine peu avenante et déplaisants à rencontrer,
mais ce sont d’admirables types humains. Ils
sont d’un réalisme pur, mais leurs visages ru-
des et irréguliers sont animés d’une expression
bienveillante. La construction de 1a. figure est
brutale, mais son expression est angélique et
c’est là tout l’idéalisme du moyen-âge.
Les bergers de la Renaissance ont une figure
régulière ; l’artiste veut leur faire exprimer la
beauté, mais l’expression est moins vivante
qu’aux âges précédents (fig. 3). Les bergers de
Ghirlandajo et de Luca Signorelli (Londres)
sont vrais ; ce sont des paysans d’une plus belle
race. Chez les Italiens primitifs et chez les Fla-
mands, les bergers sont rudes et recueillis. A la
Renaissance, et au XVII9 siècle surtout, ils sont
civilisés et dissipés, ils sont familiers, indiscrets,
agitent les volailles qu’ils apportent et pren-
nent des poses académiques.
Dans les temps modernes les Bergers sont plus
discrets et plus recueillis ; ce sont des paysans
travestis, selon la formule académique. Lerolle
et de IJhde leur donnent des attitudes vraies
et leur font exprimer les joies naïves du peuple.
Les plus belles visions de pasteurs sont celles
de Lorenzo di Credi (1459-1537). Chez cet ar-
tiste, rien de forcé, rien d’excessif, mais le
naturel. L’humanité toute seule unissant sa
grâce antique au charme chrétien peut figurer
dans les Nativités.
Le paysage.
Le paysage avait le droit de figurer dans les
fig. 3. La. bonne nouvelle annoncée aux -bergers
(Miniature de la Bibliothèque de Cassel de.Gérard
Horenbout, contemporain et collaborateur de
Memling)
Nativités, puisque, à la naissance de Jésus, « les
temples païens se sont écroulés, les animaux se
se sont, agenouillés, les vignes ont fleuri en plein
hiver. »
Lorsque le peintre apprend à copier la na-
ture, à représenter une architecture en perspec-
tive, à dessiner un animal, il aime à montrer son
savoir. Il peint des rochers abrupts, des che-
vreuils, des cerfs fuyant sous les futaies, des
77 —