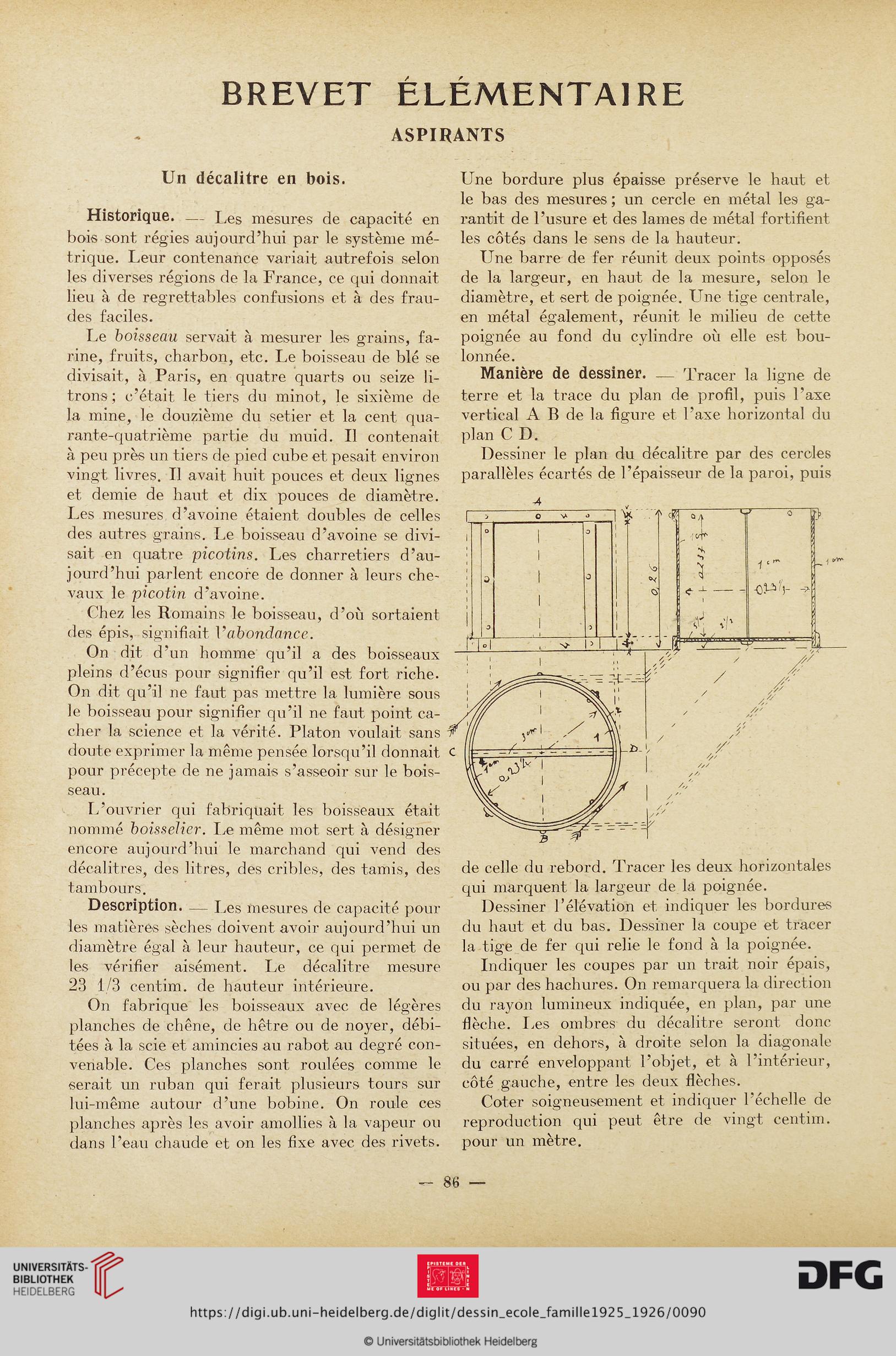BREVET ÉLÉMENTAIRE
ASPIRANTS
Un décalitre en bois.
Historique. — Les mesures de capacité en
bois sont régies aujourd’hui par le système mé-
trique. Leur contenance variait autrefois selon
les diverses régions de la France, ce qui donnait
lieu à de regrettables confusions et à des frau-
des faciles.
Le boisseau servait à mesurer les grains, fa-
rine, fruits, charbon, etc. Le boisseau de blé se
divisait, à Paris, en quatre quarts ou seize li-
trons; c’était le tiers du minot, le sixième de
la mine, le douzième du setier et la cent qua-
rante-quatrième partie du muid. Il contenait
à peu près un tiers de pied cube et pesait environ
vingt livres. Il avait huit pouces et deux lignes
et demie de haut et dix pouces de diamètre.
Les mesures d’avoine étaient doubles de celles
des autres grains. Le boisseau d’avoine se divi-
sait en quatre picotins. Les charretiers d’au-
jourd’hui parlent encore de donner à leurs che-
vaux le picotin d’avoine.
Chez les Romains le boisseau, d’où sortaient
des épis, signifiait Vabondance.
On dit d’un homme qu’il a des boisseaux
pleins d’écus pour signifier qu’il est fort riche.
On dit qu’il ne faut pas mettre la lumière sous
le boisseau pour signifier qu’il ne faut point ca-
cher la science et la vérité. Platon voulait sans
doute exprimer la même pensée lorsqu’il donnait
pour précepte de ne jamais s’asseoir sur le bois-
seau.
L’ouvrier qui fabriquait les boisseaux était
nommé boisselier. Le même mot sert à désigner
encore aujourd’hui le marchand qui vend des
décalitres, des litres, des cribles, des tamis, des
tambours.
Description. — Les mesures de capacité pour
les matières sèches doivent avoir aujourd’hui un
diamètre égal à leur hauteur, ce qui permet de
les vérifier aisément. Le décalitre mesure
23 1/3 centim. de hauteur intérieure.
On fabrique les boisseaux avec de légères
planches de chêne, de hêtre ou de noyer, débi-
tées à la scie et amincies au rabot au degré con-
venable. Ces planches sont roulées comme le
serait un ruban qui ferait plusieurs tours sur
lui-même autour d’une bobine. On roule ces
planches après les avoir amollies à la vapeur ou
dans l’eau chaude et on les fixe avec des rivets.
Une bordure plus épaisse préserve le haut et
le bas des mesures; un cercle en métal les ga-
rantit de l’usure et des lames de métal fortifient
les côtés dans le sens de la hauteur.
Une barre de fer réunit deux points opposés
de la largeur, en haut de la mesure, selon le
diamètre, et sert de poignée. Une tige centrale,
en métal également, réunit le milieu de cette
poignée au fond du cylindre où elle est bou-
lonnée.
Manière de dessiner. — Tracer la ligne de
terre et la trace du plan de profil, puis l’axe
vertical A B de la figure et l’axe horizontal du
plan C D.
Dessiner le plan du décalitre par des cercles
parallèles écartés de l’épaisseur de la paroi, puis
de celle du rebord. Tracer les deux horizontales
qui marquent la largeur de la poignée.
Dessiner l’élévation et indiquer les bordures
du haut et du bas. Dessiner la coupe et tracer
la tige de fer qui relie le fond à la poignée.
Indiquer les coupes par un trait noir épais,
ou par des hachures. On remarquera la direction
du rayon lumineux indiquée, en plan, par une
flèche. Les ombres du décalitre seront donc
situées, en dehors, à droite selon la diagonale
du carré enveloppant l’objet, et à l’intérieur,
côté gauche, entre les deux flèches.
Coter soigneusement et indiquer l’échelle de
reproduction qui peut être de vingt centim.
pour un mètre.
— 86 —
ASPIRANTS
Un décalitre en bois.
Historique. — Les mesures de capacité en
bois sont régies aujourd’hui par le système mé-
trique. Leur contenance variait autrefois selon
les diverses régions de la France, ce qui donnait
lieu à de regrettables confusions et à des frau-
des faciles.
Le boisseau servait à mesurer les grains, fa-
rine, fruits, charbon, etc. Le boisseau de blé se
divisait, à Paris, en quatre quarts ou seize li-
trons; c’était le tiers du minot, le sixième de
la mine, le douzième du setier et la cent qua-
rante-quatrième partie du muid. Il contenait
à peu près un tiers de pied cube et pesait environ
vingt livres. Il avait huit pouces et deux lignes
et demie de haut et dix pouces de diamètre.
Les mesures d’avoine étaient doubles de celles
des autres grains. Le boisseau d’avoine se divi-
sait en quatre picotins. Les charretiers d’au-
jourd’hui parlent encore de donner à leurs che-
vaux le picotin d’avoine.
Chez les Romains le boisseau, d’où sortaient
des épis, signifiait Vabondance.
On dit d’un homme qu’il a des boisseaux
pleins d’écus pour signifier qu’il est fort riche.
On dit qu’il ne faut pas mettre la lumière sous
le boisseau pour signifier qu’il ne faut point ca-
cher la science et la vérité. Platon voulait sans
doute exprimer la même pensée lorsqu’il donnait
pour précepte de ne jamais s’asseoir sur le bois-
seau.
L’ouvrier qui fabriquait les boisseaux était
nommé boisselier. Le même mot sert à désigner
encore aujourd’hui le marchand qui vend des
décalitres, des litres, des cribles, des tamis, des
tambours.
Description. — Les mesures de capacité pour
les matières sèches doivent avoir aujourd’hui un
diamètre égal à leur hauteur, ce qui permet de
les vérifier aisément. Le décalitre mesure
23 1/3 centim. de hauteur intérieure.
On fabrique les boisseaux avec de légères
planches de chêne, de hêtre ou de noyer, débi-
tées à la scie et amincies au rabot au degré con-
venable. Ces planches sont roulées comme le
serait un ruban qui ferait plusieurs tours sur
lui-même autour d’une bobine. On roule ces
planches après les avoir amollies à la vapeur ou
dans l’eau chaude et on les fixe avec des rivets.
Une bordure plus épaisse préserve le haut et
le bas des mesures; un cercle en métal les ga-
rantit de l’usure et des lames de métal fortifient
les côtés dans le sens de la hauteur.
Une barre de fer réunit deux points opposés
de la largeur, en haut de la mesure, selon le
diamètre, et sert de poignée. Une tige centrale,
en métal également, réunit le milieu de cette
poignée au fond du cylindre où elle est bou-
lonnée.
Manière de dessiner. — Tracer la ligne de
terre et la trace du plan de profil, puis l’axe
vertical A B de la figure et l’axe horizontal du
plan C D.
Dessiner le plan du décalitre par des cercles
parallèles écartés de l’épaisseur de la paroi, puis
de celle du rebord. Tracer les deux horizontales
qui marquent la largeur de la poignée.
Dessiner l’élévation et indiquer les bordures
du haut et du bas. Dessiner la coupe et tracer
la tige de fer qui relie le fond à la poignée.
Indiquer les coupes par un trait noir épais,
ou par des hachures. On remarquera la direction
du rayon lumineux indiquée, en plan, par une
flèche. Les ombres du décalitre seront donc
situées, en dehors, à droite selon la diagonale
du carré enveloppant l’objet, et à l’intérieur,
côté gauche, entre les deux flèches.
Coter soigneusement et indiquer l’échelle de
reproduction qui peut être de vingt centim.
pour un mètre.
— 86 —