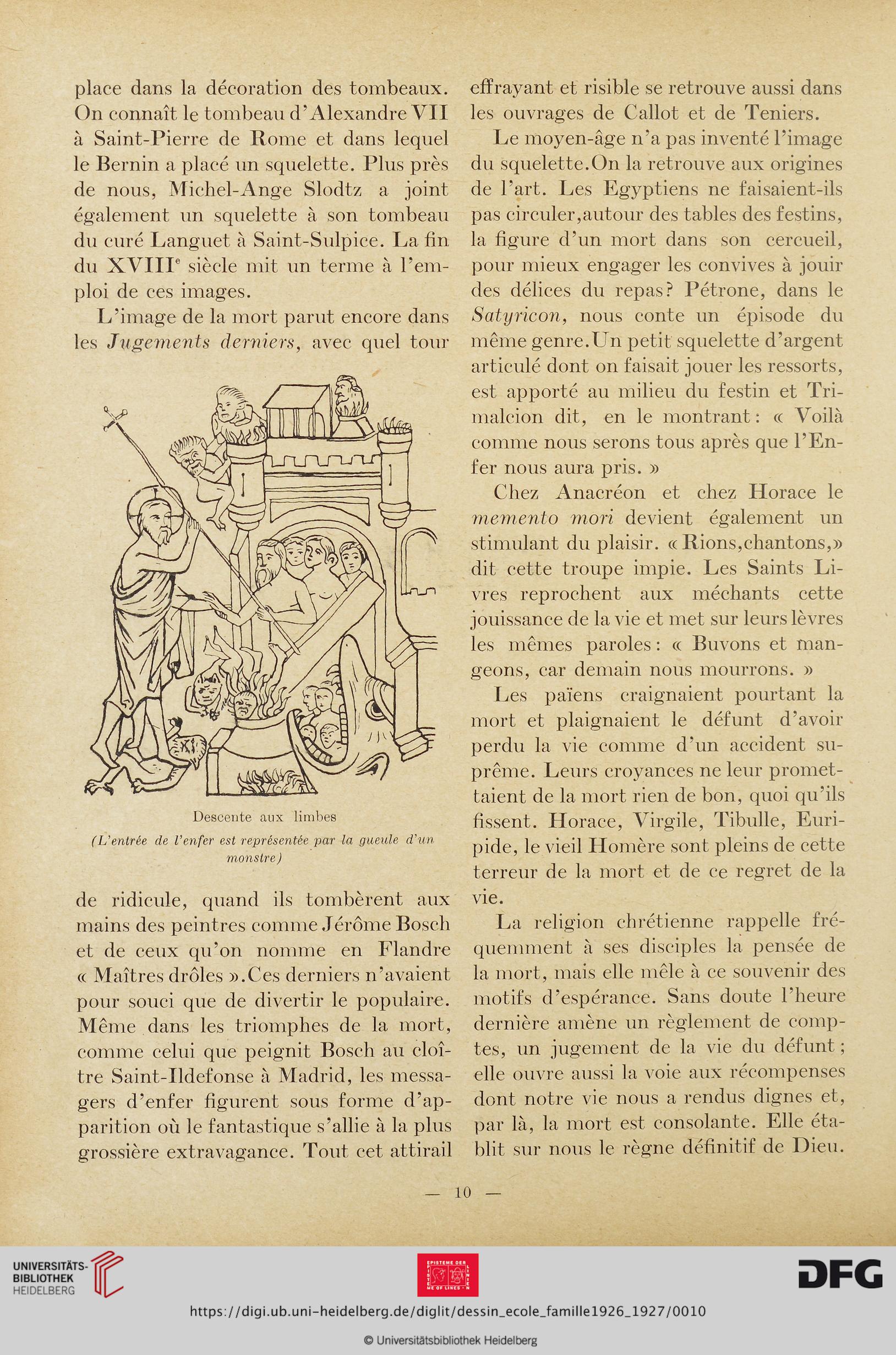place dans la décoration des tombeaux.
On connaît le tombeau d’Alexandre VII
à Saint-Pierre de Rome et dans lequel
le Bernin a placé un squelette. Plus près
de nous, Michel-Ange Slodtz a joint
également un squelette à son tombeau
du curé Languet à Saint-Sulpice. La fin
du XVIIIe siècle mit un terme à l’em-
ploi de ces images.
L’image de la mort parut encore dans
les Jugements derniers, avec quel tour
(L’entrée de l’enfer est représentée par la gueule d’un
monstre )
de ridicule, quand ils tombèrent aux
mains des peintres comme Jérôme Bosch
et de ceux qu’on nomme en Flandre
« Maîtres drôles ».Ces derniers n’avaient
pour souci que de divertir le populaire.
Même dans les triomphes de la mort,
comme celui que peignit Bosch au cloî-
tre Saint-Ildefonse à Madrid, les messa-
gers d’enfer figurent sous forme d’ap-
parition où le fantastique s’allie à la plus
grossière extravagance. Tout cet attirail
effrayant et risible se retrouve aussi dans
les ouvrages de Callot et de Teniers.
Le moyen-âge n’a pas inventé l’image
du squelette.On la retrouve aux origines
de l’art. Les Egyptiens ne faisaient-ils
pas circuler,autour des tables des festins,
la figure d’un mort dans son cercueil,
pour mieux engager les convives à jouir
des délices du repas? Pétrone, dans le
Satyricon, nous conte un épisode du
même genre.Un petit, squelette d’argent
articulé dont on faisait jouer les ressorts,
est apporté au milieu du festin et Tri-
malcion dit, en le montrant: (c Voilà
comme nous serons tous après que l’En-
fer nous aura pris. »
Chez Anacréon et chez Horace le
memento mori devient également un
stimulant du plaisir. « Rions,chantons,»
dit cette troupe impie. Les Saints Li-
vres reprochent aux méchants cette
jouissance de la vie et met sur leurs lèvres
les mêmes paroles : « Buvons et man-
geons, car demain nous mourrons. »
Les païens craignaient pourtant la
mort et plaignaient le défunt d’avoir
perdu la vie comme d’un accident su-
prême. Leurs croyances ne leur promet-
taient de la mort rien de bon, quoi qu’ils
fissent. Horace, Virgile, Tibulle, Euri-
pide, le vieil Homère sont pleins de cette
terreur de la mort et de ce regret de la
vie.
La religion chrétienne rappelle fré-
quemment à ses disciples la pensée de
la mort, mais elle mêle à ce souvenir des
motifs d’espérance. Sans doute l’heure
dernière amène un règlement de comp-
tes, un jugement de la vie du défunt ;
elle ouvre aussi la voie aux récompenses
dont notre vie nous a rendus dignes et,
par là, la mort est consolante. Elle éta-
blit sur nous le règne définitif de Dieu.
10
On connaît le tombeau d’Alexandre VII
à Saint-Pierre de Rome et dans lequel
le Bernin a placé un squelette. Plus près
de nous, Michel-Ange Slodtz a joint
également un squelette à son tombeau
du curé Languet à Saint-Sulpice. La fin
du XVIIIe siècle mit un terme à l’em-
ploi de ces images.
L’image de la mort parut encore dans
les Jugements derniers, avec quel tour
(L’entrée de l’enfer est représentée par la gueule d’un
monstre )
de ridicule, quand ils tombèrent aux
mains des peintres comme Jérôme Bosch
et de ceux qu’on nomme en Flandre
« Maîtres drôles ».Ces derniers n’avaient
pour souci que de divertir le populaire.
Même dans les triomphes de la mort,
comme celui que peignit Bosch au cloî-
tre Saint-Ildefonse à Madrid, les messa-
gers d’enfer figurent sous forme d’ap-
parition où le fantastique s’allie à la plus
grossière extravagance. Tout cet attirail
effrayant et risible se retrouve aussi dans
les ouvrages de Callot et de Teniers.
Le moyen-âge n’a pas inventé l’image
du squelette.On la retrouve aux origines
de l’art. Les Egyptiens ne faisaient-ils
pas circuler,autour des tables des festins,
la figure d’un mort dans son cercueil,
pour mieux engager les convives à jouir
des délices du repas? Pétrone, dans le
Satyricon, nous conte un épisode du
même genre.Un petit, squelette d’argent
articulé dont on faisait jouer les ressorts,
est apporté au milieu du festin et Tri-
malcion dit, en le montrant: (c Voilà
comme nous serons tous après que l’En-
fer nous aura pris. »
Chez Anacréon et chez Horace le
memento mori devient également un
stimulant du plaisir. « Rions,chantons,»
dit cette troupe impie. Les Saints Li-
vres reprochent aux méchants cette
jouissance de la vie et met sur leurs lèvres
les mêmes paroles : « Buvons et man-
geons, car demain nous mourrons. »
Les païens craignaient pourtant la
mort et plaignaient le défunt d’avoir
perdu la vie comme d’un accident su-
prême. Leurs croyances ne leur promet-
taient de la mort rien de bon, quoi qu’ils
fissent. Horace, Virgile, Tibulle, Euri-
pide, le vieil Homère sont pleins de cette
terreur de la mort et de ce regret de la
vie.
La religion chrétienne rappelle fré-
quemment à ses disciples la pensée de
la mort, mais elle mêle à ce souvenir des
motifs d’espérance. Sans doute l’heure
dernière amène un règlement de comp-
tes, un jugement de la vie du défunt ;
elle ouvre aussi la voie aux récompenses
dont notre vie nous a rendus dignes et,
par là, la mort est consolante. Elle éta-
blit sur nous le règne définitif de Dieu.
10