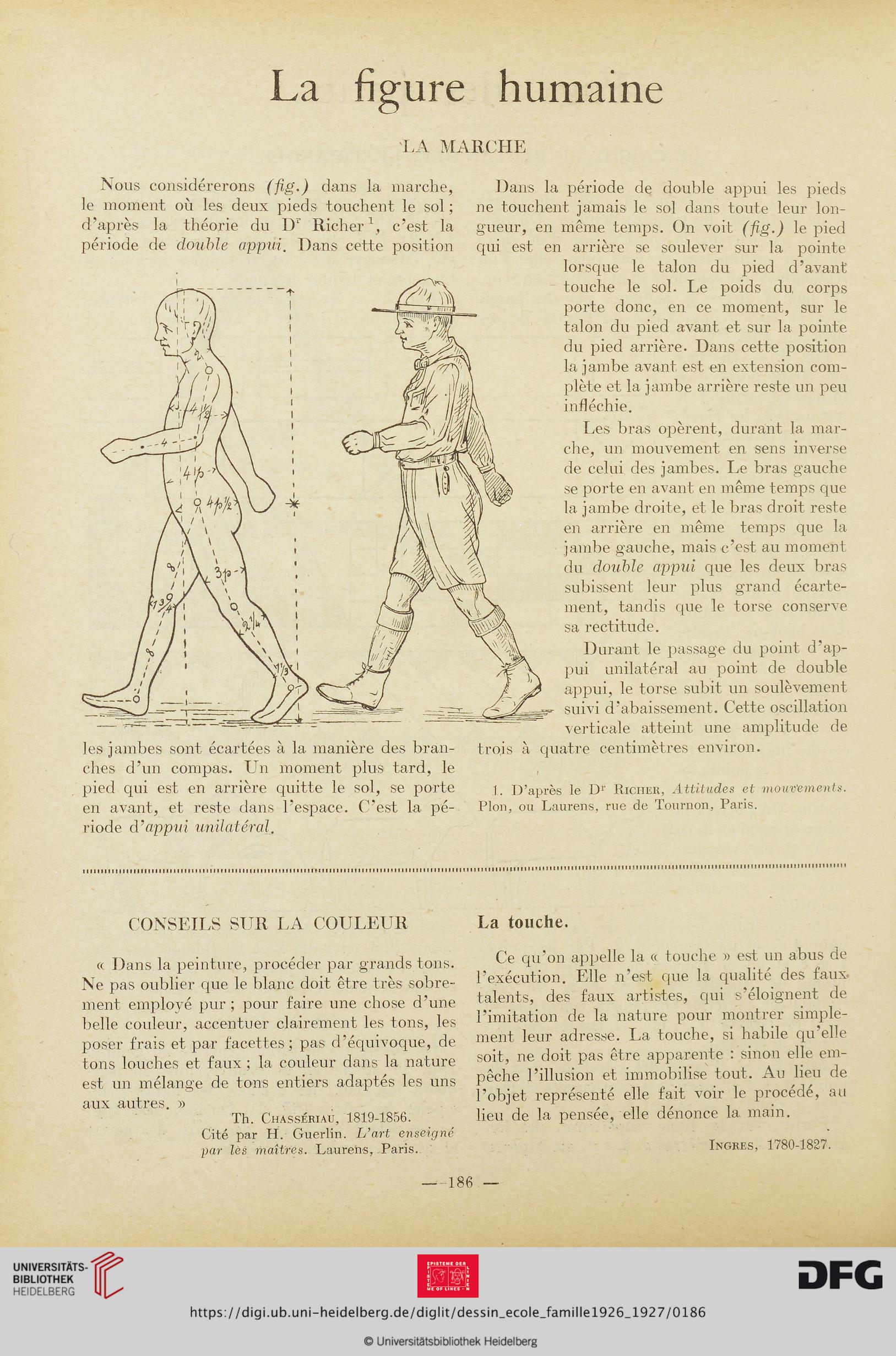La figure humaine
LA MARCHE
Nous considérerons (fig.) dans 1a. marche,
le moment où les deux pieds touchent le sol ;
d’après la théorie du Dr Richer c’est la
période de double appui. Dans cette position
les jambes sont écartées à la manière des bran-
ches d’un compas. Un moment plus tard, le
pied qui est en arrière quitte le sol, se porte
en avant, et reste dans l’espace. C’est la pé-
riode d’appui unilatéral.
Dans la période de double appui les pieds
ne touchent jamais le sol dans toute leur lon-
gueur, en même temps. On voit (fig.) le pied
qui est en arrière se soulever sur la pointe
lorsque le talon du pied d’avant'
touche le sol. Le poids du corps
porte donc, en ce moment, sur le
talon du pied avant et sur la pointe
du pied arrière. Dans cette position
la jambe avant est en extension com-
plète et la jambe arrière reste un peu
infléchie.
Les bras opèrent, durant la mar-
che, un mouvement en sens inverse
de celui des jambes. Le bras gauche
se porte en avant en même temps que
la jambe droite, et le bras droit reste
en arrière en même temps que la
jambe gauche, mais c’est au moment
du double appui que les deux bras
subissent leur plus grand écarte-
ment, tandis que le torse conserve
sa rectitude.
Durant le passage du point d’ap-
pui unilatéral au point de double
appui, le torse subit un soulèvement
suivi d’abaissement. Cette oscillation
verticale atteint une amplitude de
trois à quatre centimètres environ.
1. D’après le Dr Richer, Attitudes et mouvements.
Plon, ou Laurens, rue de Tournon, Paris.
CONSEILS SUR LA COULEUR La touche.
« Dans la peinture, procéder par grands tons.
Ne pas oublier que le blanc doit être très sobre-
ment employé pur ; pour faire une chose d’une
belle couleur, accentuer clairement les tons, les
poser frais et par facettes; pas d’équivoque, de
tons louches et faux ; la couleur dans la nature
est un mélange de tons entiers adaptés les uns
aux autres. »
Th. Chassériau, 1819-1856.
Cité par H. Guerlin. L’art enseigné
par lès maîtres. Laurens, Paris.
Ce qu’on appelle la ce touche » est un abus de
l’exécution. Elle n’est que la qualité des faux
talents, des faux artistes, qui s’éloignent de
l’imitation de la nature pour montrer simple-
ment leur adresse. La touche, si habile qu'elle
soit, ne doit pas être apparente : sinon elle em-
pêche l’illusion et immobilise tout. Au lieu de
l’objet représenté elle fait voir le procédé, au
lieu de la pensée, elle dénonce la main.
Ingres, 1780-1827.
— 186 —
LA MARCHE
Nous considérerons (fig.) dans 1a. marche,
le moment où les deux pieds touchent le sol ;
d’après la théorie du Dr Richer c’est la
période de double appui. Dans cette position
les jambes sont écartées à la manière des bran-
ches d’un compas. Un moment plus tard, le
pied qui est en arrière quitte le sol, se porte
en avant, et reste dans l’espace. C’est la pé-
riode d’appui unilatéral.
Dans la période de double appui les pieds
ne touchent jamais le sol dans toute leur lon-
gueur, en même temps. On voit (fig.) le pied
qui est en arrière se soulever sur la pointe
lorsque le talon du pied d’avant'
touche le sol. Le poids du corps
porte donc, en ce moment, sur le
talon du pied avant et sur la pointe
du pied arrière. Dans cette position
la jambe avant est en extension com-
plète et la jambe arrière reste un peu
infléchie.
Les bras opèrent, durant la mar-
che, un mouvement en sens inverse
de celui des jambes. Le bras gauche
se porte en avant en même temps que
la jambe droite, et le bras droit reste
en arrière en même temps que la
jambe gauche, mais c’est au moment
du double appui que les deux bras
subissent leur plus grand écarte-
ment, tandis que le torse conserve
sa rectitude.
Durant le passage du point d’ap-
pui unilatéral au point de double
appui, le torse subit un soulèvement
suivi d’abaissement. Cette oscillation
verticale atteint une amplitude de
trois à quatre centimètres environ.
1. D’après le Dr Richer, Attitudes et mouvements.
Plon, ou Laurens, rue de Tournon, Paris.
CONSEILS SUR LA COULEUR La touche.
« Dans la peinture, procéder par grands tons.
Ne pas oublier que le blanc doit être très sobre-
ment employé pur ; pour faire une chose d’une
belle couleur, accentuer clairement les tons, les
poser frais et par facettes; pas d’équivoque, de
tons louches et faux ; la couleur dans la nature
est un mélange de tons entiers adaptés les uns
aux autres. »
Th. Chassériau, 1819-1856.
Cité par H. Guerlin. L’art enseigné
par lès maîtres. Laurens, Paris.
Ce qu’on appelle la ce touche » est un abus de
l’exécution. Elle n’est que la qualité des faux
talents, des faux artistes, qui s’éloignent de
l’imitation de la nature pour montrer simple-
ment leur adresse. La touche, si habile qu'elle
soit, ne doit pas être apparente : sinon elle em-
pêche l’illusion et immobilise tout. Au lieu de
l’objet représenté elle fait voir le procédé, au
lieu de la pensée, elle dénonce la main.
Ingres, 1780-1827.
— 186 —