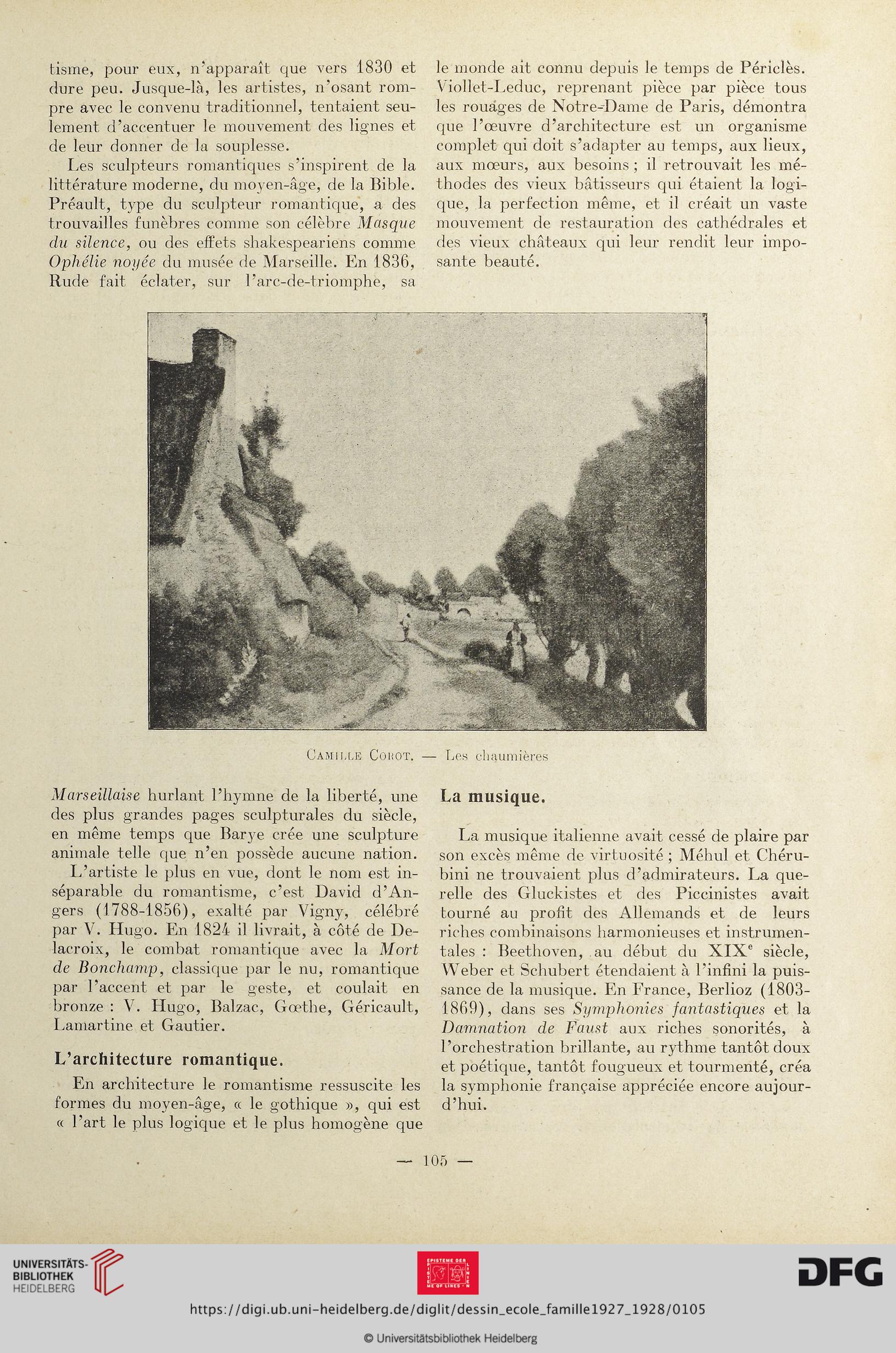tisme, pour eux, n’apparaît que vers 1830 et
dure peu. Jusque-là, les artistes, n’osant rom-
pre avec le convenu traditionnel, tentaient seu-
lement d’accentuer le mouvement des lignes et
de leur donner de la souplesse.
Les sculpteurs romantiques s’inspirent de la
littérature moderne, du moyen-âge, de la Bible.
Préault, type du sculpteur romantique, a des
trouvailles funèbres comme son célèbre Masque
du silence, ou des effets shakespeariens comme
Ophélie noyée du musée de Marseille. En 1836,
Rude fait éclater, sur l’arc-de-triomphe, sa
Marseillaise hurlant l’hymne de la liberté, une
des plus grandes pages sculpturales du siècle,
en même temps que Barye crée une sculpture
animale telle que n’en possède aucune nation.
L’artiste le plus en vue, dont le nom est in-
séparable du romantisme, c’est David d’An-
gers (1788-1856), exalté par Vigny, célébré
par V. Hugo. En 1824 il livrait, à côté de De-
lacroix, le combat romantique avec la Mort
de Bonchamp, classique par le nu, romantique
par l’accent et par le geste, et coulait en
bronze : V. Hugo, Balzac, Goethe, Géricault,
Lamartine et Gautier.
L’architecture romantique.
En architecture le romantisme ressuscite les
formes du moyen-âge, « le gothique », qui est
« l’art le plus logique et le plus homogène que
le monde ait connu depuis le temps de Périclès.
Viollet-Leduc, reprenant pièce par pièce tous
les rouages de Notre-Dame de Paris, démontra
que l’œuvre d’architecture est un organisme
complet qui doit s’adapter au temps, aux lieux,
aux mœurs, aux besoins ; il retrouvait les mé-
thodes des vieux bâtisseurs qui étaient la logi-
que, la perfection même, et il créait un vaste
mouvement de restauration des cathédrales et
des vieux châteaux qui leur rendit leur impo-
sante beauté.
La musique.
La musique italienne avait cessé de plaire par
son excès même de virtuosité ; Méhul et Chéru-
bini ne trouvaient plus d’admirateurs. La que-
relle des Gluckistes et des Piccinistes avait
tourné au profit des Allemands et de leurs
riches combinaisons harmonieuses et instrumen-
tales : Beethoven, au début du XIXe siècle,
Weber et Schubert étendaient à l’infini la puis-
sance de la musique. En France, Berlioz (1803-
1869), dans ses Symphonies fantastiques et la
Damnation de Faust aux riches sonorités, à
l’orchestration brillante, au rythme tantôt doux
et poétique, tantôt fougueux et tourmenté, créa
la symphonie française appréciée encore aujour-
d’hui.
Camille Cokot. — Les chaumières
105 —
dure peu. Jusque-là, les artistes, n’osant rom-
pre avec le convenu traditionnel, tentaient seu-
lement d’accentuer le mouvement des lignes et
de leur donner de la souplesse.
Les sculpteurs romantiques s’inspirent de la
littérature moderne, du moyen-âge, de la Bible.
Préault, type du sculpteur romantique, a des
trouvailles funèbres comme son célèbre Masque
du silence, ou des effets shakespeariens comme
Ophélie noyée du musée de Marseille. En 1836,
Rude fait éclater, sur l’arc-de-triomphe, sa
Marseillaise hurlant l’hymne de la liberté, une
des plus grandes pages sculpturales du siècle,
en même temps que Barye crée une sculpture
animale telle que n’en possède aucune nation.
L’artiste le plus en vue, dont le nom est in-
séparable du romantisme, c’est David d’An-
gers (1788-1856), exalté par Vigny, célébré
par V. Hugo. En 1824 il livrait, à côté de De-
lacroix, le combat romantique avec la Mort
de Bonchamp, classique par le nu, romantique
par l’accent et par le geste, et coulait en
bronze : V. Hugo, Balzac, Goethe, Géricault,
Lamartine et Gautier.
L’architecture romantique.
En architecture le romantisme ressuscite les
formes du moyen-âge, « le gothique », qui est
« l’art le plus logique et le plus homogène que
le monde ait connu depuis le temps de Périclès.
Viollet-Leduc, reprenant pièce par pièce tous
les rouages de Notre-Dame de Paris, démontra
que l’œuvre d’architecture est un organisme
complet qui doit s’adapter au temps, aux lieux,
aux mœurs, aux besoins ; il retrouvait les mé-
thodes des vieux bâtisseurs qui étaient la logi-
que, la perfection même, et il créait un vaste
mouvement de restauration des cathédrales et
des vieux châteaux qui leur rendit leur impo-
sante beauté.
La musique.
La musique italienne avait cessé de plaire par
son excès même de virtuosité ; Méhul et Chéru-
bini ne trouvaient plus d’admirateurs. La que-
relle des Gluckistes et des Piccinistes avait
tourné au profit des Allemands et de leurs
riches combinaisons harmonieuses et instrumen-
tales : Beethoven, au début du XIXe siècle,
Weber et Schubert étendaient à l’infini la puis-
sance de la musique. En France, Berlioz (1803-
1869), dans ses Symphonies fantastiques et la
Damnation de Faust aux riches sonorités, à
l’orchestration brillante, au rythme tantôt doux
et poétique, tantôt fougueux et tourmenté, créa
la symphonie française appréciée encore aujour-
d’hui.
Camille Cokot. — Les chaumières
105 —