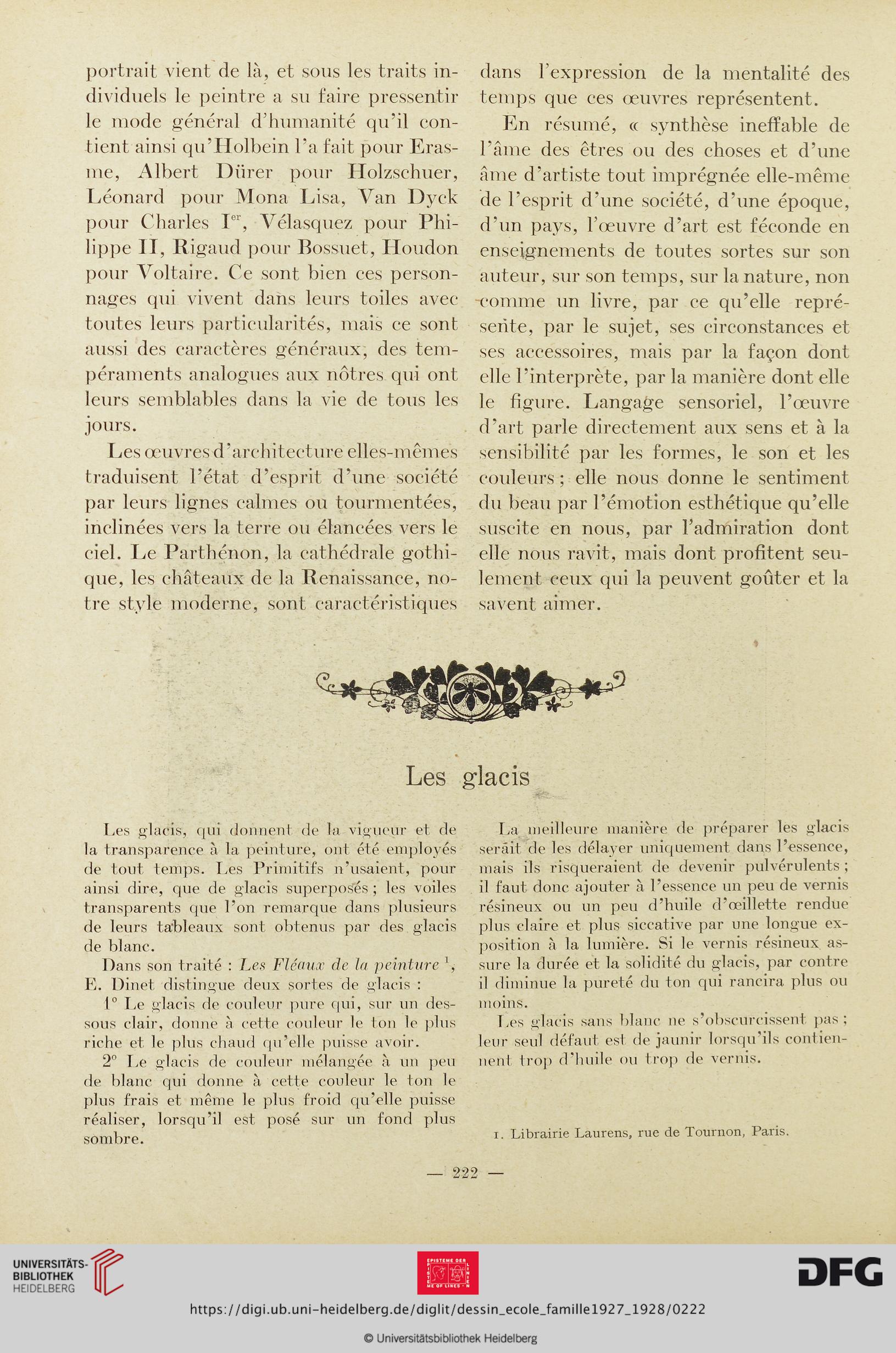portrait vient de là, et sous les traits in-
dividuels le peintre a su faire pressentir
le mode général d’humanité qu’il con-
tient ainsi qu’Holbein l’a fait pour Eras-
me, Albert Dürer pour Holzschuer,
Léonard pour Mona Lisa, Van Dyck
pour Charles Ier, Vélasquez pour Phi-
lippe II, Rigaud pour Bossuet, Houdon
pour Voltaire. Ce sont bien ces person-
nages qui vivent dans leurs toiles avec
toutes leurs particularités, mais ce sont
aussi des caractères généraux, des tem-
péraments analogues aux nôtres qui ont
leurs semblables dans la vie de tous les
jours.
Les œuvres d'architecture elles-mêmes
traduisent l’état d’esprit d’une société
par leurs lignes calmes ou tourmentées,
inclinées vers la terre ou élancées vers le
ciel. Le Parthénon, la cathédrale gothi-
que, les châteaux de la Renaissance, no-
tre style moderne, sont caractéristiques
dans l’expression de la mentalité des
temps que ees œuvres représentent.
En résumé, « synthèse ineffable de
l’âme des êtres ou des choses et d’une
âme d’artiste tout imprégnée elle-même
de l’esprit dhine société, d’une époque,
d’un pays, l’œuvre d’art est féconde en
enseignements de toutes sortes sur son
auteur, sur son temps, sur la nature, non
-comme un livre, par ce qu’elle repré-
sente, par le sujet, ses circonstances et
ses accessoires, mais par la façon dont
elle l’interprète, par la manière dont elle
le figure. Langage sensoriel, l’œuvre
d’art parle directement aux sens et à la
sensibilité par les formes, le son et les
couleurs ; elle nous donne le sentiment
du beau par l’émotion esthétique qu’elle
suscite en nous, par l’admiration dont
elle nous ravit, mais dont profitent seu-
lement ceux qui la peuvent goûter et la
savent aimer.
Les glacis
Les glacis, qui donnent de la vigueur et de
la transparence à la peinture, ont été employés
de tout temps. Les Primitifs n’usaient, pour
ainsi dire, que de glacis superposés ; les voiles
transparents que l’on remarque dans plusieurs
de leurs tableaux sont obtenus par des glacis
de blanc.
Dans son traité : Les Fléaux de la peinture 1,
E. Dinet distingue deux sortes de glacis :
1° Le glacis de couleur pure qui, sur un des-
sous clair, donne à cette couleur le ton le plus
riche et le plus chaud qu’elle puisse avoir.
2° Le glacis de couleur mélangée à un peu
de blanc qui donne à cette couleur le ton le
plus frais et même le plus froid qu’elle puisse
réaliser, lorsqu’il est posé sur un fond plus
sombre.
La meilleure manière de préparer les glacis
serait de les délayer uniquement dans l’essence,
mais ils risqueraient de devenir pulvérulents ;
il faut donc ajouter à l’essence un peu de vernis
résineux ou un peu d’huile d’œillette rendue
plus claire et plus siccative par une longue ex-
position à la lumière. Si le vernis résineux as-
sure la durée et la solidité du glacis, par contre
il diminue la pureté du ton qui rancira plus ou
moins.
Les glacis sans blanc ne s’obscurcissent pas ;
leur seul défaut es! de jaunir lorsqu’ils contien-
nent trop d’huile ou trop de vernis.
x. Librairie Laurens, rue de Tournon, Paris.
dividuels le peintre a su faire pressentir
le mode général d’humanité qu’il con-
tient ainsi qu’Holbein l’a fait pour Eras-
me, Albert Dürer pour Holzschuer,
Léonard pour Mona Lisa, Van Dyck
pour Charles Ier, Vélasquez pour Phi-
lippe II, Rigaud pour Bossuet, Houdon
pour Voltaire. Ce sont bien ces person-
nages qui vivent dans leurs toiles avec
toutes leurs particularités, mais ce sont
aussi des caractères généraux, des tem-
péraments analogues aux nôtres qui ont
leurs semblables dans la vie de tous les
jours.
Les œuvres d'architecture elles-mêmes
traduisent l’état d’esprit d’une société
par leurs lignes calmes ou tourmentées,
inclinées vers la terre ou élancées vers le
ciel. Le Parthénon, la cathédrale gothi-
que, les châteaux de la Renaissance, no-
tre style moderne, sont caractéristiques
dans l’expression de la mentalité des
temps que ees œuvres représentent.
En résumé, « synthèse ineffable de
l’âme des êtres ou des choses et d’une
âme d’artiste tout imprégnée elle-même
de l’esprit dhine société, d’une époque,
d’un pays, l’œuvre d’art est féconde en
enseignements de toutes sortes sur son
auteur, sur son temps, sur la nature, non
-comme un livre, par ce qu’elle repré-
sente, par le sujet, ses circonstances et
ses accessoires, mais par la façon dont
elle l’interprète, par la manière dont elle
le figure. Langage sensoriel, l’œuvre
d’art parle directement aux sens et à la
sensibilité par les formes, le son et les
couleurs ; elle nous donne le sentiment
du beau par l’émotion esthétique qu’elle
suscite en nous, par l’admiration dont
elle nous ravit, mais dont profitent seu-
lement ceux qui la peuvent goûter et la
savent aimer.
Les glacis
Les glacis, qui donnent de la vigueur et de
la transparence à la peinture, ont été employés
de tout temps. Les Primitifs n’usaient, pour
ainsi dire, que de glacis superposés ; les voiles
transparents que l’on remarque dans plusieurs
de leurs tableaux sont obtenus par des glacis
de blanc.
Dans son traité : Les Fléaux de la peinture 1,
E. Dinet distingue deux sortes de glacis :
1° Le glacis de couleur pure qui, sur un des-
sous clair, donne à cette couleur le ton le plus
riche et le plus chaud qu’elle puisse avoir.
2° Le glacis de couleur mélangée à un peu
de blanc qui donne à cette couleur le ton le
plus frais et même le plus froid qu’elle puisse
réaliser, lorsqu’il est posé sur un fond plus
sombre.
La meilleure manière de préparer les glacis
serait de les délayer uniquement dans l’essence,
mais ils risqueraient de devenir pulvérulents ;
il faut donc ajouter à l’essence un peu de vernis
résineux ou un peu d’huile d’œillette rendue
plus claire et plus siccative par une longue ex-
position à la lumière. Si le vernis résineux as-
sure la durée et la solidité du glacis, par contre
il diminue la pureté du ton qui rancira plus ou
moins.
Les glacis sans blanc ne s’obscurcissent pas ;
leur seul défaut es! de jaunir lorsqu’ils contien-
nent trop d’huile ou trop de vernis.
x. Librairie Laurens, rue de Tournon, Paris.