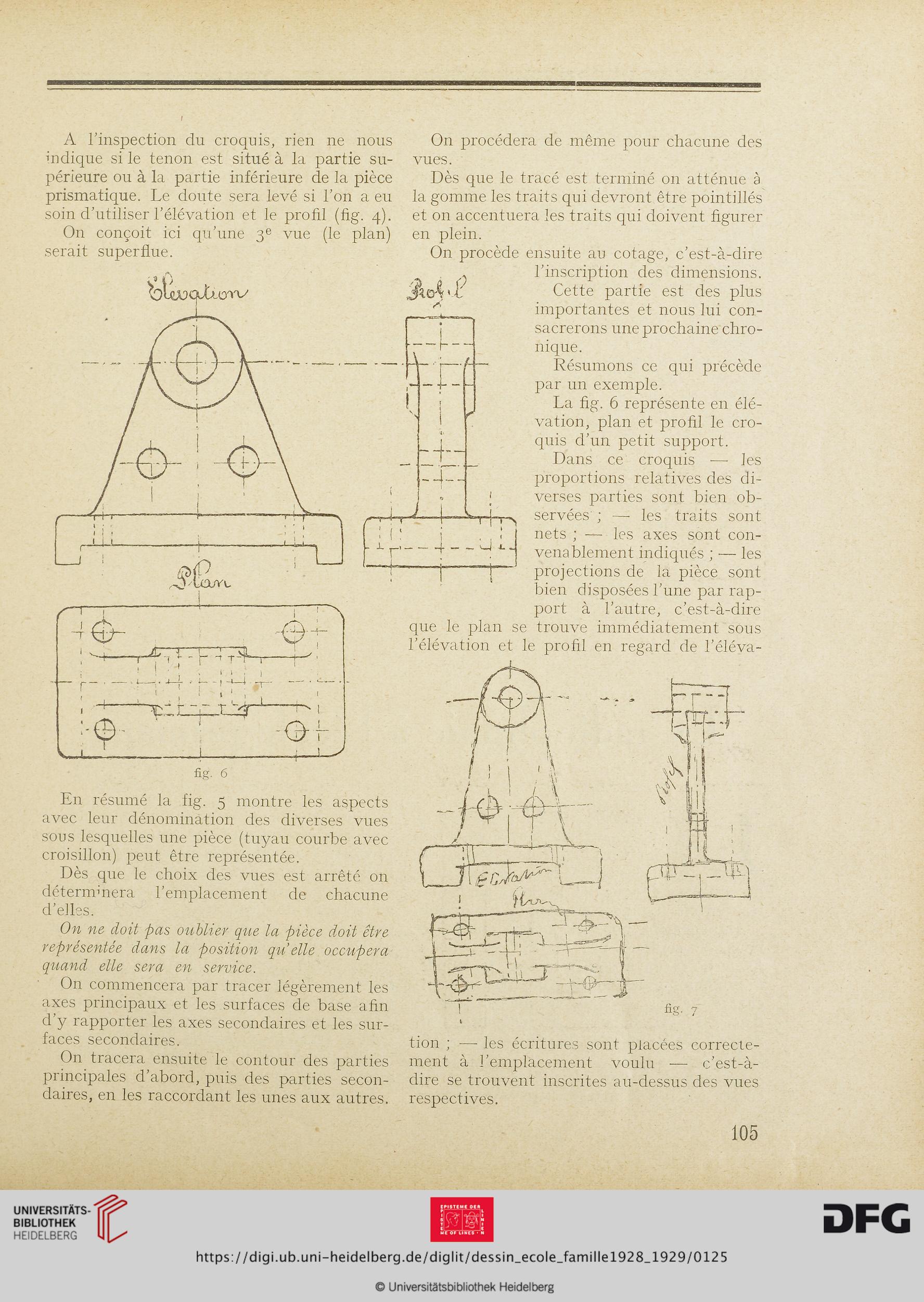A l’inspection du croquis, rien ne nous
indique si le tenon est situé à la partie su-
périeure ou à la partie inférieure de la pièce
prismatique. Le doute sera levé si l’on a eu
soin d’utiliser l’élévation et le profil (fig. 4).
On conçoit ici qu’une 3e vue (le plan)
serait superflue.
vdÙlcU>..
otv'
;M *
A-
!~
On procédera de même pour chacune des
vues.
Dès que le tracé est terminé on atténue à
la gomme les traits qui devront être pointillés
et on accentuera les traits qui doivent figurer
en plein.
On procède ensuite au cotage, c’est-à-dire
l’inscription des dimensions.
Cette partie est des plus
importantes et nous lui con-
sacrerons une prochaine chro-
nique.
Résumons ce qui précède
par un exemple.
La fig. 6 représente en élé-
vation, plan et profil le cro-
quis d’un petit support.
Dans ce croquis •—• les
proportions relatives des di-
verses parties sont bien ob-
servées' ; —- les traits sont
nets ; — les axes sont con-
venablement indiqués ; — les
projections de la pièce sont
bien disposées l’une par rap-
port à l’autre, c’est-à-dire
que le plan se trouve immédiatement sous
l’élévation et le profil en regard de l’éléya-
1*”
1
4-
!
j
4
-
~+~
-4--j
i J
^,-i
r~r : i
!
> ( !
. j. r—
—u_
1
- 4 -
- dj -*- *■
fig. 6
En résumé la fig. 5 montre les aspects
avec leur dénomination des diverses vues
sous lesquelles une pièce (tuyau courbe avec
croisillon) peut être représentée.
Dès que le choix des vues est arrêté on
déterminera l’emplacement de chacune
d’elles.
On ne doit pas oublier que la pièce doit être
représentée dans la position quelle occupera
quand elle sera en service.
On commencera par tracer légèrement les
axes principaux et les surfaces de base afin
d’y rapporter les axes secondaires et les sur-
faces secondaires.
On tracera ensuite le contour des parties
principales d’abord, puis des parties secon-
daires, en les raccordant les unes aux autres.
tion ; — les écritures sont placées correcte-
ment à l’emplacement voulu — c’est-à-
dire se trouvent inscrites au-dessus des vues
respectives.
105
indique si le tenon est situé à la partie su-
périeure ou à la partie inférieure de la pièce
prismatique. Le doute sera levé si l’on a eu
soin d’utiliser l’élévation et le profil (fig. 4).
On conçoit ici qu’une 3e vue (le plan)
serait superflue.
vdÙlcU>..
otv'
;M *
A-
!~
On procédera de même pour chacune des
vues.
Dès que le tracé est terminé on atténue à
la gomme les traits qui devront être pointillés
et on accentuera les traits qui doivent figurer
en plein.
On procède ensuite au cotage, c’est-à-dire
l’inscription des dimensions.
Cette partie est des plus
importantes et nous lui con-
sacrerons une prochaine chro-
nique.
Résumons ce qui précède
par un exemple.
La fig. 6 représente en élé-
vation, plan et profil le cro-
quis d’un petit support.
Dans ce croquis •—• les
proportions relatives des di-
verses parties sont bien ob-
servées' ; —- les traits sont
nets ; — les axes sont con-
venablement indiqués ; — les
projections de la pièce sont
bien disposées l’une par rap-
port à l’autre, c’est-à-dire
que le plan se trouve immédiatement sous
l’élévation et le profil en regard de l’éléya-
1*”
1
4-
!
j
4
-
~+~
-4--j
i J
^,-i
r~r : i
!
> ( !
. j. r—
—u_
1
- 4 -
- dj -*- *■
fig. 6
En résumé la fig. 5 montre les aspects
avec leur dénomination des diverses vues
sous lesquelles une pièce (tuyau courbe avec
croisillon) peut être représentée.
Dès que le choix des vues est arrêté on
déterminera l’emplacement de chacune
d’elles.
On ne doit pas oublier que la pièce doit être
représentée dans la position quelle occupera
quand elle sera en service.
On commencera par tracer légèrement les
axes principaux et les surfaces de base afin
d’y rapporter les axes secondaires et les sur-
faces secondaires.
On tracera ensuite le contour des parties
principales d’abord, puis des parties secon-
daires, en les raccordant les unes aux autres.
tion ; — les écritures sont placées correcte-
ment à l’emplacement voulu — c’est-à-
dire se trouvent inscrites au-dessus des vues
respectives.
105