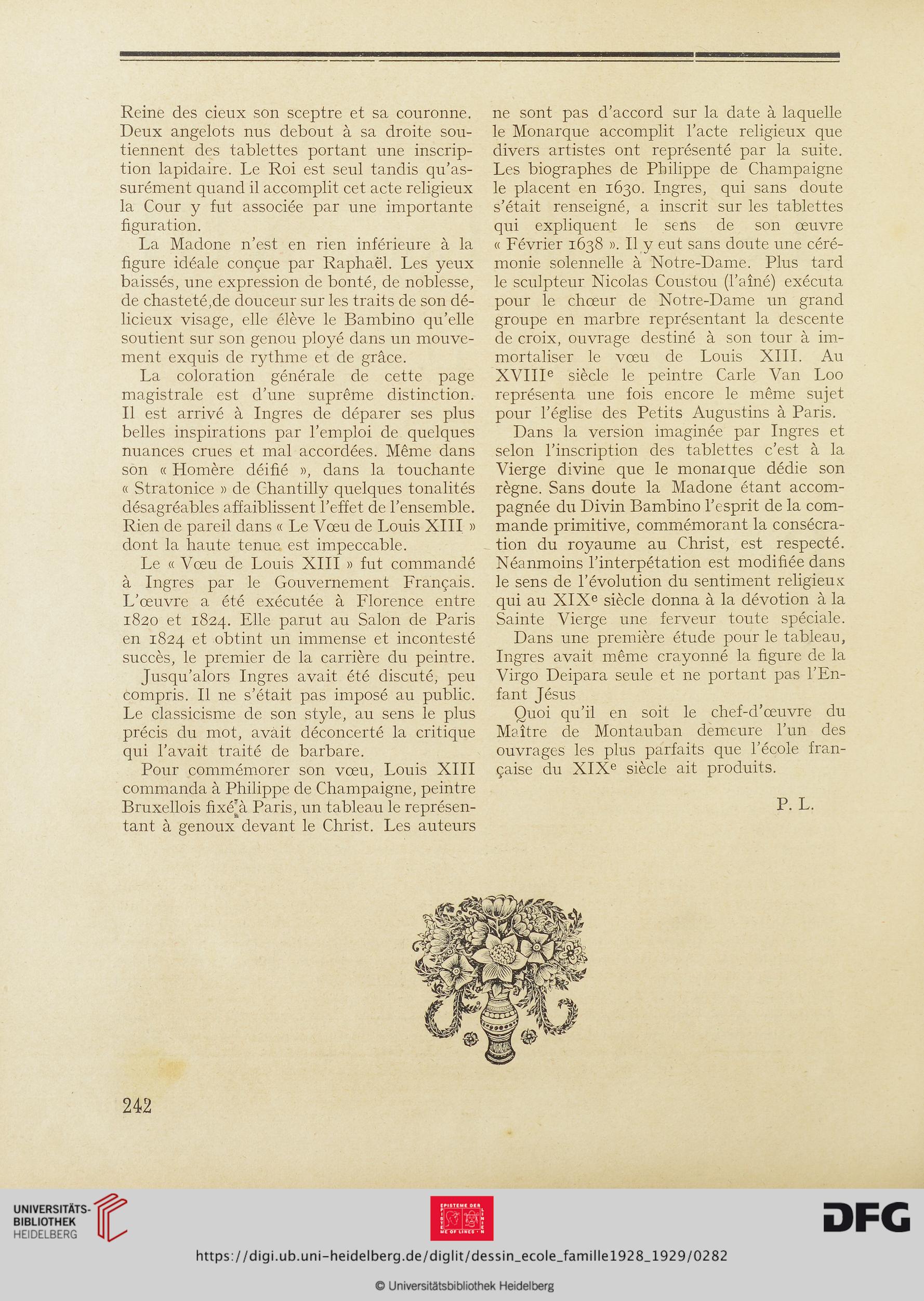Reine des cieux son sceptre et sa couronne.
Deux angelots nus debout à sa droite sou-
tiennent des tablettes portant une inscrip-
tion lapidaire. Le Roi est seul tandis qu’as-
surément quand il accomplit cet acte religieux
la Cour y fut associée par une importante
figuration.
La Madone n’est en rien inférieure à la
ligure idéale conçue par Raphaël. Les yeux
baissés, une expression de bonté, de noblesse,
de chasteté,de douceur sur les traits de son dé-
licieux visage, elle élève le Bambino qu’elle
soutient sur son genou ployé dans un mouve-
ment exquis de rythme et de grâce.
La coloration générale de cette page
magistrale est d’une suprême distinction.
Il est arrivé à Ingres de déparer ses plus
belles inspirations par l’emploi de quelques
nuances crues et mal accordées. Même dans
son « Homère déifié », dans la touchante
« Stratonice » de Chantilly quelques tonalités
désagréables affaiblissent l’effet de l’ensemble.
Rien de pareil dans « Le Vœu de Louis XIII »
dont la haute tenue est impeccable.
Le « Vœu de Louis XIII » fut commandé
à Ingres par le Gouvernement Français.
L’œuvre a été exécutée à Florence entre
1820 et 1824. Elle parut au Salon de Paris
en 1824 et obtint un immense et incontesté
succès, le premier de la carrière du peintre.
Jusqu’alors Ingres avait été discuté, peu
compris. Il ne s’était pas imposé au public.
Le classicisme de son style, au sens le plus
précis du mot, avait déconcerté la critique
qui l’avait traité de barbare.
Pour commémorer son vœu, Louis XIII
commanda à Philippe de Champaigne, peintre
Bruxellois fixéM Paris, un tableau le représen-
tant à genoux devant le Christ. Les auteurs
ne sont pas d’accord sur la date à laquelle
le Monarque accomplit l’acte religieux que
divers artistes ont représenté par la suite.
Les biographes de Philippe de Champaigne
le placent en 1630. Ingres, qui sans doute
s’était renseigné, a inscrit sur les tablettes
qui expliquent le sens de son œuvre
« Février 1638 ». Il y eut sans doute une céré-
monie solennelle à Notre-Dame. Plus tard
le sculpteur Nicolas Coustou (l’aîné) exécuta
pour le chœur de Notre-Dame un grand
groupe en marbre représentant la descente
de croix, ouvrage destiné à son tour à im-
mortaliser le vœu de Louis XIII. Au
XVIIIe siècle le peintre Carie Van Loo
représenta une fois encore le même sujet
pour l’église des Petits Augustins à Paris.
Dans la version imaginée par Ingres et
selon l’inscription des tablettes c’est à la
Vierge divine que le monarque dédie son
règne. Sans doute la Madone étant accom-
pagnée du Divin Bambino l’esprit de la com-
mande primitive, commémorant la consécra-
tion du royaume au Christ, est respecté.
Néanmoins l’interpétation est modifiée dans
le sens de l’évolution du sentiment religieux
qui au XIXe siècle donna à la dévotion à la
Sainte Vierge une ferveur toute spéciale.
Dans une première étude pour le tableau,
Ingres avait même crayonné la figure de la
Virgo Deipara seule et ne portant pas l’En-
fant Jésus
Quoi qu’il en soit le chef-d’œuvre du
Maître de Montauban demeure l’un des
ouvrages les plus parfaits que l’école fran-
çaise du XIXe siècle ait produits.
P. L.
242
Deux angelots nus debout à sa droite sou-
tiennent des tablettes portant une inscrip-
tion lapidaire. Le Roi est seul tandis qu’as-
surément quand il accomplit cet acte religieux
la Cour y fut associée par une importante
figuration.
La Madone n’est en rien inférieure à la
ligure idéale conçue par Raphaël. Les yeux
baissés, une expression de bonté, de noblesse,
de chasteté,de douceur sur les traits de son dé-
licieux visage, elle élève le Bambino qu’elle
soutient sur son genou ployé dans un mouve-
ment exquis de rythme et de grâce.
La coloration générale de cette page
magistrale est d’une suprême distinction.
Il est arrivé à Ingres de déparer ses plus
belles inspirations par l’emploi de quelques
nuances crues et mal accordées. Même dans
son « Homère déifié », dans la touchante
« Stratonice » de Chantilly quelques tonalités
désagréables affaiblissent l’effet de l’ensemble.
Rien de pareil dans « Le Vœu de Louis XIII »
dont la haute tenue est impeccable.
Le « Vœu de Louis XIII » fut commandé
à Ingres par le Gouvernement Français.
L’œuvre a été exécutée à Florence entre
1820 et 1824. Elle parut au Salon de Paris
en 1824 et obtint un immense et incontesté
succès, le premier de la carrière du peintre.
Jusqu’alors Ingres avait été discuté, peu
compris. Il ne s’était pas imposé au public.
Le classicisme de son style, au sens le plus
précis du mot, avait déconcerté la critique
qui l’avait traité de barbare.
Pour commémorer son vœu, Louis XIII
commanda à Philippe de Champaigne, peintre
Bruxellois fixéM Paris, un tableau le représen-
tant à genoux devant le Christ. Les auteurs
ne sont pas d’accord sur la date à laquelle
le Monarque accomplit l’acte religieux que
divers artistes ont représenté par la suite.
Les biographes de Philippe de Champaigne
le placent en 1630. Ingres, qui sans doute
s’était renseigné, a inscrit sur les tablettes
qui expliquent le sens de son œuvre
« Février 1638 ». Il y eut sans doute une céré-
monie solennelle à Notre-Dame. Plus tard
le sculpteur Nicolas Coustou (l’aîné) exécuta
pour le chœur de Notre-Dame un grand
groupe en marbre représentant la descente
de croix, ouvrage destiné à son tour à im-
mortaliser le vœu de Louis XIII. Au
XVIIIe siècle le peintre Carie Van Loo
représenta une fois encore le même sujet
pour l’église des Petits Augustins à Paris.
Dans la version imaginée par Ingres et
selon l’inscription des tablettes c’est à la
Vierge divine que le monarque dédie son
règne. Sans doute la Madone étant accom-
pagnée du Divin Bambino l’esprit de la com-
mande primitive, commémorant la consécra-
tion du royaume au Christ, est respecté.
Néanmoins l’interpétation est modifiée dans
le sens de l’évolution du sentiment religieux
qui au XIXe siècle donna à la dévotion à la
Sainte Vierge une ferveur toute spéciale.
Dans une première étude pour le tableau,
Ingres avait même crayonné la figure de la
Virgo Deipara seule et ne portant pas l’En-
fant Jésus
Quoi qu’il en soit le chef-d’œuvre du
Maître de Montauban demeure l’un des
ouvrages les plus parfaits que l’école fran-
çaise du XIXe siècle ait produits.
P. L.
242