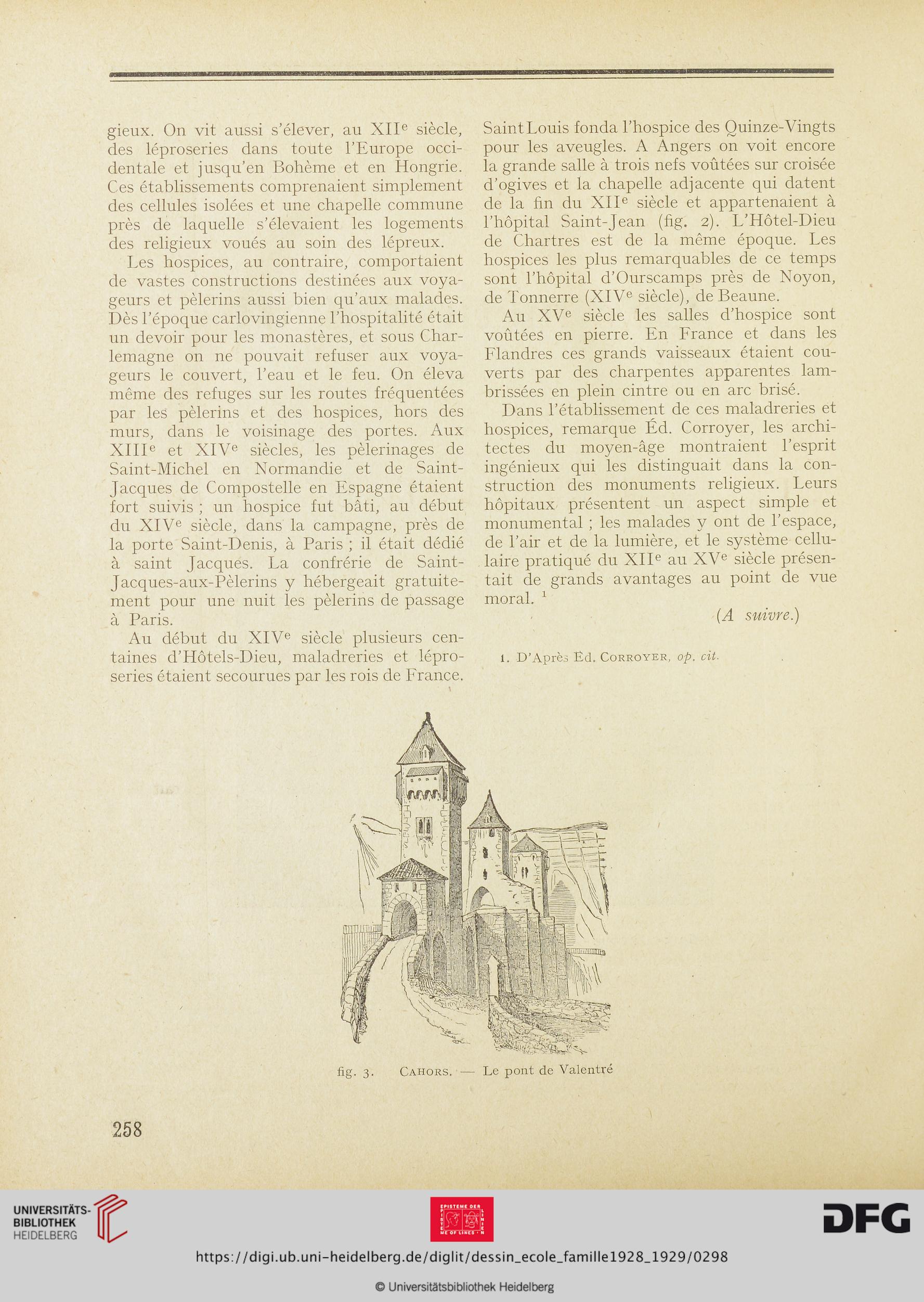gieux. On vit aussi s’élever, au XIIe siècle,
des léproseries dans toute l’Europe occi-
dentale et jusqu’en Bohème et en Hongrie.
Ces établissements comprenaient simplement
des cellules isolées et une chapelle commune
près de laquelle s’élevaient les logements
des religieux voués au soin des lépreux.
Les hospices, au contraire, comportaient
de vastes constructions destinées aux voya-
geurs et pèlerins aussi bien qu’aux malades.
Dès l’époque carlovingienne l’hospitalité était
un devoir pour les monastères, et sous Char-
lemagne on ne pouvait refuser aux voya-
geurs le couvert, l’eau et le feu. On éleva
même des refuges sur les routes fréquentées
par les pèlerins et des hospices, hors des
murs, dans le voisinage des portes. Aux
XIIIe et XIVe siècles, les pèlerinages de
Saint-Michel en Normandie et de Saint-
Jacques de Compostelle en Espagne étaient
fort suivis ; un hospice fut bâti, au début
du XIVe siècle, dans la campagne, près de
la porte Saint-Denis, à Paris ; il était dédié
à saint Jacques. La confrérie de Saint-
Jacques-aux-Pèlerins y hébergeait gratuite-
ment pour une nuit les pèlerins de passage
à Paris.
An début du XIVe siècle plusieurs cen-
taines d’Hôtels-Dieu, maladreries et lépro-
series étaient secourues par les rois de France.
Saint Louis fonda l’hospice des Ouinze-Vingts
pour les aveugles. A Angers on voit encore
la grande salle à trois nefs voûtées sur croisée
d’ogives et la chapelle adjacente qui datent
de la hn du XIIe siècle et appartenaient à
l’hôpital Saint-Jean (fig. 2). L’Hôtel-Dieu
de Chartres est de la même époque. Les
hospices les plus remarquables de ce temps
sont l’hôpital d’Ourscamps près de Noyon,
de Tonnerre (XIVe siècle), de Beaune.
Au XVe siècle les salles d’hospice sont
voûtées en pierre. En France et dans les
Flandres ces grands vaisseaux étaient cou-
verts par des charpentes apparentes lam-
brissées en plein cintre ou en arc brisé.
Dans l’établissement de ces maladreries et
hospices, remarque Éd. Corroyer, les archi-
tectes du moyen-âge montraient l’esprit
ingénieux qui les distinguait dans la con-
struction des monuments religieux. Leurs
hôpitaux présentent un aspect simple et
monumental ; les malades y ont de l’espace,
de l’air et de la lumière, et le système cellu-
laire pratiqué du XIIe au XVe siècle présen-
tait de grands avantages au point de vue
moral. 1
(A suivre.)
l. D’Après Ëd. Corroyer, op. cït.
w.. vor «MIc
fig. 3. Cahors. 1— Le pont de Valentré
258
des léproseries dans toute l’Europe occi-
dentale et jusqu’en Bohème et en Hongrie.
Ces établissements comprenaient simplement
des cellules isolées et une chapelle commune
près de laquelle s’élevaient les logements
des religieux voués au soin des lépreux.
Les hospices, au contraire, comportaient
de vastes constructions destinées aux voya-
geurs et pèlerins aussi bien qu’aux malades.
Dès l’époque carlovingienne l’hospitalité était
un devoir pour les monastères, et sous Char-
lemagne on ne pouvait refuser aux voya-
geurs le couvert, l’eau et le feu. On éleva
même des refuges sur les routes fréquentées
par les pèlerins et des hospices, hors des
murs, dans le voisinage des portes. Aux
XIIIe et XIVe siècles, les pèlerinages de
Saint-Michel en Normandie et de Saint-
Jacques de Compostelle en Espagne étaient
fort suivis ; un hospice fut bâti, au début
du XIVe siècle, dans la campagne, près de
la porte Saint-Denis, à Paris ; il était dédié
à saint Jacques. La confrérie de Saint-
Jacques-aux-Pèlerins y hébergeait gratuite-
ment pour une nuit les pèlerins de passage
à Paris.
An début du XIVe siècle plusieurs cen-
taines d’Hôtels-Dieu, maladreries et lépro-
series étaient secourues par les rois de France.
Saint Louis fonda l’hospice des Ouinze-Vingts
pour les aveugles. A Angers on voit encore
la grande salle à trois nefs voûtées sur croisée
d’ogives et la chapelle adjacente qui datent
de la hn du XIIe siècle et appartenaient à
l’hôpital Saint-Jean (fig. 2). L’Hôtel-Dieu
de Chartres est de la même époque. Les
hospices les plus remarquables de ce temps
sont l’hôpital d’Ourscamps près de Noyon,
de Tonnerre (XIVe siècle), de Beaune.
Au XVe siècle les salles d’hospice sont
voûtées en pierre. En France et dans les
Flandres ces grands vaisseaux étaient cou-
verts par des charpentes apparentes lam-
brissées en plein cintre ou en arc brisé.
Dans l’établissement de ces maladreries et
hospices, remarque Éd. Corroyer, les archi-
tectes du moyen-âge montraient l’esprit
ingénieux qui les distinguait dans la con-
struction des monuments religieux. Leurs
hôpitaux présentent un aspect simple et
monumental ; les malades y ont de l’espace,
de l’air et de la lumière, et le système cellu-
laire pratiqué du XIIe au XVe siècle présen-
tait de grands avantages au point de vue
moral. 1
(A suivre.)
l. D’Après Ëd. Corroyer, op. cït.
w.. vor «MIc
fig. 3. Cahors. 1— Le pont de Valentré
258