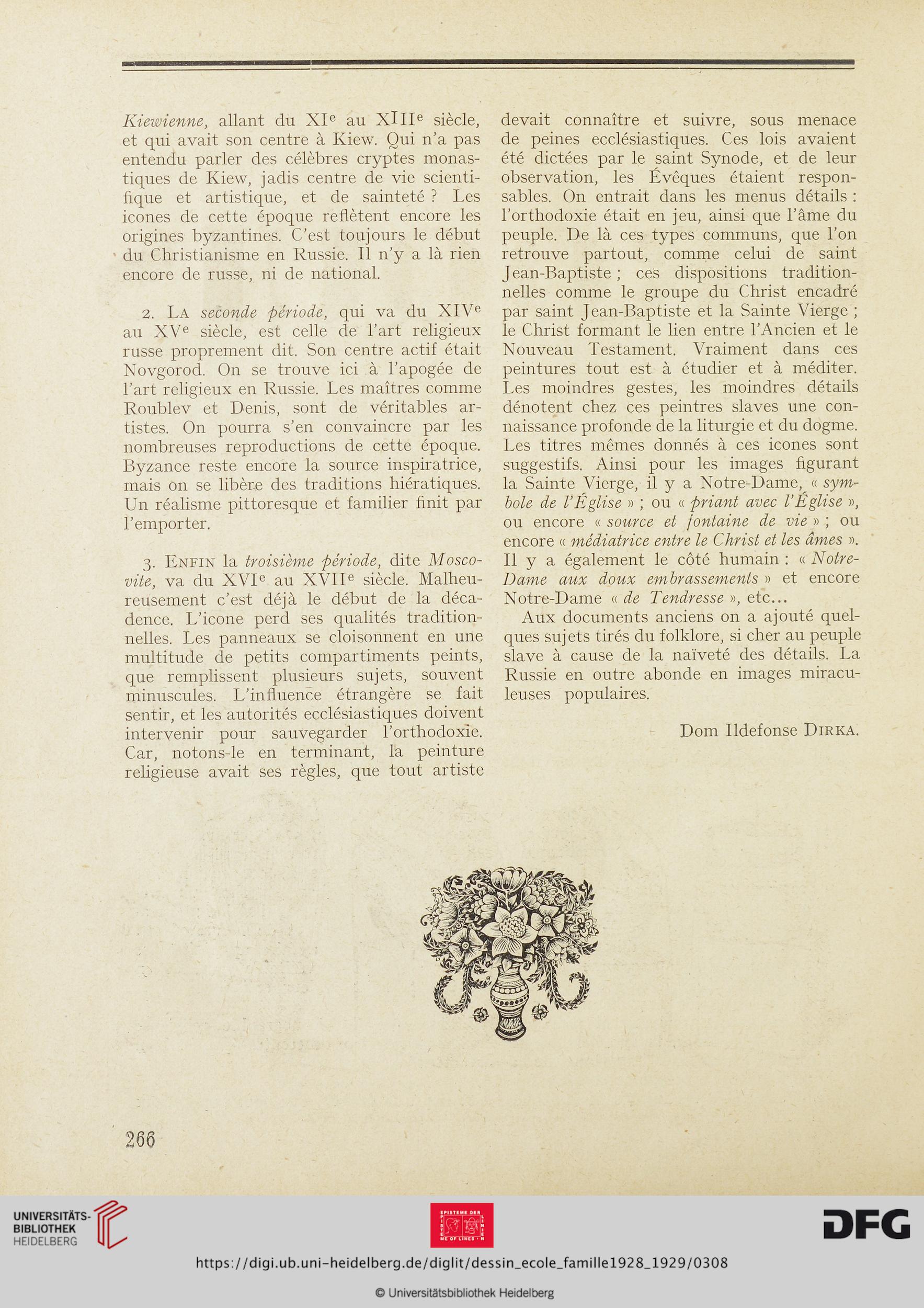Kiewienne, allant du XIe au XIIIe siècle,
et qui avait son centre à Kiew. Qui n'a pas
entendu parler des célèbres cryptes monas-
tiques de Kiew, jadis centre de vie scienti-
fique et artistique, et de sainteté ? Les
icônes de cette époque reflètent encore les
origines byzantines. C’est toujours le début
du Christianisme en Russie. Il n’y a là rien
encore de russe, ni de national.
2. La seconde période, qui va du XIVe
au XVe siècle, est celle de l’art religieux
russe proprement dit. Son centre actif était
Novgorod. On se trouve ici à l’apogée de
l’art religieux en Russie. Les maîtres comme
Roublev et Denis, sont de véritables ar-
tistes. On pourra s’en convaincre par les
nombreuses reproductions de cette époque.
Byzance reste encore la source inspiratrice,
mais on se libère des traditions hiératiques.
Un réalisme pittoresque et familier finit par
l’emporter.
3. Enfin la troisième période, dite Mosco-
vite, va du XVIe au XVIIe siècle. Malheu-
reusement c’est déjà le début de la déca-
dence. L’icone perd ses qualités tradition-
nelles. Les panneaux se cloisonnent en une
multitude de petits compartiments peints,
que remplissent plusieurs sujets, souvent
minuscules. L’influence étrangère se fait
sentir, et les autorités ecclésiastiques doivent
intervenir pour sauvegarder l’orthodoxie.
Car, notons-le en terminant, la peinture
religieuse avait ses règles, que tout artiste
devait connaître et suivre, sous menace
de peines ecclésiastiques. Ces lois avaient
été dictées par le saint Synode, et de leur
observation, les Évêques étaient respon-
sables. On entrait dans les menus détails :
l’orthodoxie était en jeu, ainsi que l’âme du
peuple. De là ces types communs, que l’on
retrouve partout, comme celui de saint
Jean-Baptiste ; ces dispositions tradition-
nelles comme le groupe du Christ encadré
par saint Jean-Baptiste et la Sainte Vierge ;
le Christ formant le lien entre l’Ancien et le
Nouveau Testament. Vraiment dans ces
peintures tout est à étudier et à méditer.
Les moindres gestes, les moindres détails
dénotent chez ces peintres slaves une con-
naissance profonde de la liturgie et du dogme.
Les titres mêmes donnés à ces icônes sont
suggestifs. Ainsi pour les images figurant
la Sainte Vierge, il y a Notre-Dame, « sym-
bole de l’Église » ; ou « priant avec l’Église »,
ou encore « source et fontaine de vie y ; ou
encore « médiatrice entre le Christ et les âmes ».
Il y a également le côté humain : « Notre-
Dame aux doux embrassements » et encore
Notre-Dame « de Tendresse », etc...
Aux documents anciens on a ajouté quel-
ques sujets tirés du folklore, si cher au peuple
slave à cause de la naïveté des détails. La
Russie en outre abonde en images miracu-
leuses populaires.
Dom Udefonse Dirka.
266
et qui avait son centre à Kiew. Qui n'a pas
entendu parler des célèbres cryptes monas-
tiques de Kiew, jadis centre de vie scienti-
fique et artistique, et de sainteté ? Les
icônes de cette époque reflètent encore les
origines byzantines. C’est toujours le début
du Christianisme en Russie. Il n’y a là rien
encore de russe, ni de national.
2. La seconde période, qui va du XIVe
au XVe siècle, est celle de l’art religieux
russe proprement dit. Son centre actif était
Novgorod. On se trouve ici à l’apogée de
l’art religieux en Russie. Les maîtres comme
Roublev et Denis, sont de véritables ar-
tistes. On pourra s’en convaincre par les
nombreuses reproductions de cette époque.
Byzance reste encore la source inspiratrice,
mais on se libère des traditions hiératiques.
Un réalisme pittoresque et familier finit par
l’emporter.
3. Enfin la troisième période, dite Mosco-
vite, va du XVIe au XVIIe siècle. Malheu-
reusement c’est déjà le début de la déca-
dence. L’icone perd ses qualités tradition-
nelles. Les panneaux se cloisonnent en une
multitude de petits compartiments peints,
que remplissent plusieurs sujets, souvent
minuscules. L’influence étrangère se fait
sentir, et les autorités ecclésiastiques doivent
intervenir pour sauvegarder l’orthodoxie.
Car, notons-le en terminant, la peinture
religieuse avait ses règles, que tout artiste
devait connaître et suivre, sous menace
de peines ecclésiastiques. Ces lois avaient
été dictées par le saint Synode, et de leur
observation, les Évêques étaient respon-
sables. On entrait dans les menus détails :
l’orthodoxie était en jeu, ainsi que l’âme du
peuple. De là ces types communs, que l’on
retrouve partout, comme celui de saint
Jean-Baptiste ; ces dispositions tradition-
nelles comme le groupe du Christ encadré
par saint Jean-Baptiste et la Sainte Vierge ;
le Christ formant le lien entre l’Ancien et le
Nouveau Testament. Vraiment dans ces
peintures tout est à étudier et à méditer.
Les moindres gestes, les moindres détails
dénotent chez ces peintres slaves une con-
naissance profonde de la liturgie et du dogme.
Les titres mêmes donnés à ces icônes sont
suggestifs. Ainsi pour les images figurant
la Sainte Vierge, il y a Notre-Dame, « sym-
bole de l’Église » ; ou « priant avec l’Église »,
ou encore « source et fontaine de vie y ; ou
encore « médiatrice entre le Christ et les âmes ».
Il y a également le côté humain : « Notre-
Dame aux doux embrassements » et encore
Notre-Dame « de Tendresse », etc...
Aux documents anciens on a ajouté quel-
ques sujets tirés du folklore, si cher au peuple
slave à cause de la naïveté des détails. La
Russie en outre abonde en images miracu-
leuses populaires.
Dom Udefonse Dirka.
266