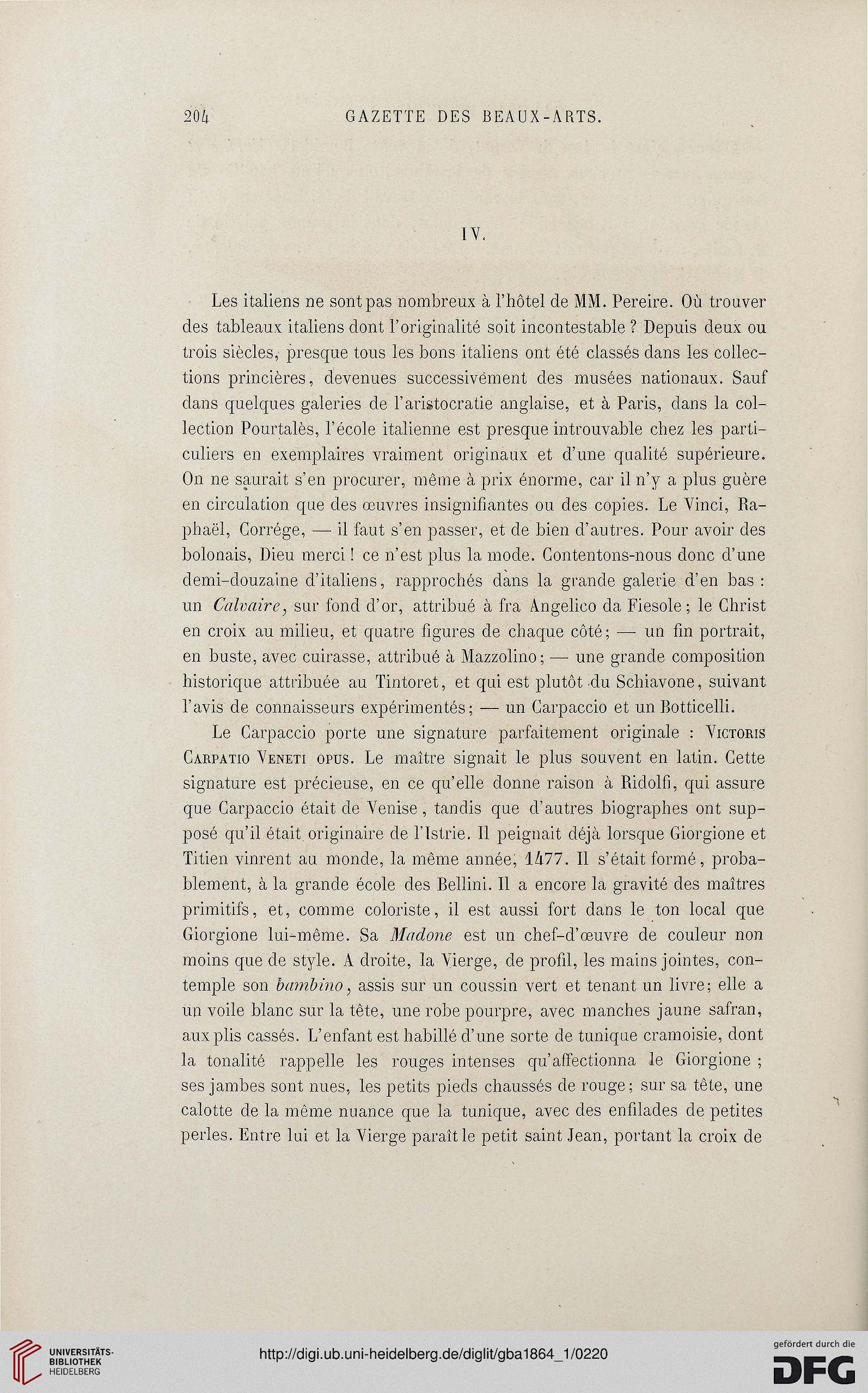GAZETTE DES BEAUX-ARTS.
20 A
IV.
Les italiens ne sont pas nombreux à l’hôtel de MM. Pereire. Où trouver
des tableaux italiens dont l’originalité soit incontestable ? Depuis deux ou
trois siècles, presque tous les bons italiens ont été classés dans les collec-
tions princières, devenues successivement des musées nationaux. Sauf
dans quelques galeries de l’aristocratie anglaise, et à Paris, dans la col-
lection Pourtalès, l’école italienne est presque introuvable chez les parti-
culiers en exemplaires vraiment originaux et d’une qualité supérieure.
On ne saurait s’en procurer, même à prix énorme, car il n’y a plus guère
en circulation que des œuvres insignifiantes ou des copies. Le Vinci, Ra-
phaël, Corrége, — il faut s’en passer, et de bien d’autres. Pour avoir des
bolonais, Dieu merci ! ce n’est plus la mode. Contentons-nous donc d’une
demi-douzaine d’italiens, rapprochés dans la grande galerie d’en bas :
un Calvaire, sur fond d’or, attribué à fra Angelico da Fiesole ; le Christ
en croix au milieu, et quatre figures de chaque côté; — un fin portrait,
en buste, avec cuirasse, attribué à Mazzolino; — une grande composition
historique attribuée au Tintoret, et qui est plutôt du Schiavone, suivant
l’avis de connaisseurs expérimentés; — un Carpaccio et unBotticelli.
Le Carpaccio porte une signature parfaitement originale : Victoris
Carpatio Veneti opus. Le maître signait le plus souvent en latin. Cette
signature est précieuse, en ce qu’elle donne raison à Ridolfi, qui assure
que Carpaccio était de Venise, tandis que d’autres biographes ont sup-
posé qu’il était originaire de l’istrie. Il peignait déjà lorsque Giorgione et
Titien vinrent au monde, la même année, 1A77. Il s’était formé, proba-
blement, à la grande école des Bellini. Il a encore la gravité des maîtres
primitifs, et, comme coloriste, il est aussi fort dans le ton local que
Giorgione lui-même. Sa Madone est un chef-d’œuvre de couleur non
moins que de style. A droite, la Vierge, de profil, les mains jointes, con-
temple son bambino, assis sur un coussin vert et tenant un livre; elle a
un voile blanc sur la tête, une robe pourpre, avec manches jaune safran,
aux plis cassés. L’enfant est habillé d’une sorte de tunique cramoisie, dont
la tonalité rappelle les rouges intenses qu’affectionna le Giorgione ;
ses jambes sont nues, les petits pieds chaussés de rouge; sur sa tête, une
calotte de la même nuance que la tunique, avec des enfilades de petites
perles. Entre lui et la Vierge paraît le petit saint Jean, portant la croix de
20 A
IV.
Les italiens ne sont pas nombreux à l’hôtel de MM. Pereire. Où trouver
des tableaux italiens dont l’originalité soit incontestable ? Depuis deux ou
trois siècles, presque tous les bons italiens ont été classés dans les collec-
tions princières, devenues successivement des musées nationaux. Sauf
dans quelques galeries de l’aristocratie anglaise, et à Paris, dans la col-
lection Pourtalès, l’école italienne est presque introuvable chez les parti-
culiers en exemplaires vraiment originaux et d’une qualité supérieure.
On ne saurait s’en procurer, même à prix énorme, car il n’y a plus guère
en circulation que des œuvres insignifiantes ou des copies. Le Vinci, Ra-
phaël, Corrége, — il faut s’en passer, et de bien d’autres. Pour avoir des
bolonais, Dieu merci ! ce n’est plus la mode. Contentons-nous donc d’une
demi-douzaine d’italiens, rapprochés dans la grande galerie d’en bas :
un Calvaire, sur fond d’or, attribué à fra Angelico da Fiesole ; le Christ
en croix au milieu, et quatre figures de chaque côté; — un fin portrait,
en buste, avec cuirasse, attribué à Mazzolino; — une grande composition
historique attribuée au Tintoret, et qui est plutôt du Schiavone, suivant
l’avis de connaisseurs expérimentés; — un Carpaccio et unBotticelli.
Le Carpaccio porte une signature parfaitement originale : Victoris
Carpatio Veneti opus. Le maître signait le plus souvent en latin. Cette
signature est précieuse, en ce qu’elle donne raison à Ridolfi, qui assure
que Carpaccio était de Venise, tandis que d’autres biographes ont sup-
posé qu’il était originaire de l’istrie. Il peignait déjà lorsque Giorgione et
Titien vinrent au monde, la même année, 1A77. Il s’était formé, proba-
blement, à la grande école des Bellini. Il a encore la gravité des maîtres
primitifs, et, comme coloriste, il est aussi fort dans le ton local que
Giorgione lui-même. Sa Madone est un chef-d’œuvre de couleur non
moins que de style. A droite, la Vierge, de profil, les mains jointes, con-
temple son bambino, assis sur un coussin vert et tenant un livre; elle a
un voile blanc sur la tête, une robe pourpre, avec manches jaune safran,
aux plis cassés. L’enfant est habillé d’une sorte de tunique cramoisie, dont
la tonalité rappelle les rouges intenses qu’affectionna le Giorgione ;
ses jambes sont nues, les petits pieds chaussés de rouge; sur sa tête, une
calotte de la même nuance que la tunique, avec des enfilades de petites
perles. Entre lui et la Vierge paraît le petit saint Jean, portant la croix de