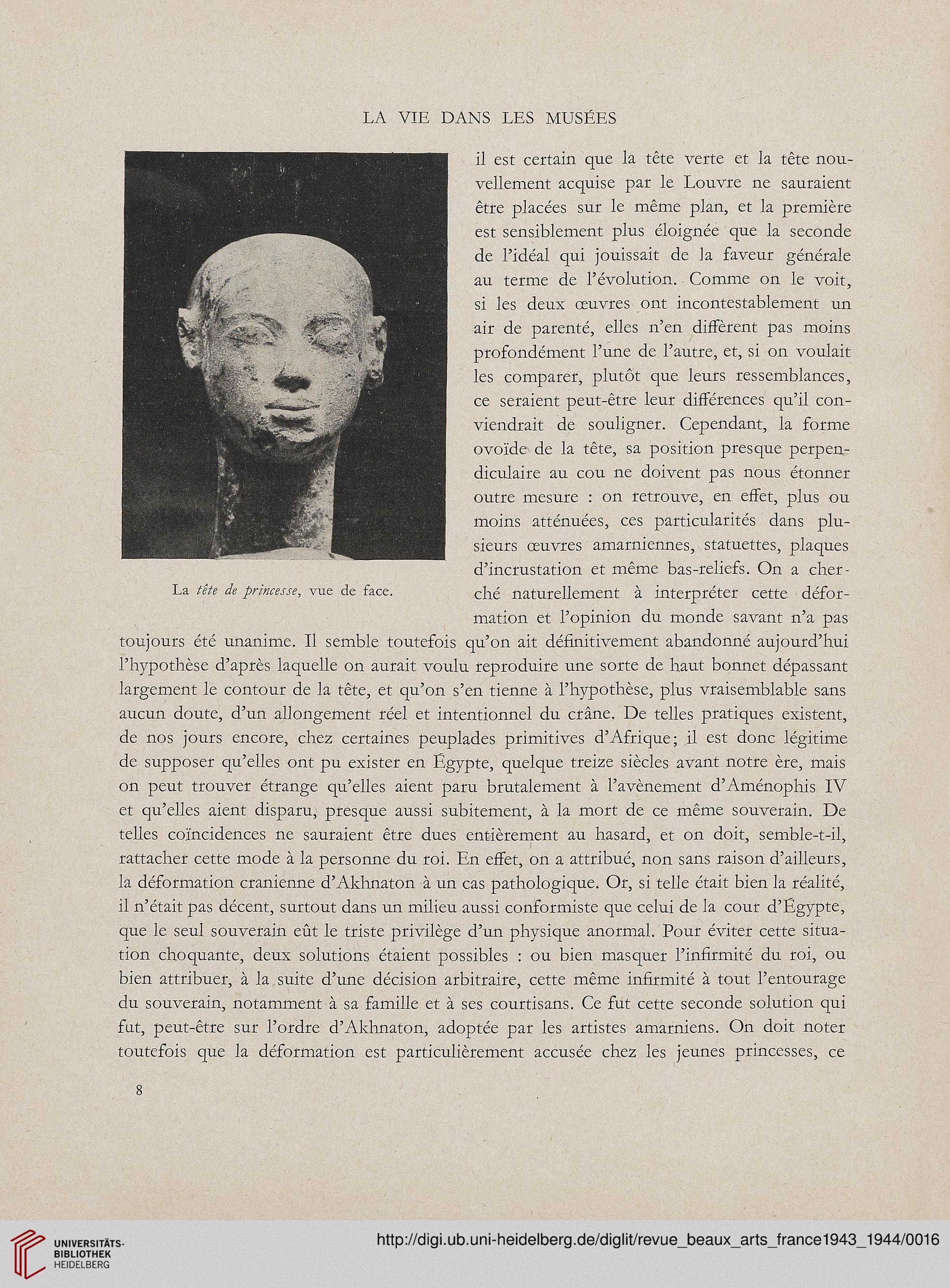LA VIE DANS LES MUSÉES
il est certain que la tête verte et la tête nou-
vellement acquise par le Louvre ne sauraient
être placées sur le même plan, et la première
est sensiblement plus éloignée que la seconde
de l’idéal qui jouissait de la faveur générale
au terme de l’évolution. Comme on le voit,
si les deux œuvres ont incontestablement un
air de parenté, elles n’en diffèrent pas moins
profondément l’une de l’autre, et, si on voulait
les comparer, plutôt que leurs ressemblances,
ce seraient peut-être leur différences qu’il con-
viendrait de souligner. Cependant, la forme
ovoïde de la tête, sa position presque perpen-
diculaire au cou ne doivent pas nous étonner
outre mesure : on retrouve, en effet, plus ou
moins atténuées, ces particularités dans plu-
sieurs œuvres amarniennes, statuettes, plaques
d’incrustation et même bas-reliefs. On a cher-
La tête de princesse, vue de face. naturellement à interpréter cette défor-
mation et l’opinion du monde savant n’a pas
toujours été unanime. Il semble toutefois qu’on ait définitivement abandonné aujourd’hui
l’hypothèse d’après laquelle on aurait voulu reproduire une sorte de haut bonnet dépassant
largement le contour de la tête, et qu’on s’en tienne à l’hypothèse, plus vraisemblable sans
aucun doute, d’un allongement réel et intentionnel du crâne. De telles pratiques existent,
de nos jours encore, chez certaines peuplades primitives d’Afrique; il est donc légitime
de supposer qu’elles ont pu exister en Egypte, quelque treize siècles avant notre ère, mais
on peut trouver étrange qu’elles aient paru brutalement à l’avènement d’Aménophis IV
et qu’elles aient disparu, presque aussi subitement, à la mort de ce même souverain. De
telles coïncidences ne sauraient être dues entièrement au hasard, et on doit, semble-t-il,
rattacher cette mode à la personne du roi. En effet, on a attribué, non sans raison d’ailleurs,
la déformation crânienne d’Akhnaton à un cas pathologique. Or, si telle était bien la réalité,
il n’était pas décent, surtout dans un milieu aussi conformiste que celui de la cour d’Egypte,
que le seul souverain eût le triste privilège d’un physique anormal. Pour éviter cette situa-
tion choquante, deux solutions étaient possibles : ou bien masquer l’infirmité du roi, ou
bien attribuer, à la suite d’une décision arbitraire, cette même infirmité à tout l’entourage
du souverain, notamment à sa famille et à ses courtisans. Ce fut cette seconde solution qui
fut, peut-être sur l’ordre d’Akhnaton, adoptée par les artistes amarniens. On doit noter
toutefois que la déformation est particulièrement accusée chez les jeunes princesses, ce
8
il est certain que la tête verte et la tête nou-
vellement acquise par le Louvre ne sauraient
être placées sur le même plan, et la première
est sensiblement plus éloignée que la seconde
de l’idéal qui jouissait de la faveur générale
au terme de l’évolution. Comme on le voit,
si les deux œuvres ont incontestablement un
air de parenté, elles n’en diffèrent pas moins
profondément l’une de l’autre, et, si on voulait
les comparer, plutôt que leurs ressemblances,
ce seraient peut-être leur différences qu’il con-
viendrait de souligner. Cependant, la forme
ovoïde de la tête, sa position presque perpen-
diculaire au cou ne doivent pas nous étonner
outre mesure : on retrouve, en effet, plus ou
moins atténuées, ces particularités dans plu-
sieurs œuvres amarniennes, statuettes, plaques
d’incrustation et même bas-reliefs. On a cher-
La tête de princesse, vue de face. naturellement à interpréter cette défor-
mation et l’opinion du monde savant n’a pas
toujours été unanime. Il semble toutefois qu’on ait définitivement abandonné aujourd’hui
l’hypothèse d’après laquelle on aurait voulu reproduire une sorte de haut bonnet dépassant
largement le contour de la tête, et qu’on s’en tienne à l’hypothèse, plus vraisemblable sans
aucun doute, d’un allongement réel et intentionnel du crâne. De telles pratiques existent,
de nos jours encore, chez certaines peuplades primitives d’Afrique; il est donc légitime
de supposer qu’elles ont pu exister en Egypte, quelque treize siècles avant notre ère, mais
on peut trouver étrange qu’elles aient paru brutalement à l’avènement d’Aménophis IV
et qu’elles aient disparu, presque aussi subitement, à la mort de ce même souverain. De
telles coïncidences ne sauraient être dues entièrement au hasard, et on doit, semble-t-il,
rattacher cette mode à la personne du roi. En effet, on a attribué, non sans raison d’ailleurs,
la déformation crânienne d’Akhnaton à un cas pathologique. Or, si telle était bien la réalité,
il n’était pas décent, surtout dans un milieu aussi conformiste que celui de la cour d’Egypte,
que le seul souverain eût le triste privilège d’un physique anormal. Pour éviter cette situa-
tion choquante, deux solutions étaient possibles : ou bien masquer l’infirmité du roi, ou
bien attribuer, à la suite d’une décision arbitraire, cette même infirmité à tout l’entourage
du souverain, notamment à sa famille et à ses courtisans. Ce fut cette seconde solution qui
fut, peut-être sur l’ordre d’Akhnaton, adoptée par les artistes amarniens. On doit noter
toutefois que la déformation est particulièrement accusée chez les jeunes princesses, ce
8