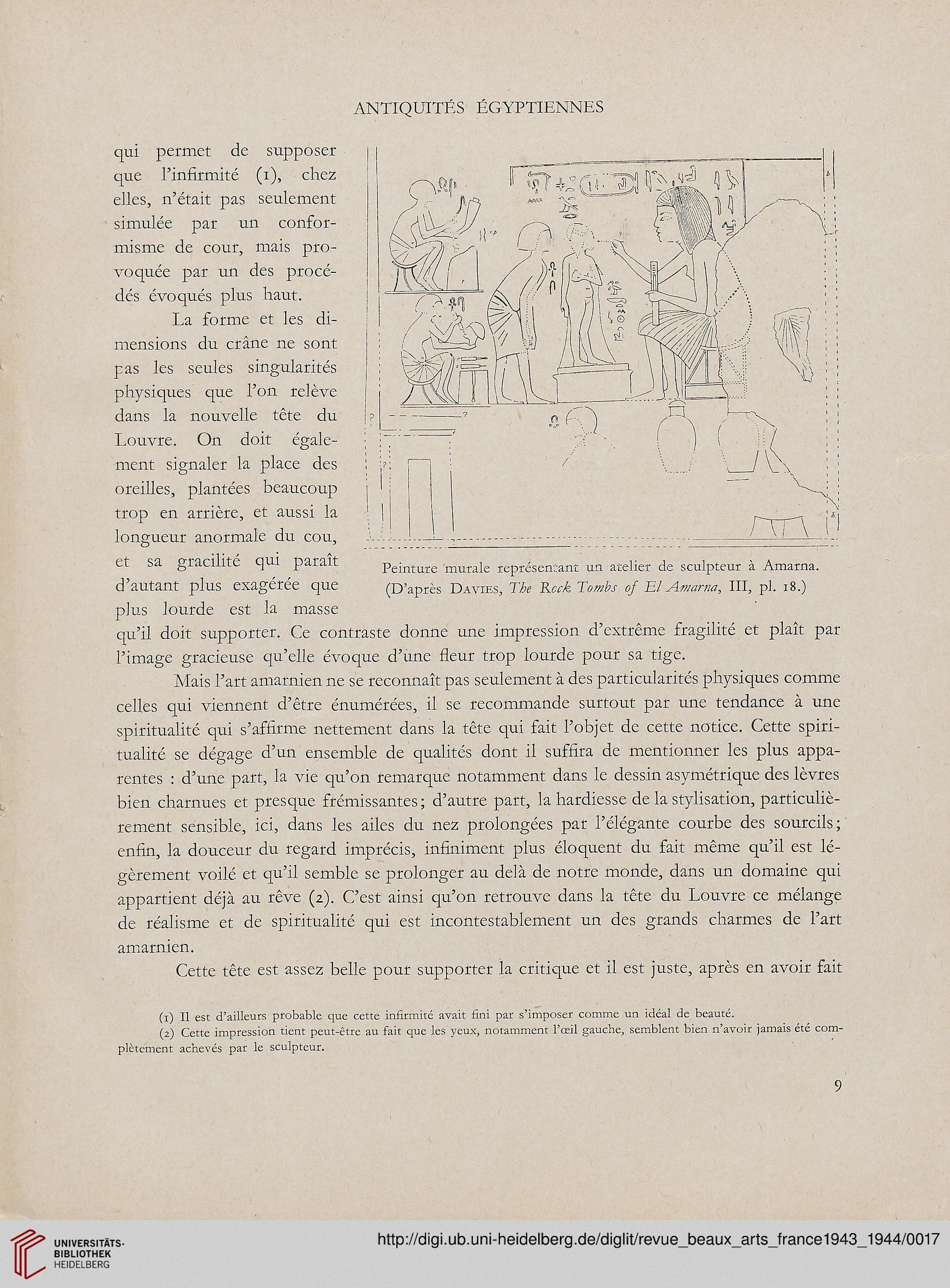ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES
Peinture murale représentant un atelier de sculpteur à Amarna.
(D’après Davies, The Reek Tombs of El Amarna, III, pl. 18.)
qu’il doit supporter. Ce contraste donne une impression d’extrême fragilité et plaît par
l’image gracieuse qu’elle évoque d’une fleur trop lourde pour sa tige.
Mais l’art amarnien ne se reconnaît pas seulement à des particularités physiques comme
celles qui viennent d’être énumérées, il se recommande surtout par une tendance à une
spiritualité qui s’affirme nettement dans la tête qui fait l’objet de cette notice. Cette spiri-
tualité se dégage d’un ensemble de qualités dont il suffira de mentionner les plus appa-
rentes : d’une part, la vie qu’on remarque notamment dans le dessin asymétrique des lèvres
bien charnues et presque frémissantes; d’autre part, la hardiesse de la stylisation, particuliè-
rement sensible, ici, dans les ailes du nez prolongées par l’élégante courbe des sourcils;
enfin, la douceur du regard imprécis, infiniment plus éloquent du fait même qu’il est lé-
gèrement voilé et qu’il semble se prolonger au delà de notre monde, dans un domaine qui
appartient déjà au rêve (2). C’est ainsi qu’on retrouve dans la tête du Louvre ce mélange
de réalisme et de spiritualité qui est incontestablement un des grands charmes de l’art
amarnien.
Cette tête est assez belle pour supporter la critique et il est juste, après en avoir fait
(1) U est d’ailleurs probable que cette infirmité avait fini par s’imposer comme un idéal de beauté.
(2) Cette impression tient peut-être au fait que les yeux, notamment l’œil gauche, semblent bien n’avoir jamais été com-
plètement achevés par le sculpteur.
qui permet de supposer
que l’infirmité (1), chez
elles, n’était pas seulement
simulée par un confor-
misme de cour, mais pro-
voquée par un des procé-
dés évoqués plus haut.
La forme et les di-
mensions du crâne ne sont
pas les seules singularités
physiques que l’on relève
dans la nouvelle tête du
Louvre. On doit égale-
ment signaler la place des
oreilles, plantées beaucoup
trop en arrière, et aussi la
longueur anormale du cou,
et sa gracilité qui paraît
d’autant plus exagérée que
plus lourde est la masse
9
Peinture murale représentant un atelier de sculpteur à Amarna.
(D’après Davies, The Reek Tombs of El Amarna, III, pl. 18.)
qu’il doit supporter. Ce contraste donne une impression d’extrême fragilité et plaît par
l’image gracieuse qu’elle évoque d’une fleur trop lourde pour sa tige.
Mais l’art amarnien ne se reconnaît pas seulement à des particularités physiques comme
celles qui viennent d’être énumérées, il se recommande surtout par une tendance à une
spiritualité qui s’affirme nettement dans la tête qui fait l’objet de cette notice. Cette spiri-
tualité se dégage d’un ensemble de qualités dont il suffira de mentionner les plus appa-
rentes : d’une part, la vie qu’on remarque notamment dans le dessin asymétrique des lèvres
bien charnues et presque frémissantes; d’autre part, la hardiesse de la stylisation, particuliè-
rement sensible, ici, dans les ailes du nez prolongées par l’élégante courbe des sourcils;
enfin, la douceur du regard imprécis, infiniment plus éloquent du fait même qu’il est lé-
gèrement voilé et qu’il semble se prolonger au delà de notre monde, dans un domaine qui
appartient déjà au rêve (2). C’est ainsi qu’on retrouve dans la tête du Louvre ce mélange
de réalisme et de spiritualité qui est incontestablement un des grands charmes de l’art
amarnien.
Cette tête est assez belle pour supporter la critique et il est juste, après en avoir fait
(1) U est d’ailleurs probable que cette infirmité avait fini par s’imposer comme un idéal de beauté.
(2) Cette impression tient peut-être au fait que les yeux, notamment l’œil gauche, semblent bien n’avoir jamais été com-
plètement achevés par le sculpteur.
qui permet de supposer
que l’infirmité (1), chez
elles, n’était pas seulement
simulée par un confor-
misme de cour, mais pro-
voquée par un des procé-
dés évoqués plus haut.
La forme et les di-
mensions du crâne ne sont
pas les seules singularités
physiques que l’on relève
dans la nouvelle tête du
Louvre. On doit égale-
ment signaler la place des
oreilles, plantées beaucoup
trop en arrière, et aussi la
longueur anormale du cou,
et sa gracilité qui paraît
d’autant plus exagérée que
plus lourde est la masse
9