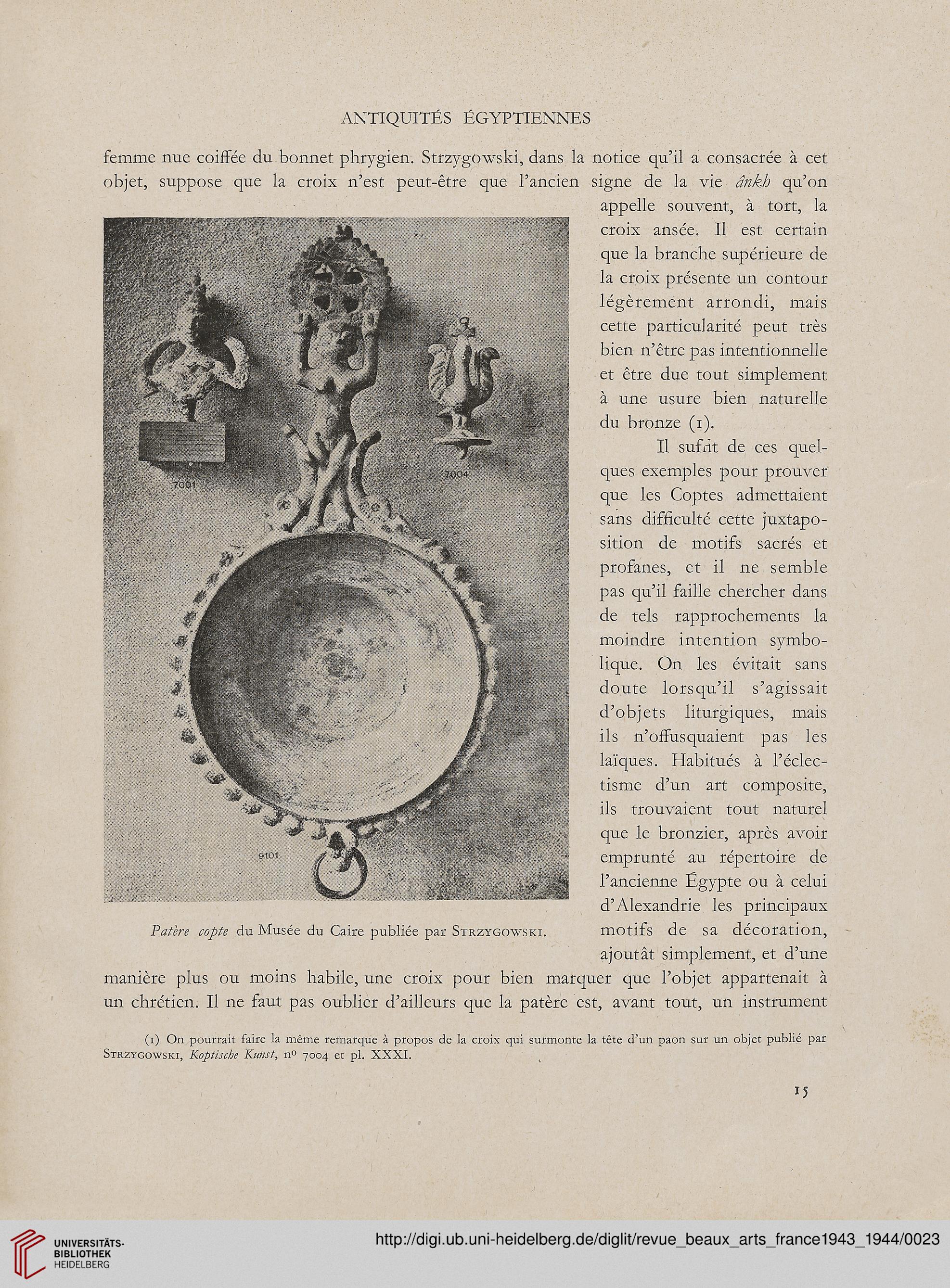ANTIQUITÉS ÉGYPTIENNES
■■
(i) On pourrait faire la même remarque à propos de la croix qui surmonte la tête d’un paon sur un objet publié par
Strzygowski, Koptische Kimst, n° 7004 et pl. XXXI.
femme nue coiffée du bonnet phrygien. Strzygowski, dans la notice qu’il a consacrée à cet
objet, suppose que la croix n’est peut-être que l’ancien signe de la vie ânkh qu’on
appelle souvent, à tort, la
croix ansée. Il est certain
que la branche supérieure de
la croix présente un contour
légèrement arrondi, mais
cette particularité peut très
bien n’être pas intentionnelle
et être due tout simplement
à une usure bien naturelle
du bronze (i).
Il suffit de ces quel-
ques exemples pour prouver
que les Coptes admettaient
sans difficulté cette juxtapo-
sition de motifs sacrés et
profanes, et il ne semble
pas qu’il faille chercher dans
de tels rapprochements la
moindre intention symbo-
lique. On les évitait sans
doute lorsqu’il s’agissait
d’objets liturgiques, mais
ils n’offusquaient pas les
laïques. Habitués à l’éclec-
tisme d’un art composite,
ils trouvaient tout naturel
que le bronzier, après avoir
emprunté au répertoire de
l’ancienne Égypte ou à celui
d’Alexandrie les principaux
motifs de sa décoration,
ajoutât simplement, et d’une
manière plus ou moins habile, une croix pour bien marquer que l’objet appartenait à
un chrétien. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que la patère est, avant tout, un instrument
91Ü t
Patère copte du Musée du Caire publiée par Strzygowski.
H
■■
(i) On pourrait faire la même remarque à propos de la croix qui surmonte la tête d’un paon sur un objet publié par
Strzygowski, Koptische Kimst, n° 7004 et pl. XXXI.
femme nue coiffée du bonnet phrygien. Strzygowski, dans la notice qu’il a consacrée à cet
objet, suppose que la croix n’est peut-être que l’ancien signe de la vie ânkh qu’on
appelle souvent, à tort, la
croix ansée. Il est certain
que la branche supérieure de
la croix présente un contour
légèrement arrondi, mais
cette particularité peut très
bien n’être pas intentionnelle
et être due tout simplement
à une usure bien naturelle
du bronze (i).
Il suffit de ces quel-
ques exemples pour prouver
que les Coptes admettaient
sans difficulté cette juxtapo-
sition de motifs sacrés et
profanes, et il ne semble
pas qu’il faille chercher dans
de tels rapprochements la
moindre intention symbo-
lique. On les évitait sans
doute lorsqu’il s’agissait
d’objets liturgiques, mais
ils n’offusquaient pas les
laïques. Habitués à l’éclec-
tisme d’un art composite,
ils trouvaient tout naturel
que le bronzier, après avoir
emprunté au répertoire de
l’ancienne Égypte ou à celui
d’Alexandrie les principaux
motifs de sa décoration,
ajoutât simplement, et d’une
manière plus ou moins habile, une croix pour bien marquer que l’objet appartenait à
un chrétien. Il ne faut pas oublier d’ailleurs que la patère est, avant tout, un instrument
91Ü t
Patère copte du Musée du Caire publiée par Strzygowski.
H