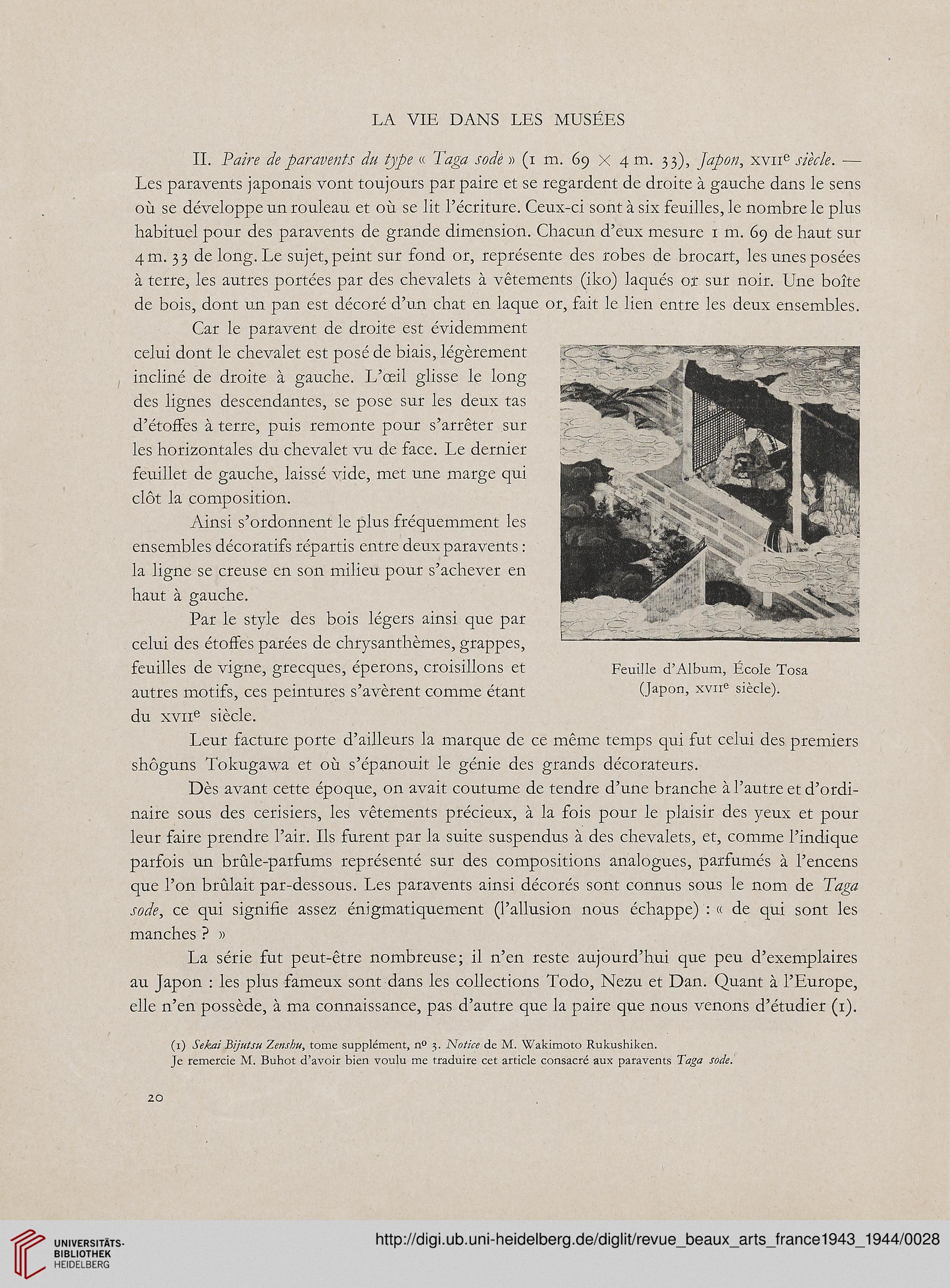LA VIE DANS LES MUSÉES
II. Paire de paravents du type « Taga sodé » (i m. 69 x 4 m. 33), Japon, xvne siècle. —
Les paravents japonais vont toujours par paire et se regardent de droite à gauche dans le sens
où se développe un rouleau et où se lit l’écriture. Ceux-ci sont à six feuilles, le nombre le plus
habituel pour des paravents de grande dimension. Chacun d’eux mesure 1 m. 69 de haut sur
4 m. 53 de long. Le sujet, peint sur fond or, représente des robes de brocart, les unes posées
à terre, les autres portées par des chevalets à vêtements (iko) laqués or sur noir. Une boîte
de bois, dont un pan est décoré d’un chat en laque or, fait le lien entre les deux ensembles.
Car le paravent de droite est évidemment
celui dont le chevalet est posé de biais, légèrement
incliné de droite à gauche. L’œil glisse le long
des lignes descendantes, se pose sur les deux tas
d’étoffes à terre, puis remonte pour s’arrêter sur
les horizontales du chevalet vu de face. Le dernier
feuillet de gauche, laissé vide, met une marge qui
clôt la composition.
Ainsi s’ordonnent le plus fréquemment les
ensembles décoratifs répartis entre deux paravents :
la ligne se creuse en son milieu pour s’achever en
haut à gauche.
Par le style des bois légers ainsi que par
celui des étoffes parées de chrysanthèmes, grappes,
feuilles de vigne, grecques, éperons, croisillons et
autres motifs, ces peintures s’avèrent comme étant
du xvne siècle.
Feuille d’Album, École Tosa
(Japon, xvne siècle).
Leur facture porte d’ailleurs la marque de ce même temps qui fut celui des premiers
shoguns Tokugawa et où s’épanouit le génie des grands décorateurs.
Dès avant cette époque, on avait coutume de tendre d’une branche à l’autre et d’ordi-
naire sous des cerisiers, les vêtements précieux, à la fois pour le plaisir des yeux et pour
leur faire prendre l’air. Ils furent par la suite suspendus à des chevalets, et, comme l’indique
parfois un brûle-parfums représenté sur des compositions analogues, parfumés à l’encens
que l’on brûlait par-dessous. Les paravents ainsi décorés sont connus sous le nom de Paga
sodé, ce qui signifie assez énigmatiquement (l’allusion nous échappe) : « de qui sont les
manches ? »
La série fut peut-être nombreuse; il n’en reste aujourd’hui que peu d’exemplaires
au Japon : les plus fameux sont dans les collections Todo, Nezu et Dan. Quant à l’Europe,
elle n’en possède, à ma connaissance, pas d’autre que la paire que nous venons d’étudier (1).
(1) Sekai Tàjutsu 7.enshu, tome supplément, n° 3. Notice de M. Wakimoto Rukushiken.
Je remercie M. Buhot d’avoir bien voulu me traduire cet article consacré aux paravents Taga sodé.
20
II. Paire de paravents du type « Taga sodé » (i m. 69 x 4 m. 33), Japon, xvne siècle. —
Les paravents japonais vont toujours par paire et se regardent de droite à gauche dans le sens
où se développe un rouleau et où se lit l’écriture. Ceux-ci sont à six feuilles, le nombre le plus
habituel pour des paravents de grande dimension. Chacun d’eux mesure 1 m. 69 de haut sur
4 m. 53 de long. Le sujet, peint sur fond or, représente des robes de brocart, les unes posées
à terre, les autres portées par des chevalets à vêtements (iko) laqués or sur noir. Une boîte
de bois, dont un pan est décoré d’un chat en laque or, fait le lien entre les deux ensembles.
Car le paravent de droite est évidemment
celui dont le chevalet est posé de biais, légèrement
incliné de droite à gauche. L’œil glisse le long
des lignes descendantes, se pose sur les deux tas
d’étoffes à terre, puis remonte pour s’arrêter sur
les horizontales du chevalet vu de face. Le dernier
feuillet de gauche, laissé vide, met une marge qui
clôt la composition.
Ainsi s’ordonnent le plus fréquemment les
ensembles décoratifs répartis entre deux paravents :
la ligne se creuse en son milieu pour s’achever en
haut à gauche.
Par le style des bois légers ainsi que par
celui des étoffes parées de chrysanthèmes, grappes,
feuilles de vigne, grecques, éperons, croisillons et
autres motifs, ces peintures s’avèrent comme étant
du xvne siècle.
Feuille d’Album, École Tosa
(Japon, xvne siècle).
Leur facture porte d’ailleurs la marque de ce même temps qui fut celui des premiers
shoguns Tokugawa et où s’épanouit le génie des grands décorateurs.
Dès avant cette époque, on avait coutume de tendre d’une branche à l’autre et d’ordi-
naire sous des cerisiers, les vêtements précieux, à la fois pour le plaisir des yeux et pour
leur faire prendre l’air. Ils furent par la suite suspendus à des chevalets, et, comme l’indique
parfois un brûle-parfums représenté sur des compositions analogues, parfumés à l’encens
que l’on brûlait par-dessous. Les paravents ainsi décorés sont connus sous le nom de Paga
sodé, ce qui signifie assez énigmatiquement (l’allusion nous échappe) : « de qui sont les
manches ? »
La série fut peut-être nombreuse; il n’en reste aujourd’hui que peu d’exemplaires
au Japon : les plus fameux sont dans les collections Todo, Nezu et Dan. Quant à l’Europe,
elle n’en possède, à ma connaissance, pas d’autre que la paire que nous venons d’étudier (1).
(1) Sekai Tàjutsu 7.enshu, tome supplément, n° 3. Notice de M. Wakimoto Rukushiken.
Je remercie M. Buhot d’avoir bien voulu me traduire cet article consacré aux paravents Taga sodé.
20