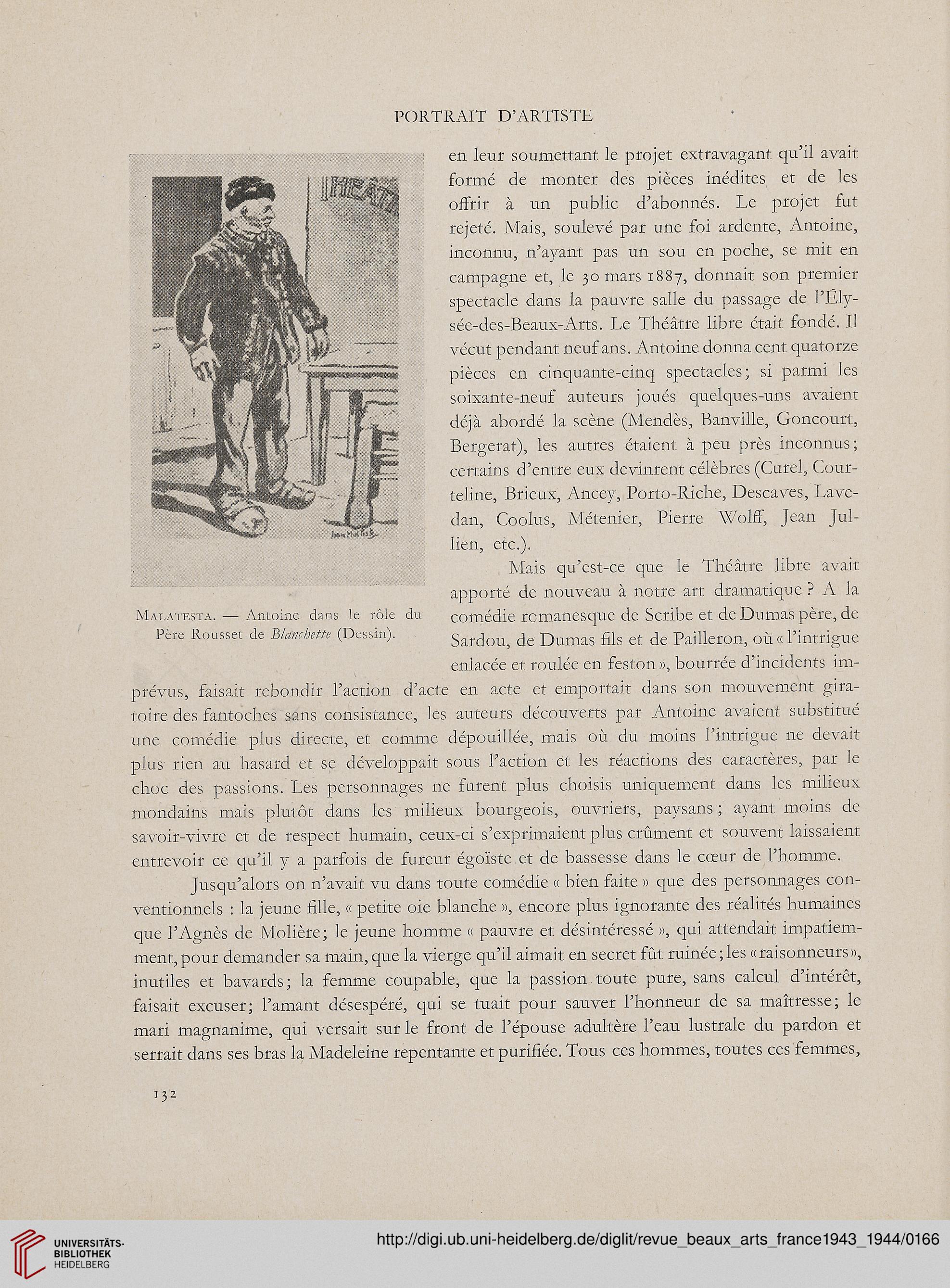PORTRAIT D’ARTISTE
en leur soumettant le projet extravagant qu’il avait
formé de monter des pièces inédites et de les
offrir à un public d’abonnés. Le projet fut
rejeté. Mais, soulevé par une foi ardente, Antoine,
inconnu, n’ayant pas un sou en poche, se mit en
campagne et, le 30 mars 1887, donnait son premier
spectacle dans la pauvre salle du passage de l’Ely-
sée-des-Beaux-Arts. Le Théâtre libre était fondé. Il
vécut pendant neuf ans. Antoine donna cent quatorze
pièces en cinquante-cinq spectacles; si parmi les
soixante-neuf auteurs joués quelques-uns avaient
déjà abordé la scène (Mendès, Banville, Goncourt,
Bergerat), les autres étaient à peu près inconnus;
certains d’entre eux devinrent célèbres (Curel, Cour-
teline, Brieux, Ancey, Porto-Riche, Descaves, Lave-
dan, Coolus, Métenier, Pierre Wolff, Jean Jul-
lien, etc.).
Mais qu’est-ce que le Théâtre libre avait
apporté de nouveau à notre art dramatique ? A la
comédie romanesque de Scribe et de Dumas père, de
Sardou, de Dumas fils et de Pailleron, où « l’intrigue
enlacée et roulée en feston », bourrée d’incidents im-
prévus, faisait rebondir l’action d’acte en acte et emportait dans son mouvement gira-
toire des fantoches sans consistance, les auteurs découverts par Antoine avaient substitué
une comédie plus directe, et comme dépouillée, mais où du moins l’intrigue ne devait
plus rien au hasard et se développait sous l’action et les réactions des caractères, par le
choc des passions. Les personnages ne furent plus choisis uniquement dans les milieux
mondains mais plutôt dans les milieux bourgeois, ouvriers, paysans ; ayant moins de
savoir-vivre et de respect humain, ceux-ci s’exprimaient plus crûment et souvent laissaient
entrevoir ce qu’il y a parfois de fureur égoïste et de bassesse dans le cœur de l’homme.
Jusqu’alors on n’avait vu dans toute comédie « bien faite » que des personnages con-
ventionnels : la jeune fille, « petite oie blanche », encore plus ignorante des réalités humaines
que l’Agnès de Molière; le jeune homme « pauvre et désintéressé », qui attendait impatiem-
ment, pour demander sa main, que la vierge qu’il aimait en secret fût ruinée;les «raisonneurs»,
inutiles et bavards; la femme coupable, que la passion toute pure, sans calcul d’intérêt,
faisait excuser; l’amant désespéré, qui se tuait pour sauver l’honneur de sa maîtresse; le
mari magnanime, qui versait sur le front de l’épouse adultère l’eau lustrale du pardon et
serrait dans ses bras la Madeleine repentante et purifiée. Tous ces hommes, toutes ces femmes.
Malatesta. — Antoine dans le rôle du
Père Rousset de Planchette (Dessin).
132
en leur soumettant le projet extravagant qu’il avait
formé de monter des pièces inédites et de les
offrir à un public d’abonnés. Le projet fut
rejeté. Mais, soulevé par une foi ardente, Antoine,
inconnu, n’ayant pas un sou en poche, se mit en
campagne et, le 30 mars 1887, donnait son premier
spectacle dans la pauvre salle du passage de l’Ely-
sée-des-Beaux-Arts. Le Théâtre libre était fondé. Il
vécut pendant neuf ans. Antoine donna cent quatorze
pièces en cinquante-cinq spectacles; si parmi les
soixante-neuf auteurs joués quelques-uns avaient
déjà abordé la scène (Mendès, Banville, Goncourt,
Bergerat), les autres étaient à peu près inconnus;
certains d’entre eux devinrent célèbres (Curel, Cour-
teline, Brieux, Ancey, Porto-Riche, Descaves, Lave-
dan, Coolus, Métenier, Pierre Wolff, Jean Jul-
lien, etc.).
Mais qu’est-ce que le Théâtre libre avait
apporté de nouveau à notre art dramatique ? A la
comédie romanesque de Scribe et de Dumas père, de
Sardou, de Dumas fils et de Pailleron, où « l’intrigue
enlacée et roulée en feston », bourrée d’incidents im-
prévus, faisait rebondir l’action d’acte en acte et emportait dans son mouvement gira-
toire des fantoches sans consistance, les auteurs découverts par Antoine avaient substitué
une comédie plus directe, et comme dépouillée, mais où du moins l’intrigue ne devait
plus rien au hasard et se développait sous l’action et les réactions des caractères, par le
choc des passions. Les personnages ne furent plus choisis uniquement dans les milieux
mondains mais plutôt dans les milieux bourgeois, ouvriers, paysans ; ayant moins de
savoir-vivre et de respect humain, ceux-ci s’exprimaient plus crûment et souvent laissaient
entrevoir ce qu’il y a parfois de fureur égoïste et de bassesse dans le cœur de l’homme.
Jusqu’alors on n’avait vu dans toute comédie « bien faite » que des personnages con-
ventionnels : la jeune fille, « petite oie blanche », encore plus ignorante des réalités humaines
que l’Agnès de Molière; le jeune homme « pauvre et désintéressé », qui attendait impatiem-
ment, pour demander sa main, que la vierge qu’il aimait en secret fût ruinée;les «raisonneurs»,
inutiles et bavards; la femme coupable, que la passion toute pure, sans calcul d’intérêt,
faisait excuser; l’amant désespéré, qui se tuait pour sauver l’honneur de sa maîtresse; le
mari magnanime, qui versait sur le front de l’épouse adultère l’eau lustrale du pardon et
serrait dans ses bras la Madeleine repentante et purifiée. Tous ces hommes, toutes ces femmes.
Malatesta. — Antoine dans le rôle du
Père Rousset de Planchette (Dessin).
132