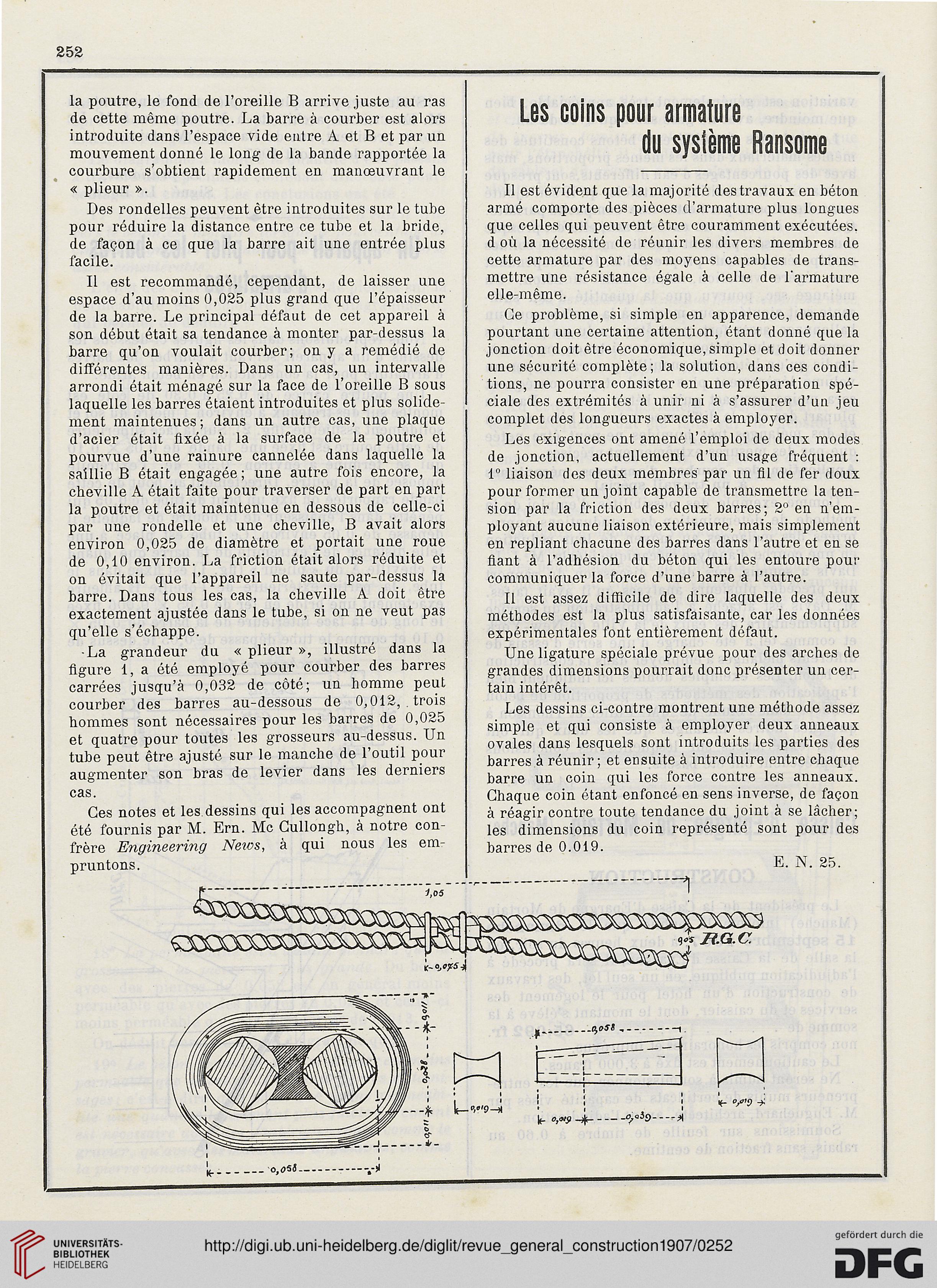252
la poutre, le fond de l'oreille B arrive juste au ras
de cette même poutre. La barre à courber est alors
introduite dans l'espace vide entre A et B et par un
mouvement donné le long de la bande rapportée la
courbure s'obtient rapidement en manœuvrant le
« plieur ».
Des rondelles peuvent être introduites sur le tube
pour réduire la distance entre ce tube et la bride,
de façon à ce que la barre ait une entrée plus
facile.
Il est recommandé, cependant, de laisser une
espace d'au moins 0,025 plus grand que l'épaisseur
de la barre. Le principal défaut de cet appareil à
son début était sa tendance à monter par-dessus la
barre qu'on voulait courber; on y a remédié de
différentes manières. Dans un cas, un intervalle
arrondi était ménagé sur la face de l'oreille B sous
laquelle les barres étaient introduites et plus solide-
ment maintenues ; dans un autre cas, une plaque
d'acier était fixée à la surface de la poutre et
pourvue d'une rainure cannelée dans laquelle la
saillie B était engagée; une autre fois encore, la
cheville À était faite pour traverser de part en part
la poutre et était maintenue en dessous de celle-ci
par une rondelle et une cheville, B avait alors
environ 0,025 de diamètre et portait une roue
de 0,10 environ. La friction était alors réduite et
on évitait que l'appareil ne saute par-dessus la
barre. Dans tous les cas, la cheville A doit être
exactement ajustée dans le tube, si on ne veut pas
qu'elle s'échappe.
•La grandeur du « plieur », illustré dans la
figure 1, a été employé pour courber des barres
carrées jusqu'à 0,032 de côté; un homme peut
courber des barres au-dessous de 0,012, trois
hommes sont nécessaires pour les barres de 0,025
et quatre pour toutes les grosseurs au-dessus. Un
tube peut être ajusté sur le manche de l'outil pour
augmenter son bras de levier dans les derniers
cas.
Ces notes et les dessins qui les accompagnent ont
été fournis par M. Ern. Me Cullongh, à notre con-
frère Engineering Neics, à qui nous les em-
pruntons.
r Los
Les coins pour armature
du système Ransome
Il est évident que la majorité des travaux en béton
armé comporte des pièces d'armature plus longues
que celles qui peuvent être couramment exécutées,
d où la nécessité de réunir les divers membres de
cette armature par des moyens capables de trans-
mettre une résistance égale à celle de l'armature
elle-même.
Ce problème, si simple en apparence, demande
pourtant une certaine attention, étant donné que la
jonction doit être économique, simple et doit donner
une sécurité complète; la solution, dans ces condi-
tions, ne pourra consister en une préparation spé-
ciale des extrémités à unir ni à s'assurer d'un jeu
complet des longueurs exactes à employer.
Les exigences ont amené l'emploi de deux modes
de jonction, actuellement d'un usage fréquent :
1° liaison des deux membres par un fil de fer doux
pour former un joint capable de transmettre la ten-
sion par la friction des deux barres; 2° en n'em-
ployant aucune liaison extérieure, mais simplement
en repliant chacune des barres dans l'autre et en se
fiant à l'adhésion du béton qui les entoure poui'
communiquer la force d'une barre à l'autre.
Il est assez difficile de dire laquelle des deux
méthodes est la plus satisfaisante, car les données
expérimentales font entièrement défaut.
Une ligature spéciale prévue pour des arches de
grandes dimensions pourrait donc présenter un cer-
tain intérêt.
Les dessins ci-contre montrent une méthode assez
simple et qui consiste à employer deux anneaux
ovales dans lesquels sont introduits les parties des
barres à réunir; et ensuite à introduire entre chaque
barre un coin qui les force contre les anneaux.
Chaque coin étant enfoncé en sens inverse, de façon
à réagir contre toute tendance du joint à se lâcher;
les dimensions du coin représenté sont pour des
barres de 0.019.
E. N. 25.
la poutre, le fond de l'oreille B arrive juste au ras
de cette même poutre. La barre à courber est alors
introduite dans l'espace vide entre A et B et par un
mouvement donné le long de la bande rapportée la
courbure s'obtient rapidement en manœuvrant le
« plieur ».
Des rondelles peuvent être introduites sur le tube
pour réduire la distance entre ce tube et la bride,
de façon à ce que la barre ait une entrée plus
facile.
Il est recommandé, cependant, de laisser une
espace d'au moins 0,025 plus grand que l'épaisseur
de la barre. Le principal défaut de cet appareil à
son début était sa tendance à monter par-dessus la
barre qu'on voulait courber; on y a remédié de
différentes manières. Dans un cas, un intervalle
arrondi était ménagé sur la face de l'oreille B sous
laquelle les barres étaient introduites et plus solide-
ment maintenues ; dans un autre cas, une plaque
d'acier était fixée à la surface de la poutre et
pourvue d'une rainure cannelée dans laquelle la
saillie B était engagée; une autre fois encore, la
cheville À était faite pour traverser de part en part
la poutre et était maintenue en dessous de celle-ci
par une rondelle et une cheville, B avait alors
environ 0,025 de diamètre et portait une roue
de 0,10 environ. La friction était alors réduite et
on évitait que l'appareil ne saute par-dessus la
barre. Dans tous les cas, la cheville A doit être
exactement ajustée dans le tube, si on ne veut pas
qu'elle s'échappe.
•La grandeur du « plieur », illustré dans la
figure 1, a été employé pour courber des barres
carrées jusqu'à 0,032 de côté; un homme peut
courber des barres au-dessous de 0,012, trois
hommes sont nécessaires pour les barres de 0,025
et quatre pour toutes les grosseurs au-dessus. Un
tube peut être ajusté sur le manche de l'outil pour
augmenter son bras de levier dans les derniers
cas.
Ces notes et les dessins qui les accompagnent ont
été fournis par M. Ern. Me Cullongh, à notre con-
frère Engineering Neics, à qui nous les em-
pruntons.
r Los
Les coins pour armature
du système Ransome
Il est évident que la majorité des travaux en béton
armé comporte des pièces d'armature plus longues
que celles qui peuvent être couramment exécutées,
d où la nécessité de réunir les divers membres de
cette armature par des moyens capables de trans-
mettre une résistance égale à celle de l'armature
elle-même.
Ce problème, si simple en apparence, demande
pourtant une certaine attention, étant donné que la
jonction doit être économique, simple et doit donner
une sécurité complète; la solution, dans ces condi-
tions, ne pourra consister en une préparation spé-
ciale des extrémités à unir ni à s'assurer d'un jeu
complet des longueurs exactes à employer.
Les exigences ont amené l'emploi de deux modes
de jonction, actuellement d'un usage fréquent :
1° liaison des deux membres par un fil de fer doux
pour former un joint capable de transmettre la ten-
sion par la friction des deux barres; 2° en n'em-
ployant aucune liaison extérieure, mais simplement
en repliant chacune des barres dans l'autre et en se
fiant à l'adhésion du béton qui les entoure poui'
communiquer la force d'une barre à l'autre.
Il est assez difficile de dire laquelle des deux
méthodes est la plus satisfaisante, car les données
expérimentales font entièrement défaut.
Une ligature spéciale prévue pour des arches de
grandes dimensions pourrait donc présenter un cer-
tain intérêt.
Les dessins ci-contre montrent une méthode assez
simple et qui consiste à employer deux anneaux
ovales dans lesquels sont introduits les parties des
barres à réunir; et ensuite à introduire entre chaque
barre un coin qui les force contre les anneaux.
Chaque coin étant enfoncé en sens inverse, de façon
à réagir contre toute tendance du joint à se lâcher;
les dimensions du coin représenté sont pour des
barres de 0.019.
E. N. 25.