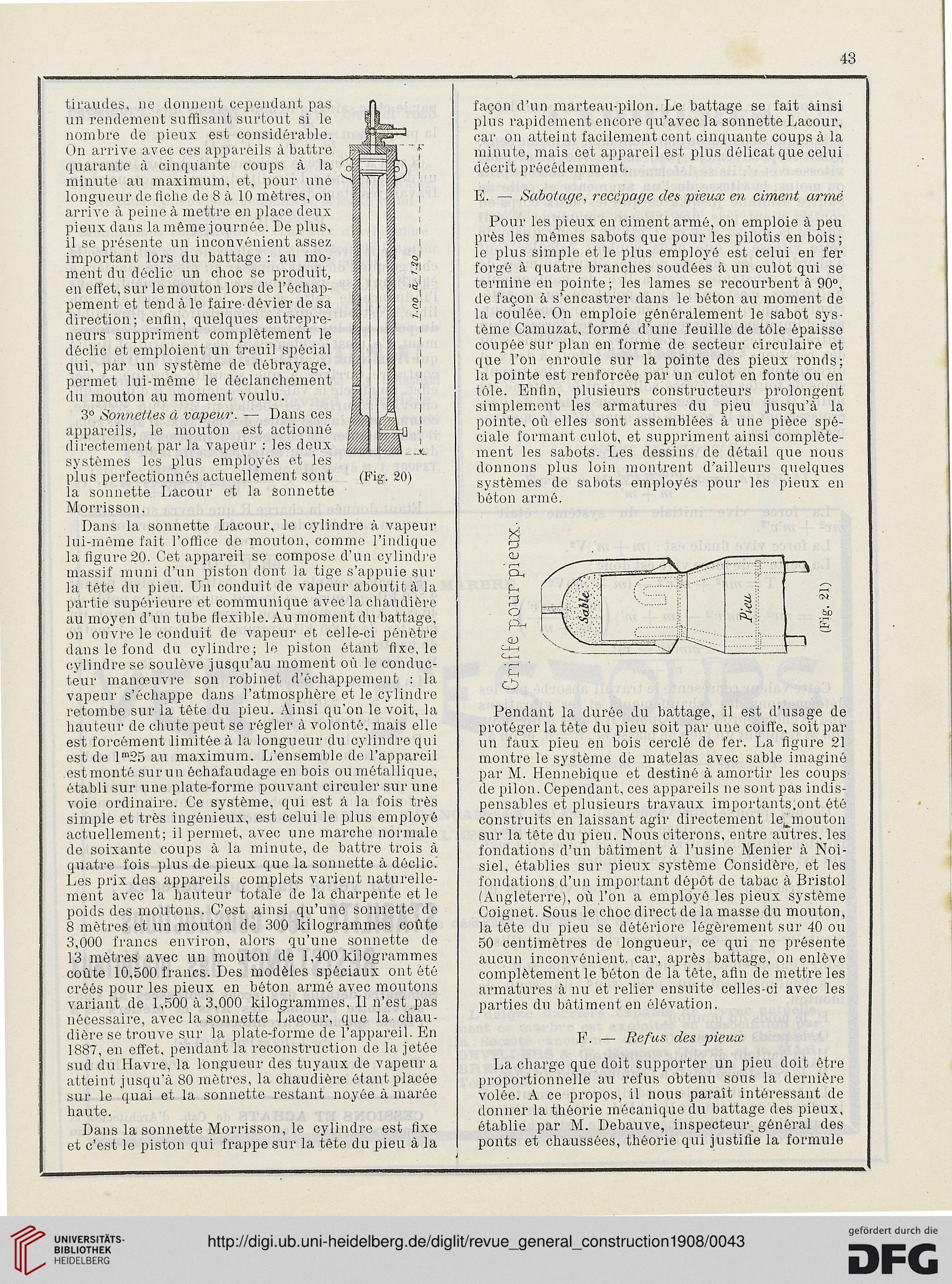18
tiraudes, ne donnent cependant pas
un rendement suffisant surtout si le
nombre de pieux est considérable.
On arrive avec ces appareils à battre
quarante à cinquante coups à la
minute au maximum, et, pour une
longueur de fiche de 8 à 10 mètres, on
arrive à peine à mettre en place deux
pieux dans la même journée. De plus,
il se présente un inconvénient assez
important lors du battage : au mo-
ment du déclic un choc se produit,
en effet, sur le mouton lors de l'échap-
pement et tend à le faire-dévier de sa
direction; enfin, quelques entrepre-
neurs suppriment complètement le
déclic et emploient un treuil spécial
qui, par un système de débrayage,
permet lui-même le déclanchement
du mouton au moment voulu.
3° Sonnettes à vapeur. — Dans ces
appareils, le mouton est actionné
directement par la vapeur : les deux
systèmes les plus employés et les
plus perfectionnés actuellement sont (Fig. 20)
la sonnette Lacour et la sonnette
Morrisson.
Dans la sonnette Lacour, le cylindre à vapeur
lui-même fait l'office de mouton, comme l'indique
la figure 20. Cet appareil se compose d'un cylindre
massif muni d'un piston dont la tige s'appuie sur
la tête du pieu. Un conduit de vapeur aboutit à la
partie supérieure et communique avec la chaudière
au moyen d'un tube flexible. Au moment du battage,
on ouvre le conduit de vapeur et celle-ci pénètre
dans le fond du cylindre; le piston étant fixe, le
cylindre se soulève jusqu'au moment où le conduc-
teur manœuvre son robinet d'échappement : la
vapeur s'échappe dans l'atmosphère et le cylindre
retombe sur la tête du pieu. Ainsi qu'on le voit, la
hauteur de chute peut se régler à volonté, mais elle
est forcément limitée à la longueur du cylindre qui
est de lm25 au maximum. L'ensemble de l'appareil
est monté sur un échafaudage en bois ou métallique,
établi sur une plate-forme pouvant circuler sur une
voie ordinaire. Ce système, qui est à la fois très
simple et très ingénieux, est celui le plus employé
actuellement; il permet, avec une marche normale
de soixante coups à la minute, de battre trois à
quatre fois plus de pieux que la sonnette à déclic.
Les prix des appareils complets varient naturelle-
ment avec la hauteur totale de la charpente et le
poids des moutons. C'est ainsi qu'une sonnette do
8 mètres et un mouton de 300 kilogrammes coûte
3,000 francs environ, alors qu'une sonnette de
13 mètres avec un mouton de 1,400 kilogrammes
coûte 10,500 francs. Des modèles spéciaux ont été
créés pour les pieux en béton armé avec moutons
variant de 1,500 à 3,000 kilogrammes. Il n'est .pas
nécessaire, avec la sonnette Lacour, que la chau-
dière se trouve sur la plate-forme de l'appareil. En
1887, en effet, pendant la reconstruction de la jetée
sud du Havre, la longueur des tuyaux de vapeur a
atteint jusqu'à 80 mètres, la chaudière étant placée
sur le quai et la sonnette restant noyée à marée
haute.
Dans la sonnette Morrisson, le cylindre est fixe
et c'est le piston qui frappe sur la tête du pieu à la
façon d'un marteau-pilon. Le battage se fait ainsi
plus rapidement encore qu'avec la sonnette Lacour,
car on atteint facilement cent cinquante coups à la
minute, mais cet appareil est plus délicat que celui
décrit précédemment.
E. — Subotage, recépage des pieux en ciment armé
Pour les pieux en ciment armé, on emploie à peu
près les mêmes sabots que pour les pilotis en bois;
le plus simple et le plus employé est celui en fer
forgé à quatre branches soudées à un culot qui se
termine en pointe; les lames se recourbent à 90°,
de façon à s'encastrer dans le béton au moment de
la coulée. On emploie généralement le sabot sys-
tème Camuzat, formé d'une feuille de tôle épaisse
coupée sur plan en forme de secteur circulaire et
que l'on enroule sur la pointe des pieux ronds;
la pointe est renforcée par un culot en fonte ou en
tôle. Enfin, plusieurs constructeurs prolongent
simplement les armatures du pieu jusqu'à la
pointe, où elles sont assemblées à une pièce spé-
ciale formant culot, et suppriment ainsi complète-
ment les sabots. Les dessins de détail que nous
donnons plus loin montrent d'ailleurs quelques
systèmes de sabots employés pour les pieux en
béton armé.
X
u
P-i
P
o
■3!
52*
Pendant la durée du battage, il est d'usage de
protéger la tête du pieu soit par une coiffe, soit par
un faux pieu en bois cerclé de fer. La figure 21
montre le système de matelas avec sable imaginé
par M. Hennebiqne et destiné à amortir les coups
de pilon. Cependant, ces appareils ne sont pas indis-
pensables et plusieurs travaux importants.ont été
construits en laissant agir directement le^mouton
sur la tête du pieu. Nous citerons, entre autres, les
fondations d'un bâtiment à l'usine Menier à Noi-
siel, établies sur pieux système Considère., et les
fondations d'un important dépôt de tabac à Bristol
(Angleterre), où l'on a employé les pieux système
Coignet. Sous le choc direct de la masse du mouton,
la tête du pieu se détériore légèrement sur 40 ou
50 centimètres de longueur, ce qui ne présente
aucun inconvénient, car, après battage, on enlève
complètement le béton de la tête, afin de mettre les
armatures à nu et relier ensuite celles-ci avec les
parties du bâtiment en élévation.
P. — Refus des pieux
La charge que doit supporter un pieu doit être
proportionnelle au refus obtenu sous la dernière
volée. A ce propos, il nous paraît intéressant de
donner la théorie mécanique du battage des pieux,
établie par M. Debauve, inspecteur, général des
ponts et chaussées, théorie qui justifie la formule
tiraudes, ne donnent cependant pas
un rendement suffisant surtout si le
nombre de pieux est considérable.
On arrive avec ces appareils à battre
quarante à cinquante coups à la
minute au maximum, et, pour une
longueur de fiche de 8 à 10 mètres, on
arrive à peine à mettre en place deux
pieux dans la même journée. De plus,
il se présente un inconvénient assez
important lors du battage : au mo-
ment du déclic un choc se produit,
en effet, sur le mouton lors de l'échap-
pement et tend à le faire-dévier de sa
direction; enfin, quelques entrepre-
neurs suppriment complètement le
déclic et emploient un treuil spécial
qui, par un système de débrayage,
permet lui-même le déclanchement
du mouton au moment voulu.
3° Sonnettes à vapeur. — Dans ces
appareils, le mouton est actionné
directement par la vapeur : les deux
systèmes les plus employés et les
plus perfectionnés actuellement sont (Fig. 20)
la sonnette Lacour et la sonnette
Morrisson.
Dans la sonnette Lacour, le cylindre à vapeur
lui-même fait l'office de mouton, comme l'indique
la figure 20. Cet appareil se compose d'un cylindre
massif muni d'un piston dont la tige s'appuie sur
la tête du pieu. Un conduit de vapeur aboutit à la
partie supérieure et communique avec la chaudière
au moyen d'un tube flexible. Au moment du battage,
on ouvre le conduit de vapeur et celle-ci pénètre
dans le fond du cylindre; le piston étant fixe, le
cylindre se soulève jusqu'au moment où le conduc-
teur manœuvre son robinet d'échappement : la
vapeur s'échappe dans l'atmosphère et le cylindre
retombe sur la tête du pieu. Ainsi qu'on le voit, la
hauteur de chute peut se régler à volonté, mais elle
est forcément limitée à la longueur du cylindre qui
est de lm25 au maximum. L'ensemble de l'appareil
est monté sur un échafaudage en bois ou métallique,
établi sur une plate-forme pouvant circuler sur une
voie ordinaire. Ce système, qui est à la fois très
simple et très ingénieux, est celui le plus employé
actuellement; il permet, avec une marche normale
de soixante coups à la minute, de battre trois à
quatre fois plus de pieux que la sonnette à déclic.
Les prix des appareils complets varient naturelle-
ment avec la hauteur totale de la charpente et le
poids des moutons. C'est ainsi qu'une sonnette do
8 mètres et un mouton de 300 kilogrammes coûte
3,000 francs environ, alors qu'une sonnette de
13 mètres avec un mouton de 1,400 kilogrammes
coûte 10,500 francs. Des modèles spéciaux ont été
créés pour les pieux en béton armé avec moutons
variant de 1,500 à 3,000 kilogrammes. Il n'est .pas
nécessaire, avec la sonnette Lacour, que la chau-
dière se trouve sur la plate-forme de l'appareil. En
1887, en effet, pendant la reconstruction de la jetée
sud du Havre, la longueur des tuyaux de vapeur a
atteint jusqu'à 80 mètres, la chaudière étant placée
sur le quai et la sonnette restant noyée à marée
haute.
Dans la sonnette Morrisson, le cylindre est fixe
et c'est le piston qui frappe sur la tête du pieu à la
façon d'un marteau-pilon. Le battage se fait ainsi
plus rapidement encore qu'avec la sonnette Lacour,
car on atteint facilement cent cinquante coups à la
minute, mais cet appareil est plus délicat que celui
décrit précédemment.
E. — Subotage, recépage des pieux en ciment armé
Pour les pieux en ciment armé, on emploie à peu
près les mêmes sabots que pour les pilotis en bois;
le plus simple et le plus employé est celui en fer
forgé à quatre branches soudées à un culot qui se
termine en pointe; les lames se recourbent à 90°,
de façon à s'encastrer dans le béton au moment de
la coulée. On emploie généralement le sabot sys-
tème Camuzat, formé d'une feuille de tôle épaisse
coupée sur plan en forme de secteur circulaire et
que l'on enroule sur la pointe des pieux ronds;
la pointe est renforcée par un culot en fonte ou en
tôle. Enfin, plusieurs constructeurs prolongent
simplement les armatures du pieu jusqu'à la
pointe, où elles sont assemblées à une pièce spé-
ciale formant culot, et suppriment ainsi complète-
ment les sabots. Les dessins de détail que nous
donnons plus loin montrent d'ailleurs quelques
systèmes de sabots employés pour les pieux en
béton armé.
X
u
P-i
P
o
■3!
52*
Pendant la durée du battage, il est d'usage de
protéger la tête du pieu soit par une coiffe, soit par
un faux pieu en bois cerclé de fer. La figure 21
montre le système de matelas avec sable imaginé
par M. Hennebiqne et destiné à amortir les coups
de pilon. Cependant, ces appareils ne sont pas indis-
pensables et plusieurs travaux importants.ont été
construits en laissant agir directement le^mouton
sur la tête du pieu. Nous citerons, entre autres, les
fondations d'un bâtiment à l'usine Menier à Noi-
siel, établies sur pieux système Considère., et les
fondations d'un important dépôt de tabac à Bristol
(Angleterre), où l'on a employé les pieux système
Coignet. Sous le choc direct de la masse du mouton,
la tête du pieu se détériore légèrement sur 40 ou
50 centimètres de longueur, ce qui ne présente
aucun inconvénient, car, après battage, on enlève
complètement le béton de la tête, afin de mettre les
armatures à nu et relier ensuite celles-ci avec les
parties du bâtiment en élévation.
P. — Refus des pieux
La charge que doit supporter un pieu doit être
proportionnelle au refus obtenu sous la dernière
volée. A ce propos, il nous paraît intéressant de
donner la théorie mécanique du battage des pieux,
établie par M. Debauve, inspecteur, général des
ponts et chaussées, théorie qui justifie la formule