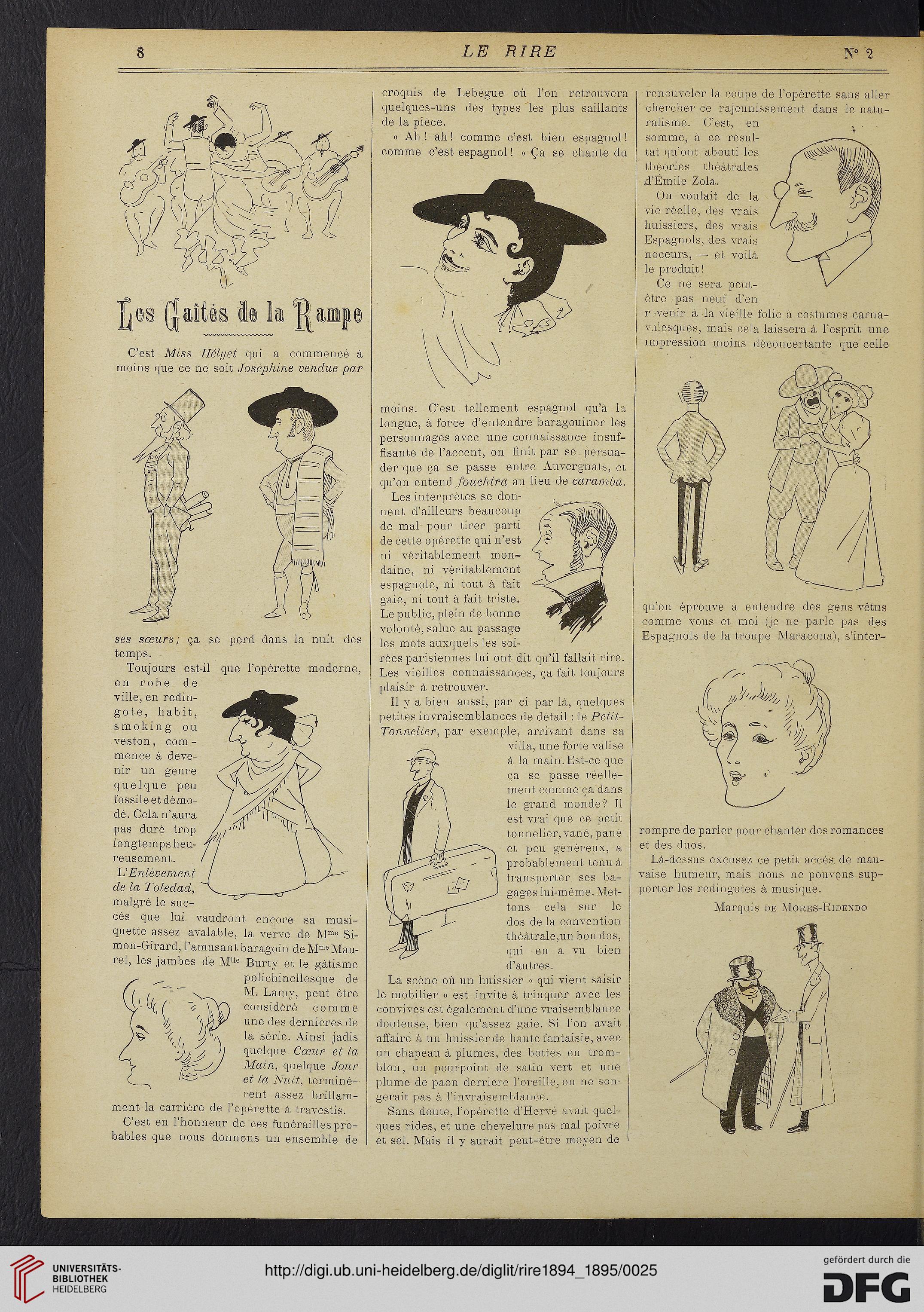8
LE RIRE
N° 2
C’est iWiss Hélyet qui a commencé à
moins que ce ne soit Joséphine vendue par
ses sœurs; ça se perd dans la nuit des
temps.
Toujours est-il que l’opérette moderne,
en robe de
ville, en redin-
go t e, habit,
smoking ou
veston, com -
mence à deve-
nir un genre
quelque peu
fossile et démo-
dé. Cela n’aura
pas duré trop
longtemps heu-
reusement.
L'Enlèvement
de la Toledad,
malgré le suc-
cès que lui vaudront encore sa musi-
quette assez avalable, la verve de Mme Si-
mon-Girard, l’amusant baragoin de Mme Mau-
rel, les jambes de M1Ie Burty et le gâtisme
polichinellesque de
M. Lamy, peut être
considéré c o m m e
une des dernières de
la série. Ainsi jadis
quelque Cœur et la
Main, quelque Jour
et la Nuit, terminè-
rent assez brillam-
ment la carrière de l’opérette à travestis.
C’est en l’honneur de ces funérailles pro-
bables que nous donnons un ensemble de
croquis de Lebègue où l’on retrouvera
quelques-uns des types les plus saillants
de la pièce.
« Ah ! ah ! comme c’est bien espagnol !
comme c’est espagnol ! » Ça se chante du
moins. C’est tellement espagnol qu’à la
longue, à force d’entendre baragouiner les
personnages avec une connaissance insuf-
fisante de l’accent, on finit par se persua-
der que ça se passe entre Auvergnats, et
qu’on entend fouehtra au lieu de earamba.
Les interprètes se don-
nent d’ailleurs beaucoup
de mal pour tirer parti
de cette opérette qui n’est
ni véritablement mon-
daine, ni véritablement
espagnole, ni tout à fait
gaie, ni tout à fait triste.
Le public, plein de bonne
volonté, salue au passage
les mots auxquels les soi-
rées parisiennes lui ont dit qu’il fallait rire.
Les vieilles connaissances, ça fait toujours
plaisir à retrouver.
Il y a bien aussi, par ci par là, quelques
petites invraisemblances de détail : le Petit-
Tonnelier, par exemple, arrivant dans sa
villa, une forte valise
à la main. Est-ce que
ça se passe réelle-
ment comme ça dans
le grand monde? Il
est vrai que ce petit
tonnelier, vané, pané
et peu généreux, a
probablement tenu à
transporter ses ba-
gages lui-mème. Met-
tons cela sur le
dos de la convention
théâtrale,un bon dos,
qui en a vu bien
d’autres.
La scène où un huissier « qui vient saisir
le mobilier » est invité à trinquer avec les
convives est également d’une vraisemblance
douteuse, bien qu’assez gaie. Si l’on avait
affaire à un huissier de haute fantaisie, avec
un chapeau à plumes, des bottes en trom-
blon, un pourpoint de satin vert et une
plume de paon derrière l’oreille^, on ne son-
gerait pas à l’invraisemblance.
Sans doute, l’opérette d’Hervé avait quel-
ques rides, et une chevelure pas mal poivre
et sel. Mais il y aurait peut-être moyen de
renouveler la coupe de l’opérette sans aller
chercher ce rajeunissement dans le natu-
ralisme. C’est, en
somme, à ce résul-
tat qu’ont abouti les
théories théâtrales
d’Émile Zola.
On voulait de la
vie réelle, des vrais
huissiers, des vrais
Espagnols, des vrais
noceurs, — et voilà
le produit!
Ce ne sera peut-
être pas neuf d’en
;
r 'venir à la vieille folie à costumes carna-
valesques, mais cela laissera à l’esprit une
impression moins déconcertante que celle
qu’on éprouve à entendre des gens vêtus
comme vous et moi (je ne parle pas des
Espagnols de la troupe Maracona), s’inter-
rompre de parler pour chanter des romances
et des duos.
Là-dessus excusez ce petit accès, de mau-
vaise humeur, mais nous ne pouvons sup-
porter les redingotes à musique.
Marquis de Mores-Ridendo
LE RIRE
N° 2
C’est iWiss Hélyet qui a commencé à
moins que ce ne soit Joséphine vendue par
ses sœurs; ça se perd dans la nuit des
temps.
Toujours est-il que l’opérette moderne,
en robe de
ville, en redin-
go t e, habit,
smoking ou
veston, com -
mence à deve-
nir un genre
quelque peu
fossile et démo-
dé. Cela n’aura
pas duré trop
longtemps heu-
reusement.
L'Enlèvement
de la Toledad,
malgré le suc-
cès que lui vaudront encore sa musi-
quette assez avalable, la verve de Mme Si-
mon-Girard, l’amusant baragoin de Mme Mau-
rel, les jambes de M1Ie Burty et le gâtisme
polichinellesque de
M. Lamy, peut être
considéré c o m m e
une des dernières de
la série. Ainsi jadis
quelque Cœur et la
Main, quelque Jour
et la Nuit, terminè-
rent assez brillam-
ment la carrière de l’opérette à travestis.
C’est en l’honneur de ces funérailles pro-
bables que nous donnons un ensemble de
croquis de Lebègue où l’on retrouvera
quelques-uns des types les plus saillants
de la pièce.
« Ah ! ah ! comme c’est bien espagnol !
comme c’est espagnol ! » Ça se chante du
moins. C’est tellement espagnol qu’à la
longue, à force d’entendre baragouiner les
personnages avec une connaissance insuf-
fisante de l’accent, on finit par se persua-
der que ça se passe entre Auvergnats, et
qu’on entend fouehtra au lieu de earamba.
Les interprètes se don-
nent d’ailleurs beaucoup
de mal pour tirer parti
de cette opérette qui n’est
ni véritablement mon-
daine, ni véritablement
espagnole, ni tout à fait
gaie, ni tout à fait triste.
Le public, plein de bonne
volonté, salue au passage
les mots auxquels les soi-
rées parisiennes lui ont dit qu’il fallait rire.
Les vieilles connaissances, ça fait toujours
plaisir à retrouver.
Il y a bien aussi, par ci par là, quelques
petites invraisemblances de détail : le Petit-
Tonnelier, par exemple, arrivant dans sa
villa, une forte valise
à la main. Est-ce que
ça se passe réelle-
ment comme ça dans
le grand monde? Il
est vrai que ce petit
tonnelier, vané, pané
et peu généreux, a
probablement tenu à
transporter ses ba-
gages lui-mème. Met-
tons cela sur le
dos de la convention
théâtrale,un bon dos,
qui en a vu bien
d’autres.
La scène où un huissier « qui vient saisir
le mobilier » est invité à trinquer avec les
convives est également d’une vraisemblance
douteuse, bien qu’assez gaie. Si l’on avait
affaire à un huissier de haute fantaisie, avec
un chapeau à plumes, des bottes en trom-
blon, un pourpoint de satin vert et une
plume de paon derrière l’oreille^, on ne son-
gerait pas à l’invraisemblance.
Sans doute, l’opérette d’Hervé avait quel-
ques rides, et une chevelure pas mal poivre
et sel. Mais il y aurait peut-être moyen de
renouveler la coupe de l’opérette sans aller
chercher ce rajeunissement dans le natu-
ralisme. C’est, en
somme, à ce résul-
tat qu’ont abouti les
théories théâtrales
d’Émile Zola.
On voulait de la
vie réelle, des vrais
huissiers, des vrais
Espagnols, des vrais
noceurs, — et voilà
le produit!
Ce ne sera peut-
être pas neuf d’en
;
r 'venir à la vieille folie à costumes carna-
valesques, mais cela laissera à l’esprit une
impression moins déconcertante que celle
qu’on éprouve à entendre des gens vêtus
comme vous et moi (je ne parle pas des
Espagnols de la troupe Maracona), s’inter-
rompre de parler pour chanter des romances
et des duos.
Là-dessus excusez ce petit accès, de mau-
vaise humeur, mais nous ne pouvons sup-
porter les redingotes à musique.
Marquis de Mores-Ridendo