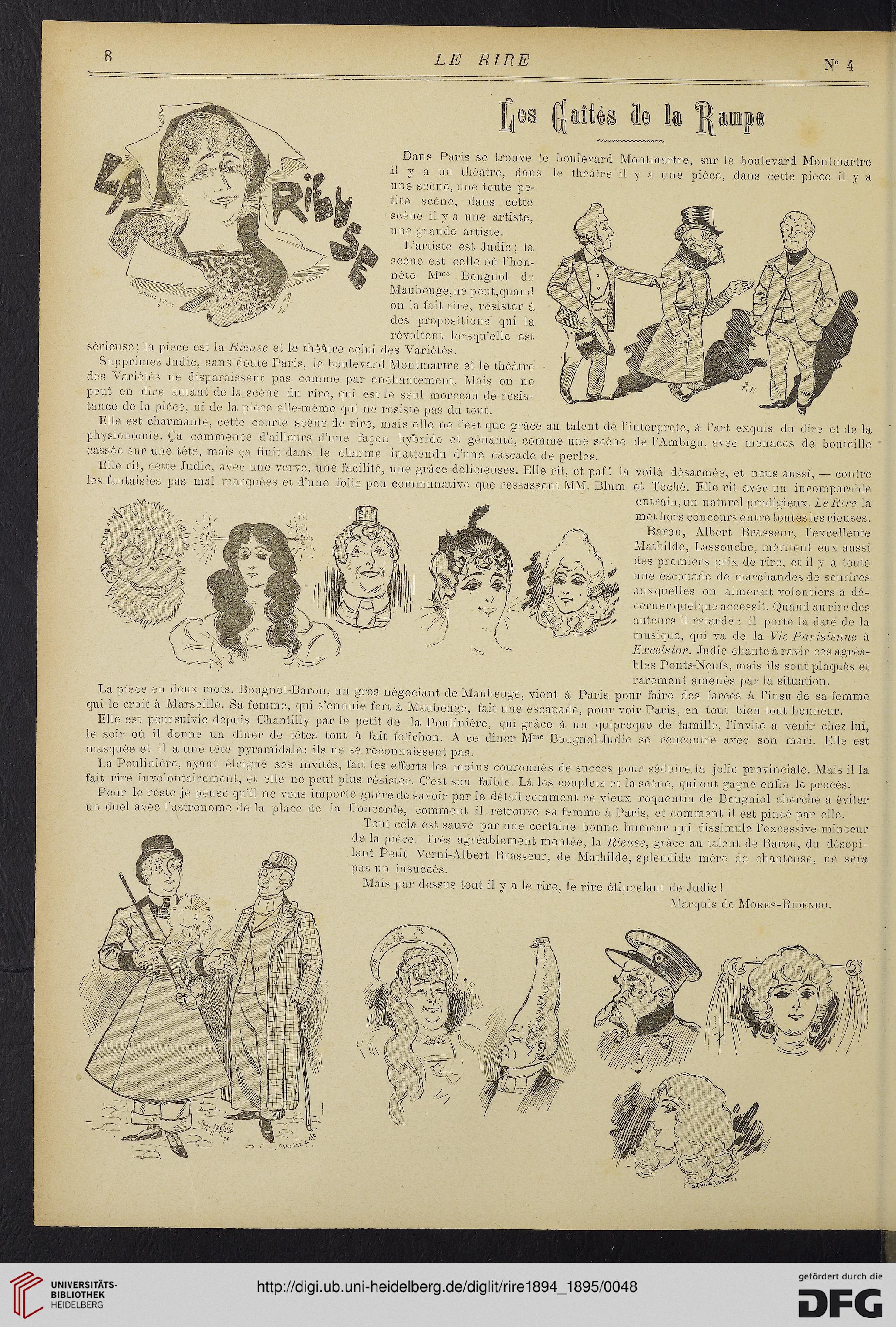8
LE RIRE
N° 4
Dans Paris se trouve le boulevard Montmartre, sur le boulevard Montmartre
il y a un théâtre, dans le théâtre il y a une pièce, dans cette pièce il y a
une scène, une toute pe-
tite scène, dans cette
scène il y a une artiste,
une grande artiste.
L’artiste est Judic ; la
scène est celle où l’hon-
nête Mmo Bougnol do
Maubeuge,ne peut,quand
on la fait rire, résister à
des propositions qui la
révoltent lorsqu’elle est
sérieuse; la pièce est la Rieuse et le théâtre celui des Variétés.
Supprimez Judic, sans doute Paris, le boulevard Montmartre et le théâtre
des Variétés ne disparaissent pas comme par enchantement. Mais on ne
peut en dire autant de la scène du rire, qui est le seul morceau de résis-
tance de la pièce, ni de la pièce elle-même qui ne résiste pas du tout.
Elle est charmante, cette courte scène de rire, mais elle ne l’est que grâce au talent de l’interprète, à l’art exquis du dire et de la
physionomie. Ça commence d’ailleurs d’une façon hybride et gênante, comme une scène de l’Ambigu, avec menaces do bouteille
cassée sur une tète, mais ça finit dans le charme inattendu d’une cascade de perles.
Elle rit, cette Judic, avec une verve, une facilité, une grâce délicieuses. Elle rit, et paf! la voilà désarmée, et nous aussi, — contre
les fantaisies pas mal marquées et d’une folie peu communative que ressassent MM. Blum et Tochê. Elle rit avec un incomparable
entrain, un naturel prodigieux. Le Rire la
met hors concours entre toutes les rieuses.
Baron, Albert Brasseur, l’excellente
Mathilde, Lassouche, méritent eux aussi
des premiers prix de rire, et il y a toute
une escouade de marchandes de sourires
auxquelles on aimerait volontiers à dé-
cerner quelque accessit. Quand au rire des
auteurs il retarde : il porte la date de la
musique, qui va de la Vie Parisienne à
Exeelsior. Judic chante à ravir ces agréa-
bles Ponts-Neufs, mais ils sont plaqués et
rarement amenés par la situation.
La pièce en deux mots. Bougnol-Baron, un gros négociant de Maubeuge, vient à Paris pour faire des farces à l’insu de sa femme
qui le croit à Marseille. Sa femme, qui s’ennuie fort à Maubeuge, fait une escapade, pour voir Paris, en tout bien tout honneur.
Elle est poursuivie depuis Chantilly par le petit de la Poulinière, qui grâce à un quiproquo de famille, l’invite à venir chez lui,
le soir où il donne un dîner de tètes tout à fait folichon. A ce dîner Mme Bougnol-Judic se rencontre avec son mari. Elle est
masquée et il a une tète pyramidale: ils ne se reconnaissent pas.
La Poulinière, ayant éloigné ses invités, fait les efforts les moins couronnés de succès pour séduire.la jolie provinciale. Mais il la
fait rire involontairement, et elle ne peut plus résister. C’est son faible. Là les couplets et la scène, qui ont gagné enfin le procès.
Pour le reste je pense qu’il ne vous importe guère de savoir par le détail comment ce vieux roquentin de Bougniol cherche à éviter
un duel avec l’astronome de la place de la Concorde, comment il retrouve sa femme à Paris, et comment il est pincé par elle.
Tout cela est sauvé par une certaine bonne humeur qui dissimule l’excessive minceur
de la pièce. Très agréablement montée, la Rieuse, grâce au talent de Baron, du désopi-
lant Petit Verni-Albert Brasseur, de Mathilde, splendide mère de chanteuse, ne sera
pas un insuccès.
Mais par dessus tout il y a le rire, le rire étincelant de Judic !
Marquis de Mores-Ridendo.
> D;
LE RIRE
N° 4
Dans Paris se trouve le boulevard Montmartre, sur le boulevard Montmartre
il y a un théâtre, dans le théâtre il y a une pièce, dans cette pièce il y a
une scène, une toute pe-
tite scène, dans cette
scène il y a une artiste,
une grande artiste.
L’artiste est Judic ; la
scène est celle où l’hon-
nête Mmo Bougnol do
Maubeuge,ne peut,quand
on la fait rire, résister à
des propositions qui la
révoltent lorsqu’elle est
sérieuse; la pièce est la Rieuse et le théâtre celui des Variétés.
Supprimez Judic, sans doute Paris, le boulevard Montmartre et le théâtre
des Variétés ne disparaissent pas comme par enchantement. Mais on ne
peut en dire autant de la scène du rire, qui est le seul morceau de résis-
tance de la pièce, ni de la pièce elle-même qui ne résiste pas du tout.
Elle est charmante, cette courte scène de rire, mais elle ne l’est que grâce au talent de l’interprète, à l’art exquis du dire et de la
physionomie. Ça commence d’ailleurs d’une façon hybride et gênante, comme une scène de l’Ambigu, avec menaces do bouteille
cassée sur une tète, mais ça finit dans le charme inattendu d’une cascade de perles.
Elle rit, cette Judic, avec une verve, une facilité, une grâce délicieuses. Elle rit, et paf! la voilà désarmée, et nous aussi, — contre
les fantaisies pas mal marquées et d’une folie peu communative que ressassent MM. Blum et Tochê. Elle rit avec un incomparable
entrain, un naturel prodigieux. Le Rire la
met hors concours entre toutes les rieuses.
Baron, Albert Brasseur, l’excellente
Mathilde, Lassouche, méritent eux aussi
des premiers prix de rire, et il y a toute
une escouade de marchandes de sourires
auxquelles on aimerait volontiers à dé-
cerner quelque accessit. Quand au rire des
auteurs il retarde : il porte la date de la
musique, qui va de la Vie Parisienne à
Exeelsior. Judic chante à ravir ces agréa-
bles Ponts-Neufs, mais ils sont plaqués et
rarement amenés par la situation.
La pièce en deux mots. Bougnol-Baron, un gros négociant de Maubeuge, vient à Paris pour faire des farces à l’insu de sa femme
qui le croit à Marseille. Sa femme, qui s’ennuie fort à Maubeuge, fait une escapade, pour voir Paris, en tout bien tout honneur.
Elle est poursuivie depuis Chantilly par le petit de la Poulinière, qui grâce à un quiproquo de famille, l’invite à venir chez lui,
le soir où il donne un dîner de tètes tout à fait folichon. A ce dîner Mme Bougnol-Judic se rencontre avec son mari. Elle est
masquée et il a une tète pyramidale: ils ne se reconnaissent pas.
La Poulinière, ayant éloigné ses invités, fait les efforts les moins couronnés de succès pour séduire.la jolie provinciale. Mais il la
fait rire involontairement, et elle ne peut plus résister. C’est son faible. Là les couplets et la scène, qui ont gagné enfin le procès.
Pour le reste je pense qu’il ne vous importe guère de savoir par le détail comment ce vieux roquentin de Bougniol cherche à éviter
un duel avec l’astronome de la place de la Concorde, comment il retrouve sa femme à Paris, et comment il est pincé par elle.
Tout cela est sauvé par une certaine bonne humeur qui dissimule l’excessive minceur
de la pièce. Très agréablement montée, la Rieuse, grâce au talent de Baron, du désopi-
lant Petit Verni-Albert Brasseur, de Mathilde, splendide mère de chanteuse, ne sera
pas un insuccès.
Mais par dessus tout il y a le rire, le rire étincelant de Judic !
Marquis de Mores-Ridendo.
> D;