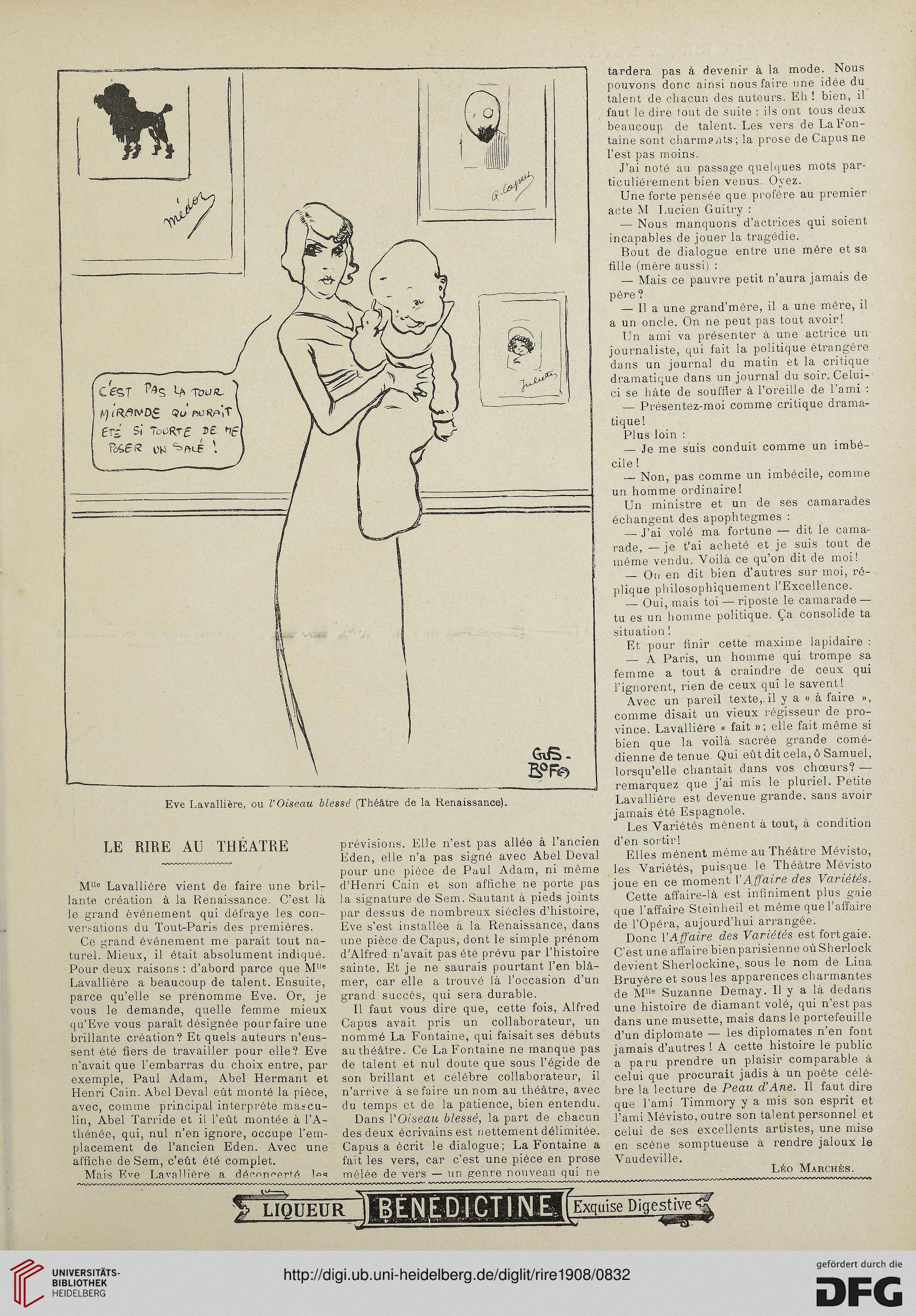LE RIRE AU THÉÂTRE
MUe Lavallière vient de faire une bril-
lante création à la Renaissance. C’est là
le grand événement qui défraye les con-
versations du Tout-Paris des premières.
Ce grand événement me paraît tout na-
turel. Mieux, il était absolument indiqué.
Pour deux raisons : d’abord parce que Mlle
Lavallière a beaucoup de talent. Ensuite,
parce qu’elle se prénomme Eve. Or, je
vous le demande, quelle femme mieux
qu’Eve vous paraît désignée pour faire une
brillante création? Et quels auteurs n’eus-
sent été fiers de travailler pour elle? Eve
n’avait que l’embarras du choix entre, par
exemple, Paul Adam, Abel Hermant et
Henri Cain. Abel Deval eût monté la pièce,
avec, comme principal interprète mascu-
lin, Abel Tarride et il l’eût montée à l’A-
thénée, qui, nul n’en ignore, occupe l’em-
placement de l’ancien Eden. Avec une
affiche de Sem, c’eût été complet.
Mais Eve Lavallière a déconcerté lo«<
prévisions. Elle n’est pas allée à l’ancien
Eden, elle n’a pas signé avec Abel Deval
pour une pièce de Paul Adam, ni même
d’Henri Cain et son affiche ne porte pas
la signature de Sem. Sautant à pieds joints
par dessus de nombreux siècles d’histoire,
Eve s’est installée à la Renaissance, dans
une pièce de Capus, dont le simple prénom
d’Alfred n’avait pas été prévu par l’histoire
sainte. Et je ne saurais pourtant l’en blâ-
mer, car elle a trouvé là l’occasion d’un
grand succès, qui sera durable.
Il faut vous dire que, cette fois, Alfred
Capus avait pris un collaborateur, un
nommé La Fontaine, qui faisait ses débuts
au théâtre. Ce La Fontaine ne manque pas
de talent et nul doute que sous l’égide de
son brillant et célèbre collaborateur, il
n’arrive à se faire un nom au théâtre, avec
du temps et de la patience, bien entendu.
Dans l'Oiseau blessé, la part de chacun
des deux écrivains est nettement délimitée.
Capus a écrit le dialogue; La Fontaine a
fait les vers, car c’est une pièce en prose
mêlée de vers — un genre nouveau qui ne
tardera pas à devenir à la mode. Nous
pouvons donc ainsi nous faire une idée du
talent de chacun des auteurs. Eh ! bien, il
faut le dire tout de suite : ils ont tous deux
beaucoup de talent. Les vers de La Fon-
taine sont charmants ; la prose de Capus ne
l’est pas moins.
J’ai noté au passage quelques mots par-
ticulièrement bien venus. Oyez.
Une forte pensée que profère au premier
acte M Lucien Guitry :
— Nous manquons d’actrices qui soient
incapables de jouer la tragédie.
Bout de dialogue entre une mère et sa
fille (mère aussi) :
— Mais ce pauvre petit n’aura jamais de
père ?
— Il a une grand’mère, il a une mère, il
a un oncle. On ne peut pas tout avoir!
Un ami va présenter à une actrice un
journaliste, qui fait la politique étrangère
dans un journal du matin et la critique
dramatique dans un journal du soir. Celui-
ci se hâte de souffler à l’oreille de l’ami :
— Présentez-moi comme critique drama-
tique!
Plus loin :
— Je me suis conduit comme un imbé-
cile !
— Non, pas comme un imbécile, comme
un homme ordinaire!
Un ministre et un de ses camarades
échangent des apophtegmes :
— J’ai volé ma fortune — dit le cama-
rade, — je t’ai acheté et je suis tout de
même vendu. Voilà ce qu’on dit de moi!
— On en dit bien d’autres sur moi, ré-
plique philosophiquement l’Excellence.
— Oui, mais toi — riposte le camarade —
tu es un homme politique. Ça consolide ta
situation !
Et pour finir cette maxime lapidaire :
— A Paris, un homme qui trompe sa
femme a tout à craindre de ceux qui
l’ignorent, rien de ceux qui le savent!
Avec un pareil texte,, il y a « à faire »,
comme disait un vieux régisseur de pro-
vince. Lavallière « fait »; elle fait même si
bien que la voilà sacrée grande comé-
dienne de tenue Qui eût dit cela, ô Samuel,
lorsqu’elle chantait dans vos choeurs? —
remarquez que j’ai mis le pluriel. Petite
Lavallière est devenue grande, sans avoir
jamais été Espagnole.
Les Variétés mènent à tout, à condition
d’en sortir!
Elles mènent même au Théâtre Mévisto,
les Variétés, puisque le Théâtre Mévisto
joue en ce moment Y Affaire des Variétés.
Cette affaire-là est infiniment plus gaie
que l’affaire Stein lieil et même que l’affaire
de l’Opéra, aujourd’hui arrangée.
Donc l'A ffaire des Variétés est fort gaie.
C’est une affaire bien parisienne où Sherlock
devient Sherlockine, sous le nom de Lina
Bruyère et sous les apparences charmantes
de Mlle Suzanne Demay. Il y a là dedans
une histoire de diamant volé, qui n’est pas
dans une musette, mais dans le portefeuille
d’un diplomate — les diplomates n’en font
jamais d’autres ! A cette histoire le public
a paru prendre un plaisir comparable à
celui que procurait jadis à un poète célè-
bre la lecture de Peau d'Ane. Il faut dire
que l’ami Timmory y a mis son esprit et
l’ami Mévisto, outre son talent personnel et
celui de ses excellents artistes, une mise
en scène somptueuse à rendre jaloux le
Vaudeville.
Léo Marchés.
, ^—-_
LIQUEUR
BENEDICTINE
Exquise Digestive
MUe Lavallière vient de faire une bril-
lante création à la Renaissance. C’est là
le grand événement qui défraye les con-
versations du Tout-Paris des premières.
Ce grand événement me paraît tout na-
turel. Mieux, il était absolument indiqué.
Pour deux raisons : d’abord parce que Mlle
Lavallière a beaucoup de talent. Ensuite,
parce qu’elle se prénomme Eve. Or, je
vous le demande, quelle femme mieux
qu’Eve vous paraît désignée pour faire une
brillante création? Et quels auteurs n’eus-
sent été fiers de travailler pour elle? Eve
n’avait que l’embarras du choix entre, par
exemple, Paul Adam, Abel Hermant et
Henri Cain. Abel Deval eût monté la pièce,
avec, comme principal interprète mascu-
lin, Abel Tarride et il l’eût montée à l’A-
thénée, qui, nul n’en ignore, occupe l’em-
placement de l’ancien Eden. Avec une
affiche de Sem, c’eût été complet.
Mais Eve Lavallière a déconcerté lo«<
prévisions. Elle n’est pas allée à l’ancien
Eden, elle n’a pas signé avec Abel Deval
pour une pièce de Paul Adam, ni même
d’Henri Cain et son affiche ne porte pas
la signature de Sem. Sautant à pieds joints
par dessus de nombreux siècles d’histoire,
Eve s’est installée à la Renaissance, dans
une pièce de Capus, dont le simple prénom
d’Alfred n’avait pas été prévu par l’histoire
sainte. Et je ne saurais pourtant l’en blâ-
mer, car elle a trouvé là l’occasion d’un
grand succès, qui sera durable.
Il faut vous dire que, cette fois, Alfred
Capus avait pris un collaborateur, un
nommé La Fontaine, qui faisait ses débuts
au théâtre. Ce La Fontaine ne manque pas
de talent et nul doute que sous l’égide de
son brillant et célèbre collaborateur, il
n’arrive à se faire un nom au théâtre, avec
du temps et de la patience, bien entendu.
Dans l'Oiseau blessé, la part de chacun
des deux écrivains est nettement délimitée.
Capus a écrit le dialogue; La Fontaine a
fait les vers, car c’est une pièce en prose
mêlée de vers — un genre nouveau qui ne
tardera pas à devenir à la mode. Nous
pouvons donc ainsi nous faire une idée du
talent de chacun des auteurs. Eh ! bien, il
faut le dire tout de suite : ils ont tous deux
beaucoup de talent. Les vers de La Fon-
taine sont charmants ; la prose de Capus ne
l’est pas moins.
J’ai noté au passage quelques mots par-
ticulièrement bien venus. Oyez.
Une forte pensée que profère au premier
acte M Lucien Guitry :
— Nous manquons d’actrices qui soient
incapables de jouer la tragédie.
Bout de dialogue entre une mère et sa
fille (mère aussi) :
— Mais ce pauvre petit n’aura jamais de
père ?
— Il a une grand’mère, il a une mère, il
a un oncle. On ne peut pas tout avoir!
Un ami va présenter à une actrice un
journaliste, qui fait la politique étrangère
dans un journal du matin et la critique
dramatique dans un journal du soir. Celui-
ci se hâte de souffler à l’oreille de l’ami :
— Présentez-moi comme critique drama-
tique!
Plus loin :
— Je me suis conduit comme un imbé-
cile !
— Non, pas comme un imbécile, comme
un homme ordinaire!
Un ministre et un de ses camarades
échangent des apophtegmes :
— J’ai volé ma fortune — dit le cama-
rade, — je t’ai acheté et je suis tout de
même vendu. Voilà ce qu’on dit de moi!
— On en dit bien d’autres sur moi, ré-
plique philosophiquement l’Excellence.
— Oui, mais toi — riposte le camarade —
tu es un homme politique. Ça consolide ta
situation !
Et pour finir cette maxime lapidaire :
— A Paris, un homme qui trompe sa
femme a tout à craindre de ceux qui
l’ignorent, rien de ceux qui le savent!
Avec un pareil texte,, il y a « à faire »,
comme disait un vieux régisseur de pro-
vince. Lavallière « fait »; elle fait même si
bien que la voilà sacrée grande comé-
dienne de tenue Qui eût dit cela, ô Samuel,
lorsqu’elle chantait dans vos choeurs? —
remarquez que j’ai mis le pluriel. Petite
Lavallière est devenue grande, sans avoir
jamais été Espagnole.
Les Variétés mènent à tout, à condition
d’en sortir!
Elles mènent même au Théâtre Mévisto,
les Variétés, puisque le Théâtre Mévisto
joue en ce moment Y Affaire des Variétés.
Cette affaire-là est infiniment plus gaie
que l’affaire Stein lieil et même que l’affaire
de l’Opéra, aujourd’hui arrangée.
Donc l'A ffaire des Variétés est fort gaie.
C’est une affaire bien parisienne où Sherlock
devient Sherlockine, sous le nom de Lina
Bruyère et sous les apparences charmantes
de Mlle Suzanne Demay. Il y a là dedans
une histoire de diamant volé, qui n’est pas
dans une musette, mais dans le portefeuille
d’un diplomate — les diplomates n’en font
jamais d’autres ! A cette histoire le public
a paru prendre un plaisir comparable à
celui que procurait jadis à un poète célè-
bre la lecture de Peau d'Ane. Il faut dire
que l’ami Timmory y a mis son esprit et
l’ami Mévisto, outre son talent personnel et
celui de ses excellents artistes, une mise
en scène somptueuse à rendre jaloux le
Vaudeville.
Léo Marchés.
, ^—-_
LIQUEUR
BENEDICTINE
Exquise Digestive