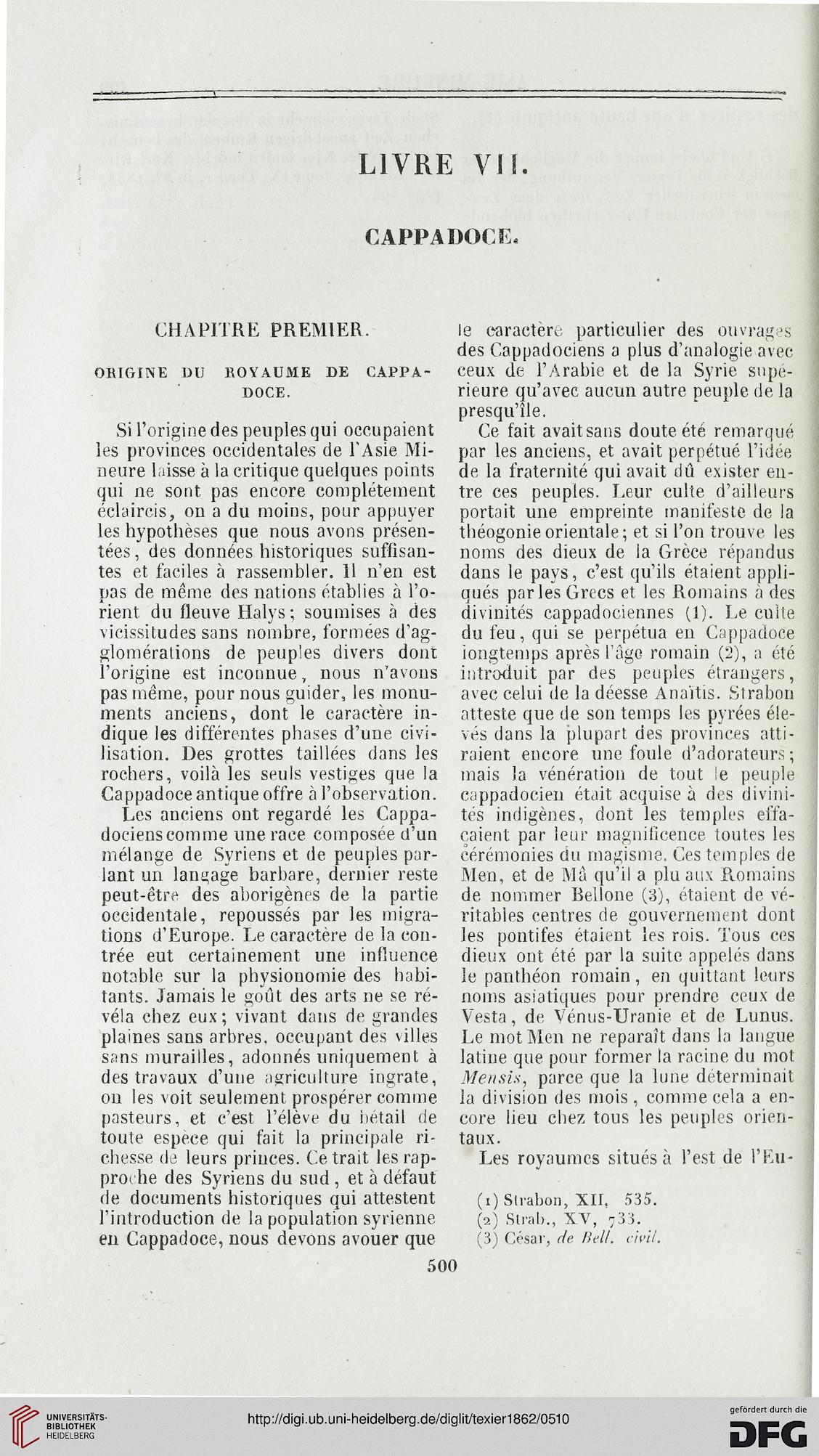Texier, Charles
Asie Mineure: description geographique, historique et archeologique des provinces et des villes de la chersonnése d'Asie
— Paris, 1862
Zitieren dieser Seite
Bitte zitieren Sie diese Seite, indem Sie folgende Adresse (URL)/folgende DOI benutzen:
https://doi.org/10.11588/diglit.10179#0510
DOI Seite / Zitierlink:
https://doi.org/10.11588/diglit.10179#0510
Schmutztitel
Titelblatt
Livre premier
1
CONSEILS SUR L’ORGANISATION d’üN VOYAGE EN ASIE. — HYGIÈNE.
…
puis que l’auteur de ce livre entreprit
…
ne dormaient que sous la protection de
…
de l’autre, position peu commode pour
…
été suivies de conflits dont l’issue fut
…
les monuments; cardans une opération
2
d’une invasion étrangère. Les voyageurs
…
gnés des offres de service les plus ami-
…
fonds commun des connaissances de l’O-
…
et nous signalerons les lacunes qui exis-
…
nes , c’est la confiance dans les popu-
…
élevé dans la crainte des Turcs et de
…
golfe Persique, car les mœurs sont à
3
un autre, il y a encore, un papier de
…
Mahmoud à la demande de l’ambassa-
…
tures , que les vivres nécessaires lui
…
les règles de l’hospitalité soient obser-
…
dessus. Vous donc qui êtes les autorités
…
ne le moleste pas parla demande de la
…
vant les capitulations impériales. Tel
…
Écrit à la fin de la lune de safer 1251
…
Un cawass est une espèce de maréchal
…
mission par les bureaux de la Porte.
…
provisionné , les chevaux bien four-
…
de l’importance en molestant le petit
…
n’a besoin que de savoir faire le pilaw;
…
« indistinctement » toutes les langues
4
sions dans les bazars, et accompagne
…
cheval et par heure de marche; mais
…
une monture plus fine que les chevaux
…
assiettes de fer battu et deux petits ton-
…
de se munir d’une caméra lucida, petit
…
tenant les médicaments les plus usuels,
…
tageusement les sangsues, peut rendre
…
de zèle.
…
voyage, de prendre une consultation
…
les petites indispositions, que la fatigue
5
simples : se conformer à la manière de
…
Les salaisons ne sont pas un aliment
…
quelques boîtes de conserves et de lé-
…
quelques embouchures de fleuves, le
…
un sujet d’effroi pour les voyageurs eu-
…
Orient, nous venions comme tous les
…
une partie de la population franque de
…
puis cette époque les médecins du Caire
…
viendrons plus tard sur ce sujet, qui ne
6
du backchich^ mot turc que les voya-
…
gratuite que l’on attend de l’étranger.
…
avec soi une certaine provision de pias-
…
vénient de morceler l’histoire des pro-
…
les ont élevés, elle tient aussi à la for-
…
commodes, et les grands rochers cal-
7
que, entre les races européennes et les
…
de l’Asie en deux souches bien dis-
…
ce fait avait de saillant pour l’étude
…
souches, l’une, appelée par les anciens
…
de Bryges et de Mysiens émigrés de
…
qui peut s’établir de la manière sui-
…
Les Myliens ;
…
les Grecs, que l’Asie fut ainsi nommée
8
ans, non compris le temps de l’invasion
…
l’Halys (2). Il ressort de toutes ces ci-
…
plètement effacée de la mémoire des
…
de l’expédition des Æoliens qui chas-
…
pas manqué de le dire, comme il le
…
nom à la totalité de l’Asie actuelle;
…
de l’Asie moyenne; voilà pour le conti-
…
contrée est désignée sous le nom de
…
de la nommer La Chersonnèse (1) en
…
DIVISIONS DE L’ASIE MINEURE A DIF-
…
guerre de Troie, les principales provinces
9
rent les divisions de la contrée anté-
…
géographiques. L’invasion de Sésos-
…
les races, soit pour le territoire. La ré-
…
merci des tribus errantes, comme les
…
aborigènes de Lydie avant de se mesu-
…
sion géographique de l’Asie Mineure
…
Les trois dernières en furent détachées.
…
' Les deux Mysies.
…
Les Romains, faisant abstraction des
…
située au nord de cette chaîne ; elle com-
…
dix mille pas de long sur trois cent
…
midi la mer de Pamphylie et faisait sa
…
(4) Ici les provinces du sud ne font plus
10
longueur de cinq cent soixante mille
…
Dès l’origine de la puissance romaine
…
justice. Strabon se plaint de la confu-
…
à cette confusion, c’est que les Romains,
…
ville de Phrygie; elle compte vingt-cinq
…
L’apameenne, chéf-lieu Apamée de
…
nasse; les six villes qui sont sous sa
…
La Lycaonie, annexée au district de
…
siens du Sipyle et les Macédoniens
…
de Diane persique.
…
de l’Asie. » Elle avait dans son ressort
11
Jeune, qui, comme gouverneur de cette
…
mentait l’autorité du proconsul sur
…
inspection générale sur toutes les pro-
…
Constantin tout le territoire de l’empire
…
langue grecque synonyme de juridic-
…
Le nom de thème, qui fut donné à
…
thèmes de l’empire byzantin, ce nom
…
se trouvent les montagnes froides ( le
…
de la Phrygie capatienne depuis Acroï-
…
de l’Isaurie. En largeur, il a vers sa
…
plus tard reçut le nom de patrice.
12
niaient un nombre de troupes indé-
…
monarchies; les Romains les divisèrent
…
tières de l’Arménie. Strabon ni les au-
…
partie de la Cilicie, qui renfermait qua-
…
qui était sous les ordres du proconsul
…
grec désignant, à la cour de Byzance,
…
même où habitent les Bithyniens.
…
Les nations qui habitaient ce thème
…
(1) Célèbre par son église de l’Archange
13
fut appelé Optimatum ; les troupes n’y
…
Les villes remarquables sont :
…
le fleuve Sangarius, sur lequel un pont
…
nom d’un lieu particulier ou de’ quel-
…
Les peuples qui occupent ce thème
…
Héraclée, Pruse (sur l’Hypius), Teium.
…
les cite pourtant au nombre des peu-
…
ciens Perses venus de la Chaldée. La
…
le prouvent les noms seuls des contrées.
14
THÈME XII DE LYCANDUS.
…
de l’Arménie.
…
dement des troupes, sous le titre de
…
poignée d’Arméniens, alla s’emparer de
…
tile et admirablement pourvue de bons
…
peaux de mille brebis variés de couleur
…
ses, mille couleur de belette, mille
…
joie, et fit inscrire sur la porte de Ly-
…
THÈME XIV DE CIBYRRHA.
…
le tombeau de Mausole
15
trouve, la célèbre ville de Telmissus,
…
nom de la ville (1). De là on voit le
…
colonie de Lacédémone.
…
avec un fleuve de même nom, puis le
…
rive à Sagalassus pour finir dans les ré-
…
prétend de la race d’Hercule.
…
La Bithynie, sandjak de Khodawen-
…
coup d’oeil sur la forme géné-
…
tinent, en se dirigeant de l’est à l’ouest.
…
ractère physique ; enfin le relief de la
16
entre le 24° 35' et le 55e degré de lon-
…
degré, et au nord, le promontoire de
…
par cette partie de la Méditerranée que
…
de la ligne tirée d’Amisus à Issus, ou
…
Eratosthène, a trois mille stades de
…
de Chalcédoine à Sinope, soit 647 k- 34,
…
et Issus se trouvent sur le même méri-
…
part énorme dans la constitution de ré-
…
nous le Bosphore comme les Darda-
…
tout le terrain qui avoisine les îles
…
parler de la loi des atterrissements.
…
sur certaines côtes; mais partout où
…
terons de prendre pour exemples quel-
…
de retrait, et en même temps les causes
17
Pompéiopolis, sur la côte d’Asie, Hip-
…
temps diluviens, s’étant établis sur les
…
commode, n’offre plus sur son rivage
…
La province voisine, que les anciens
…
on arrive dans la province de Lycie qui
…
les eaux n’ont pu charrier de limon
…
pas un seul digne de ce nom. Voci la
…
sur cette côte pendant huit mois de l’an-
…
exemples les plus curieux de la puis-
18
times les plus célèbres de l’antiquité.
…
de son pouvoir maritime. Mais Milet
…
anéantir complètement cette mère de
…
observation avait déjà été faite par les
…
prises sur les péages.
…
posée qui est ravinée de la même ma-
…
l’action des eaux sur les rives étant in-
…
bles , a peu à peu comblé le port de
…
jourd’hui comblé par les alluvions du
…
proché où les vaisseaux ne pourront
19
l’ancien rivage; les jetées de l’ancien
…
trouvés les géographes qui voulaient re-
…
qui ont formé de vastes territoires sur
…
moins frappant; sur toute la côte de
…
La côte occidentale de l’Asie Mineure,
…
larges et profonds comme ceux de
…
Trébizonde, située à l’origine de la
…
Les navires sont mouillés aux parages
…
le delta des Kizil Irmak forment les
20
le plus saillant de cette courbe ; ensuite
…
saurait donner le nom de golfe à cet
…
rains autrefois inondes. A partir de ce
…
mation a toujours été pour les popula-
…
qui est à lui seul un port magnifique de
…
d’aspect ; la mer de Marmara dont
…
Bosphore a perdu de sa puissance en
…
L’île de Ténédos en face de la Troade
…
fond du golfe que les terres s’abaissent
21
seaux. Tout ce groupe de montagnes
…
est loin de ressembler à la précédente.
…
l’entrée du golfe de Smyrne; celui du
…
de sa couleurnoire qui avait déjà frappé
…
doutables pour les navires.
…
nexe du golfe de Smyrne; et il fut un
…
de beaucoup tous les âges historiques.
…
forme régulière que les Turcs appellent
…
nombre de petites îles, et notamment
…
portants mouillages de l’Asie Mineure.
…
face à l’île de Chio et au milieu des dé-
…
commerciale inouïe. Les villes de Claros,
22
formaient, qui ont engendré les étangs
…
tué, indique l’entrée du golfe de Jassus,
…
quité sous le nom de Triopium pro-
…
Les terres du cap Krio sont tellement
…
Au fond du golfe de Symé s'élève
…
jourd’hui sous le nom peu poétique de
…
jourd’hui baie de Mermeridjé et en
…
une bande de sable, défend l’entrée des
…
qui avait eu l’imprudence de se retirer à
…
est le plus avancé dans les terres est
…
lomètres dans les terres a é é entière-
…
ment des eaux de la mer; car il se re-
23
trouverait marqué sur toute ia côte, il
…
port de Wathi près d’Antiphellus les
…
l’île de Kastellorizo forme une suite
…
roun par les Turcs, Hepta Kavi par les
…
perd de vue l’entrée, et les marins com-
…
habitées. Un groupe de petites îles,
…
langue de lerre rocheuse; l’autre petite
…
qui n’a pas un kilomètre de large; le
…
inconnu. Le canal de Kakava offre le
…
trace de ville antique. La ville de Limyra,
…
de nature rocheuse, ne reçoit aucun
…
du goife de même nom formé par la côte
24
dans la longueur de plus de quatre-
…
dont le reste de la côte n’offre pas
…
que cette côte a subies par les témoi-
…
parition de ce lac, qui a certainement
…
On voit par le nombre infini de
…
sées dans les rochers, une montagne
…
Trachée des Grecs. Les géographes
…
golfe; mais par suite de la proximité
…
peut mériter le titre de véritable port;
…
de notre ère un témoignage non équi-
25
la physionomie de la côte. Ce phéno-
…
Pyramus atteindre l’île sacrée de Chypre
…
monceaux de sable qui ont obstrué
…
qui viennent sur lest pour faire des char-
…
des briques et une quantité de pro-
…
marin de peu de profondeur; la nou-
…
obstruée par les sables. Le vent de
…
cuper de questions de géographie an-
…
Montagnes de la Lycie.
26
de six ou huit cents métrés au dessus
…
ce qui a lieu, et les vérifications réité-
…
de raison, que l’Asie Mineure n’est pas
…
Ératosthène estime la largeur de la
…
ment au témoignage de ses yeux , voit de
…
leurs ondulations ont formé les limites
…
comme la plus considérable de la terre
27
donne pas moins de vingt différents,
…
mont Zagros de Perse. Ammien Mar-
…
province de Lycie au sud ouest de l’A-
…
née est celle du fleuve Xanthus que les
…
pays; et il n’est pas rare que les habi-
…
de précision. Le nom même du Taurus
…
A l’ouest de la vallée du Xanthus s’é-
…
vert de neige et ses rameaux s’étendent
…
moins de 600 mètres au-dessus du ni-
…
que nous ont laissés les géographes.
…
D’après la description de Strabon, il
…
golfe de Macri appartenait aux Rho-
…
tagne faisait partie de la Lycie, c’est-à-
28
une ville de même nom. C’est dans ces
…
est clair que nous devons restreindre les
…
abrupte vallée de Phinéca, est le mont
…
a une scierie pour débiter les bois.
…
majestueux. Chaque plan de montagne,
…
Étienne de Byzance le désigne comme
…
ble le Cragus, les villes de Xanthus et
…
de Cragus était donné à quelque chaîne
…
de Cragus serait, comme celui de Tau-
29
Tout le massif lycien est composé de
…
le golfe de Telmissus est une brèche
…
est déterminé par la présence de fossiles
…
calcaires qui a porté le peuple de la
…
de ces vallées inextricables au fond des-
…
dans les bas fonds par la fonte des
…
tour de la Lycie. Le port de Caunus
…
le territoire de Caunus passait pour
…
vince de Cibyratis les habitants étaient
…
TAURUS DE PAMPHYLIE ET DE CI-
30
autrefois le nom de Sagalassus. L’épais-
…
laisser passer les eaux de la rivière Dou-
…
conservedehauteur, de huitàneuf cents
…
sif porte aujourd’hui le nom de Des-
…
prend le nom de Baoulo et se rap-
…
nes de Konieh, sont plusieurs massifs,
…
fleuve Mêlas ou Manafgat que les an-
…
alpestre que dans la région de l’ouest.
…
au fleuve Mêlas, il se rapproche de la
…
Le Gœukdagh est de nature calcaire
…
de Cragus était tout à fait local et n’ap-
…
de la côte tant en hauteur qu’en lati-
31
détails de la région montagneuse; c’est
…
aller de la côte à Séleucie. Ici Stra-
…
phylie et la Pisidie, et qui servit de re-
…
barus, que Pline indique au nord de
…
C’est dans la région orientale de
…
saurait se faire une idée de la confu-
…
arrive sur un plateau d’où partent en
…
offre de nombreux fossiles qui ne se
…
pas encore reçu de nom des géologues ;
…
sin du Sarus de celui du Pyramus.
…
tiens, et les ruines de nombreux châ-
…
Pline (2), est de douze mille pas. Pen-
…
les rapides de la montagne, il reprend
32
des géologues, c'est un mélange de
…
depuis la latitude de Malatia jusqu’à
…
Pas de Termessus,
…
La chaîne de montagnes qui borne
…
de Beïlan dagh. Cette chaîne court
…
méridionale de la chaîne. La hauteur ne
…
dans l’intérieur; la ville de Beïlan est
…
fréquemment dans les noms de lieux ,
…
des montagnes de la Cappadoce, c’est-à-
33
ou insaisissables, il est préférable de
…
déterminer les limites des provinces.
…
de précision, la boussole et le baro-
…
teau central de la Phrygie et en for-
…
abord ferait concevoir l’existence de
…
de la Phrygie, apporte à la mer de
…
description de ces montagnes, nous
…
golfe de Macri appartenait à la Carie;
…
se composent différentes parties de
…
le centre de nombreuses vallées qui
34
Une presqu’île rocheuse de calcaire
…
plus de dix mètres au-dessus de la mer,
…
nous signalons sur toute la côte de
…
par une grande île, et à gauche les
…
de sable ferme tout à fait ce passage.
…
ouest. La constitution géologique de ces
…
Phœnix se rattache aux montagnes de
…
vaient les villes de Stratonicée, Mylasa,
…
veiné. La montagne sur laquelle est
…
matériaux pour les monuments de l’a-
…
carrière de fort beau marbre blanc. »
…
dessus du niveau de la mer. Cette mon-
35
tchaï. Toute la composition de cette
…
mée de roches à base de feldspath;
…
dont les eaux jadis marines, adou-
…
tres poissons de mer qui furent enfer-
…
ceinture de forêts qui sont célèbres
…
De l’autre côté du lac court une
…
golfe de Milet. C’est le mont Grius ou
…
posée de schistes micacés et de gneiss,
…
danslequel sontdes carrières de marbre
…
ce nom peut signifier le milieu de la
…
longueur de plus de vingt myriamètres,
…
sous un aspect verdoyant et fertile. Les
…
Messogis diffère complètement de la
…
tiquité peuples de villes nombreuses.
…
jusqu’au plateau de la Phrygie.
36
cupent les pentes est Tralles, aujour-
…
cette province qui fourn t les figues con-
…
c’est aussi le nom du reste de la chaîne
…
reste de la description peut encore s’appli-
…
par les Phrygiens, une autre partie par
…
fondes, qui donnent naissance à de pe-
…
d u mont Pactyas, qui cont ient les chaînes
…
la côte méridionale de l’ancien golfe
…
dénomination de Strabon lui est bien
…
que Pline donne également le nom de
…
à son sommet. Ses flancs renferment de
…
sortant d’Éphèse est Magnésie sur le
37
est située près de ce fleuve ; mais elle est
…
Le revers septentrional de la mon-
…
forme le revers septentrional de la val-
…
dont il ne reste plus aujourd’hui que de
…
table; mais c’est de ses flancs nord que
…
du sein de la terre, alors que le géant
…
avons pas rencontré. Dans les régions de
38
espèce d'autorité, les Grottes d’Homere.
…
ligne de la chaîne du Tmolus. La mon-
…
ne (3) lui donne le nom de Martusie.
…
tièrement composé de trachytes et de
…
dionale du golfe de Smyrne est re-
39
tenté de faire réunir au continent l’île
…
anecdote assez plaisante. Le massif sur
…
golfe de Smyrne s’appelle aujourd’hui
…
de tous ceux qui ont visité ces parages.
…
sine de Chio rentre dans la grande fa-
…
Sur la rive droite du golfe de Smyrne
…
Les roches qui les composent sont des
…
de Bournabat et de Nymphi ; au nord
…
une des montagnes importantes de la
40
calcaire a cessé et les roches schis-
…
dessus de la ville de Pergame on entre
…
de Pergame; c’est un chaos de blocs de
…
une demeure, et quelques murailles de
…
dans tout le cours de l’antiquité sans
…
Il serait difficile de dire laquelle des
…
le sujet de commentaires plus variés et
…
ainsi dire du reste de la NI vsie. C’est
…
Aussi les anciens et surtout Homère
…
Les différents passages des anciens au-
…
comme point de comparaison avec l’é-
…
La meilleure idée topographique de
41
doit être prise de la position de l’Ida.
…
de la Propontide, depuis le détroit d’A-
…
vancent en forme de pieds qui lui
…
traverse pour aller de Ténédos à Les-
…
uns l’appellent golfe de l’Ida; d’autres
…
Selon Démétrius de Scepsis, des par-
…
l’une de l’autre par un long col qui, s’é-
…
stades au-dessus de Scepsis; de cette
…
bité par les Lélèges. Gargara était, dit-il,
…
ainsi nommée de Gargare, fils de Ju-
…
Étienne de Byzance nous apprend
42
de végétation portent le nom de Pha-
…
par le lever du soleil, et qui de nos jours
…
un petit fort est bâti sur une pointe
…
la roche nue de couleur jaunâtre sort
…
Les terrains calcaires que l’on ob-
…
sur la. côte dans une longueur de dix oü
…
empêche de donner à la pierre aucun
…
avons représentée plus haut. Les ma-
43
à l’existence de mines d’argent dans
…
de calcaire marneux et par conséquent
…
par la presqu’île de Cyzique qui est
…
qui est de nature, calcaire, marbre gri-
…
région de l’Olympe, les anciens citent
…
d’Apollonias ou de Milétopolis. Cepen-
…
vers le nord et forme le cap de Bouz
…
tant sur le bord du Sangarius que dans
…
du lac de Sabandja, court a une distance
44
karia l’un des plus longs de l’Asie Mi-
…
Les ondulations de terrain qui se
…
(temple de Jupiter Urius), qui s’élève en
…
dans les eaux de la mer. Son revers
…
montagnes de la Paphlagonie et du
…
ture de noms turcs qui ne se rattache à
…
cette chaîne portait autrefois le nom de
…
montagnes du centre comme les anciens
…
plus commune en Asie que dans les
…
la lutte de l’Euphrate avec le mont
…
dre à tâche de se détourner de son cours
…
mer de Marmara, l’Hermus prenant sa
…
les eaux, ce sont comme des fentes
45
plupart des petits fleuves de la côte sud
…
longeant tranquillement les montagnes
…
de jeter les yeux sur la carte d’Asie pour
…
ou plutôt le massif de l’Olympe mysien
…
La chaîne qui se détache de l’Olympe
…
der hissar (le Château de seigle) est
…
Elle porte aujourd’hui le nom de Mou-
…
de Kutayah est dominée par une mon-
…
vu des hauteurs de Kédiz, grand
…
de la ville de Sevri hissar. Mais le re-
Livre II: La Bithynie
47
PREMIERS COLONS DE LA BITHYNIE.
…
primitive de cette contrée est tellement
…
trouvait hors de la Bithynie an-
…
avec les Dotions. Et quoique Strabon
…
peuples qui ont occupé la partie de la
…
tur., liv. V, ch. XXX; Apollonius de Rhod.,
48
niens et les Ioniens ; ceux-ci se fixèrent
…
peuplades, il serait superflu de vouloir
…
bryces, tué par Pollux (1), les Argo-
…
fut exterminée ; mais les Cimmériens ne
…
point d’absorber tous les autres peu-
…
Cette invasion des peuples de la fa-
…
venaient occuper, que les différentes
…
loin ; il regarde tous les Bithyniens
49
les mêmes faits.
…
Anciennement, les Bithyniens possé-
…
difficile de déterminer les limites de la
…
Sangarius (4). Étienne de Byzance
…
Mais Strabon, sur l’autorité de Théo-
…
plade. Les Milésiens ayant bâti Héra-
…
tie de la Bithynie qu’existe encore une
…
la mer, dit-il, sont cantonnés les Ca-
…
mentionne les Caucones du Pélopon-
…
thénius (5). Il n’est pas étonnant de
50
durent, chassés à leur tour par les Mè-
…
thénius, et qui possédaient la ville de
…
montagne ait conservé de tout temps le
…
Nous croyons que ces documents sur
…
de ces peuples ont perdu jusqu’à leur
…
niens, qui tentèrent constamment de
51
de gouvernement monarchique. C’est ce
…
sur lequel les historiens anciens nous
…
Botyras, fils de Dédalsès , se trouva
…
formé le projet de rendre la liberté aux
…
toujours Bias de cet adversaire dange-
…
Zipœtès dut aussi affermir par les ar-
…
lit être accablé par les forces de Ptolé-
…
celles de Chalcédoine. Mais les discus-
…
Les princes d’Héraclée se souvenaient
…
vent encore parmi les peuples du pla-
52
Zipœtès mourut après un règne de
…
les annales de l’Orient. Il fit massacrer
…
mort. Retiré dans la partie orientale de
…
raclée, anciens ennemis de la Bithynie,
…
de Chalcédoine/Mais, d’un autre côté,
…
vit paraître sur les bords de la Propon-
…
qui campaient aux portes de Byzance
…
Les intérêts de Byzance sont ménagés
…
pour défendre les côtes. Les Gaulois
53
tant de dureté, que Ziélas, l’aîné, fut
…
clée et de Tium avaient pris le parti de
…
ménie ou dans la Cappadoce, car les
…
L’autre fils de Nicomède, Prusias,
…
A la mort de Ziélas , son fils Prusias,
…
Une des places les plus importantes de
…
la ville de Cius (2), ayant fait alliance
54
ville de Myrlée, fondée par Myrlus,
…
pour la distinguer de la ville du même
…
quillement sa vie , après un règne de
…
chasseur, monta sur le trône de Bithynie
…
avait tenté de l’assassiner ; la guerre fut
…
et porta la guerre dans les États du roi
…
cependant détourner Prusias de la plus
…
avouée de rétablir la concorde entre
55
Prusias, obligé de rendre à Eumène
…
bassesse de ses supplications, lui furent
…
thynie pour se venger sur les rois de
…
roi, et reçut le surnom de Philopator.
…
tant qui date de l’époque où elle n’était
…
Romains, mais ne l’empêcha pas de
…
parèrent de la Cappadoce pour venger
…
Ce prince, sous le nom de Nicomède III,
…
fois sur son trône. Depuis ce moment
…
La dynastie des rois de Bithynie doit
…
régna de 378 à 328
…
de l’empire. Décrétée province du peuple
…
vent. son territoire devint le champ de
56
De tous les combats qu’excitèrent les
…
de lui une armée de cinquante mille
…
et engagea la bataille, qui se donna sur
…
Pendant les règnes suivants, l’em-
…
ainsi que les provinces limitrophes,
…
sur le trône, se fit gloire de réparer les
…
comme empereur les murailles de
…
la ville de Nicée. A peine investi de cette
…
des partisans de Procope, lui donna les
…
eut la tête tranchée par ordre de l’em-
…
de faire une guerre en règle, mais dont
…
tection près du trône, les fidèles cou-
…
Les autres parties de l’Asie Mineure
57
les mains de la race musulmane, qui
…
éloigné jusque-là des frontières de la
…
pereur (1). Les Seldjoukides, d’ailleurs
…
chef de la dynastie d’Osman, voulant
…
lorsque les armées des croisés vinrent
…
les limites de la province nouvellement
…
la partie occidentale de la province
…
cendants. C’est là l’origine de la puis-
…
uns de ces fiefs, donnés pour un certain
…
jouissent, de la part des autorités, sinon
…
FRONTIÈRES DE LA BITHYNIE.
…
la limite extrême du territoire de Cau-
58
Héraclée. Elle est à droite de ceux qui
…
Bosphore qui sépare Byzance de Chal-
…
Sous la domination des Romains, les
…
tué au delà de cette ville jusqu’à l’em-
…
Néanmoins, tous les auteurs mo-
…
terminées par la chaîne de l'Olympe,
…
détacha de la Bithynie une vaste portion
…
de la ville la plus importante construite
…
thonius, sur le penchant duquel était
59
s’étend de l’est à l’ouest, dont la partie
…
Plus tard , la ville de Nicomédie ayant
…
Le cap de Chalcédoine, nommé aussi
…
jeter quantité de' caisses dans la mer,
…
, (3) Démosth. de Bithynie, liv. IV. apud
…
pendant les guerres civiles. Pierre Gilles
…
but d’arrêter les efforts du courant.
…
Calpé,/situé près de la rivière de ce
…
de haut à l’endroit le plus bas; et au-
…
plus à l’est, servait aussi de port pour les
60
principes avaient dirigé les artistes de
…
Lorsque les premiers colons grecs
…
par une colonie de Mégariens au com-
…
Spartes habitant de Thèbes. » Si en effet
…
mirent les nouveaux colons. Dédal-
…
de la mort de Lysimaque. 'Le succes-
61
disant qu’Astacus s’est relevée de ses
…
Constantinople les provisions deneige re-
…
sur ces deux cités qu’Astacus, fondée
…
de Nicomédie qu’une seule et même
…
les populations vinrent se fondre dans
…
Le titre de fondateur d’une ville
…
Zipœtès, père de Nicomède. Ce der-
…
l’antiquité, de placer les villes sur des
…
élevée une suite de murailles flanquées
62
de prospérité. Une grande portion de
…
ville de Nicomédie, la nécessité d’avoir
…
Par la seule observation de ses mu-
…
voit les débris d’un môle qui, semblable à
…
qui n’existait pas du temps de l’an-
…
l’élévation varie de cinq à deux mètres,
…
primitivement inaccessible de tous côtés.
63
mède l’orna de monuments somptueux
…
Les empereurs romains , maîtres de
…
vertes dans toutes les directions, des
…
les matériaux précieux dont les patri-
…
satisfaite. Les arsenaux de Nicomédie ,
…
voisinage de tant de carrières magni-
…
curèrent de grands avantages. Pline l’orna
…
pour le bien-être de la province qu’il
…
le golfe de Nicomédie sans avoir à passer
…
villes de son gouvernement, un violent
…
communauté de surveillants pour pré-
…
des sociétés de ce genre (3). En effet,
64
usage répandu dans toutes les villes
…
de Commode. Ce prince a reçu, en ef-
…
jours fidèle à l’empereur, et parmi les
…
inscription identique qui existe dans les
…
guste, pieux, sébaste, la rie année de sa
…
Nicomédie fut le séjour favori de
…
tous les actes odieux reprochés à Dio-
…
il donnait l’ordre de démolir des édi-
…
par ses ordres, et les habitants, ap-
…
habitations de la ville. Tous ces édi-
…
quittant la résidence de Nicomédie,
…
commença la persécution contre les
65
trouve dans une église grecque de la
…
qui administrait le diocèse de Scaman-
…
parèrent de Chalcédoine (2), et cette
…
lorsque les barbares se trouvèrent obli-
…
les phénomènes naturels se joignirent à
…
voit près de la mer quelques affleure-
…
les derniers jours de Nicomédie.
…
nement de la ville croulèrent les uns
…
midi. A ce moment les dieux gardiens de
…
de villes et de montagnes. Etau milieu
…
(1) Libarrii Monodia de Nicomedia, in
66
distinguait pas les objets les plus voi-
…
tourbillons et des torrents de vapeurs
…
rurent de crainte et de disette dans
…
cinquante nuits, achevé de ruiner
…
Ce ne fut guère que sous le règne de
…
mais aucun de ces édifices n’a subsisté
…
niveau de la source, afin que les quar-
…
plus de traces de ce monument ; mais la
67
sur îes briques, était un blocage com-
…
ont longtemps fourni les galères et les
…
les plus importantes de l’Asie Mineure;
…
d’obtenir des renseignements exacts sur
…
gouverneur. Les Arméniens se livrent
68
sacrée par ie sultan Orkhan au culte de
…
port à l’entrée de l’arsenal : Sinam, qui
…
Constantinople, et qui porte le nom de
…
bâtin ems d’un fort tonnage; car les at-
…
Si les nnnes de Nicomédie, exami-
…
pittoresque dans les constructions éle-
…
en Italie des artistes pour étudier les
…
les constructions les modèles d’un art
…
DE NICOMÉDIE.
…
l’origine du terrain de grès rouge qui
69
PERIPLE DU GOLFE DE NICOMEDIE.
…
de Yalovatch qui marque la position
…
ordinairement de quinze jours; on pro-
…
Les coupoles qui couvrent le bain
…
de Nicomédie.
…
combat contre les Sarra/.ins, ces der-
…
petit ruisseau dont les eaux forment
…
sa source dans les montagnes qui sé-
…
du côte de l’ouest par le duc de Nor-
…
village de Hersek est bâti sur un pro-
70
face de celui de Dil ; de sorte qu’en ce
…
conservation de sa conquête (1326). Un
…
doute fondée Astacus « en lace de Ni-
…
La Langue de Lièvre. Un gros village
…
chaudement. Cela dure trois jours ; les
…
qui s’appelait Dil Baba ( le père de la
71
On arrive après une heure de marche
…
qu’une altération de Lybissa, est située à
…
De Annibal, quand i’âine en sera hors.
…
tomber entre les mains des Romains.
…
aujourd’hui couvert de gazon et qui
…
Étienne de Byzance (3) ne la cite
…
dans les terres (1), Pierre Gilles donne
…
Tables de Peutinaer.
…
Le Port de Guébizé était autrefois
…
de Soliman le Grand, une mosquée fut
…
route de Constantinople, on commence
…
nérale qui est fréquentée par les Grecs
72
en une infinité de promontoires. On ar-
…
petite chaîne de collines qui va aboutir
…
d’hui le champ de manœuvres des
…
le nom de source d’Hermagoras.
…
une colonie de Mégariens. Elle prit son
…
que l’oracle de Delphes.
…
satyre contre les habitants de Chal-
…
Sous le règne de Darius Chalcédoine
…
Pendant la guerre entre les rois Pru-
…
Lorsque Mithridate devint de nouveau
73
port, brisa les chaînes qui le fermaient,
…
que peu de monde.
…
avaient remarqué que les trésors pleu-
…
cédoine, et imaginèrent de faire dé-
…
dans le royaume de Pont, et s'étalerait
…
près Lucien, que les tables de bronze
…
sième siècle, sous le règne de l’em-
…
C’était le plus brillant quartier de
…
ment les constructions environnantes
…
fenseurardent de la foi orthodoxe. L’em-
…
le giron de l’Église, et le jour où le
…
394. Les’evêques turent mandes des di-
74
baïde et de l’Égvpte avaient été appelés ;
…
Aminonius lui donna I accolade. De ri-
…
les Byzantins. C’est de là que Théodose
…
L’église de Sainte-Euphémie, décrite
…
nom de la vill où il ei.t lieu. Hiéro-
…
de sinistres événements arrivés a cette
…
tombée entre les mains des Turcs peu
75
rediraient les hymnes chantés dans les
…
blement de terre ou une révolution
…
ville de Chalcédoine avait deux ports
…
s’ouvrait sur le Bosphore, Justinien y
…
une église de Saint Jean ; et comme le
…
qu’ils ne tombent pas sur d’antiques
…
vestige de la ville grecque a disparu.
…
anciens et qui nourrissait de petits cro-
…
sant de petits crocodiles,» et Strabon(2),
76
Le faubourg de Drys ou du Chêne avait
…
ville moderne de Scutari, nommée Us-
…
possible d’imaginer ; en aucun lieu de
…
saient les tributs levés sur les peuples
…
commémoration de ce fait, la ville fut
…
venant du Pont-Euxin. Une flotte de
…
ment pendant le règne des rois de Bi-
…
de Chrysopolis que Licinius fut vaincu
…
scutarii, créé avec les sagittarii par
…
plion emploiepour désigner les courriers
77
par des règlements (1); les voitures à
…
province qui avait la charge de les rem-
…
constamment prêts pour seller les che-
…
de Pergame pour se rendre en Bithy-
…
tration quand les Turcs se sont rendus
…
romaines succédèrent les mensil-hané,
…
blié; les routes, mal entretenues, il est
78
Non-seulement ils ont le droit de pren-
…
dans la maison de poste, prochaine. Les
…
palais. L’invention de ces signaux re-
…
siècle de notre ère. Ils furent perfec-
…
le voisinage de Tarsus (sans doute
…
stations étaient sur les sommets Isamos,
…
de cette télégraphie dans l’histoire by-
…
Le promontoire de Seutari forme la
…
aurait traversé la mer; aussi le cap de
…
mane. Faubourg de Constantinople
79
tribué à embellir Scutari de plusieurs
…
ville de Scutari d’édifices religieux, de
…
ni chrétienne. La mosquée de Sélim III
…
d’une ville qui est la première place de
…
de long cours’; ils sont aussi disposes à
…
le grand cimetière n’est pas décoré de
…
quée sur sa tombe par la forme du tur-
…
des marchands. Lés tombeaux des fem-
…
de la piété publique, sans que jamais on
80
delà d’un siècle. Les nombreuses ins-
…
traits des poètes persans ou arabes les
…
palais de Bryas entendre les cris de dé-
…
chez les Perses, s'était introduitchez les
…
L’ancienne tour était un ouvrage de l’em-
…
sif, couronné de créneaux et couvert par
…
cement de ce siècle, et remplacé par un
…
reçoit les eaux pluviales. Les Turcs ra-
81
près leur position à l’égard de Chalcé-
…
célèbre par ses mines de cuivre, et une
…
noms, les uns turcs, les autres grecs, et
…
Les îles « des Princes » furent ainsi
…
monastère de l’île de Proté, qu’il avait
…
Le plus ancien cloître de l’île de
…
couvent. Les successeurs de Nicéphore
…
Antigone avait reçu le nom de Panor-
82
grâce à la vertu de la statue bicéphale
…
Les ruines du château de Panormus
…
élevé au patriarcat de Constantinople,
…
suite desquels Méthodius fut tiré de sa
…
mines de cuivre qu’on y exploitait ; on
…
Elle paraît avoir été dès les plus anciens
…
îles comme dignes de remarque. L’île
…
tères, celui de Saint-Georges, celui de
…
groupe. Les Turcs lui donnent le nom
…
ligne de petites collines.
…
autres sur une colline. Le village est
…
reste en fait de ruines des anciennes
…
ciée par les princes byzantins qui éle-
83
que Mégalé a pris ie nom de l’île du
…
remonter sur le trône. L’usurpateur fut
…
gnité de patriarche et devint le fonda-
…
de Bryas fut construit par les empe-
…
de Satyrus fut construit par le patriar-
…
le degré de superstition que les indi-
…
la chaîne de l’Olympe Mysien vient, ren-
84
crer des offrandes. La possession de ce
…
cours des habitants de Chaleédoine.
…
fort tel qu’il existait de son temps; les
…
composés de grandes pierres de. taille
…
rent obligés de battre en retraite jus-
…
vingt-troisième année du règne de l’em-
…
ræum où Jason prit une ancre de pierre
…
limite de la presqu’île des Thyniens, et
85
PRUSE SUR L’HYPIUS.
…
noriade fut détachée de la Bithynie par
…
nopolis et Cratia. Les trois premières
…
on arrive au village de Tchandak où
…
de Dustché, dont le nom rappelle celui
…
ce village est situe sur une station an-
…
à cent quatre vingts stades de l’embou-
…
de trentre kilomètres environ. Tout ce
…
les de Pruse fondées l’une au pied de
…
de ses évêques, nommé Hesychius de
86
sans doute un de ces grands parcs de
…
pas moins de quatre mètres de long;
…
véa ou salle, creusée dans le flanc de
…
les temps modernes, plus on doit es-
…
mention d’une ancienne statue de la
…
Les habitants de tous ces districts
…
est peu différente de celle de l’Italie,
…
six kilomètres de marche, on traverse
…
des eaux de ces régions était tout à fait
87
venir déboucher dans le golfe de Ni-
…
A droite de la route de Nicomédie à
…
Sabandja n’est qu’une ville de transit;
…
cienne Sophon (1). Le lac de Sophon a
…
trente-six kilomètres : Les eaux sont
…
prou (les Cinq ponts) , on commence
88
geâtre qui contient du fer hydraté. Les
…
Bientôt on abandonne les bords du
…
le fleuve, rompant les cordages, disper-
…
qu’il ne l’achève en peu de temps ( 1). »
…
en ces termes la construction de ce mo-
…
fié. Sur une des pierres du pont est
…
maintenant tu gis sous les entraves d’une
…
grande porte en forme d’arc de triom-
…
(i) Procope, De Ædif., liv. V, ch. ni.
89
l’inscription de Justinieu, n’a pas con-
…
prouver qu’en effet le pont de Justinien
…
Ces mouvements des rivières de l’A-
…
resserre le défilé par où les eaux s’é-
…
certain nombre de salles voûtées; tout
…
nom de Xérobates que les anciens don-
…
ITINERAIRE DE SABANDJA A GEÏVEH (2),
…
gue dans lequel il entre des cailloux de
…
(1) Plutarch., de Fluviis, 1. II, p. 34,
90
vallée, grossi par les eaux et la fonte
…
pas difficile de trouver au milieu des
…
vière rapide, dont les eaux sont jau-
…
la plupart élevées sur de grands piliers de
…
On trouve à Geïveh assez de vestiges
…
mien Marcellin comme étant sur la
…
kilomètres de Geïveh), petite ville sans
91
duquel les Galles, prêtres de Cybèle,
…
Ils cultivent aussi de la soie, qui se vend
…
de vue est peuplée de nombreux villages
…
canius ou de Nicée. En sortant de Mé-
…
détours; l’endroit paraît abandonné.Les
…
grands de l’Asie Mineure, et défend le
92
les contre-forts inférieurs de l’Olympe,
…
par Antigone, fils de Philippe, qui la
…
les Nicomédiens, embrassa le parti de
…
leur palais. Dans les médailles frappées
…
120 de J.-C. A cette époque, elle était
…
semblé (2), affranchit Nicée de la juri
93
solidité de leur construction, les monu-
…
L’époque brillante de la ville de Ni-
…
paganisme que les chrétiens dissidents
…
Sous le règne de Valens, la ville
…
sements religieux pour les hommes et
…
de Lefké. Nous savons, par le même
…
sol de Nicée.
…
siastiques. Favorisée de toutes les ma-
…
comme chefs de tribus errantes dans le
…
résidence. Les deux fils de Soliman,
94
ancienne importance, fit rassembler les
…
pour les arts qui distinguait les princes
…
ils s’établissaient quelque chose de
…
dans les plaines de la Cappadoce, où
…
était trop riche en matériaux de toute
…
Le succès des Latins encouragea les
…
et revient à Nicée pour chasser les
95
Les prodiges de courage de ceux-ci ne
…
Les hardis auteurs du coup de main
…
Sur la route directe de Nicée à Ghio
…
ou cassaba , de forme carrée, que nous
…
(2) Les historiens des croisades n’ont pas
…
moine Robert, Exorogorgnm parGuibert de
…
mes sur Nicée pour surprendre Soli-
…
alors son pouvoir sur la majeure par-
…
ligence de la stratégie, il avait compris
96
par les empereurs grecs avaient été
…
loin de les intimider, redoubla leur
…
par le lac, sur lequel il n’y avait pas
…
un double rang de tours et par des che-
…
encourager les assiégés à résister aux
…
chargés d’armes, de munitions et d’ha-
97
de Hache et le comte Herman, firent
…
railles pour en saper les fondements;
…
combattaient du haut de leurs remparts
…
de s’étonner qu’une place comme Nicée
…
de l’attaque. Elle a été néanmoins re-
…
par les navires, jugèrent qu’elle ne tom-
…
barques, qui furent transportées sur
…
de ce genre. Au siège de Tarente, les
…
machines pour traîner les galères, qui
…
sur le lac Dascylitis une grande barque
…
Plus tard, au siège de Constantinople
…
passer sur des chariots des barques
…
rieure de la Corne d’Or. Mais de
…
vière appelée par les anciens fleuve As-
98
Cette flottille était sous les ordres du
…
sonne de l’empereur. Lorsque les mu-
…
ment ; le côté du midi, c’est-à dire de
…
force de bras, à faire dans la muraille
…
siège, les chrétiens s’aperçurent avec
…
les combattants qu’elle contient soient
…
événement acheva de démoraliser les
…
croisés. C’est alors que les musulmans
…
ils étaient sûrs de ne pas laisser sur
…
de Nicée n’offrit pas à l’armée ottomane
…
tits forts construits dans les plaines en-
99
traitèrent de leur reddition, dont les
…
près de l’empereur, et les habitants qui
…
d’hui les ruines de l’église appelée
…
d’hui de nombreux vestiges ; mais de-
…
amas de décombres.
…
nien fit construire la grande église de
…
tée de la basilique des anciens, où se
…
d’œuvre d’Anthémius que les architectes
…
dentif sur un plan carré. Ce caractère
…
être, comme toutes les autres, en forme
…
L’empereur, pour honorer les évêques,
100
était au centre de la ville. Mais les ca-
…
imaret (hospice pour les pauvres) que
…
recevaient toujours de la piété du fon-
…
sandjak de Kodjà-Illi ; mais, sous Ma-
…
et habite un quartier séparé, voisin de
…
cheher, au sud. Mais l’air de Nicée est
…
mencé un peu avant l’arrivée de Pline
…
nécessaire pour soutenir de lourdes
101
vons observé, les remparts sont beau-
…
éboulements, complétait la défense de
…
en voit quelques-unes qui n’ont de
…
railles est en briques, qui ont de trente
…
pareillée avec trois assises de moellons
…
tème général de défense est tellement
…
Du côté de l’orient, les murs suivent
…
aujourd’hui porte de Lefké ou deLeucæ.
…
compte soixante-quatre piédestaux d’é
…
sculptés. Sur ce chemin de ronde était
102
des tours de cette muraille est surtout re-
…
frait dans toute leur intégrité les disposi-
…
des murs (1). Chacune de ces cellules a
…
de saint George, monté sur un cheval
…
de la tour par un escalier pratiqué
…
les tours de Nicée sont complètement
…
terne de marbre donne accès dans l’in-
…
sises de 0m,50 de hauteur, et la tour
…
des murs comme un reste de la Nicée de
…
Ici est le trophée de mort des ennemis et
…
état de l’ouvrage.
103
quelques-unes sont carrées. La porte de
…
de la place. Vers la porte de Yeni
…
soldats qu’on observe dans les murailles
…
dont la construction n’a rien de remar-
…
truction ne diffère en rien de celles de
…
Strabon, bien que les quatre portes se
…
De la porte du Sud ou de Yeni
…
sure de Strabon, il faudrait prendre le
104
puisse juger de leur ancienne disposi-
…
En entrant dans la ville du côté de
…
pour venir former sur le chapiteau du
…
les entailles très-peu profondes qui
…
César Hadrien la très-illustre métropole de
…
née 120 de J.-C. 11 est remarquable en
…
La partie supérieure de l’arcade est
105
porte à deux ventaux, en madriers de
…
PORTE DE CONSTANTINOPLE.
…
de Claude II, fut appelé à l’empire l’an
…
génieurs qui ont construit les remparts
…
du rempart. Ces tours ont 10m,03 de
…
deux tours très-rapprochées de l’agger
…
Les murailles de l’agger avaient dans
…
de briques comme les grandes tours du
…
comme des morceaux de bois dans un
…
rieure un morceau d’architrave sur le-
…
ville de Nicée a élevé les murailles et les a
106
Claude n’y est pas nommé en qualité de
…
arcades élevées sur un tertre entouré de
…
Il est du petit nombre des théâtres de
…
dix-neuf mètres de diamètre ; mais il ne
…
dont nous voyons les ruines est le même
…
« Le théâtre de Nicée, bâti en très-
…
a déjà absorbé, rn’a-t on dit, plus de
…
vous qui êtes sur les lieux d’examiner
…
dées que de regarder les ruines qui
…
affermir les principes de l’islamisme,
…
du butin, soit au culte de l’islam, soit
107
ligieux ne se ralentit pas sous les suc-
…
une des fondations de Khayr-Eddin pa-
…
de pèlerinage que les sultans ont élevé
…
voir, fonda la mosquée de Nicée, con-
…
L’édifice que nous décrivons a cela de
…
barrières de marbre, découpées à jour
…
dans un esprit de piété sous le règne du
…
Sur la porte du portique on lit cette
…
férence de ces deux dates indique sans
…
qui indique la direction de la Mecque;
108
nale du quartier grec, et, malgré les
…
était ornée de mosaïques, aujourd’hui
…
qui le couronne, on voit une figure de
…
saïque. Au-dessus de la porte principale,
…
On sait que la charge de vestiarius ,
…
de la sculpture, qu’il remonte au qua-
…
et les ornements se découpent en noir
…
le nom de Sari-Kaïa (la pierre jaune) ;
…
La base des collines est composée de
…
continue pendant trois heures de route,
…
les fit faire la quatrième année de sa
109
l’an de J.-C. 68 ou 69. Voici cette ins-
…
serai' et qui paraît se prolonger sur
…
dorique, la corniche est ornée de denti-
…
passants. Les alternatives des saisons
…
Il est certain que cette masse de
…
que.L’obélisque était compose de six blocs
110
Voila pourquoi les Turcs appellent ce
…
Asclépiodote de Bithynie était ami
…
l’on ajoute à la date de ces faits les
…
teur de Bithynie. On est donc à peu
…
ROUTE DE NICÉE A C1US, GHIO, PAR
…
ridionale du lac et le port de Cius ; c’est
…
de l’Olympe, est couverte d’une végé-
…
tuation et la raison d’être de ce lac sont
…
l’est par les montagnes de Ak serai (2),
…
verra que de ce côté les eaux tendent
…
sel marin (3). Les eaux du lac nourris-
…
Peu de plantes aquatiques croissent
…
(3) Aristote, de Mirab., ch. 54.
111
les hérons, les cigognes et les pélicans
…
prennent leurs ébats sur la plage, sans
…
de la province. Sa petite fleur bleue et
…
de poudingue dont les couches, peu in-
…
partie de l’année; en effet, d'après les
…
qu’il faut placer la ville de Pythopolis,
…
crate, historien de Nicée, Pythopolis au-
…
désespéré donnaau fleuve le nom de So-
…
(2) Plutarque, Vie de Thésée.
112
des villes détruites. « Les villes de Py-
…
La petite ville de Ghio, l'ancienne
…
qu’une très-petite partie de la ville an-
…
truit de grands navires.
…
considérable , attira dans sou sein de
…
port, descendit à terre pour puiser de
…
femme de Rhésus (4) ; c’est une monta-
113
vallées, qui s’étend le long de la Pro-
…
remarquables. Les dimensions de cha-
…
reil seul n’est pas une condition de très-
…
de mortier employé dans la construction
…
jardin en dehors de la ville moderne
…
les chars qui portent des bois de l’O-
…
cornes sont un objet de commerce con-
…
vertes de végétation. A dix kilomètres
…
droite et à gauche jusqu’au sommet de
…
de toute ville, on ne peut que supposer
…
de savoir où sont les points d’attache;
…
l’on passe sur un pont de bois. Les
114
l'ouest de Cius; c’était une colonie de
…
lippe, roi de Macédoine, fils de Démé-
…
Les habitants conservèrent le droit
…
source qui arrose quelques jardins. Sur
…
sorte de culture, le pays est à peu près
…
plaine de Broussa, prend sa source sur
115
lac Dascylitis puisqu’il descend de l’O-
…
trouver dans les anciens vestiges de la
…
moyen âge, à un haut degré de splen-
…
de l’ancienne ville, nous en sommes
…
L’assietté de cette ville sur le pen-
…
qu’au moment où les tribus turques
…
la ville de Cyzique était alors le point
…
de Prusias, qui fut contemporain de
…
de Nicomédie. L’influence de Prusa sur
…
Pendant le règne de cet empereur,
116
degré de prospérité, grâce à la bonne
…
de ses grands projets par Nymphydius
…
accorder leur demande. Les fonds
…
à l’empereur Claude dans le but de
…
sants. Je me propose de construire le
…
11 résulte de cette correspondance
…
renfermant la statue de Trajan, placée
…
de plus il y a fait conduire par un ca-
117
nal des eaux fraîches afin de tempérer la
…
Les souverains comme les patriciens
…
peuplades disséminées dans les steppes
…
chent directement à l’histoire de
…
de la dynastie de Hamadan, assiégea
…
1097, amena de nouveau les musul-
…
les attaques, et la place resta entre les
…
sur les Latins.
118
très sur la plus belle ville de la contrée,
…
gouvernement entre les mains de son
…
tercepter les communications de la place
…
venant vieux, résolut de diriger toutes
…
Le commandant de la ville se pré-
…
Osman, le fondateur de la dynastie
…
s’accroissant en proportion de ses vic-
…
corée de lames d’argent, était désignée
…
Le palais qu’il fit construire sur la
…
même depuis l’antiquité. De somp-
…
les noces de Bayazid Ildirim, fils de
119
les plus beaux de sa nation. Dix d’entre
…
envahie, en 1402, par les troupes de
…
terrer les os de Bayazid et les fit brû-
…
les incendies qui y éclatèrent à plu-
…
aidé de quelques partisans , put facile-
…
mée attaqua les troupes de Djem dans
…
du grand maître de Rhodes. La suite,
…
ments funèbres de cette époque. L’autre
…
L’ensemble de la ville de Broussa se
120
l’une Sindan Capou si (la Porte de la
…
Les tours sont espacées d’environ vingt
…
sous les ombrages au milieu des ro-
…
et méditer. Il avait l’habitude de rester
121
Les habitants jouissent avec calme
…
de voir des forêts présenter réunis tant
…
sur leurs cimes altières. Le pied de ces
…
du vestibule, les maisons de Broussa
…
trale de la ville ; c’est là que sont situés
…
magnanerie; mais on coupe les jeunes
…
lui a servi de nourriture un appui tout
…
grande manufacture; les ouvriers,
122
une étoffe de soie que nous connaissons
…
sage des harem de Constantinople. On
…
Les soieries de Broussa sont peu con-
…
bre de commerce de Lyon, qui s’éton-
…
rence des soies de Lyon et de celles de
…
LES EAUX.
…
gissent de toutes parts, eaux froides,
123
tête de la source), le second Ghœuk déré
…
sinage immédiat de la vieille ville. Les
…
dans des canaux de marbre au milieu de
…
méthode de conduire les eaux a été, se-
…
tat d’abandon et de ruine où se trouvent
…
Le ruisseau de Ghœuk déré prend
…
large vallée, la seule de la montagne qui
…
verte comme certains ponts de la Suisse,
…
LES EAUX THERMALES.
…
interne du globe est la seule cause de
…
d’autres qui surgissent de terrains
…
pied de l’Olympe, et trois sur le dernier
…
le nom de son fondateur.
124
dans tout l’édifice. Autour de cette salle
…
éclairée par de nombreuses fenêtres. Au
…
mêmes tuyaux, et les nouveaux arrivés,
…
que pas de trouver, comme en tous les
…
quelle sont les sources chaudes, est cou-
125
et bombé en dessus. Sur la partie con-
…
ment en Europe; mais les habitants
…
On dit que le milieu de la grande
…
mais cette imitation de la fontaine des
…
Des baignoires de marbre sans aucun
…
cienne ville. Mais le village de Tchekir-
…
que les sultans ne font que dans les lieux
…
mieux que les monuments du culte don-
…
de l’édifice religieux musulman, n’est
126
aux offices au moyen d’instruments de
…
direction de là Mecque fut appelée
…
les ornements sont encore de style arabe.
…
ne contient pas un seul modèle de ce
…
prise de Constantinople qui soit bâtie
…
forme qui permette d’établir sur l’édi-
…
kiosque, qui coupent les lignes horizon-
127
entrer dans d’autres détails sur la forme
…
dire formée par deux arcs de cercle, mais
…
sur l’architecture des Turcs, c’est qu’ils
…
élevée, sur le plateau central de la ville;
…
vague de Oulou Djami.
…
de côté, divisé à l’intérieur en vingt-
…
Pour empêcher les oiseaux d’entrer dans
…
Les mollahs parlent avec admiration
…
un badigeon blanc recouvre tous les pi-
…
droite et à gauche de la porte principale ;
…
calier intérieur. On voit encore sur la
…
prière, et celle qui porte le nom de
128
au milieu d’un bosquet de cyprès et de
…
impériale ; aussi les travaux furent-ils
…
consacrées au culte. Le plan de cette
…
MOSQUEE DE MOURAD Ie1
…
et surtout par le caractère de sa façade
…
Au rez-de-chaussée cinq arcades ogi-
…
cellules pour les desservants et les étu-
…
rudiment de l’art byzantin.
…
LA MOSQUÉE DE MOHAMMED Ier.
129
Les marbres les plus variés, refouillés
…
ornements de celte frise rappelle en ces
…
coupoles. Les murs sont revêtus de
…
deux énormes chandeliers de bronze
…
Du sommet de la coupole pen-
…
aussi des couleurs de l’émeraude; mais
…
chapelles sépulcrales construites sur un
…
Les mollahs chargés de la garde du tom-
…
pour entretenir un certain nombre de
130
Les autres chapelles sépulcrales sont
…
Dans le fond de l’enceinte sont les
…
Le tombeau d’Osman, appelé par les
…
le narthex de l’église a été converti en
…
inscriptions qui faisaient connaître ces
…
rces par une couple de colonnettes ados-
…
tambour et un chapelet, tous deux de
…
tres d’altitude absolue. Le plateau de la
…
logique de l’Olympe que par les nom-
…
de la montagne est principalement for-
131
tremblement de terre. Les vallées orien-
…
entremêlées de veines plus pâles , et qui
…
peu de ressources comme carrière de
…
La forme générale de l’OIympe se
…
perpétuels, dont la source est dans les
…
fait est très-remarquable au point de vue
…
tendait que les Mysiens qui étaient ve-
…
Broussa étant située sur le penchant
…
raetde la montagne, c’est celle de Gœuk-
…
plus célèbre de l’OIympe, celle dont
132
par une immense muraille de rochers.
…
LES NOMADES DE L’OLYMPE.
…
sur les versants des montagnes, dans
…
tentement. Aussi quelle sérénité sur
…
pour la plus belle habitation de la ville.
…
dernières sont couvertes de peaux de
…
moyenne de la montagne depuis les fo-
…
et sauvage de l’Olympe, ne laisse pas
133
espaces couverts de ces pieux noirs et
…
tés jusqu’à Nicomédie, où on les embar-
…
tait l’entrepôt des bois coupés dans les
…
montagnes. Une quantité de ruisseaux,
…
de murs écroulés et de châteaux en
…
les guides turcomans font arrêter les
…
pour faire oublier les fatigues de la jour-
…
Le sommet de l’Olympe se divise,
…
met de lui assigner une époque déter-
…
largesses. On citait parmi les plus cèle
134
tion de saint Serge et sous la règle des
…
tée par les pèlerins, s’élève à l’est de la
…
maux redoutables. C’est dans les vallées
…
prêtrise de Comana, et l’investiture du
…
fort rare et un petit léopard que les
…
le nom de tapis de Smyrne, quoiqu’on
135
qui visitèrent Broussa dans les deux
…
il fait connaître en peu de mots la
…
La mo.ntée de cette montagne est assez
…
parti d’Anliochus, voulut se venger sur
…
l’île de besbicus ( Calolimno).
…
reste de ces géants. » Selon Apollonius,
…
fut détachée par un tremblement de
…
devant l’île de Skyros (Syra).
…
(6) Koetorzio. de Pachymère, t. II, liv. V,
136
que qui faisait partie du butin de Ca-
…
tercalés des couches de grès friable.
…
Le terrain de l’île se compose de
…
couche de grès d’une décomposition
…
Dans la manie qu’avaient les naviga-
…
ruption de Vagnitis, village qui est situé
…
C’est entre les mains d’OEbarès que les
137
soumission avant l’arrivée de la flotte
…
le titre de c’est-à-dire de bourg, de
…
tait question que de la ville, il n’y aurait
…
nous prenons le texte. d’Etienne de By-
…
que sous le nom de Chersonnèse.
…
tenté de conclure, en suivant fidèlement
…
Cependant un passage de Strabon (2),
…
« Près du lac Dascylitis est la ville de
…
de Cyzique, il ajoute que les Cyzicé-
…
lon par les habitants de cette partie de
…
(5) Siège de Cyzique, Fie de Luctillus.
138
grands, et le fit traîner sur un chariot
…
saient sur la rive gauche du Rhyndacus,
…
qui a été écrit sur ce sujet dans les
…
« elle est assez bien entretenue par les
…
serve le nom de Diaskillo. » Cette note
…
Propontide et les pentes septentrionales
…
de l’Olympe, à environ quinze kilo-
…
alluvions charriées par les eaux. La
…
Le lac est en outre alimenté par les
…
par la goélette de l’État la Mésange
…
de quelques officiers, nous nous apprê-
…
de continuité dans la chaîne de mon-
…
de péage. Des balises placées de dis-
139
tagne de marbre gris ; cette roche pa-
…
nord, et loin de trouver aucun con-
…
Rhvndacus et que nous naviguions sur
…
terrain de la plaine de Mubalitch et
…
qui vivait en bonne intelligence avec les
…
viar. Ce genre de poisson est en effet
…
par les Turcs? ceci est plus probable.
…
de Lycus, que les Grecs donnaient à
…
nous occuper du régime de ce fleuve.
…
faisait partie de la Phrygie Épictète. Il
140
de la mer, traverse la plaine d’Aizani
…
forts sud-est de l’Olympe. La plaine de
…
contourner le massif de l’Olympe, dé-
…
nous fut pas possible de reconnaître
…
régions et les rudes hivers de la Bithy-
…
preuve historique d’un froid continu de
…
en l’année 268. Les Goths, qui faisaient
…
dans son cours inférieur, il reçoit de
…
village. Dans les hauts plateaux on l’ap-
…
les habitants le confondent avec le Ma-
…
de la langue ne saurait s’y reconnaître;
…
de plusieurs fleuves de la Mysie Abret-
141
plus considérable de la Mysie Abrettène.
…
toute cette région, il porte le nom de
…
quée de tours dont quelques spécimens
…
un lieu de refuge, pendant le temps
…
appuyé sur une urne; c’est le symbole
…
parlé est représenté sur une médaille
…
Il faut que les habitants de la ville
…
« sance de ses services lui ont élevé
…
était épiscopale sous la métropole de
142
contrée déserte et marécageuse. Les oi-
…
On franchit le Rhyndacus sur un
…
du Maéestus; de sorte que comme point
…
prise par les Byzantins.
…
de la mal aria qui devient de plus en
…
fait le service religieux des chrétiens de
143
d’Édrénos, et les ruines de cette ville
…
kilomètres de marche à la petite ville
…
de marche ou quarante-huit kilomètres,
…
L’édifice qui frappe d’abord les re-
…
de douter que ce ne soient les ruines
…
de marbre ; l’épaisseur du mur est d’en-
…
Les fondations des pièces de l’in-
…
de Beyik ; elles paraissent avoir été
…
driani et Pœmaninus et deux jours de
144
serré par les défilés que forme le Tou-
…
VILLES DE L’INTÉRIEUR.
…
lac qui porte le nom de Yéni cheher
…
de Bédré tchai; c’est la rivière de
…
n’est plus qu’un marais et les maisons
…
petite mais jolie; tous les vendredis il
…
A la jonction de la rivière Poursak
…
sent de ce territoire à Ertoghrul, qui
…
bre de ces tombeaux du temps des Seld-
…
tion de cyprès et de platanes et offre
145
de l’Orient.
…
teurs. Ils s’engagèrent sous les ordres
…
la conquête des régions de l’occident
…
à Byzance lorsque les Turkomans se
…
mains. Les portes enrichies de perles
…
places fortes déjà occupées par les Tur-
…
courage indomptable tenait lieu de toute
…
au secours de ses tribus menacées, et
…
çon de cent mille pièces d’or et la pro-
…
rière-petit-fils de Seldjouk, la domination
146
de tous les pays situés au delà d’Antio-
…
matie sur tous les autres petits Etats
…
chrétiennes qui, sous la conduite de
…
ne resta pas longtemps entre les mains
…
sa fin; les beys turkomans du nom de
…
nord les armées mongoles démembraient,
…
des rives du Méandre, et la ville de
…
domination de Tekké. La Pisidie et l’I-
…
morum, et devint la province de Ker-
…
de cette contrée, Ertoghrul entreprit
…
fendre leurs frontières. Les Turcs s’a-
147
à-dire vers la capitale de l’empire by-
…
avait perdu la plus grande partie de
…
défendre les possessions de son suzerain
…
rope, fatiguée de luttes sans issue, res-
…
ques ; la question posée à la guerre de
…
Indépendamment de la voie militaire
…
presque triangulaire dont la ville de
…
Valentinien marchait sur Nicée pour se
…
duquel était la ville de Pruse, et le
148
l’est, et forme les groupes dont les
…
nière branche prend sa source dans les
…
tionnée sur les cartes et dans les dic-
…
nom de ville, tandis que c’est tout sim-
…
M. Tchihatcheff (6) donne à la ville de
…
ont bien peu attiré, jusqu’à ce jour, les
…
Tout ce pays est couvert de forêts
…
Boli a remplacé l’ancienne ville de
…
tous les musées de l’Europe. Sous les
…
de ses habitants perdirent la vie.
149
de Salone, dont le chef-lieu était une
…
de caillé appelé misitra, qui se conserve
…
Les ruines de Bithynium ne sont
…
certain nombre d’inscriptions et des
…
sant de propriétés curatives. Elles sont
…
voie de mer par Trebizonde, depuis l’é-
…
au contraire dissout les pierres de telle
…
conservé quelques rudiments de son
…
lui conserve les deux noms, la plupart
…
La division de l’Asie en patriarcats
150
cèses politiques, n’avait rien de commun
…
mises au patriarcat de Constantinople,
…
Les écrivains ecclésiastiques ont soi-
…
l’empire de Byzance ; et les documents
…
La moderne ville de Ghérédeh offre
…
la mégisserie des peaux de mouton est
…
dans les jardins, mais tous les arbres
…
pas favorable à la végétation de l’o-
…
qu’ils sentent l’air de leur pays natal.
…
Hammamlu ( des bains ), située sur ce
…
Sur ce nombre il y en a six dont
Livre III: Mysie
152
LIMITES DE LA PROVINCE.
…
prise accomplie avant la fondation de
…
de la Bithynie; la région Ascanie et
…
les invasions des Bithyniens et des
…
comprise entre la mer et les versants de
153
des Teucriens sur les penchants de
…
sont les seuls maîtres du pays. Autant
…
Le Mysien s’est mélangé avec les
…
notre ère, et qui fit alliance avec les
…
sur les peuplades'sans défense, mais ne
…
pâturages, couverte de forêts, fournis-
…
de domination grecque ou romaine. Si
…
fraîche, est le temps heureux de la vie
…
de fait qu'il a conservée sous le despo-
154
Pour étudier la Mysie telle que les Ro-
…
les deux fleuves Rhyndacus et Æsepus;
…
brement de la Mysie, cette derniere
…
lympe, les troupes d’Orkhan s’emparè-
…
Les îles de la Propontide qui appar-
…
privilégiée parmi les habitants. L’olivier
…
tème de l’Ida, et qui est situé à cent
…
de la presqu'île de Cyzique. Il est sou-
155
déterminer ies limites des Etats de la
…
les eaux profondes de l’Æsepus.... (3) »
…
par Adraste fils de Mérops, qui lui donna
…
Démotico tchaï, du nom de la principale
…
Le Granique se compose de trois
…
kilomètres au nord de la petite ville de
…
celui de plusieurs autres fleuves dont
156
le cours manque de rapidité. Pline
…
le nom de Pigas ( les sources) ; c’est dans
…
La ville de Muhalitch est située sur
…
fluence sur la nation turque, qui se livre
…
de la soie.
…
nage du lac de Manyas et sa distance
…
ment turc voulut faire de Muhalitch
157
Le lac de Miletopolis, qui portait aussi
…
vingt fois sur la même route; il le com-
…
l’état de simple village. On peut encore y
…
passer de front, ce passage est appelé
…
L’acropole de la ville antique est si-
…
tine défend les approches du côté du
…
tionnée comme ville de garnison. Le
…
comme un des édifices remarquables de
158
citent la ville de Pœmaninus. Sous les
…
bain creusé dans le sol et une salle de
…
considérables de concrétions calcaireS',
…
l’île de proconnèse.
…
tion des eaux de la mer Noire est eP
…
volcaniques à l’embouchure de }apéji'
…
temporains des premières révolution
159
i’en?ait aucune trace de rupture appâ-
…
c0J s de Gibraltar et de Messine , et,
…
de n® Peut expliquer le récit de Diodore
…
les flots. La longueur de l’Helles-
…
^h?recs le nom de province de l’Hel-
…
Se contenté de donner la nomen-
…
la grande Proconnèse (1). « Les îles
…
à l’archipel de Marmara, mais est voi-
…
car les plus beaux monuments de ce
…
identique avec celui de Marmara. Les
160
comme étant blanc veiné de noir (1) : ce
…
« vous dois rien pour les colonnes, car
…
très-abondants sur ces rivages , les îles
…
tériaux à toutes les villes delà Propontide
…
partie de l’île. Le granit gris ne se mon-
…
seur de huit ou dix mètres sans aucune
161
de l’île. Nous gravîmes ia montagne;
…
mais arrivés à 250 mètres environ de
…
Sur le flanc de cette vallée, on trouve
…
Sur le sommet d’une montagne coni-
…
étant assuré, au moyen de la longue-
…
verte de blocs de marbre éboulés. On
…
être qu’un accident de la roche.
…
carrières de Synnada , dont les flancs
…
été tiré des flancs de la colline, tantôt
…
dîmes sur la côte E. de l’île, dans un
…
village est sur l’emplacement de la nou-
162
sculpté. Ï1 est difficile de dire si c’est un
…
actuellement : elles sont entourées de
…
de ces moutons sauvages semblables à
163
petite ville située sur la côtesud-ouestde
…
La petite ville de Aïdindjik est éloi-
…
plaine couverte de plantations de mû-
…
quatre heures de marche. Le petit vil-
…
est couvert des fleurs les plus variées.
…
truite sur une éminence s’élève au mi-
…
ancienne route. Les collines jusqu’à
…
ligne de collines se trouve le village de
…
sans doute naissance dans les collines
…
de marche, dans les jardins et les ver-
…
Aïdinjik est située sur les collines de
…
de. Toursoun. Cette petite ville avait à
…
tirés des ruines de Cyzique. Aujour-
…
et de pauvreté.
164
nord on entre dans le territoire de
…
une petite couche de bitume tiède qui
…
tient à l’époque de transition. Le granit
…
et demi de large.
…
Nous avons vainement parcouru les
…
rope. Aujourd’hui les bâtiments n’y
165
porte le nom de Erméni keui; on y
…
Les Phéniciens, dit-il, après avoir mis
…
siens; elle était distante d’un stade de
…
mais comme n’existant plus de son
…
pendant la guerre de Mithridate. Ce-
…
de marbre. Les fortifications qui sont
…
génoises, faites avec de riches débris
…
beaux restes de l’ancienne Artace,
…
même de Cyzique, mais non pas dans
…
quelque auteur ancien d’une fontaine de
…
complètement abandonné de nos na-
166
de l’isthme. Une source limpide et de
…
On reconnaît, près de la tour de Bal-
…
cage, de recoupes de granit, de sable ma-
…
l’île portait alors le nom de Dolionis.
…
l’on célébrait les mystères, et fit vœu,
…
avoir donné en dot à l’épouse de Pluton
…
leur arrivée, les Cyzicéniens avaient
…
para de Cyzique , et joignit l’île à la
167
Le gouvernement de cette ville était
…
lais; le soin de ses principaux bâti-
…
elle tomba sous le pouvoir des rois de
…
détail toutes les magistratures qui
…
taient les noms des tribus athéniennes,
…
Dans le principe, les habitants de
…
noms identiques avec les noms des
…
taient à partir de l’époque de leur en-
…
de ce collège, les Prytanes passaient,
…
de Mithridate.
…
armée de cent cinquante mille fantas-
…
les collines qui s’étendent parallèlemeiV
…
profiter de sa victoire, divisa son armée
168
attaquer les remparts. Les péripéties
…
détruisit tous les apprêts de l’assaut, et
…
rir. La prévoyance de Lucullus parait
…
de Mithridate. Plusieurs tentatives
…
règne de Tibère. Ayant négligé le ser-
…
gieux, qui, par sa hauteur, servait de
169
Asie, ou les peuples se piquaient d’ai-
…
de ces villes une troupe de gladiateurs
…
tous (1). Diverses inscriptions men-
…
zance, fait enlever.de Cyzique la statue
…
blement de terre. Cependant elle con-
…
de la province de Karasi, l’ancienne
…
(3) Hammer, Histoire de fempire otto-
…
La grande tour de Bal-Kiz paraît
…
pas que les murailles se soient étendues
…
l’ouest une vallée assez profonde, sur
…
l’arène de l’amphithéâtre , ce qui me
…
vestiges de ce monument, comme des
…
pour les constructions modernes, soit
170
En descendant le vallon de l’amphi-
…
cage, avec des revêtements de marbre;
…
thodique, le théâtre de Cyzique ne le
…
sous los archontes collègues de Julius Seleu-
…
de dalles de marbre, les colonnes étaient
…
rateur Aristide, qui a laissé de ces mo-
…
passé parmi les écrivains du tepnp’
…
aux habitants de Cyzique différent
…
tout faits les colonnes et les enta^
…
toutes les fois qu’on la dérangeait;e s,
171
RUINES DE CYZIQUE D’APRÈS d’AN-
…
de l’oubli fons Cupidités, mentionnée
…
trentaine de mètres en ligne droite; ils
…
mais en certains endroits les murs sont
…
Toutes les entraves mises à l’agricul-
…
terdit à l’étranger le droit de posséder
…
et (jp iP01nt de vue de l’histoire de l’art
…
la c trace de monuments antérieurs à
…
A^.^ot les villes et villages de la côte,
…
d’o^d l’auteur s’est retiré. Les Grecs
172
uniquement en l’honneur de la ville de
…
la richesse de la ville et le noble esprit
…
« Les constructions qui sont au-dessous
…
de l’édifice et qui font partie de ce bel
…
L’amphithéâtre est situé au nord de
…
l’ouest de la vallée. La forme elliptique
…
de l’arène. D’après le caractère p
…
masses de verdure. Cet édifice, se
…
les broussailles qu’il est impossib*e
…
geux; la lagune couverte de rose
…
de construction très-solide fortifie 4
…
nord de ce port, il y a une m»58
173
UyL Sn9u* sont probablement les ves-
…
Cy^rsque Pocoke visita les ruines de
…
qU hui dépouillées de leurs marbres,
…
,des masses de recoupes demarbre.
…
CÔTES DE L’HELLESPONT.
174
gnages par les habitants de Cyzique.
…
Un village du nom de Karaboga occupe
…
vin excellent; mais les Grecs et les
…
possible d’en obtenir de bons produits ;
…
dateur souvent décerné dans les 1 2 <
…
il n’en paraît pas de vestiges ;
…
de son territoire. La fondation
…
naissance de cet événement, ils ° j|5
…
l’abondance des fruits de la terre-
175
Çl eaux étaient couverts de vignobles ,
…
tijp D’Athènes, et malgré les tenta-
…
Setv Use situation lui permit de con-
…
les dernières années de l’indë-
…
«t ( Piège tendu par les partis ennemis,
…
%srt des villes de l’Hellespont quand
…
nelles fut témoin de la plus grande
…
plus de cinquante bâtiments furent
…
songea pas à faire augmenter les for-
…
rien changer à l’ancien état de choses.
…
vaillèrent sous les ordres de l’architecte
176
un ouvrage de Mahomet II. Presque
…
vèrent chargés de fournir les garnisons
…
des ruines qui n’existent plus de nos
…
pas un bloc de marbre ancien. Cepen-
…
Le territoire situé au sud de Lamp-
…
taie, roi de Pergame, qui constr11
…
temps de la guerre de Troie. Deux
…
lin de l’empire romain; elle est ^j,i
…
sage de Str abon (5) : « La distant
177
DU raPPort à Sestos. Près de cette der-
…
q- ?ept stades, le point de jonction fut
…
le?*1] e de S0Q ar,née, fit élever par
…
lesus æ nom de trône (Tact ) ; les Turcs
…
°hspVe fiue tous les tumulus que l’on
…
nuits à franchir le détroit ; ce tableau de
…
père de l’histoire (1).
…
lieu au retour de Darius dans la Cher-
…
forces de Philippe, filsde Démétrius,qui
178
naces ne purent décider les habitants
…
dit Étienne de Byzance, que les habi-
…
cile de Chalcédoine et à la lettre sy-
…
curément sous les gouvernements des
…
TROA.DE. — ÉLÉMENTS DES POPULA-
…
que des éléments qu’il s’agit de mettre
…
(3) Voy. aussi sur Abydos Tournefort,
…
peut compter combien de périodes de
…
des langues est celui qui offre les
…
nes, on s’est cru autorisé à regarder les
179
étrangers aux influences de l’Occident,
…
restait non plus aucune notion de leur
…
les forêts, détruit les bêtes féroces et
…
venu dans ces parages ; or les Hellènes
…
puisse mettre en opposition avec les
…
Pélasges, cette activité qui les pousse à
…
les écrivains grecs ne trouvent qu’un jeu
…
les ancêtres des Grecs. Partout où
…
les peuples se soient formés en nations
180
pontifie et les côtes de l’Asie Mineure.
…
comme habitant les sommets des mon-
…
établis sur les côtes méridionales de
…
le nom de Baal; cette race syrienne
…
quait sur ces côtes les tribus actives
…
la conduite de son chef Dardanus, et
…
maine commençait à peupler les som-
…
de l’Ida arrosé de sources (3) ».
…
qui de temps à autre venait apporter
…
Les Assyriens les connaissaient sous le
…
pendant plusieurs générations (5). Les
181
pelée lepays des dattes. Chez les peuples
…
générale et est restée en usage chez les
…
comme les mœurs des Phéniciens prou-
…
et la côte, les Phéniciens n’avaient
…
commerce, devint comme le centre de
…
fiquants, ils s’emparèrent de plusieurs
…
gine de ce commerce aux temps les plus
…
les habitudes des peuples sémitiques.
…
de l’Orient, les marchandises de re-
…
commerce licite de cette nature ils
182
les marchands phéniciens échangeaient
…
voitant déjà les heureuses situations de
…
Ils étaient originaires de Thrace, et leur
…
tion de Troie. Les Teucriens sont les an-
…
regarderies Teucriens et les Dardaniens
…
nies plus tard. Les Teucriens ont précédé
…
nèrent en Europe pour y faire les ex-
…
Les Cariens, peuple mélangé, étaient
…
de Lycie. Chez les Grecs des âges sui-
183
gare et se retrouvent sur les rivages lie
…
Milet et Éphèse et sont unis de parenté
…
commence à se répandre sur les côtes
…
pour ses marchands un comptoir de
…
Les Phrygiens appartenaient à la race
…
leurs caractères sont les mêmes que les
…
blir la parenté entre les deux races. La
184
manière puissan te ; c’était de cette souche
…
royaume de Troie s’étend sur les con-
…
D’un autre côté, les tribus crétoises
…
chez les Crétois (1).
…
rapidement sur la côte d’Asie, est trans-
…
Troade une puissante alliance de peu-
…
même demande aux enfants de Ly-
185
caon des artistes pour élever les monu-
…
le territoire de la Troade et dans les
…
Il résulte donc de cette concordance
…
fondit avec le royaume de Priam.
…
de Jupiter, c’est-à-dire de la famille
…
pollon et de Neptune, dieux lyciens,
…
Il ressort de ces traditions quel-
…
dis que le nom de Troie représente la
…
qu’un même peuple. Les Lyciens de
186
rien et le nom de Capys a un caractère
…
phrygien de Darius. C’est du moins
…
fédération dans laquelle les Cariens
…
treprendre des expéditions à la solde de
…
de Persée, fils de Danaë, prince d’Argos
…
minant que les Grecs se plaisent à
…
et de sanglants combats. C’est alors
…
La ruine de Troie arriva avant l’é-
…
tèrent de tout temps entre les Grecs et
187
qui faisaient l’envie de tous les peuples,
…
les savants de l’Europe voulurent re-
…
des navigateurs ; les capitaines génois
…
L’emplacement de la citadelle troyenne
…
les écrivains grecs et romains ont com-
…
Les vaisseaux furent tirés à terre, ran-
…
Les deux caps qui formaient les
188
entre ces deux caps était de six mille
…
A la pointe sud de l’embouchure de
…
de Proconnèse, qui était déjà peuplée
…
temps de Lysimaque, qui voulut donner
…
épigraphiques de la langue grecque. Au-
…
tertre que d’un commun accord les an-
…
et que dans les anciennes traditions ils
…
les eaux du Scamandre, dont les sour-
…
seul Gouffier, Voyage de la Grèce, tome II.
189
Scamandre, malgré la conformité de
…
de la colline de Bounar-Bachi, dans un
…
aucune incertitude sur l’identité de ces
…
sur la colline de Bounar-Bachi n’ont
…
par les fonteniers turcs). En longeant ce
…
canal déverse une partie de ses eaux
…
position de noms qui a trompé les écri-
…
la colline sur laquelle est bâti le village
190
c’est-à-dire dont les lits étaient horizon-
…
de terre au sud-ouest de la citadelle, et
…
arrive, après deux heures de marche,
…
à fait sur le rivage de la mer.
…
importance. Les habitants avaient soin
…
alors composé que de quelques maisons
…
Il institua des fêtes en l’honneur de
…
reçus par les Romains les députés des
191
et elle fut dédaignée par les Gaulois.
…
les traces du siégé (1). Lucullus, après
…
souvenirs de la triste II ion, en comblant
…
Asie le siège de l’empire (2). Sous le
…
ment à y transporter le siège de l’empire.
…
d’admiration (3). Les restes de murailles
…
(2) Suétone, Vie de César.
…
Quoique la ville de Scamandria 11e soit
…
à l’Apollon de Chrysa, car j’ai trouvé
…
de ses propres deniers cet autel, et l’a dédié
192
topographie ancienne de la
…
La ville de Troie était au sud-est du
…
minait sur la plaine. Le tombeau d’Hec-
…
ceux d’Achille, de Patrocle et d’Anti-
…
du couchant au rivage de la mer pas-
…
mandre pour aller de la ville au camp
…
perdu son ancien nom chez les indi-
193
verte de débris d’antiquités; mais au-
…
viron treize kilomètres de ce dernier
…
De Tchiblac on se rend à Enaï, grand
…
Enaï occupe la position de l’an-
…
passe le Scamandre sur un pont de
…
Cette petite ville est située sur une
…
on arrive au village de Eïvadjik, situé
…
sortent de terre dans le voisinage,
…
de cette topographie de la plaine de
…
est de la chaîne de l’Ida, renfermait
…
Cette partie de la montagne s’appe-
…
toire et celui de Scepsis.
…
gulaire, composée de grosses pierres
194
cours du ciseau. Un cercle de pierres
…
nérée dans ces régions. Les vestiges de
…
quelle résista a l’attaque de Dercil-
…
pied de ce mamelon.
…
Troas aurait fait partie de la Cébrénie.
…
peut supposer que les ruines de cette
…
Les successeurs d’Alexandre vou-
…
nom de. Troas, pour la distinguer des
…
de Cebrene (5), Sigée (6) et autres villes
…
les privilèges dont jouissaient les villes
195
courir les chrétiens de Macédoine. Saint
…
de lui apporter à Rome en l’an 65. La
…
raille sur la côte; elle était sans doute
…
colonnes a motivé l’abandon de l’autre ;
…
les voyageurs. Il est fâcheux de voir un
…
de marbre : aussi ne reste-t-il plus un
…
troisième fois mouiller sur la côte de
196
sent dans les interstices des pierres, et
…
d’abord, était composé de deux bassins,
…
moles, dont les vestiges existent encore,
…
sur la destination duquel les antiquaires
…
Les eaux jouaient un grand rôle dans les
…
côté garnie de pilastres, devant les-
…
au sud, et l’autre au nord. Les exer-
…
n’a pas son parallèle de l’autre côté;
197
naître la disposition primitive (1). Les
…
trésors au surplus de la dépense. Les
…
lexandria Troas paraissent dater de la
…
sont toutes couvertes de débris et occu-
…
dans la terre, et revêtu de maçonnerie
…
le calcaire tertiaire de la plaine de Troie,
…
petite ville d’Énaï. La ville de Scaman-
…
porte le nom de plaine de Baïramitch.
198
Le promontoire de Lectos et la crête
…
peuple sur lequel les écrivains anciens
…
de Lelex régna sur la Laconie à une
…
d’avoir réuni en une peuplade les Lé-
…
continent de la Grèce européenne ; ce-
…
regardé les Léléges comme le même
…
nion les Cariens sont autochthones.
…
tion de cette province, aurai-je à re-
…
que de la guerre de Troie était situé
…
située sur la côte, et dont l’origine est
199
occupée pendant cent ans par les Cim-
…
sinage ; c’est là qu’on apportait les bois
…
inscriptions (4). Toute la côte nord du
…
n’indique Astyra , bois et temple de
…
dans les terres. Tous ces terrains ont
…
l'ouest de la montagne d’Assos, et je
…
(4) Eoy. Choiseul, Poyage de la Grèce,
…
divisent en plusieurs groupes de. mon-
…
mains, on trouvait dans les environs
…
dans les trachytes des tombeaux d’As-
200
J’ai observé, sur le plateau de la ci-
…
contrer dans les environs quelques gi-
…
lieu des blocs de trachyte éboulés et
…
couverts de verdure. De temps à autre
…
tent encore à Assos. Les longues et
…
met, il faut bien répéter, avec tous les
…
par les habitants de Méthymne. Éphore
…
de la contrée environnante; on connaît
…
(T) Parodie d’un vers de ïlliad., liv. VI,
201
exemple, de l’eunuque Hermias, qui
…
les leçons d’Aristote et de Platon. A
…
server son pouvoir, et devint chef de
…
ment Assos et l’Atarnée, et les Perses y
…
Assos reçut la visite de saint Paul
…
en 431 au concile d’Éphèse. Les cons-
…
poste, important. Du plateau de la cita-
…
tes débris de l’empire de Byzance.
…
exempte de construction hellénique
…
grands blocs de trachyte, sans mortier
…
que les géologues ont séparé les irachyteset
202
6m,60 de large sur llm, 10 de long.
…
est de la ville ; ensuite les murailles
…
long de ce mur est le seul qui soit
…
les couvercles rompus sont restés sur
…
porte de la ville est à l’extrémité de la
…
la pointe sud de la ville.x J’ignore s’il
…
Les murailles du nord-est ont com-
…
que les remparts extérieurs, joint le
203
branle n’a pas de feuillure ; de sorte
…
saillie est couronnée, en dehors de la
…
employée par les Romains, se retrouve
…
beau du Tantale et dans les tom-
…
C’est tout ce qu’on peut dire sur la
…
Pour expliquer la singularité de
…
fait à l’est de la ville; le couronne-
…
mine l’enceinte de la ville. Il est com-
…
Au centre de l’acropolis s’élevait un
…
mètres de hauteur.
…
avait treize colonnes sur le côté; il ré-
…
quelques fragments dans les fouilles.
204
d’une suite de bas-reliefs qui se sont re-
…
faciles à expliquer; les deux extrémités
…
sente les noces de Pirithoüs; les convives,
…
tout primitif. On peut les comparer aux
…
mis que les Étrusques sont originaires
…
La frise du temple est décorée de tri-
…
(a) Voyez, les planches i5, 16 et 48.
…
forteresse composée de plusieurs tours
…
lage de Beyrham s’est construit à l’abri
…
ressantes. Les inscriptions sont rares
…
descendant des rois de sa patrie, et le prêtre
…
encore dans l’acropolis n’a rien de re-
205
core aujourd’hui plus de huit mille ha-
…
point de murailles ; les maisons sont
…
de la ville à la mer et donnent à tout
…
qui désolèrent cette côte au moment de
…
celle de Troie, si en effet on doit l’i-
…
de gré ou de force, s’attacha au parti
…
finit par se laisser mourir de faim dans
…
ner la ville d’Astyra avec un temple de
206
d’Asîamyttium ; il était éloigné de cent
…
nue sous le nom de Acté (rivage) des
…
tamment les rivières Astron, Carmalus,
…
de même du fleuve Evenus qui four-
…
de Thébé et de Lyrnessus. Strabon
…
Selon Strabon, les deux villes de
…
tout ce pays fut le théâtre des premières
…
est interprété de deux manières par les
…
célébrité parce qu’elle fut le lieu de ré-
…
Hystiée, tyran de Milet, qui, étant à Les-
…
mis à mort dans la ville de Sardes (2).
…
Un peu au nord de l’embouchure
207
du Calque et abrité par l’archipel de
…
ment de l’ancienne Pitane à des carac-
…
elle était située sur une langue de terre
…
que distance. L’aqueduc qui portait les
…
briques qui avaient la propriété de. sur-
…
Les habitants, presque tous Grecs, se
…
(a) Banduri, Anonyme de Consty, t. Ier.
…
de la Grèce; aussi dès les premiers
…
de Kidonia fut livrée aux flammes.
…
Caïque. faisait partie de la région de
…
du sud de la ville de Pitane, prend
208
chaîne trachytique qui forme les der-
…
distance de plus de vingt kilomètres.
…
vés de main d'homme. Ils sont en tout
…
mère de Télèphe, qui se voyait à Per-
…
mulus qui s’élève à l’entrée de la ville.
…
effet les deux monuments ont une res-
…
sans forcer en rien les traditions his-
…
ceux que du temps de Pausanias on
…
dans ce nom un souvenir de la citadelle
…
47,000,009 de francs; il en confia la
209
par Docime, officier de l’armée d’Anti-
…
château de Pergame, où était renfermé
…
environs de Sardes, Philétère se vit en
…
ment ourdies, et qui lui permirent de
…
time de la trahison de Ptolémée Cérau-
…
traité signé par Philétère ; les deux
…
grande victoire qu’il remporta sur les
…
portant lisiblement le nom de la vic-
…
dans les temples, l’un à Pergame, l’autre
210
victoire, le mit à même de se mesurer
…
liance avec la république de Byzance,
…
ses efforts dans l’attaque de cette ville
…
nis de Cyzique, succéda à son père,
…
peuple romain un accroissement de I®
…
de ce prince. Aucune charge ne s’é13.^
…
Sous le règue de ce prince une an117
…
et Strabon (2) se contentent de 'll je
…
le penchant de l’acropole de Per^‘’llii’
211
Eumène mourut apres un régné .de
…
roi de Bithynie. Ce prince s’était em-
…
pour rétablir sur son trône (1) Aria-
…
Le règne de ce prince n est qu’une
…
vons° de prêtresses (1). Nous pou-
…
fabrication difficile. Les princes
…
ve|0'ln acquit en peu de temps un dé-
…
mité |. àui pouvait donner une idée de
…
C’est une erreur de croire que le Coran
…
jamais eu l’idée de la reproduction mé-
212
ses ennemis, les Bithyniens, et vainquit
…
esta. A ce moment le royaume de Per-
…
remporta d abord de grands avantages.
…
située aux environs de Smvrne: il eut
…
pour prix de l’audace qu’il avait eue de
…
La dynastie des rois de Pergame
…
en province de l’empire romain, forma
…
pereur régnant. Les jeux publics étant
…
grand pontife des temples de l’Asie à
…
neur d’élever un temple a Tibère, les
…
sénat (4). Le gouvernement de Pergame
213
neur de l’empereur Claude.
…
proconsul, abandonné de ses troupes et
…
temple d’Esculape et se perça de son
…
dant un effet réel, ce fut de créer à Per-
…
d’un évêché qui fut suffragant de
…
les Seldjoukides firent une irruption
…
Karasi fut assassiné; c’est ainsi que les
…
INTÉRIEUR DE LA VILLE, LES MURS,
214
chemins pavés de larges blocs de lave
…
de soutènement dîme admirable cons-
…
sur la face principale, et qui empê-
…
signalait au loin la situation de la ville.
…
ner les dimensions, et nous sommes
215
ces ouvrages sout de la même époque.
…
appuyé à la pente de la montagne, du
…
de Justinien, s’élève sur la rive droite
…
arc, le tout en pierres de taille bien ap-
…
pour la plupart caches a tous les yeux,
…
a exhaussé les quais pour contenir les
…
(de l’abreuvoir) est un ouvrage romain
…
tous les ponts vont racheter ces deux
…
(ni sur terre ni dans le ciel); les murs
216
venient de front et en boutisse. Les
…
truit sur le Selinus s’élève un vaste
…
rectangle de 56m de long sur 26m de
…
dans les parties supérieures du bâti-
…
un portique de huit colonnes , dont
…
voisine de i’hémicvcle, on voit des ar-
…
térieur, et plusieurs colonnes de
…
de cet édifice, il est évident qu’il n’a
217
partie de sa longueur, ou de la moitié
…
ment sur le même plan. Au fond de
…
hors, était une ligne de modillons, et
…
sans nombre sur la destination de ces
…
seule tout a fait satisfaisante. Les Grecs
…
Le culte de ce dieu était très-répandu
…
dans le plan : les deux rotondes en
…
de la ville actuelle, il existe une ruine
…
dont les dispositions méritent d’être étu-
…
toutes les dispositions que l’on ob-
…
l’on met en parallèle les ruines de théâ-
218
sion extrême pour ces sortes de diver-
…
jectures; mais tous les documents four-
…
sieurs amphithéâtres de bois s’écrou-
…
même dans l’arène, et tuer de sa main,
…
moyen déjuger l’époque de la construc-
…
d’amphithéâtres, notamment ceux de
…
qu’on en retrouve toutes les disposi-
…
L’amphithéâtre de Pergame est dans
219
les spectacles aquatiques faisaient né-
…
ainsi dire suspendue sur l’abîme. Un ra-
…
bas du sol extérieur ; les galeries com-
…
quera dans le plan que les gai. I s du
…
machie, ait présenté assez de surface,
…
Quelquefois des troupes de nymphes,
…
de ce vase au gouvernement français ;
…
la décoration, qui ne manque pas de
…
tel avait été l’usage du vase de Pergame.
…
mental comme les anciens avaient l’ha-
Livre IV: Aeolide - Lydie
221
« Les Æoliens à leur arrivée en Asie
…
aussi occupé lesîlesde Lesbos et de Chio.
…
de Troie; elle est contemporaine, du re-
…
les nouvelles colonies s’établirent avec
…
dans le territoire de Cyzique ; les Phé-
…
navigation, les Trères et les Léléges, qui
…
guerre de Troie (3). Les Grecs parvinrent
222
Les premiers Æoliens qui s’aven-
…
toire de l’Æolide; les douze villes
…
tachée de la ligne æolienne pour être
…
prenait certain nombre de petites villes
…
droit ne grevait les navires à l’entr •
…
que la voix de cet animal retentisse
…
remarques des historiens (2). .
…
talents que payaient les sept peup1^
223
Dans la conviction ou étaient les
…
pour les faire féconder par des ânes (1).
…
d’Élée, est abondamment pourvu de
…
La topographie des villes de l’Æo-
…
^iïi eta't 'e Port et l’arsenal de Per-
…
vc°té de la terre.
…
S Ie de son jeune fils qui avait été
224
La ville de Grynium fut d’abord
…
plupart des sanctuaires de ce dieu. Le
…
nait aux habitants de Myrina, et du
…
Les ruines de cette ville ont complè-
…
insérée dans la traduction française de
…
La ville maritime de Myrina avait
…
dans la plaine de Troie. Elle prit le
…
avec les distances données parStrabon.
…
Penthile pour aller s’établir sur les
…
bre des villes de ces côtes, Smyrne,
225
après que les Æoliens furent établis à
…
après la prise de Sardes, vint cher-
…
fut remarquée par les Perses, et le sa-
…
Lesbiens faisait des descentes sur les
…
Æoliens et celui de leurs voisins les Io-
…
pole d’Ephèse (4). Quelques inscrip-
226
les mains de Djouné.ïd, émir rebelle, qui
…
que le nom du grand poète est tiré de
…
Plusieurs villes de l’Æolide situées
…
on peut retrouver Remplacement de
…
continue au bord de la mer par Guzel
…
et quelques débris d’inscriptions ; l’une
227
connaître la place de la ville d’Ægæ
…
placé sur une colline escarpée, ré-
…
guer cette ville de la montagne du
…
forme la limite orientale de l’ancien
…
comme limite méridionale de l’Æo-
…
dernière ville fit même partie de la con-
…
à l’ouest par le cours de 1 Hermus, à
…
grande vallée de Bournabat, qui est le
…
moindre trace de la civilisation hellé-
…
diter le signale comme le tombeau de
…
parle des tremblements de terre de Si-
228
de Tantale, et les marais ont formé des
…
conte du mont Sipylus et de son bou-
…
vient sur ces phénomènes géologiques :
…
lis. » Le territoire de Magnésie s’éten-
…
on voit à Temnos une statue de Ve-
…
carte générale ; car de ce point, en sui-
…
peut mieux déterminé, « sur le som-
…
Le tremblement de terre de Sipylus
…
sur le texte de ce passage. Pour dési-
…
duit le port de Tantale. Eu effet, dans
…
servi de deux mots qui ont un sens si
229
effet, parler d’un port de mer : l’ins-
…
zomène et les villes de la rive sud ,
…
TOPOGRAPHIE DE SIPYLUS.
…
des instruments et tous les apparaux
…
environ des dernières maisons de
…
perdons bientôt les traces des mu-
…
trois tumulus de différents diamètres.
230
reste des traces de la porte et du cou-
…
bassement sur lequel repose
…
l’un sur l’autre et parementés, sans
…
Tumulus n° 10. Soubassement de
…
pareil pélasgique, du côté de la porte;
…
de la chambre est un sarcophage creusé
…
deux tombeaux; ce sont les plus consi-
231
sage; son épaisseur est de 2m,70. Seize
…
J’ai été obligé de le démolir, ainsi que
…
des plus considérables de tous ceux de
…
A partir de ce tombeau jusqu’à la
…
paisseur : c’était peut-être l’enceinte de
…
il est vrai, par leS| atterrissements ;
…
de pierres sèches de petit volume , s’ap-
…
monter sur l’esplanade ; mais de grosses
…
sement rectangulaire de 30 mètres de
…
ont fait partie du temple de Cybèle, de
232
les mêmes qui ont été décrits par les
…
traces de murailles toutes bâties sans
…
ceintes les angles sont arrondis et les
…
cond âge de l’antiquité grecque; c'est
…
Lorsque les tribus thraces passèrent
…
quelque caractère saillant tiré, soit de
…
vèrent en Asie avec les Mysi, et comme
…
les fleuves Hermus et Méandre. Ce can-
…
Mæoniens en Asie, n’oublie pas de d>r
…
la souche de la nation lydienne est ofl'
…
unis par une communauté de religit’
…
avec les Mæoniens il faut compter >e<
…
fiance intime qui existait entre les Peu
233
^ell •a Carie et ceux de la Lydie, et
…
htit f de Cabalie, identifie ces habi-
…
de la guerre de Troie, car Ho-
…
0I)i'ès”,lla cœur de la Lydie, et on voit
…
temps de la guerre de Troie : il 11e peut
…
autre chef de Méoniens, lphition, fils
…
les Grecs à tout le continent.
…
ville de Méonia, capitale du pays, était,
…
Méon passe pour être fils de Jupiter
234
lui donnent le nom de Mæonès ; « les
…
et gouverna les Léléges et les Cariens :
…
culte du dieu Men, dans la ville de Ca-
…
duite de Tyrrhénus, troisième fils d’A-
…
les ruines se voient encore au
…
les considérer comme véridiques,
…
récits du père de l’histoire, et noUs
…
sous le voile de la mythologie.
235
se trouvait en vigueur sur les rives de
…
DE LYDIE. — MONTAGNES. —
…
mine le plus clairement les limites de
…
vert de vignobles, qui donne naissance
…
qui coulait à l'ouest de Colossæ et
…
ava’P’ T’i régna de 73.5 jusqu’à 708
…
Celui de Sipylus autre prince
…
qS occidentales de l’Asie Mineure,
…
^.montrent les Lydiens en relation
…
Itajp'ques écrivains, se basant sur les
…
^Up](lUe dans leurs rapports avec les
…
aux peuples de race européenne
236
nom de Catacécaumène, est considérée
…
nom de Catacécaumène, soit qu’il ap-
…
des maisons royales et des lieux de re-
…
de trente stades chacun, ce qui fait deux
…
Malgré la renommée de puissance et
…
en excepter les tombeaux de la plaine
…
La destruction des monuments de la
…
de larges vallées et de montagnes gra-
…
principal employé dans les constructions.
…
place dans l’histoire, sinon les paillettes
…
palais de Crésus était bâti de briques
237
couvertes de chaume. Il faut cependant
…
les Lydiens inventant les jeux dans le
…
nom de Ludi (Lydi). Le vêtement des
…
de la jeunesse fut plus spécialement
…
de Celænæ fournissaient des flûtes
…
Les premiers navigateurs hellènes
…
occupé la plupart des îles de la Méditer-
…
Les Lydiens, cernés de tous côtés par
238
le commerce d’exportation de l’Occident
…
la suite aux rois de Lydie.
…
furent l’origine de l’élégie grecque, et le
…
la découverte de mines de métaux pré-
…
tères d’or, du poids de trente talents.
…
puisèrent les premiers éléments d’un
…
CHUTE DES ROIS HÉRACLIDES DE
239
à la cour de Candaule, et Gygès, fils de
…
attendait de sa nation. Avec Gygès les
…
jusqu’à la côte occupée par les Grecs.
…
avec les Mysiens avait facilité l’union de
…
peuples, les Mysiens, les Lydiens et les
…
d’une guerre déclarée ; et sur le conti-
…
panionium de Mycale, et réunissait sous
…
mercenaires allaient servir chez les prin-
…
En effet toutes les aspirations des
…
conquête les villes florissantes des Io-
…
puissance, et finalement les réduire sous
240
Milet le Méandre, et les troupeaux des
…
groupe, dont les citoyens se reconnais-
…
mites sur le bord de la mer ne devait
…
riens; mais le courage de ses habitants
…
et s’empara de Priene , après une résis-
…
tombée au pouvoir des rois de Lydie
…
des bords de la mer Caspienne avaient
…
avaient établis au moyen de leurs cha-
…
Au même moment les Cimmériens fai-
241
pere de Crésus, vers l’année 606 avant
…
les conquêtes faites par ses prédéces-
…
Lorsque Alyatte fils, de Sadyatte,
…
tence même de l’empire de Lydie. Les
…
liennes, et surtout de ces audacieux Ca-
…
mencement de la sixième année, au
…
L’éclipse de soleil qui donna lieu à
…
dite par Thalès de Milet. Pline place
…
et que le roi de Babylone était Nabu-
…
l’une de race carienne, l’autre de race
242
a peine arrivé sur le trône, Crésus le fit
…
perte des Grecs de l’Asie.
…
Un de ses fils, Adramys, fondateur de
…
de confisquer les biens des principaux
…
soumettre les fiers Éphésiens n’eut plus
243
dait jusqu’aux contins de la Babylonie et
…
entre les Grecs et les nations de l’est
…
Crésus, maître de l’Asie d’une mer à
…
reste stable dans les institutions humai-
…
sous la suzeraineté de la Perse : le roi de
…
Les oracles interrogés s’étaient bien
…
sur le trône à la suite d’une révolution
…
comme un réformateur religieux. Les
…
suite de cette guerre de la Perse contre
…
ché de l’armée perse, marcha contre Cy-
…
de Sardes était le nord-est ; il arriva au
244
qu’il faut entendre les mots d’Héro-
…
ville moderne de Youzgatt et les rives
…
ravagea les terres des Syriens (Cappa-
…
plus mention de Ptérium ; néanmoins ,
…
même ville sous le nom de Pteamaris,
…
cachet de l’art oriental. Nous avons re-
…
pour essayer de la détacher de l’obéis-
…
les champs de la Ptérie, car cette ré-
…
sultat , et les deux armées se retirèrent
…
de ses alliés pour la campagne pro-
…
que les Lydiens fussent rassemblés
…
marcha contre les Perses ; les deux ar-
…
premier rang de l’armée perse , une
245
FIN DE L’EMPIRE DE LYDIE.
…
lents. Sardes fut le lieu de résidence
…
la garnison turque fut expulsée par les
…
Sous le règne de Mahomet Ier, le re-
…
Le grand maître de Rhodes, qui pos-
…
cet acte d'hostilité, sur ce fait que les
…
la province de Mentesche pour y cons-
…
fense. Attaqué de nouveau, en 1424, par
…
forces du sultan. Les deux armées en
…
d’Hvpsili Hissar, sur la côte d’Ionie,
246
l'Hermus, s'empara de nouveau de
…
rad sollicita le secours des Génois de
…
mais à peine se fut-il livré entre les
…
échec les armées des sultans. Ce nom,
…
Le territoire de la Lydie, quoique fer-
…
Pline (1) désigne sous le nom de Me-
…
ou corps de garde en marbre blanc (t),
…
observées, et sur le versant sud du Tmo-
…
mière halte au village de Fortouna, et
247
nom de la ville dont ces ruines sont
…
La ville de Baïndir est toute moderne;
…
tourée d'un portique qui se détache sur
…
occupe les habitants de Baïndir. Cette
…
de la soie, des figues et un peu de laine.
…
ce qui caractérise les constructions an-
…
l’historiographe de l’empereur Basile IL
…
éloignées de Yaka keui. Caloe a dû être
…
dans cette région qu’étaient situées les mines
248
celle de Baïndir. Un grand torrent des-
…
rence; une cotisation de 500,000 pias-
…
de la ville d’Hypæpa, qui n’en est éloi-
…
Les ruines d’Hypæpa eurent beau-
…
de ses marbres pour décorer la nouvelle
…
On trouva dans les fouilles une statue
…
sine, on lit deux inscriptions qui vien-
…
chrétiens ; elle sert de dallage dans la
…
cienne Hypæpa est appelée par les Turcs
…
de Demich. Elle est souvent citée par
…
d’un mage (3), qui allumait sur un au-
…
placée sur la pente du Tmolus, aux
…
(2) Étienne de Byzance, sub. voc. Hiptepa.
249
se trouve au milieu du village de Tapoè;
…
des plus grands édifices de la ville se
…
étonnement un genre, de construction
…
d’une construction différente de ceux
…
taxerxe; les Lydiens s’en firent toujours
…
Le théâtre est situé sur la colline de
…
voulus visiter cette ville, éloignée de
250
et d’autres fragments de sculpture qui
…
dans le pays pour offrir peu de sécurité
…
Birghé. Outre le grand pont de pierre,
…
dantes et nombreuses coulent de tous
…
on en rencontre de nombreux morcea^
…
les yeux est des plus magnifiques ;
…
Les beaux arbres du mont Tm°L
…
crainte de nous trouver de nuit da
251
un nombre infini de vieux édifices, Ces
…
faut que le cours de ce dernier fleuve se
…
chaîne du Tmolus et tous formés de ter-
…
dans le Pactole, dont les eaux bruis-
…
meaux de la Suisse. Nous étions encore
…
rujSss lait peu.de chemin, que déjà le
…
p entant sur Ie Aanc de la ni0Qta-
…
de fg enes antiques, presque dépouillés
…
nUte *a structure de la montagne
252
Lorsque nous descendions les pentes
…
c’était la citadelle de cette ville qui se
…
Étienne de Byzance (t) confirme le
…
des terrains de transport, cailloux et
…
ouest, les terres friables des autres cô-
…
ciale ; les autres explorateurs qui avant
…
à ces observations un coup d’œil de géo-
253
tendue de l’ancien sommet est détruite,
…
de murs soutenus seulement par les
…
Pour s’orienter dans les ruines de
…
LE TEMPLE DE CYBÈLE.
…
tère de l’architecture, qu’il date du règne
…
ment de marbre, et les montagnes au
…
partie de l’édifice, qui depuis des siè-
…
un dessin de ce temple fait à la fin du
…
chitrave gisent sur le sol, mais ne pa-
254
En se rendant bien compte de la dis-
…
détruite ; la forme de la caoea reste avec
…
nue par un rang d’arcades de pierre, les
…
de tour sur quinze de large. L’ouvrage
…
nes, toutes de brique, mais qui ne pré-
…
mane, n’a laissé que de faibles vestiges
…
temporain de l’établissement du chris-
…
du côté de la plaine ne permet pas d’ap-
…
quoi l’histoire de Sardes nous montre
255
dominé chez les premiers rois de Lydie
…
tème de défense, mais depuis Candaule
…
torze jours de siège, lorsqu’une circons-
…
un soldat de Cyrus, nommé Héréade,
…
Cette insurrection eut de funestes con-
…
représenter la Sardes de cette époque
256
contingents dans la ville de Sardes: en
…
rient pour les grands parcs et les chas-
…
tomba sur l’emplacement même de l’an-
…
soutenu par les rois de Pergame, il se
…
de Lydie, il sut pendant une année entière
…
Lagoras, ayant remarqué les vautours
…
les corps des animaux et les issues
…
ans du fruit de ses victoires ; mais vaincu
…
Après tant de catastrophes causées
…
reconnaître encore de nos jours les
257
pas toujours; les nouveaux chrétiens
…
de restauration de l’ancien culte des
…
Dans le onzième siècle les Seljoukides
…
(4) Table de Peutenger.
…
TOMBEAUX DES ROIS DE LYDIE.
…
plaine : aussi les Lydiens avaient-ils
…
du Taurus. Les derniers musulmans
…
temps de verdure où les Turcomans
258
connaît bientôt que cette masse de terre
…
d’Alyatte, père de Crésus. « On voit en
…
monté d’un cône de terre amoncelée.
…
toujours rempli ; les Lydiens lui ont
…
de pin semblable à celle qui surmontait
259
particulier de sainteté, et que les popu-
…
forme de tumulus ne saurait plus être
…
l’époque de la domination seythe.
…
couvert de roseaux et de souchets,
…
seul lac qui soit en Lydie. « (Les Iles)
…
son de la flûte et tournaient en rond.
260
ITINÉRAIRE DE SMYRNE A SARDES.
…
les ruines de Sardes prennent une route
…
gueur la plaine de Bournabat, on fran-
…
voir le fleuve Cryos (froid)de Pline (1),
…
vallée de Nymphio est couverte d’une
…
dure; les cerises de Nymphio sont les
…
tine comme lieu de plaisance des empe-
…
alternantes de moellons et de briques ;
…
position de cet édifice ont une grande
…
niers étaient maîtres de toute la partie
…
les bas reliefs assyriens sculptés, près
…
gris très dur, à une hauteur de quarante
261
dant du côté de l’Orient. Sa coiffure
…
tion des pluies a fortement agi sur le
…
Ce monument est situé sur l’ancienne
…
aussi dans l’Ionie deux figures de Sésos-
…
dans la main gauche, avec le reste de
…
maître de ce pays (1). « Le spithame
…
l’ajustement de cette figure n’est pas
…
pien. Les chaussures à pointes relevées
…
anciens monuments de l’Asie Mineure
…
un mémoire (1), dont j’extrais les pas-
…
le fait de la conquête. On sait aussi que
…
rait en état de porter un jugement sur
262
ques très-reculées les rois égyptiens
…
ci, placé a sept lieues de Smyrne, à
…
costume de ce personnage avec ceux des
…
insistons seulement sur ce fait que le
…
La route actuelle de Nymphio à Sar-
…
vers l’est; elle prend alors le nom de
…
de la famille des sultans.
…
surtout des maisons de campagne iso-
…
motivé pour nous lenom anglais de cette
…
énorme. Les Grecs, comme les Turcs,
…
employés en guise de monuments fu-
263
trouve, en fait de provisions, du laitage,
…
Scipion contre Antiochus, roi de Syrie,
…
truction du royaume de Pergame.
…
ville, et venait camper autour de Ma-
…
crut d’autant. Sous le règne de Tibère,
…
siècle, la capitale de l’empire byzantin.
…
vince, devint maître de Magnésie et de
…
acheva de soumettre les villes de Lydie ;
264
de Timour, Magnésie resta sous le
…
encore l’essence même de l’islamisme;
…
du sectaire de nouveaux adhérents. Les
…
corps d’armée de Brededdin, un de ses
…
dans les récits des montagnards.
…
temps , rappelé à la tête de ses armées,
…
maison pour les fous, un bain, un cara-
…
de deux grandes mosquées impériales
…
beaucoup de soin, et de riches peintures
…
pèlerins de la Mecque.
…
n’offre rien de remarquable.
…
dans le golfe de Smyrne,se rattache du
…
sommet est au sud-est de la ville; au
265
milton (1) supposent que la ville de
…
les antiquaires sont d’accord pour y voir
…
La position de cette figure ne peut être
…
nom de Biiyuk suret, la grande statue.
…
s’élève verticalement au-dessus de la
…
caravanséraï qui répond à toutes les
…
Le champ de bataille entre Antiochus
…
intérieur de la Lydie (2) : « A la plaine du
…
de Pline, pays étendu, fertile et lien
266
de Cvrus, ainsi nommée par les mêmes.
…
mention de cette ville dans Strabon ni
…
BOUTE DE SABDES A PEBGAME PAR
…
virons assez de fragments antiques
…
d’abord Pelopia, c’est-à-dire ville de
267
donnerait lieu de croire que Séleucus
…
Euhippa, c’est-à-direqui fournit de bons
…
qu’ils occupaient. On compta donc les
…
était ornée, et parmi les inscriptions
…
quelques fûts de colonnes de marbre,
…
foi nouvelle. Sept villes principales de
…
Le livre de l’Apocalypse s’adresse à
…
ville fut réunie au royaume de Pergame,
…
portance. La forteresse qui s’élève sur
…
été longtemps incertain sur la position
…
bien cultivée; les maisons sontbâties en
268
merce de cette ville consiste principale-
…
le trafic des tissus de la Perse. Les
…
ROUTE DE THYATIRE A PERGAME
…
conventus juridicus de Pergame.
…
est estimée trois heures de marche, ou
…
assez grand nombre de fragments an-
…
De Bakir à Souma la route passe par
269
moins l’attention de l’observateur qui
…
orientale de la Lydie, à vingt-huit mil-
…
pied de la montagne. Elle fut fondée par
…
Mais à part ces avantages de position,
…
la nature du sol (2). » Il est juste de dire
…
de cela, et Philadelphie existe encore.
…
parement en petits moellons de gneiss,
…
brèche qui forme l’entrée de la ville: les
…
par la richesse et la beauté de ses mo-
270
numents. Il y a lieu de croire que ses
…
nant que chaque voyageur ait pu les
…
système de murailles appartenant à
…
les ruines de cette ville, on peut penser
…
tilité du pays, les troupeaux nombreux,
…
élégants; il diffère de celui des femmes
…
Les Grecs ont conservé à cette ville
…
celui de Allah, dieu, a motivé une mé-
…
ble au sujet des truites de l’Olympe
271
ville fut le point de mire de leurs plus
…
fut comprise dans le partage de l’émir
…
mais fut obligé de battre en retraite
…
maison impériale de Byzance; Andronic
…
Turcs Bayazid Ildirim. Sur ces entre-
…
entre les États de l’émir Aïdin et ceux
…
de l’émir Djounéid, qui posséda toute
…
ce rebelle elle rentra dans les posses-
…
sorte de miel tiré du Myrica et du fro-
…
le nom de halva fait les délices des en-
…
les îles de la Grèce. Le halva de Phi-
272
diffère totalement de celle qu’on vient
…
de l’autre, le nom de Catacécaumène
…
latif. Les plus anciens volcans de l’Asie
…
sortie de terre par de larges fissures, et
…
de cristaux blancs plus ou moins par-
…
davantage de la classe des porphyres,
…
sans jamais laisser de traces de ce que
…
de l’effort immense qui s’était produit.
…
de la roche, ont bientôt augmenté ces
…
de la lave de fusion n’ait pas été pré-
…
rapporter la formation de ces monta-
273
talie, et dont les produits sont identi-
…
temps, ont formé ces bancs de roche
…
dans ces régions; les peuples qui ont
…
sur une vaste étendue de terrains ignés.
…
due de leur cours que la désolation et
…
éruption considérable, dont les épan-
274
phores d’eau pour les faire rafraîchir.
…
de forge , parsemée çà et là de globules
…
coulée, car les flancs du cône sont cou-
…
d’un myrïàmètre, les traces de ces érup-
…
contact de l’eau et des laves bouillantes
…
je n’ai jamais observé de cristallisation
…
existants; mais les terrains ignés s’é-
…
composé de lave violâtre, contenant du
…
A part les choses fabuleuses que
275
territoire de Kara hissar, où l’on ob-
…
de Catacécauménite. Le canton était
…
portait de la pierre ponce. Les trois
…
du premier, entre les villages de Sandal et
…
est située à sept milles à l’est de Sandal :
…
La ville de Koula est agréablement
…
Koula est une ville de quatre a cinq
…
culte de cette divinité.
…
nom connu. Le nom de Koula boulé,
276
position de Clanudda, marquée dans la
…
de Koula, une localité qui mérite d’être
…
un de ces centres où la religion s’u-
…
composé de pierres de grand appareil,
…
de mètres d’étendue; elle est fermée
…
environ lm 50 de hauteur ; l’archivolte
…
Au nord de l’enceinte sont des restes
…
de Caroura et de Charouium (1).
277
marqué une inscription gravée sur une
…
La partie nord de la Catacécaumène
…
La ville de Mœonia était au centre de
…
mètres au nord de Koula, et M. Hamil-
…
taine analogie de noms, à l’assimiler
…
nombre de sièges sont encore en place.
278
de grand appareil, réunies sans ciment;
…
pinion de M. Hamilton; les deux ob-
…
maine. Les restes de monuments sont
…
l’axe de la porte sont les ruines d’un
…
cessive ; les ornements de cet édifice
…
autre portique est composé de deux
…
Saïttge, comprise parmi les villes de
…
Léon .-elle appartenait au canton de Mœo-
…
au nord de Kouia près du village de
…
qui a quatre kilomètres de longueur;
…
cendant dans la plaine on reconnaît les
…
quelques jours au milieu de ces ruines.
…
fleuve Hyllus, qui est si loin de là. Ceci
…
Le cours de l’Hyllus baignait les murs
279
de deux autres villes de Lydie dont la
…
La position de cette ville n’a pas
…
aux Ioniens de Milet. La ville occupait,
…
et les villes de l’intérieur, a du être
…
scénium et tous les gradins ontdisparu.
…
nommé Chérémon, atfligé de voir sa
280
dans le çours des siècles causé de nou-
…
dans son palais de Nymphæum, et ne
…
nom de beau château; depuis ce temps
…
cement de l’ancienne Tralles; elle s’est
…
verte des débris de murailles qui ont
…
couverts de peintures : les amorces de
…
les blocs de marbre qui sont encore en-
…
ont été opérées dans le but de recher-
281
belle époque de l’art. Aujourd’hui ou
…
base de colonne évidée.
…
stable et puissant. Les émirs d’Aïdin,
…
liers, qui étaient un fléau pour les villa-
…
a pas plus de quatre cents occupées par
…
La plaine est dans un état de culture
…
sidérable; outre l’industrie de la tan-
…
Dans presque toutes les villes de la Ly-
282
tume qu’ont souvent reproduit les pein-
…
encore la pipe et les pincettes. Leur cu-
…
habitudes, qu’ils ne sont pas de race ot-
…
Thraces fondateurs de Tralles qui s’em-
…
c’est que dans les pays de montagnes
…
teur de cette milice qui jouit encore
…
des Nizam contre les Zeibeks; on en
…
d’attrait pour les musulmans et surtout
…
d’un grand crédit, sans qu’on sache de
…
Les arbres marabouts sont nombreux
…
et de mauvaise mine ; l’arbre marabout
…
l’on rencontre sur toutes les routes des
283
L’arbre marabout, selon les Turcs,
…
de la koubba d’un santon. On pourrait
…
les rencontre dans des lieux inhabités,
…
moindre que les arbres voisins des cha-
…
taines pierres jouissent de cette réputa-
…
chiffons, on les cloue dans les joints.
…
les musulmans ; Borlage, auteur anglais,
…
La capitale de l’Islam n’est pas plus
…
cette sueur de la pierre qu’on attribue
…
trouve dans la mosquée de la sultane
…
du diamètre de 0,30 c., au plus; elle
…
matériels, les montagnards de l’Asie re-
284
déjouer ce genre de maléfice : c’est d’at-
…
de bœuf, de cheval, ou de chameau. Au
…
chez les Grecs comme chez les musul-
…
en Perse. Les pierres accumulées par
…
dues dans tant de contrées diverses,
…
souvent si rare, les puits et les sour-
…
dans le reste de l’Orient ; en Perse, on
…
les jeunes gens de l’endroit font des
…
pelés vacouf en Turquie. Les biens va-
285
torisée à prêter de l’argent aux pro-
…
couf, c’est-à-dire propriété de la mos-
…
Si les osmanlis déploient toujours
…
ne tarde pas à enlever; cependant les
…
11 faut croire que cette science de la
…
de cinquante à soixante centimes par
…
ceaux d’étoffe, et brodés ensuite sur les
…
VILLES DE LYDIE AU SUD DU CAYSTRE.
…
de commerce. Les villes de ces contrées
…
tes et abandonnées, les premières jouis-
286
ment de leur création.
…
Les ruines de la ville s’étendent au
…
périeur ; mais si l’on en juge par les dé-
…
grands blocs de pierre. Aucun temple
…
les pentes du mont Messogis sont peu-
…
vanes composées chacune de plusieurs
287
importance à celle des figues et les pro-
…
petit rouet ; c’est l’occupation de toute
…
Nysa était située sur le penchant du
…
et a reconnu les vestiges des principaux
…
nèrent leurs noms : la population de
…
rousia, salle d’assemblée pour les vieil-
…
Chandler reconnut à Sultan hissar les
…
sous le rapport de l’architecture, peut-
…
une place voisine de Nysa, se retrouve
…
un mille au-dessus du village de Mas-
Livre V: Ionie
289
PREMIÈRES MIGRATIONS IONIENNES.
…
États puissants pour avoir la faculté de
…
dent parmi les indigènes, et tout ce
…
tinentale et les peuples de l’extrême
…
chent à cet important mouvement de la
…
mentionnées, et les héros grecs n’appa-
…
les monarques égyptiens accueillaient
…
formes architectoniques. Les Phéniciens
290
ration que les Grecs cherchent en vain
…
avait de sauvage dans son culte oriental.
…
les indigènes des relations, fondaient
…
s’établir sur cette côte; mais le mélange
…
germe de population dans lequel domi-
…
les divinités indigènes. Cette conformité
…
pouvoir étranger les eût soumis au même
…
blissements ioniens sur la côte d’Asie
…
Les antiques sanctuaires des aborigènes
…
rer le manque absolu de documents ori
291
même difficulté pour la géographie de
…
l’emplacement de l’ancienne Smyrne.
…
des Dilettanti de Londres, affectaient un
…
Les Pélasges, sans être absolument no-
…
incorporés dans les nouveaux centres
…
n’est-il prononcé par les historiens grecs
…
taient autant de sujets qui leur arri-
…
cours de son installation par l’appui et
…
de l’esprit et au développement des for-
292
ces et de la beauté : les gymnases, les
…
ils à surmonter les difficultés d’un pre-
…
faut reconnaître que, malgré toutes les
…
Les premiers Ioniens qui quittèrent la
…
mariés à des femmes de Carie, dont ils
…
rèrent de l’autre côté du Méandre. Cy-
…
pendant chez les Éphésiens et les Colo-
…
sacré situé dans le territoire de Mycale,
293
Toutes les affaires de la confédération
…
sous le nom de Panhellenium, dont l’em-
…
de l’Ionie sans vanter la beauté du ciel,
…
Les dispositions de cette partie du con-
…
formaient une riche ceinture de villes
…
Hérodote a soin de faire remarquer que
…
tion grecque sur les confins de leur
…
l’ionie sous les perses.
…
centre de ralliement, ce fut un citoyen
294
de toute attaque dirigée contre les villes
…
dans l’île de Cymé.
…
la ville de Magnésie, qui se relevait à
…
Les Ioniens montraient en effet au
…
qu’Harpagus fut obligé d’assiéger et de
…
Les bas-reliefs de Ninive nous mettent
…
Les révolutions dont l’ionit étaient
295
distinction les colons ioniens qui ve-
…
Les villes d'Ionie, Chio, Téos, Phocée
…
elles avaient seules le droit de fournir
…
BEGNES DE CAMBYSE ET DE DABIUS.
…
la nation ionienne un temps de repos
…
nouvelle division de son empire en sa-
…
ristagoras attira sur l’Ionie la fureur du
…
donnés par les Athéniens, les Ioniens
296
villes, et à cesser de recourir à la force.
…
tant de l’impôt était le même qu’avant
…
Le danger commun avait fait taire les
…
encore une fois les barbares sur les
…
pointe de l’île appelée les Calames, où
…
ler au promontoire de Mycale pour se
…
aux Ioniens pour les détacher du ser-
…
taquèrent avec succès les Perses , qui
…
qui les armèrent, et ils contribuèrent
…
La mort de Xerxès et la défaite de l’ar-
…
mais les dissensions qui s’élevèrent
297
entre les alliés donnèrent au successeur
…
Artaxerxe monta sur le trône en 465 ;
…
L’intérêt de la politique d’Artaxerxe
…
niture de son vin, et Myus, dans la val-
…
lant pas renouveler en personne les
…
sible de faire la guerre à ses compatriotes
…
renouvelées entre les villes grecques
…
belle page dans les historiens grecs, mais
…
niistocle et Midas ont bu du sang de tau-
298
Les efforts des Athéniens pour résister
…
du Péloponnèse et battit sur terre l’ar-
…
gouverneur de l’Asie, fut arrivé à Sardes,
…
dans lequel toutes les forces navales
…
Pendant les années qui suivirent cette
…
Zenis, grec de Dardanie, avait gou-
…
vince sous l’autorité de la Perse.
…
sous les coups de Dercellydas.
…
Les promenades militaires se termi-
…
de Tissapherne ; mais il avait préparé se-
299
de tous les peuples grecs. Il emmena
…
Conon. Ces derniers battirent les Lacédé-
…
sance de Lacédémone fut complètement
…
Les villes ioniennes, réduites à l’état
…
des Perses se contentait de lever des
…
des armées de nombreuses troupes d’é-
…
aucune idée de la construction des vais-
…
aussi chez les Grecs les modes orienta-
…
claves. Les Perses agissaient sur les
…
La cour de Polycrate, qui se distin-
300
aussi, quand, sur le théâtre, un pauvre
…
lontiers changé le gouvernement de ses
…
dans toutes les branches des sciences et
…
noms les plus illustres de l’Attique et
…
Ce n’est pas un mince honneur pour les
…
L’idée de couronner une colonne par
…
Les Grecs ont su donner à ces pre-
…
Dans les pays étrangers à la Grèce
…
leur avait permis de construire.
…
Un lien plus fort unissait les villes
…
rémonies religieuses, les statues et les
301
Les jeux de la scène qui accompa-
…
litique comme la religion faisaient les
…
et l’autre édifice. Ce goût pour les mo-
…
la Carie, les villes, libres dans leur gou-
…
ritoire de l’Ionie; car Aristonicus avait
…
de Nicomède, roi de Bithynie, qui
…
Ionie avaut l’établissement définitif de
…
mination. Étienne de Byzance nous a
302
SOUS LES EMPEREURS ROMAINS.
…
bornée à l’est par les montagnes où ce
…
Samos et Chio étaient les capitales
…
particulier (1). Ce passage de l’historien
…
de préséance de la manière suivante :
…
que fait Hérodote du climat de l’Ionie.
…
(2) 3,43o stades de 700 au desré font 4
303
que des marécages où les habitants hé
…
la mer de Samos ne demanderait qu’à
…
sol, qui est toujours la même : les gras
…
par stratagème entre les mains des
…
Dans la suite, Alyatte, fils de Sadvatte,
…
dispersés dans les villages pendant l’es-
…
tait de son temps : « Il y a le golfe de
…
trait plus avant dans les terres qu’elle
…
sud-ouest de Bournaliat, une localité
…
La Smyrne dont on voit les ruines
304
une ville sur le mont Pagus, où il
…
mont Pagus, partie sur la montagne et
…
Mais la partie inférieure de la ville,
…
tion de la ville moderne.
…
Tibère, et elle l'emporta sur ses rivales:
…
De tous les ouvrages exécutés par les
…
jusqu’au tiers de sa hauteur. Elle est
…
ne restait en 1836 que les deux parties
…
ques découvertes de fragments dans les
…
sont les ruines d’un ancien agora, avec
305
plaine et sur le chemin de Bournabat
…
de grosse maçonnerie, avec quelques
…
les appuie.
…
de Smyrne, dont la rédaction est à peu
…
jamais pu y établir de maisons; d’ail-
…
ville; on n’y rencontre aucune trace de
…
Les empereurs grecs, menacés par
306
de l’Église; mais pendant qu’il disait
…
et tous les chrétiens furent massacrés.
…
capitale de l’Ionie était possédée par
…
vestie de trois côtés; le port formait le
…
ment réussi au siège de Siwas (Sé-
…
resta au pouvoir de Djoiméid; c’est le
…
Mais les chrétiens de Rhodes n’a-
…
conquête pour aller sur les côtes de
307
brûlée, les mosquées détruites; la fu-
…
anéantie, se retira dans les masures qui
…
est maître de Smyrne, mais non sans
…
de Janus a Rome: cet édifice était près
…
téin (marché aux étoffes), long de
…
d’ordinaire les voyageurs qui arrivent
…
chantement passé, on est étonné de ne
308
d terre : de manière que jour se sarantir
…
les étrangers à acquérir des biens-fonds.
…
n aît a déplorer quelque malheur de
…
de sorte qu’on peut dire qu’en l’es-
…
et de plus l’usage des cliali-nichin,
…
à peine, et les toitures se touchent d’un
…
qui au fond ne sont pas fâchés de voir
…
Les alignements sont la chose dont
…
de bois et des bâtisses de tous genres.
…
Tais Copriuïs (les ordures), où sont
…
avec peu de dépenses, en achetant quel-
…
vernement ni les particuliers ne vou-
…
C’était un excellent calcul pour les négo-
…
d hui entouré de maisons.
309
ROUTE DE SMYRNE A A ÏASALOÜK.
…
côte du nord, les sommets découpés du
…
de la ville. Ensuite on passe un pont
…
de l’homme ne s’y reconnaît qu’aux tra-
…
serré, que les habitants appellent le
…
les eaux des différents vallons prennent
…
un corps de garde et quelques khans.
…
ros et Éphèse. L'ondulation de terrain
…
du Tmolus, au pied de laqtiel e sont si-
310
ques habitations forment le village de
…
Sou (l’Eau de la Source) parce qu’elle
…
pas suivi la ligne direcie qui mène de
…
vallée d’un mille de largeur; les terres
…
^a“o>), qui fournis-ait ensuite de l'eau à
…
il va se jeter dans la mer, près de la
…
pour la plupart dans la partie sud de
…
mosquées. Les pierres sépulcrales qui
…
de l’importance et de la grandeur de
311
construction indique un temps de bar-
…
rieur du château il n’y a que de misé-
…
fut- de colonnes brisées, qui sont les res-
…
par un perron de dix marches, est ornée,
…
criptibles. L’exécution de tons ces orne-
…
la sol.di é. : les fondations manque, t
…
impériale, est ornée de deux u inatets :
…
une cour au milieu de laquelle il v a une
…
Dans une plinthe de marbre, tout
…
tique, d'ordre composite : tous les autres
312
un passage assez curieux sur Éphèse: il
…
ancienne et vénérée par les Grecs. Ici
…
chez eux : ils s’y rendaient de divers
…
de l’Ionie. Éphèse. a bien souvent attiré
…
the , car il y a solution de continuité
…
Ioniens, nous devons ajouter les Ama-
…
Toutes les recherches faites sur ces fem-
…
Les Léléges et les Cariens habitaient
…
répandu en Asie. Une statue de Diane,
…
Les deux Amazones Smyrna et Si-
313
à la ville. Le culte de Diane était déjà
…
certain nombre de femmes de race ama-
…
nom de Smyrne, était placée sur la
…
par Àndroclus était près du temple de
…
Vers la fin de la guerre du Pélopo-
…
Les Grecs, soumis et traités avec dou-
…
grande vallée, qui s'étend de l’est à
…
jusqu’au mont Messogis. Du côté de
…
titution de ces privilèges en faveur du
…
dans les terres, par suite de l’ensable-
…
donner passage à des myriades de pois-
…
de mulet. Celte pêche est affermée
…
ou plutôt une des villes de ce nom,
…
(1) Plutarque, vie de Lysandre,
314
«tendue de terrain. Celles qui se recon-
…
LES MURS DE LA VILLE.
…
les Perses ont affectionné particulière-
…
gueur de deux kilomètres en suivant les
…
tours sont dans un bon état de conser-
…
plaine : il est probable que les pierres
…
ions du temple de Diane. Lysimaque
315
d’hui les ruines qui existent appartien-
…
massif de ruines entourant un mame-
…
frent pas aujourd’hui de vestiges plus
…
de grandes salies, qui ont sans doute
…
de dispositions differentes des autres
…
Stade; la conservation de l’enceinte ré-
…
de Vitruve, devait accompag er tout
316
LES THERMES, LE GYMNASE.
…
de ces portiques qu’on voit les débris
…
est, il est vrai, dépouillé de ses marbres
…
a quelques-uns appuyés sur la mon-
…
Le long de la montagne voisine sont
…
nombre de piles carrées, construites
…
Tibère Lésa'-, son fils, et au peuple d’É-
…
dont on voit de nombreux vestiges, mais
…
de marbre, d’où furent tirés les maté-
…
part de cette découverte; il y fut ac-
317
furent célébrés sur le lieu meme où cette
…
Les carrières du mont Prion méritent
…
fondeur; le sol est couvert de recoupes
…
Le culte d’Apollon et celui de Diane,
…
nes sur ces cotes, c’est-à-dire dans ledou-
…
dans son temple peu de temps après
…
de l’autre, le corps formait une sorte de
…
gaine couverte par de nombreuses ma-
…
haut en bas de l’enceinte sacrée pour
…
Le premier temple de Diane fut un
…
prêtres tires de divers pays, et qu’on ap-
…
vice du temple par un collège de prê-
…
diané, prêtresse d’Artémis, fille de Mun-
…
a fonctionné en exécutant les mystères
…
tresse chargée de disposer les vêtements
318
tère Straton était chargé de la garde de
…
Diane par les Éphésiens était un monu-
…
architecte. Tous les details que nous
…
Pour le nom de celui qui construisit le
…
lexandrie d'après les ordres d Alexandre.
…
de Diane qui achevèrent l’éddice, dont
…
de front et nu double portique iatéral;
…
cliné, au moyen de sacs de sable qu’il
…
de l’architecte, et à son reveil il trouva
…
tallie, Diociès : on est convenu de l’appeler
319
siphon (î) pour transporter de la car-
…
depuis près de quatre cents ans. Avant
…
étaient de bois décadré, et les marches
…
la mesure de cette distance, de sorte
…
Malgré tant de détails donnés par les
…
rain de la ville ayant été singulièrement
…
Le séjour de saint Paul à Ephèse ei
320
tus que devaient pratiquer les nouveaux
…
Paul fonda de la sorte une grande
…
resta pas circonscrite aux murs de la
…
par excellence le nom de province
…
Paul prêcha de la sorte pendant deux
…
La population d’Éphèse, habituée de
…
des pratiques de la magie, malgré les lois
…
de christianisme, et qui, effrayés des
…
et d'un haut prix ; les manuscrits étaient
…
de la conviction des anciens agents de
…
métier était de fabriquer de petites châs-
…
tume dans les cérémonies païennes de
…
de bois, d’or ou d'argent : on en poitait
…
des images de la déesse, dont la matière
321
Il y avait de plus le commerce des ex-
…
Les grandes fêtes de Diane avaient
…
cordaient avec de grands marchés,
…
était jonchée de fleurs ; les magistrats
…
l’Apôtre des Gentils , et c’était pour les
…
pleine de tumulte et de confusion.
…
dans les auteurs.
…
qui étaient de ses amis, l’envoyèrent
…
le greffier de la ville, le grammateus,
…
mage est tombée des mains de Jupiter?
…
représente au naturel une de ces émo-
322
qui sont en scène n’y apparaît hors de
…
le greffier de la ville ; c’est encore un
…
Dans le second siècle de notre ère,
…
il s’empara de toutes les richesses con-
…
vive opposition de la part des prêtres;
…
riaux tout prêts; les douze colonnes de
…
ribole; les colonnes au grand temple,
…
LES TURCS A ÉPHÈSE.
323
le plus célèbre monument de l’Asie ait
…
Comnène rapporte que les infidèles s’étant
…
la plaine au dessous de la citadelle; ce
…
vagea d’abord la campagne à la tête de
…
qui venait de mourir, se joignit à Men-
…
des Éphésiens, les assiégeants mirent le
…
dit à Mentesché, qui remit le pays d’É-
…
sortes de crimes et de cruautés. Au mi-
…
entre les mains de Mahomet I, qui, ayant
…
l’honneur de tous les apôtres. »
324
BUINES DE PYGELE *, NÉAP0L1S.
…
quitter le bord de la mer.
…
sont les derniers contre-forts du mont
…
le flanc de la montagne. A gauche, il
…
mises de galères ; mais sur le continent
…
chercher remplacement du temple de
…
dans une longue navigation, de descen-
…
temps de Dioscoride, célèbre parla qua-
…
échangèrent avec les Samiens, contre la
325
Les maisons s’élèvent en amphithéâtre
…
Georges. Les juifs sont nombreux et
…
ils réclamèrent près de la sultane Validé,
…
et pour la plupart couvertes de vignes.
…
de peupliers: les rochers taillés à pic
…
Les constructions qui s’élèvent de tou-
…
descente de cheval, et nous apportent
…
on se croirait dans quelque vallée de la
…
tiges imposants; ce sont trois assises de
…
Les eaux passaient sans doute par
…
mentionne les restaurations qui ont été
…
en ce même endroit la Mère de Dieu.
326
maître de Sa source, aux frais et par le se-
…
Mois de février 1814.
…
partie de la grotte a été excavée de main
…
la fable place l’accouchement de cette
…
« On célèbre tous les ans à Ortygie
…
Il ne reste plus rien de tous ces édifi-
…
pas éloigné d’un myriamètre de la mer
…
sur les flancs duquel on aperçoit encore
…
(i) Voy. les médailles de Magnésie sur
327
rien de remarquable. La plate-forme
…
nord une espèce de tour circulaire, au
…
citerne ou le puits de quelque oracle ?
…
ture. Toute cette ruine paraît dater de
…
un peu au-dessus de son embouchure.
…
vait le temple de Neptune Héliconius.
…
volonté aux habitants de la ville d’Hélice,
…
foule sur le rivage, et je m’avançais
…
vêtues les couvraient de sable et de
…
mois. de septembre on vient de tous
…
règlement tacite qui détermine les jours
328
A une lieue de là, on voit une source
…
d’autres voyages examiné les fortifica-
…
due de l’enceinte. On retrouve dans ces
…
portent pas de traces d'ornementation
…
nom de cette place; nous sommes là-
…
pour les anciens Grecs étaient déjà per-
…
avec les populations, et qui finirent par
…
territoire de Tchangli : c’est une vaste
…
c’est l’extrémité nord du canal de Samos
…
Panionium. C’est au milieu de cette en-
329
de vestiges. Rien n'annonce aux alen-
…
tinés à loger les envoyés. C’est derrière
…
Les renseignements donnés par les
…
les Européens. Sans compter faire là
…
les ruines de plusieurs petites églises
…
commerciale. Tous les ports situés à
…
miers Grecs. Les monuments anciens
…
servé les tremblements de terre comme
330
un édifice d’un côté, et de le i elever par
…
de guerre. Il signale comme le plus
…
font boursoufler. Les villes maritimes
…
blement de terre qui engloutit la ville de
…
parlé de l’Asie Mineure sans mention-
…
globe : les puits et les fontaines modi-
…
de terre (3).
…
tion qui se manifeste dans les couches
…
Le grand tremblement de terre qui
…
Sous le règne d’Auguste la ville de
…
les décombres ; trois vides de la pro-
331
l'an 300, sous le règne de Dioclétien,
…
quantité de citoyens furent écrasés sous
…
tremblement de terre de Broussa, qui
…
blements de terre.
…
la secousse qui a renversé les plus beaux
…
dans la vallée du Méandre. La ville de
332
sa suprématie malgré les guerres qu’elle
…
manière approximative, l’époque de la
…
située sur la rive gauche du Méandre, et
…
Strabon se contente de citer Icaros et
…
qu'au jour où les rois de Lydie tentèrent
…
tre les Milésiens, mais comme il voulait
…
son des instruments camper sur le ter-
…
chose à ravager de nouveau. La guerre
…
dienne ayant mis comme de coutume le
333
été consultée à ce sujet refusa de rendre
…
fut informé par Périandre de la réponse
…
administrer la republique les proprié-
…
RÈGNE DE DARIUS.
…
les conseils d’Aristagoras, et se mita la
334
aucun doute sur les vices de cette con-
…
de Milet par terre et par mer. Les Perses
…
« Pour toi, ô ville de Milet, artisan de
…
Pasitigris, qui coule non loin de Suze,
…
une occasion de secouer le joug des
…
le gouvernement de d’Ionie et de la
…
thènes, sur quarante-huit vais-eaux,
…
de répandre les épidémies, et c’est à la
335
Alexandre s’empara de la ville exté-
…
les Milésiens avec douceur, incorpora
…
elle fut, comme toutes les autres villes
…
comblés, et les navires mouillaient dans
…
une place de guerre doit avoir été une
…
qui attire aujourd’hui les regards et qui
…
des vomitoires et de la galerie circulaire
336
Comme cette place est située sur la
…
à la ruine'de cette ville.
…
dans les domaines de la Porte, ce n’est
…
peut donner une idée de la transforma-
…
hasard voulut qu’à son retour les pre-
…
fut fondée au bord de la mer, en était
337
Lorsque les Ioniens arrivèrent sur la
…
norés dans le pays, et les plus célèbres
…
offrandes, des objets d’art les plus pré-
…
des plus célèbres de la contrée; il do-
…
restée dans cette famille; c’est de là que
…
sein , donna à son fils le nom de Bran-
…
tagne du nom de Didyme, parce qu elle
…
la famille de Branchus. Léodamas, Mi-
…
guerre de Troie. Macharéus vivait 1171
…
de Delphes; elles s’étaient déjà telle-
…
les richesses du temple pour armer des
…
fut consommée par ordre de Xerxès,
338
les établit dans la Sogdiane ; mais
…
vons en reconnaître les principales dis-
…
de fleurir de nouveau dans ces parages,
…
irdvTtov) ; mais les Miiésiens furent
…
diant le plan de l’édifice. Pausanias se
…
ou édicules où se rendaient les oracles
…
élevé sur plusieurs marches, et sem-
…
que les Romains appelaient Cella , et ies lieux
339
rines de Diane. 11 en existe quelques-
…
trouvés dans la mer, près de Livourne.
…
a Memphis, les députés Milésiens ap-
…
chevé; mais comme les cérémonies re-
…
qui mentionnent les riches offrandes
…
presque toutes les inscriptions recueil-
…
pour l’accomplissement de cette partie
…
maintint pas sous les Romains; cepen-
…
d’Hygie, rappelle que les Milésiens
…
L’empereur Julien, en essayant de
340
triompher : la ville de Milet se dépeu-
…
Les premiers voyageurs qui obser-
…
avant de partir pour sa campagne contre
…
riode de 400 à 1,600 qu’il fut renversé ;
…
cueilli le moindre détail sur cette ca-
…
Le temple est éloigné d’une lieue de
…
vingtaine de maisons de pierre, un
…
avec les officiers de la Mésange. Tous
…
comme une montagne de décombres
…
Le mur de la cella du temple existe
…
férence de trente degrés au nord, si
341
pas enterrés ; car le sol actuel est de plus
…
des cannelures, fut en haut de la co-
…
l'entrée de la cella. Le mur de la cella
…
ordre de colonnes, et en effet, tout
…
ple d’Apollon doit différer de ce dernier
…
difficulté de construction, puisque le
…
ce temple de la disposition indiquée par
…
de bois ; ces figures sont vêtues de tu-
342
• fade ; mais on ne voit aucune trace de
…
lèrent peu à peu les Cariens de toutes
…
que Philotas, second fondateur de cette
…
dans les environs (4). Priène ne paraît
…
quité que sa qualité de ville sainte ; elle
…
que les rois de Lydie tournèrent leurs
…
Ioniens de s’embarquer avec leurs famil-
…
drait toute ITonie. Les Grecs préférèrent
…
ment de Tabatès, général perse, et plus
…
La situation de Priène sur ies pentes
…
ritime. Dès que les alluvions du Méan-
343
stades (7 kil. ) de la mer; aujourd’hui la
…
Pausanias cite le temple de Minerve avec
…
caractères qui était gravée sur une des
…
La brièveté de cette inscription con-
…
de la religion chrétienne dans ces con-
…
concile de Chalcédoine par Étienne,
…
d’une église. Il n’est pas nécessaire de
…
destruction. La plupart des temples de
…
RUINES DE PRIÈNE.
344
bossage. La pente de la montagne étant
…
La partie supérieure de l’acropole est
…
Cette partie haute de la ville ne pa-
…
un vestibule soutenu par deux rangs de
…
ple de Minerve dans la ville de Priène ,
…
les architectes Tharchésius et Hermo-
…
les temps de décadence que la profusion
…
née de denticules et de palmeltes ; au-
…
tait sans doute un escalier, sur la terrasse
…
trième dans le haut de la ville ; elles sont
345
seràit certain de faire des découvertes
…
draient visiter Priène feraient bien de
…
taille de Mycale dit positivement (1) que
…
Trogilia (2). Sur la partie de la côte nom-
…
aurait lieu de croire qu’il s’agit de deux
…
bouchure plus au large vers l’ouest. Les
…
plus de la côte maritime.
…
elle faisait partie des douze villes de l’al-
346
DE DIANE LEUCOPHRYNE.
…
dans les ruines duquel se trouvent plu-
…
Les anciens se sont plu à faire tant de
…
octostyle (c’est-à-direà huit colonnes de
…
L’édifice était orienté de l’est à l’ouest.
…
générale de tous les grands temples de
…
également couvert de décombres, pro-
…
tous les morceaux d’architrave cor-
…
ROUTE DE SCALA-NOVA A MAGNÉSIE
347
donnons ici la traduction de ces deux
…
fonction dans les districts des pays qui
…
à des particuliers qui offriraient de s’en
…
voyageurs français de distinction vont
…
récépissé de ce qu’ils vous auront payé ;
…
tions, et vous vous appliquerez, de tout
…
dée, le dernier jour du mois de djémazi-
…
deur de France nous ayant exposé, dans
…
rité de ces voyageurs, nous avons bien
348
mencement du mois de djémazi-oul-
…
franchir une des crêtes les plus élevées
…
vallée appelée Atchiova, au milieu de
…
hommes; ce sont des pans de murs
…
rigènes. Au village de Atchiova, on re-
…
antique de l’endroit. Il y avait aux en-
…
ter de nouveau, marchant toujours sur
…
vage. Les lianes qui se mêlent aux ar-
…
ment du tribut d’une foule de ruisseaux
…
importante. Mais il n’y a point d’ins-
…
et a fini par chasser tous les habitants
…
du Mycale qui chez les anciens portait le
349
couronnée de constructions archaïques
…
de Lydie. Thucydide mentionne souvent
…
par mer; car les habitants de Chio y
…
Méandre; mais il fut attaque par les
…
bords de la mer de Samos. Étienne de
…
montagneux qui s’étend de l’ouest à
…
de Atchiova. Au moment de joindre la
…
de mont Thorax. Le revers oriental du
…
lage composé de quelques huttes, re-
…
lage de Hylé, qui, selon Pausanias,
…
très-antique statue de ce dieu.
…
une petite ville du nom de Leucophrys,
…
de Diane (2). Cette localité se reconnaît
350
aujourd’hui près du village de Gumuch.
…
rendent si malsaine. Autrefois les eaux
…
En parlant du bourg de Leucophrys,
…
dut sa création à une colonie de Ma-
…
par une muraille en pierres de taille,
…
Tous les gradins sont encore en place,
…
sur lesquels s’élevaient divers monu-
…
enceinte de muraille, encore parfaite-
…
La petite mosquée est bâtie sur les
351
ancres de fer scellées e-n plomb. Une
…
gravee sur le lit supérieur. La série
…
de huit colonnes, dont les entre-colon-
…
Les colonnes extrêmes 1 et 8 s’ajustent
…
égalementlepied d’une statue de femme,
…
élevé enl’honneur de quelque empereur ;
…
même place que le massif de maçon-
352
L’inscription suivante est gravée sur
…
Par les soins de Titus Flavius Démocharès,
…
au point de vue de l’étude de l’édifice,
…
bien réellement le temple de Diane
…
du temple, pour se continuer sur les
…
d’égale dans les monuments de l’art
…
de Magnésie est à plus haut relief, car
…
avec entente de la sculpture monumen-
…
fice , si elles étaient placées près de
353
jamais anéanti, et nous ait permis de
…
Le passage de Strabon n’est pas le
…
artistes les plus célèbres de son temps.
…
sacré, surpasse tous les temples d’A-
…
pierre de taille, à bossages, qui se rat-
…
peinture unie. Sur le devant du temple,
…
Les inscriptions ne permettent pas de
…
Toutelarégion de la valléeduMéandre
354
plaines marécageuses où les habitants
…
les premiers siècles de notre ère puis-
…
comme elles sont comptées de l’em-
…
face au lac. Les gradins ont été enlevés ;
…
La pente du terrain de la ville était
…
roc. Sur l’une des terrasses était située
…
Les tombeaux de la nécropole d’Hé-
355
de Néocore.
…
et de Phébé. Le Latmicus sinus prenait
…
sieurs endroits de la montagne; ces
…
(3) Barbié du Bocage, Notes sur Chandler,
…
de rochers de. granit, qui descendent
…
les îles qui s’élevaient à l’entrée de
356
de Byzance (1). Il en est de même
…
VILLES DE LA PRESQU’ILE ERYTHREE.
…
en Crète et est passé sur le continent
…
les Amazones. C’est ainsi que ces deux
…
chez les peuples qui s’appelaient alors
…
le dieu qui répand les oracles: c’est la
…
Pausanias, en parlant de l’origine de
…
attribue à Mopsus la fondation de
357
devin. Ea ville de Mopsuestia dans la
…
cun de ceux qui le consultaient. Virgile,
…
Pausanias vante les frênes du bois sacré
…
pollonius de Rhodes (5) dit que la ville
…
de Colophon, qui faisait partie de la
…
la cavalerie de Colophon, » signifiait
…
Les Grecs prétendent que Tychicus,
358
La ville de Scyppium appartenait au
…
Halésus était connue sous 1e nom de
…
venteur et le protecteur des jeux de
…
la nature de sa population, Lébédus
…
un grand concours de visiteurs. Cette
…
tent des temps byzantins, les vestiges
…
place à l’ordre ionique dans toutes les
…
de Mahaladji, bâti au pied des collines
…
cours d’eau prend le nom de rivière de
359
de pierre calcaire compacte, grise, res-
…
des habitants est de. fabriquer des sacs
…
ment de ses ruines n’ait été déterminé.
…
de colonnes d’architraves et de cor-
…
maient les meilleurs contingents du
…
située sur la rive gauche du Caystre
…
à monter les contreforts du mont Gal-
…
sance dans les sommets du Gallesus,
…
que par un grand escalier placé sur la
360
d’un théâtre dépouillé de ses sièges, et
…
huit personnes; dans l’angle du côté de
…
fession de pirate, viennent de temps en
…
La fumée de notre cuisine avait attiré
…
ruines de son temple.
…
de Zillé, on suit le bord de la mer à une
…
le petit bourg de Hypsili hissar, dernier
…
accessible, du côté de la terre, que par
361
Il y avait sur ce promontoire une pe-
…
du-château moderne de Hypsili hissar
…
que Strabon désigne sous le nom de
…
TÉOS. — ARRIVÉE DE LA COLONIE
…
après, par une troupe d’Athéniens et de
…
trouva absorbée par la population de race
…
Téos était située sur une presqu’île
…
ville, et dans le grand nombre de litté-
…
nysiaque. Le nom de dithyrambe comme
…
vante; les initiés couverts de masques
362
rent ensuite les poètes dithyrambiques,
…
par les deux moitiés du chœur. Le poète
…
ces fêtes à cause de son caractère émi-
…
bruyante, les rôles sont plus tranchés
…
de Bacchus, les représentations publi-
…
Une ville toute consacrée au culte de
…
« Les acteurs d’Asie et tous ceux qui
…
Après les désastres de Sicile les
363
voit les vestiges, et qui datent du qua-
…
promis de fournir cinq mille amphores
…
envoya ensuite des troupes de débarque-
…
réussi les Téïens, conformément à la
…
voir des rois de Pergame, et sous l’em-
…
RUINES DE TÉOS — SIGADJIK. —
364
de Téos. Le port de Sigadjik est l’ancien
…
en ce genre si l’on pouvait remuer les
…
traités conclus avec les autres États.
…
il avait six colonnes de front et onze
…
entourée de portiques : c’est du reste la
…
tion est le théâtre, assis sur une des col-
…
d’imaginer que les anciens spectateurs
…
la salle de spectacle presqu’aussi
…
est dépouillé de ses sièges et de t>us ses
…
de la Pamphylie.
365
examiner un de ces murs en pierres
…
plâtres moulés sur les monuments rem-
…
que le temple de Bacchus, mais d’une
…
Avant déterminer l’examen de l’in-
…
midale construite sur une éminence et
…
dues sur le sol : l’édifice était construit
…
sur trois côtés ; elle se compose de huit
…
sapherne, ont été reconstruites quand les
…
core près de là, cette partie de la mu-
…
distingue par les mots ante urbem,
…
les vestiges d’un môle au milieu des
…
l’attention, ce sont de grands blocs de
…
voulu expliquer l’usage de ces blocs
366
Les grandes carrières d’où ont été
…
de la ville d’Érythræ, et la troisième
…
geur du détroit entre ce cap et l’île de
…
le premier, le golfe de Tchechmé, le se-
…
de Tchechmé, on doit en conclure que
…
se composait de plusieurs fractions des
…
de Troie avaient longtemps erré avec
…
de nation, qui s’établit promptement
…
Les efforts des habitants pour le tirer à
367
ment conduit à terre, si les femmes
…
éleva un temple dans l’intérieur de la
…
de Minerve Poliade ; la statue de la
…
doit conclure de ce passage de l’auteur
…
célèbre que les oracles de Branchydes
…
l’illustre origine du roi de Macédoine.
…
les soulèvements tentés par les villes
…
voisine de Chio; mais la marine de
…
de Rome contre Antiochus, et reçut
…
la petite ville de Tchechmé, dont la
…
vents d’ouest par l’île de Chio, et son
…
la faculté de faire pousser la barbe.
368
nal de Chio. Toutes les maisons sont
…
nord de la ville, en longeant le bord de
…
fréquenté par les habitants de la pres-
…
abruptes. En contournant les sinuo-
…
ère : près de l’acropole est une autre
…
de cette ville, qui appartient à la masse
…
elle avait lieu de nos jours ; ce sont ces
…
Au centre de la ville est un exhaus-
369
de tous côtés par un soubassement de
…
tous les temples d’Ionie étaient d’ordre
…
de probabilité, être attribué au temple
…
par les Byzantins : le temple aura été
…
qui pouvait servir comme pierres de
…
nommé à cause de la couleur noire
…
mais qui manque de fond, c’est l’an-
…
dispersés autour de sa base, mais il ne
…
GOLFE DE SMYRNE.
…
fonde échancrure appelée par les marins
…
Vient ensuite le golfe de Vourla, au-
…
tour et très-montagneux : les Grecsycul-
…
mouillage du golfe, et les flottes euro-
370
tout ce qui reste de l’ancienne Clazo-
…
de l’Æolide et bâtirent auprès du mont
…
fondèrent Scyppium sur le versant sud
…
Alyatte, roi de Lydie, et lui firent éprou-
…
tinent de la Grèce et avait à Delphes
…
précieux et célèbres; après l’incendie de
…
phores, plus de cent cinquante litres. La
…
indication qui a guidé les premiers ex-
…
cents mètres de longueur : elle est sou-
…
prit parti pour les Romains dans la
…
les pirates de Cilicie s’en emparèrent
…
de base d’opérations contre Smyrne. Au-
…
de terre avec un château moderne ap-
371
voit encore les restes de plusieurs cons-
…
cours d’eau voisin ; près de ces bains
…
et le golfe de Smyrne (.2).
…
L’entrée du golfe de Smyrne est si-
…
Le groupe de monticules dont il est
…
accusés de s’être livrés au pillage du
…
projets de colonisation appelait sur les
…
pour entourer leur ville de murailles,
372
était de deux cents stades ou deux mille
…
senal des bâtiments de guerre; l’autre
…
maison au roi. Les Phocéens demandè-
…
éloigner son armée, les Phocéens se hâ-
…
les images de leurs dieux, et les monu-
…
rent ; ils formèrent le projet de se rendre
…
mer une masse de fer rougie au feu, ils
…
Mais s’étant mis à ravager les côtes
…
FONDATION DE MARSEILLE.
373
Avant de quitter l’Ionie, ils avaient
…
jours impatiente de recouvrer sa liberté,
…
les Perses, ne pouvait être que désas-
…
métier de pirate, donnant la chasse aux
…
Phocée reprend son rang de grand ar-
…
et que le camp de Séleucus n’était pas
374
SIÈGE DE PHOCEE.
…
ville une proclamation pour inviter les
…
battit les murailles; mais les assiégés
…
De nouvelles propositions de capitu-
…
du roi de Pergame. Il est à croire que
…
de l’Ionie.
…
Lorsque les Romains fuient tran-
…
confond avec celle de l’empire. Phocée
…
maine. Les ports se comblaient lente-
…
11 y avait dans le voisinage de cette
…
compromise, et les Latins, de concert
375
aux Génois la libre possession de Phocée
…
fût soldée, et la république de Phocée
…
Les souffrances des populations
…
quel ils ont laissé les intérêts chrétiens.
…
La ville de Leucæ était sur le bord
…
voisine de la côte d’Æolide. Le ter-
…
se faire avec sécurité que si les Euro-
…
cousse assez violente de tremblement
Livre VI: Phrygie - Galatie
377
Il résulte de l’examen des auteurs
…
les phénomènes volcaniques et le tra-
…
les villes de l’Asie Mineure furent expo-
…
garder les Phrygiens comme étant d’o-
…
cevoir quelques doutes sur l’origine
…
contraire, adopté les derniers faits
…
la guerre de Troie. » Strabon critique
378
de Troie, et que les Phrygiens qu’Ho-
…
les historiens, en supposant qu’a des
…
générale sur l’antiquité des Phry-
…
que les auteurs de l’époque romaine
…
du golfe de Smyrne; c’est là qu’il fit
…
d’Asie en Éurope, soumit les Thra-
379
leur mouvement de migration en Asie;
…
par les migrations venues d’Europe.
…
rente de celle des Lydiens leurs voisins.
…
qu’une ancienne dynastie de ce nom
…
dans la pierre de Pessinunte, que l’on
…
mine la ville de Pessinunte. Oïi peut
…
trouvaient des temples de la mère des
380
de tufs tendres et faciles à travailler,
…
transporté en Asie par les colons qui
…
étant venus pour les intérêts du roi
…
nage de Cymé, et toutes ces villes, du
…
cette partie de l’Asie le mode de sep*,
…
L’art de la sculpture dut se ratta*'
…
présent au temple de Delphes (1)’ e il11
…
preuve dans les monuments q11 |t i’
381
Midas roi de Phrygie dans la Revue orien-
…
portait un diadème orné de cornes
…
pont, conduisant en Asie les Brygès,
…
tion grotesque qui fait de ce roi la risée
…
^ho^SPntat‘ons formées de parties
…
ai/es colosses d’Euyuk, les figures
…
kLltller la force ; les ailes, pour ex-
…
sa h "Üon soutenue, et de cornes pour
…
Nsi ^yauté admis chez les Asiatiques,
…
/piei? certain nombre de cylindres et
…
o?corn du ridicule et de la sottise,
382
Le roi de Phrygie est couronné d’un
…
aurait eu la pensée de faire de ce prince
…
grand nombre de statues de ces rois
…
sentation de la royauté, les artistes phry-
…
Les cornes et les longues
…
de sa légitime signification, et être,.^
…
Le premier chef de ces tribus PLjjl
…
et Euménia , et par Étienne de JW
…
Les princes Midas faisaient «e
383
la mort de ce prince, l’empire
…
de Lydie, perdit toute importance po-
…
les révolutions qu'a subies la contrée
…
logie des princes de ce nom, après le
…
ses États envahis par les Cimmériens,
…
rive ^aus la de Midæum, sur les
…
de Gordius, régna sept cent
…
Çoïe de la mort de sa mère C’est en-
…
11 autre prince de la dynastie de
…
j sait rien de son règne, ni de
384
ture était son unique occupation, les
…
tissus ; les matières tinctoriales abon-
…
n’avait pas duré moins de vingt ans, et
…
pouilles , une partie de la Phrygie leur
…
abandonnée de Gordium , en releva les
…
chandises qui étaient transportées de
…
Scopas, que l’on traversait sur un pont;
…
de prendre Cyzique perdit la partie du
…
à un haut degré de prospérité. C’est
…
suppression du royaume de Pergame
…
(1) De lEdificiis.
385
mort de Constance, la révolution qui se
…
sidérable, de la garde de la Mésopota-
…
Les mesures rigoureuses prises par
…
rendre en Syrie ; déjà il était sur les
…
goût de celles des officiers du palais,
…
de Constantinople, il osait à peine con-
…
se hâta de venir à Mygdonie , ville de
…
Lorsque les légions furent sur le
386
légitime héritier de l’empire il rappela
…
rêter les ennemis. Cet officier, parvenu
…
daigna de combattre ce partisan, par-
…
qui tenait encore pour Valens. Les as-
…
et Cyzique tomba au pouvoir de Pro-
…
de préteur Hormisdas, descendant des
…
nées Lupicin, marcha sur Pessinunte,
…
région que nous devrons rechercher les
387
vent être classées de la manière sui-
…
région occidentale : Ancyre de Phrygie
…
renfermait les plus riches cantons, et se
…
et une partie de la Pisidie sont dans
…
de Hiéroclès y met vingt-deux évêchés.
…
Bien que les frontières de la Phrygie
…
la Mysie. Sous les satrapes de Perse, la
…
nale fut désignée sous le nom de Phry-
388
dans la partie de la Phrygie à laquelle
…
Sangarius au nord, la pointe sud de la
…
consacrée à cette déesse. Sur le versant
…
longe le versant occidental de l’Olympe,
…
mène , près duquel étaient situées les
…
cachet particulier de la contrée. C’est
…
Les roches tendres des environs de Ku-
…
Les premiers essais de ce genre remon-
…
soit à cause de la grande pauvreté du
…
Le pays qui renferme le plus de mo-
…
parallèlement deux arbres à terre, les
389
une espèce de pyramide, qu’ils recou-
…
on n’y trouve rien de ce qui est néces-
…
Les montagnes du sud, qui dépendent
…
sans bois; aussi, dans l’antiquité, les
…
ticulièrement cette manière de bâtir des
…
aient conduit les habitants à s’établir
…
sur la terre.
…
par les eaux. Il est au sud de la contrée
…
tagneuse , et reçoivent les faibles ruis-
390
dans son parcours réunit les eaux de
…
d’eau les moins connus de l’Asie Mi-
…
sur le bord d’une branche de ce fleuve.
…
cond, au lieu de mettre la ville de Pes-
…
colonel Leake, dérouté par les itiné-
…
tater ce fait avec plus de soin que je ne
…
tout ses détails, le cours singulier de
…
27 kil. 70, de Pessinunte; il traverse la
…
devant laquelle est l’île de Thynia (3). »
391
dans l’antiquité; les Grecs l'appelaient
…
ment Xerabate, parce que dans les
…
tagnes qui séparent les deux branches
…
qui longe la plaine de Kara hissar, et
…
(4) Voy. pour plus de détails Ritter Erd-
…
ITINÉRAIRE DE BROUSSA A KUTAYAH
…
suivre la vallée de Ghœuk déré.’et nous
…
lepieddes chevaux,présente les plus bel-
…
où l’on trouve deux puits pour les ca-
…
sinage de grandes exploitations de bois.
…
cheher à l’est. Elle est cernée par les
392
sans intérêt ; les maisons sont bâties de
…
de syenite ou de mica-schiste, et par
…
sur le versant méridional de la mon-
…
Le village de Tchoukourdji est situé
…
neh gheul est de soixante kilomètres :
…
encore un col de l’Ak dagh, dont l’al-
…
rocher; les nombreux minarets des mos-
…
sur le pied de six kilomètres par heure
…
ITINÉRAIRE DE BROUSSA A AIZAN1
393
mence à monter un des contre-forts de
…
la vaste plaine de Taouchanli. Plusieurs
…
La petite ville de Mohimoul, distante seu-
…
suffisants d’un ancien centre” de popu-
…
âmes environ ; les Grecs y sont pour plus
…
elle est peuplée de nombreux villages
…
la rangée de collines au sud de la falaise
…
zani s’élève au milieu de la plaine et
394
avec très-peu d’altération sous celui de
…
de cette province. La fondation de cette
…
métropole de la Phrygie; mais en 1402,
…
soit bien éloignée du site de Kutayah,
…
cher ses troupes dans les meil’eU
…
Sous les empereurs byzantins
395
p belle auge de fontaine.
…
tejyZ a’nsi dire, sans lacune depuis les
…
vo^ante que la nature de l’animal dé-
…
rare de trouver sur les monu-
…
de la province :
…
la cour de Byzance.
…
ble curiosité, elle est composée de ban-
…
rempli de pqissons
…
Les maisons sont bâties partie en
396
Aucun vestige des monuments de
…
Au commencement de l’année 1833,
…
ville. Il fallait qu’il vînt occuper les
…
à Kutayah fut bientôt enlacé dans les
…
lieues de la ville, dans le voisinage de
…
urgentes; mais bientôt, obligé de battre
…
La population de Kutayah dépasse
…
de Smyrne, le Rhyndacus d’une part
…
de Kutayah est presque entièrement
…
élevées, et l’on traverse autant de plaines
397
calcaire lacustre , dont les roches ont
…
les évêchés de la Phrygie Pacatienne au
…
Hérodien, cité par Étienne de By-
…
petit nombre de documents que nous
…
pées de stérilité, et souffrant de la di-
…
nion soit venu de ce nom. »
…
royaume de leur père. La part qui échut
…
un temple de la mère des dieux où la
…
du Rhyndacus. Les médailles les plus
398
’ACavol dans ie texte de Strabon, avait
…
fautive. Les Grecs écrivent aizanoi (1).
…
dont les deux versants donnent naissance
…
d’Aizani. C’est dans les vallées supérieu-
…
épaisse de terre végétale qui produit en
…
franchit le Rhyndacus sur un pont de
…
(2) Les observations que j’ai faites à Aizani
…
La moyenne de ces deux observations, d’a-
…
et qui conserve tant de splendides ves-
…
daient de temps à autre dans les villes
…
d’autres fois, les monuments les plus
…
tayah, située à vingt-sept milles de là.
…
vers le nord-ouest, les ruines d’un
399
ne s’étendait point de ce côté, si, au
…
temple est de 45 mètres, et sa longueur
…
longent les quais n’a point d’égale dans
…
nale de la ville, quoique, d’une conser-
…
de marbre blanc, s’élevait, dans la
…
La partie antérieure de cette terrasse
…
pour les prêtres. C’est cette vaste en-
…
entouré de portiques, Peribolos, qui,
…
aux Grecs ; on la retrouve dans les
…
de la moulure inférieure de la Cella
…
lieu sûr aux citoyens pour y déposer
400
placé au fond de la Cella. La largeur du
…
d’angle de l’occident porte, selon la
…
était disposé delà même manière sur les
…
but était de donner plus de largeur
…
mur de refend donne la distance exacte
…
un très-grand nombre de temples an-
…
pour revêtir la statue de vêtements et
…
entre les deux colonnes, dont les bases
…
La solidité de cette construction au-
…
fatale idée de le démolir d’un seul coup.
…
plit la Cella; on entoura de fagots les
401
résista pas à l’intensité de la chaleur;
…
habitants. En examinant la masse de
…
lent est restée empreinte sur l’intérieur
…
voit pas de vestiges. Or, ces colonnes,
…
pliquerait la chute de la corniche et de
…
fut de la colonne est composé d’une
…
de 8n'7O5 et la hauteur totale de la co-
…
dans aucun autre édifice. Les propor-
…
raient que le fragment trouvé près de
…
est orné de fleurons variés et se trouve
…
l’aplomb de chaque volute.
…
la courbure n’est point un arc de cercle
402
avaient 5m440 de longueur sur 0m680
…
huit inscriptions grecques et latines
…
Il résulte de l’examen des inscriptions
…
lettre n’existe pas sur les murs du
…
notable. Dans le titre de cette lettre,
…
S’il ne parait pas que le champ dédié par les
…
qui se passe dans les villes voisines; et si Met-
…
par les rois, « dicatus à regibus, » dé-
…
de notre très-grand empereur. Après que je
…
J’ai de plus écrit à Hespérus, procurateur im-
…
sacré a Jupiter, afin que de nouvelles contesta-
403
tard des effets de la sagesse de l’empereur ....
…
copie d’une lettre de Quiétus à Hespé-
…
copie de la réponse d’Hespérus à Quié-
…
Copie d’une lettre de Quiétus a Hespérus.
…
enjoint de vous faire connaître la mesure des
…
qu’un seul temple , mats tous les autres
…
prêtre de Jupiter.
…
blics de la Dart de ses concitoyens d’ Ai-
…
choisirait Ces inscriptions se compo-
…
de l’aréopage, d’une autre lettre de
…
de sa construction, quoique les inscrip-
…
Romains, qui n’ont jamais eu de grands
…
assez bien avec l’époque de transition à
404
LES PONTS ET LA VOIE DES TOM-
…
gues dans les grands monuments taillés
…
espèces de caves ; de plus , les barrages
…
sur le défunt. La partie supérieure de
…
inférieure. Il y a seize rangs de gradins,
…
Les gradins de la précinction supé-
…
rayon de l’orclvstre, relevé avec le plus
405
qui n’a vu que les théâtres de l’Europe;
…
partie de l’édifice consacrée aux jeux a
…
de pierres calcaires, et il était revêtu de
…
endroit, a-t-il amené la destruction de
…
sines, et les portes du chœur, qui
…
servaient évidemment pour les jeux de
…
les théâtres antiques les spectateurs ne
…
composât que de sièges pour les specta-
…
de marbre qui est accumulée dans l’or-
…
qui conserve encore une partie de ses
…
pose de sept arcades de 2m 60 de large,
406
ment couvert par les décombres , que
…
on ne voit aucun vestige de construc-
…
sible de m’assurer si le milieu de l’a-
…
pour des courses de chevaux et même
…
L’ancienne Cadi, située aux sources de
…
pulation, Kédiz, bâtie à cheval sur un
…
elle intéressante qu’au point de vue de |
…
forêt de pins et de chênes verts; tout ce
…
que les eaux des pluies ou des neiges
407
de la montagne.
…
les terrains calcaires, et l’on entre dans
…
volcanique dont les lave-s basaltiques
…
on suit la direction jusqu’au bas de la
…
Le seul monument qui attire les re-
…
gne volcanique et pointue sur laquelle
…
de femme vêtue de la stoia, l’autre de
…
naret de la mosquée se dessine sur le
…
la partie orientale de cette province : ce
408
sine de Blaundussur les frontière delà
…
La colline sur laquelle est située l’a-
…
pays, un bas relief de marbre avec deux
…
les murs de la mosquée et des maisons
…
gius prend sa source dans les contre-
…
le fleuve un peu au-dessus de la ville
…
rylœum, est située sur la rive orientale
…
thène (1) et par presque tous les géo-
…
gée de fond en comble. L’empereur
409
Les notices ecclésiastiques donnent à
…
Le voyageur Jouvin de Rochefort
…
La ville de Dorylée est célèbre dans
…
Après avoir éprouvé de grandes pertes
…
camp tomba au pouvoir de Godefroid,
…
sont situés les bazars et les bains; ce
…
EXPLOITATION DE L’ÉCUME DE MER
…
banc d’argile qui suit les ondulations du
410
sans arbres, les habitants ne recueillent
…
trouve de dix à douze mètres en con-
…
contrée en guise de savon dans les bains
…
portée jusqu’en Europe sous le nom de
…
nom d’écume de mer et en minéralogie
…
qui atteignent un pied cube; les blocs
…
et de Russie viennent chercher le
411
u gros. Les Turcs, qui savent si bien
…
rieure du terrain de transition et aux
…
même dans les cartes les plus moder-
…
ROUTE DE SEVRI HISSAR A ESKI
…
descendant le revers de la montagne ,
…
tenter ce passage. Le village de Ak kaia
…
fortes de la Phrygie Épictète ; elle est si-
412
des villes, dit qu’elle prit son nom de
…
time que les inscriptions portant le nom
…
de temps après avoir quitté la vallée des
…
de colonnes. Tout nous dit que Naco-
…
criptions avec le nom de cette ville ont
…
moyen de cet enfoncement de la vallée,
…
inscription portant le uom de Nacoléia
…
Midœum était sur le fleuve Sangarius
413
cées sur la grande route qui de la Pro-
…
Pompée tomba entre les mains des lieu-
…
la notice de Hiéroclès, Midœum fut épis-
…
se voyait le tombeau de Mygdon,chef
…
nom du village, qui signifie, les ruines
…
rius , et à l’est par les terres des Ga-
…
Gaulois. La chute de la monarchie
414
lionne les anciennes habitations des
…
partie de l’habitation. » A cette époque,
…
tine : les Turcs l’ont trouvé trop peu ac-
…
courant presque nord et sud, à l’entrée de
…
parfaitement à la description de Stra-
…
Sangarius, depuis le village de In œughi,
…
Sangarius. Nous les observerons encore,
…
pour établir le culte de Cybèle, la divi-
…
lui inspira un accès de fureur à la suite
415
en Pin, et nous retrouvons les régions
…
de la terre, et c’est en revenant de con-
…
les paysans de l’antique Midœum con-
…
de la monarchie.
…
VALLEE DE NAGOLEIA, TOMBEAUX
…
nombreuses de son goût pour les arts
…
même de leurs inscriptions reste renfer-
…
cher un refuge contre les persécutions
…
repose sur le gazon frais des vallées; il
…
trahit le séjour de l’homme. A certaines
…
voyageur peut seule les découvrir après
416
Les chambres sépulcrales de Seïd
…
niquant les unes avec les autres, et si-
…
cles, elles servent de demeures d’hiver
…
de monuments construits, qu’on puisse
…
pied de laquelle est le château de Bayat,
…
ce sont des sépulcres; les chambres sont
…
les à tailler. A six milles de là, on re-
…
d’été (Yaéla) des habitants de Ivosrew-
…
de Phrygie, tous taillés dans le roc et
…
et dont toutes les hauteurs sont cou-
…
harmonie dans les environs, et i’austère
417
de pierre sur laquelle se continuaient les
…
fac-similé de 1 inscription du monument,
…
ture du mot qui suit le nom de Midas
…
conclure que ce n’est pas le tombeau de
…
connaître le nom phrygien du père de
…
traduction de roi.
…
et paraît dériver de quelque verbe pri-
…
colonel Leake comme un surnom de
418
trouve de trace de construction. Le ro-
…
et les agglomérats de pierre ponce de-
…
sont percées d’une infinité de cellules
…
seule qui se remarque au milieu de ces
…
sur lesquels étaient déposés les corps.
…
À un demi-mille de cet endroit, on
…
complètement. La largeur totale de
…
ainsi que sur tout le rocher environ-
…
tiquité de ces caractères, qui ont la plus
419
les plus archaïques, et surtout avec le
…
plus de six siècles avant J.-C.; et la lan-
…
de Phrygie avant que cet empire fût
…
sible de discerner quelques mots qui
…
les anciens donnaient à la presqu’île
…
mais la signification de ces mots épars
…
que s’il est possible de regarder la ni-
…
l’antiquité qui puisse nous guider sur
…
que village de ce nom dans les envi-
…
tous les caractères de l’art grec. Sa
…
de 3m,7O, et les entre-colonnemcnts la-
420
de longueur dans l’architrave du milieu,
…
cher isolé de toutes parts et qui ren-
…
cédemment. Le nom de Gherdek kaïa
…
renferme une quantité notable de pierre
…
cord avec les règles de l’architecture
…
de sarcophages. Mais en parcourant
…
les Arabes, était usité dès la plus ha
…
les excavations pratiquées dans les l(j
…
isolé sur lequel s’élève une 3°t jj
…
lés de main d'homme pour auginpI'üg
…
de ces bourgs des Phrygiens qui e ' e(i-
421
ig, on peut arriver de plain-
…
bi-ij. . côté de la vallée le tombeau
…
i>i6(i ’ong, on peut arriver de plain-
…
%3utX ^ans l’ntfifndc de l’adoration ,
…
deur, l’une est voûtée, le plafond de l’au-
…
de parapet; cette plate-forme, qui a une
…
de rochers avait certainement été dis-
…
venons de parler, quoique l’escarpement,
…
Sur la même face de rocher ont été
…
Le village de Combett occupe la
…
de Niche à offrandes (1) ; une ouverture
422
sonie ancient monuments, willi inscriptions
…
(3) Cet animal est aussi reproduit dans les
…
<'it forme de cheminée communique
…
le plus remarquable de ce groupe, dé-
…
regardant face à face, et entre les deux
…
de Méduse ne sont plus que de® 1 1$
…
temple; les deux aigles qui sont
…
de la maison de l’Agha de Comb^^e
…
quoique les Turcs aient encore
423
artésien, mais il n’y a point de culture
…
heures de marche à faire jusqu’à Sit-
…
de tabac, et la récolte de la soie est nulle.
…
tente de secouer une peau de bouc, une
…
tjvs.ysteme des jachères, les terrains cul-
…
y; fait une des richesses de cette pro-
…
plaque jusqu’à Smyrne; on a sous les
…
le la présence de l’homme; ce col
424
tissées en forme de claie. Tout ce pays
…
On fait halte au village de Kara keui,
…
plaine où les anciennes armées se sont
…
vent sur une hauteur ; ils sont abandon-
…
dentées, mais les abords de la route
…
pays où les faits de ce genre sont de
…
autre lieu du globe. La nature de ces
…
nous ferons halte dans les principales
…
les villes étaient nombreuses dans cette
…
de toutes les autres est l’antique Prym-
425
de Séid el Ghazi, Séid le Conquérant.
…
tirer des anciennes médailles de Prym-
…
nom de Nacoléia; MM. Bartli et Mord-
…
tant les mots : « Le sénat et le peuple des
…
Strabon ni par Étienne de Byzance;
…
les Seldjoukides y ont ajouté une école,
…
tend de l’est à l’ouest; on y compte
…
et de propreté dues à l’esprit industrieux
426
exclusivement entre les mains des fem-
…
tendue par une traverse de bois ; un cy-
…
(0m,G3 centi.) carré, ainsi un tapis de
…
On voit que c’est une erreur que de
…
quinze mille habitants, dont les deux
…
dernier, un déré bey, du nom de Hadji
…
aucun débris de grand monument, mais
427
étalon de mesures pour les liquides (1).
…
tenait à la juridiction de Synnada.
…
composée d’un grand nombre de cham-
…
On suit, pendant une heure de mar-
…
un composé de laves violâtres englobées
…
Du côté du couchant les tufs sont
…
vert de terres végétales qui sont en par-
…
mur percé de fenêtres. Une de ces
…
de décoration ou de moulure , rien qui
…
était sur la route qui va de Dorylée à
…
fier avec Acmonia le village de Abat
428
traverse une riche plaine de trois milles
…
truit en grands blocs de pierre en assises
…
tres théâtres, était séparée de la cavéa ou
…
cher les ruines de cette dernière place
429
La région méridionale de la Phrygie
…
infinité de tours et de bastions. Aujour-
…
barre le passage; de sorte qu’il y a à
…
mètres, et larges de cinq mètres, sont
…
de son fils Orkhan.
…
vait s’en rapporter à la relation de Paul
…
cas , ne dit pas un mot de ces ruines,
…
porte le nom de Prymnesia (1). Mais on
…
fois des fragments de ce beau marbre
…
et les maisons sont couvertes en ter-
…
passe au milieu de la toison; on frappe
430
plus que par l’extrême bon marché de
…
La culture de l’opium est la grande
…
blanc à fleurs simples. Lorsque les fleurs
…
teau ; on en fait des boules de la gros-
…
dont les effets se sont étendus à plu-
…
série de monticules de même nature ro-
…
Synnada était le chef-lieu de la
…
guerre de Troie vint s’établir en Phry-
…
de cette plaine on trouve le bourg Doci-
…
qui se rapprochent de l’albâtre pour
…
de Forum synnadense (3) ; il traversa
…
chant contre les Gaulois; nous la re-
431
de la description de Sainte-Sophie (1).
…
retrouvions le gissement de ces mar-
…
la plaine de Kara hissar, dont la largeur
…
est donc éloignée de dix-huit milles
…
considérable, car on en retrouve les
…
(2) Table de Peutinger.
…
nique , Parthique, très grand, maître de
…
siècle de notre ère.
…
comme il était jadis, à cause de la gloire de
…
à l’ancienne Synnada ; les carrières que
…
rières d’une distance de trente-cinq
432
à une distance de vingt lieues de la mer.
…
qu’aux ondulations de la moire. Il y a
…
sur le sol cette forme ondulée qui est
…
de mètres dans l’intérieur de la monta-
…
ment couvert par des monceaux de re-
…
laisse aucun doute sur l’identité des car-
…
n’offre pas de résistance à la taille, et
…
par de grandes fissures verticales, dues
…
dans le cœur de la montagne, on en
433
aspect de brèche bien caractérisé; mais
…
grande quantité de ce marbre a été
…
core sur la paroi verticale, des traces
…
de ces morceaux sur place. Les inspec-
…
la roche ou le prix de revient; car j’ai
…
édit de Constantin qui, après l’abolition
…
rient de tout ce qu’ils devaient en na-
…
voyageur qui parcourt ces contrées de
434
communique avec la grande vallée de
…
née il s’en éboule quelque partie. Les
…
Quoique toutes les parties de l’ou-
…
et peu éloignés de l’époque des rois de
…
l’est et au nord, jusqu’au village de
…
Il paraît que le rez-de-chaussée de l’é-
…
A partir de la place de cette inscription, tout
…
en nombre infini; à six kilomètres de
…
arrive au pied de la montagne que cou-
…
les constructions sont byzantines ou
435
leur maison de campagne, faite des ar-
…
nord, on arrive dans la vallée de Ak
…
gissement formant une sorte de cirque
…
trouve un caveau rempli de décombres;
…
bris d’inscriptions témoignent que ce
…
de ia un ruisseau sans nom aujourd’hui,
…
Philomelium était une petite ville de
…
lium. Il ne reste des ruines de l’an-
…
A six milles au nord de la ville est
…
villes de la grande Phrygie ; elle fut
…
tous les renseignements que nous four-
…
d’ichékli, et le grand nombre d’ins-
436
avait reçu le titre de Sébaste, et des
…
tion des jeux augustaux de Rome. Les
…
des inscriptions municipales ) nommé
…
bien déterminées qu’après les recherches
…
au sud par une chaîne de collines r
…
à plusieurs sources dont les eaux s
…
comme une rivière de Carie (1). Pfl ,s,
…
de colonnes et de piédestaux sont rép3^
…
ville nouvelle sur les bords du ir
437
debout; une inscription placée sur la
…
Nicostrate, le plus jeune des fils de Lu-
…
était le père de l’empereur Trajan. Plu-
…
podrome destiné aux courses de che-
…
un odeum ou théâtre de musique. Les
…
soubassements, et les bases des colon-
…
sur des arcades qui prennent naissance
…
hors de leur canal, et ont-elles oblitéré
…
sieu ,Cee, qui embellit la ville de plu-
…
A$o lv'èresqui l’entouraient: les fleuves
…
v°Va >1,),ion sommaire. Presque tous les
438
elle est mentionnée dans l’épître de
…
toutes les vicissitudes de la guerre,
…
de Laodicée, et paraît s’être formée de
…
entourée de murs. Mais au commence-
…
cachet tout particulier; les mosquées
…
ioin de s’accommoder de cette vie en-
…
Carie; il est plus éloigné de Lao'11^
…
Après avoir quitté le village de 1
…
degré de la propriété incrustante-
439
fleuves Asopus etCaprus sont les
…
de e le territoire de Chonos, Colossæ,
…
«6 pe d’étrange; les indigènes appellent
…
W-Spute à la neige, et dont les formes
…
ind6 <lu’elle conserve encore parmi les
…
dès les temps les plus recules, autour
…
ils se sont tous attachés à décrire les
…
qui se forme sans cesse, les monuments,
…
se présente aujourd’hui aux regards de
…
de petits ruisseaux, sur les bords des-
…
de Laodicée, est Hiérapolis. On y voit
…
sur une colline basse de la montagne
…
et (npr3ts calcaires déposés par les eaux,
440
plèthre de circonférence ( 15"',40e). Une
…
ma 1, i 1 ex pire sur le-champ ; 1 es taureaux
…
marqué par les signes de suffocation qui
…
tion, ou s’ils font usage de quelques an-
…
carbonique ; lorsque les eaux ont coulé
…
droits, tombant avec moins de force sur
…
recouverts de stalactites d’une régula-
…
larité. Vers le nord-ouest de la ville, ces
…
dépôts sont plus anciens que ceux de la
441
erré dans toute l’étendue de la colline,
…
qu’il faut bien se garder de confondre
…
quantité de ces eaux, puisqu’il est plus
…
à la vapeur de ce puits meurt incon-
…
déjà de son temps beaucoup perdu de
…
par M. Cockerell entre le théâtre et les
…
cherché. Peut-être depuis le voyage de
…
édifice qui est regardé par les uns
442
de ce monument l’édifice thermal le
…
un trop petit nombre de réactifs pour
…
La situation de la ville est des plus
…
lièrement Hiérapolis, c’était son titre de
…
En montant du côté de l’est, on ob-
…
est éclairé par de petites fenêtres, closes
…
de se durcir à l’air.
…
d’employer dans les monuments des
…
d’une salle de thermes, communique
…
en effet, d’empêcher le dépôt de se for-
…
dans les murailles un grand nombre de
…
cour ornée à ses deux extrémités de
443
les pilastres n’ont jamais été employés
…
ques-uns de ces filts qui se sont courbés
…
quantité d’eau de carrière dans cette
…
comme la cour. La destination de ces
…
En avançant dans l'intérieur de la
…
tance d’en mesurer les ruines d’une
…
à une demi-lieue de là, au pied de la
…
ment difficile de séjourner dans la ville
444
La disposition de la scène du théâtre
…
de colonnes disposés sans ordre. On
…
tiens qui se déclarèrent partisans de la
…
construction est analogue a celle de
…
temple; ce sont ceux que les auciens
…
les au sud de Laodicée; Strabon la
…
Dans son voyage de Phocide il revient
445
sur le même sujet, et ajoute : ces Phry-
…
temps que les Gaulois exerçaient leurs
…
cule, Apollon et Mercure, de l’existence
…
quante kilomètres, au sud de Laodicée,
…
l’orient de l’ancienne Colossæ; c’est au
…
communique avec le Méandre par les
…
de Téféné, sans tenir compte de cette
…
de la Phrygie, antérieure peut être à
…
ciens, vainqueur de Marsyas, ne repré-
…
torique. (2) Les Cabales, les Pisidiens,
…
de ses eaux et les hauts rochers qui pré-
…
premiers combats entre les indigènes
446
la place publique de la ville, et va se je-
…
Xénophon donne sur l’ancien site de
…
y séjourna sept jours, de là on fit vingt
…
dans une colline appelée Celænæ, sur
…
res de flûtes; c’est, dit-on, de ce lac que
…
tait au milieu de la citadelle de Celænæ.
…
vallée de Dombai; le nom d’Aulocrene
…
était gardé par une garnison de mille
…
rent de rendre la place si elle n’était
…
de la ruine de Celænæ; cette ville con-
…
et l’appela Apamée, du nom de sa mère
447
les habitants de Celænæ; Apamée reçut
…
ville de la province d’Asie, et la rivale
…
Apamée fut souvent ravagée par les
…
se jeter dans le Méandre à peu de dis-
…
Tous ces rochers sont de nature cal-
…
carte topographique des plaines de
…
nord-ouest de la ville un grand nom-
…
couverte de poteries, sans doute l’a-
…
Un certain nombre d’inscriptions ont été
448
ville de Phrygie nommée Anava et d’un
…
district d’Apamée de celui de Cibyra;
…
frère. Sous le règne de Néron, Colossæ
…
dit, sous l’influence des prédications de
…
là dans les jardins, et en un théâtre an-
…
une ville du nom de Chonæ fut bâtie
…
Michel ; cet édifice fut brûlé par les
…
QUELQUES VILLES DE LA PHRYGIE
…
que très-peu de vestiges d’antiquités à
…
tans Seldjoukides, on remarque les rui-
…
Olou bounar derbend, le défilé de la
…
taine de Midas » mentionnée par Xé-
…
(i) Hesearches, de., t. II, 184.
449
ville de nombreux fragments d’antiqui-
…
plus orientale de la Phrygie ; son empla-
…
habitants. Les ruines de l’ancienne ville
…
que les Grecs n’ont'pas mis la main à
…
APOLLONIA DE PHRYGIE —
…
milles au sud est d'Apamée, sur la route
…
rang distingué parmi les villes phry-
…
sur l’identité des deux endroits.
…
vue s’étend sur toute la plaine envi-
450
ment à la découverte de monuments
…
nerons dans ce chapitre à suivre les
…
suit que la moyenne de la parasange
…
de l’agneau) qui passe devant Philadel-
…
sur un pont de sept bateaux, et apr
…
florissantes de là Phrygie Parorée ; e g
451
|eaire de la province de Kermian, dont
…
Marche de 30 parasanges, 140 kil.
…
Par '"ne de Midas. Ce lieu est marqué
…
ftaJ^nde plaine voisine de la ville,
…
a Èv Cett® distance. Les habitants de
…
le village de Ketch hissar. La distance
…
porte aujourd’hui le nom de Kulek bo-
…
Sarus au sud de la ville d’Adana, et,
…
à Issus dont les ruines se voient au
…
appelait portes Syriennes , et que les
452
De Sardes :
…
Portes de Cilicie.
…
PRÉCIS DE LA MARCHE d’aLEXAN-
…
Alexandre traverse l’Hellespont, de
…
du Practius. De là il se dirige par Co-
…
lie, prend la ville de Perga. Les dépu-
…
sa dernière bataille dans les plaines
453
Le pays qui reçut le nom de Gallo-
…
sultat la conquête de la Phrygie centrale.
…
de Francs est le terme général sous le-
…
s’est écroulé; les i.atins ont renouvelé
454
nant les villes, portaient la terreur au
…
taire toute la côte de la Propontide,
…
pagnes de l’Asie, dont ils n’étaient sépa-
…
dait sur cette côte. Le bruit de leurs
…
état de défense. La ville d’Alexandria-
…
trembler les peuples amollis et habitués
…
« Les Gaulois demeureront toujours
…
sentement de Nicomède, former aucune
…
l’Illyrie. Les Boiens. souche de cette
…
faisait partie des Volces de la Narbon-
…
plus illustre, et les Romains la com-
455
avait formé son nom de celui de son
…
qui tremblèrent, et offrirent de leur
…
tous les Grecs, les Phrygiens, délicats
…
le nom de’Gallo-Grèce. Toutes les na-
…
gré. Les Trocmiens eurent en partage
…
mencèrent à exciter contre les Gaulois,
…
lois (1), sous prétexte de s’affranchir de
…
les Gau lois se retirèrent au delà du fleuve
…
les conseils d’Annibal et la coopération
…
habile pour décider les princes Attales
…
geant et si avide envers les peuples de
…
et se contenta de leur défendre de faire
…
quis , les attacha définitivement à la for-
…
nants subordonnés au général. Les états
456
d’une forêt de chênes qui leur rappelait
…
règne de douze ans , et ses enfants
…
Pylæmènes, aux fêtes de la dédicace
…
(4) D’après des inscriptions trouvées à
…
quefois de mettre une traduction grec-
…
ces, déclara Ancyre métropole de toute
…
yeux du voyageur les faibles débris de
…
ficielles de la part des archéologues (2).
…
(a) Voyez la description de Pteriinu.
457
Telles sont donc les conséquences des
…
seoir leur puissance sur une des plus
…
des victoires et s’impatronise par les
…
Galates que par la sagesse de ses lois ,
…
rables pour les princes qui réclamaient
…
moins aux panégyries de Pessinunte, et
…
en réalité pesait sur eux.
…
ciles de Nicée et de Chalcédoine. Deux
…
Malgré tant de ravages et de guerres
…
n’est pas le hasard qui les dirigea dans
…
ÉTAT DE L’AGRICULTURE.
…
tiquité il n’y avait pas de meilleurs ber-
458
tie; les Turcomans et les Nomades font
…
laiteuse qui sort de la feuille d’un figuier
…
soit travaillée, servait de vêtement aux
…
veut la traire. Une tunique de coton ou
…
néral de se raser la tête (2) a prévalu
…
chez les Asiatiques, de quelque religion
…
sadeur de Hollande, proposait à son
…
tète rasée et la houppe de cheveux sur le
459
de la belle toison soyeuse des chèvres
…
les environs de la ville de Bey bazar
…
qu’à traîner sur le sol. Les bergers n’ont
…
favorable à la finesse de la toison. Il
…
ployée pour les vêtements des sultanes.
…
renfermée dans un cercle de huit à dix
…
quelques échantillons de ces toisons,
…
de chèvre coûte, à Angora, de douze à
…
contré , à l’est de l’Halys, de nombreux
…
et l’industrie du poil de chèvre dans un
460
état de decadence relativement aux an-
…
mais d’après une remarque de son com-
…
1648 : « La récolte de leur toison se
…
vres chèvres des cris lamentables. Les
…
des animaux n’ait été en usage chez les
…
tonte des brebis aurait passé de Sicile
…
«. Les races d’animaux remarquables
…
nium et de la dynastie des Sedjoukides.
…
le territoire de Sugud, et étendit en-
…
ignore sur quelle base certaine cette
461
jour dans les plaines de la Galatie
…
rencontré du côté de l’ouest un pays qui
…
de contrées de l’Asie antérieure, et que,
…
mann a acheté à Bagdad des gants de
…
les montagnes à l'est de l’Euphrate, au
…
d’Angora. Elle a, comme elle, de gran-
…
de proche en proche vers l’est jusqu’à
…
fes , qui sont connues sous le nom de
…
célèbre matière du schall de poil de
…
mel ou teslik-ketji. On les rencontre
…
noire se tond tous les ans; son poil est
462
encore garnie de ses poils : après quel-
…
tité. Le duvet des chèvres de Syrie est
…
crite sous le nom de chèvres d’Angora :
…
crin, celui de la chèvre gueschi est aussi
…
étranger. Ainsi la laine de chevron ap-
…
fait la richesse de la ville qui lu*
…
de la récolte est filée sur les lieux mêmc ’
…
fixée sur un pied, elle sert quand
…
Les fils de trois brins sont les P* |t
…
valeur ; les plus gros sont vendus
463
Si les chèvres et les moutons offrent
…
plus de soins et de frais que les mou-
…
paient les steppes des environs du lac
…
de Paraissait complètement au dehors
…
S* les ferait reposer pendant une
…
^'rire, du reste, un moyen de con-
…
pourrait retirer de l’introduction
…
Sacr®; les plus jeunes et les plus
…
^t a/8 f?ssés et les haies; aussi, elle
…
<Ÿstes e la végétation de l’Asie : les
464
et pelues. Adroits sur les rochers, et
…
du lieu où le cheval est attaché, de
…
plus soutenue. Les chevaux nourris à
…
méridionale de la province ; aussi les
…
nons de tracer, il nous reste à dire quel-
…
des provinces en proportion de l’amitié
…
primitivement établis les Gaulois. D3’’
…
des carrières de marbre. .
…
bords de l’Halys, tantôt «sauvage®
…
siècles de possession, les Turçs J?
465
itÀkCHE DE MANLIUS PENDANT
…
j\j- a marche de Manlius dans l’Asie
…
k11 lui remit le commandement de
…
de mille fantassins et de deux
…
Elfe remonta le fleuve en longeant les
…
la halte au bord de l’Harpasus, le con-
…
aujourd’hui déserte, et dont les ruines
466
Les habitants de Tabæ de Pisidie,
…
contre les Romains, et attaquèrent en
…
de blé. L’ancienne Tabæ est remplacée
…
tité de Daouas et de Tabæ, cette der-
…
tchaï, qui sépare la Lycie de la Carie..
…
du pays, vint en personne au camp de
…
montagne, et dont les abords sont dé-
…
jetée, et sur i’île se voient les îuines
…
Une petite rivière qui passe à l’est de
…
lage de Tenghir au pied du Rabat dagh,
…
trente kilomètres de Hourzoum (t).
467
geux dont les bords sont couverts de
…
montagneux et difficile sur Mandropolis,
…
les habitants nourrissent encore de nom-
…
halte les caravannes d’Adalia. Les ruines
…
de Adalia.
…
venant sur ses pas, il marcha sur Ter-
…
Termessus était une des villes les
…
qui fut traitée de même ; et, marchant
…
reçut des ambassadeurs de Lisinoë, qui
…
Les environs furent d’abord livrés
…
mée, tout le pays avait été soumis peu de
468
se chargea des malades et de tout le ba-
…
lieu dans la plaine de Sandoukli, ce
…
afin d’éviter les montagnes qui sont au
…
plaine de Sitchanli. Métropolis était du
…
furent livrées au pillage ; les soldats
…
compté cinq heures de marche, 30 kilo-
…
était sur le territoire des Tolistoboiens,
…
était située sur la frontière nord de la
…
mense plaine qui de Seid-el-Ghazi
…
du fleuve, les Galles, prêtres de Cybèle,
…
Pessinunte est le village de Bala hissar.
…
mettre dans le voisinage de Nally khan,
469
en celui de Juliopolis. Manlius trouva
…
côté du nord les rochers étaient coupés
…
plètement privée de bois, aussi les
…
du chauffage au moyen de la fiente des
…
Si les études qui ont été faites dans
…
-’du Sangarius et du site de Pessinunte a
…
Sevri hissar, est de seize heures de
470
tres de population sont épars sur la
…
tance. Le nom de Tricomia n’apparaît
…
elle est donnée par la table de Peutinger
…
sur la grande voie militaire qui tra-
…
de Yerma, où il a retrouvé les sources
…
de l’antique Germa.
…
tout indique dans ces lieux un état de
…
voyageait pendant l’hiver de 1858, 11e
…
et le 13 décembre, la nuit fut de nou-
471
de voir tous ies enfants dressés à re-
…
puis les bords du Sangarius jusqu’à
…
18 kilomètres, au sud de Sevri hissar.
…
village de Tchandir est construit sur la
…
vestiges d’inscriptions et de fragments
…
Au nombre des inscriptions qui exis-
…
d’Orcistus en l’honneur de l’empereur
…
Amorium était située sur la route de
…
dans la province de la Galatie Salutaire.
…
par les hordes musulmanes. Placée sur
…
montagne sur laquelle on avait établi
472
terminé par M. Hamilton au village de
…
seulement les piliers. A l’est de l’acro-
…
marcha sur Angora à la tête de son ar-
…
des valeureux défenseurs de la ville
…
niers furent d’après les ordres du ca-
…
pagne contre les tribus seldjoukides qui
…
émirs de Sevri hissar, qui avaient formé
…
car on n’y observe aucune ruine de mos-
…
un plus célèbre que les autres, et qui a
…
Strabon, et d’après l’avis de plusieurs
473
nom de Bédre tchaï, mais Pline (1) met
…
dans le Sangarius, près de Leucæ. Stra-
…
posé à croire qise celui de ces affluents
…
comme faisant partie de la même pro-
…
Les trois peuples galates, en s’établis-
…
Halys. Tavium fut leur capitale. Les
…
pour montrer que le culte de Cvbèle
474
pleuré par Cybèle, reçut aussi les hon-
…
tomba en Phrygie dans la ville de Pes-
…
lates, Pessinunte avait suivi le sort de
…
culte de la déesse. La vénération qui
…
offrandes que les peuples et les rois de
…
d’égale pour la magnificence de ses
…
qui, d’après les livres sibyllins, devait
…
férente de Tite Live le prodige qui s’ac-
…
déesse de Pessinunte. On députa alors
…
aumônes pour les besoins du temple et
…
phrygienne. Plusieurs peuples de l’an-
…
la pierre de Pessinunte ait porté la
…
séquent tous les caractères d’un aéroli-
475
tJie ; ce qui expliquerait le sentiment de
…
chose qu’une pierre noire de petite di-
…
Héliogabale, ainsi que le feu de Vesta
…
bre dans l’antiquité parle culte de la mère
…
geant les affluents méridionaux , dont
…
tion. Les grands prêtres de ce temple
476
à ccnt cinquante stades, la distance de
…
On aperçoit le château de Sevri hissar
…
de quelques cabanes, dans le hameau de
…
le Sangarius. Les habitants ont donné
…
de dix-huit milles; la ville est dominée
…
dans la plaine de Sevri hissar quantité de
…
Ce hameau est éloigné de trois lieues
…
je fus frappé de l’étendue de terrain
477
rappelle tout ce qui s’est fait de plus
…
ment, le voisinage de Sevri hissar fut,
…
basée sur l’inspection rapide des lieux.
…
Eu descendant de l’acropole, et se di-
…
bâti sur le penchant de la colline ap-
…
ternativement de front et en boutisse,
…
des monceaux de débris et par des exca-
…
reste de ce monument suffit pour mon-
478
temples que les princes asiatiques
…
ment à débiter, avec de mauvais outils,
…
tillons , est de les transformer en pier-
…
siècles s’exécute incessamment dans les
…
pas très-homogène. Les affleurements
…
l’étude de la géologie de ce district.
…
peu probable. Tous les édifices publics
…
chose que les anciennes rues de
…
blocs de marbre d’une couleur plus .'’été
…
Dans toutes les villes antiques, d” u,
…
il semble que la propagation de la »ii'
…
s’élèvent deux stèles ornées de tete
479
CriL°-Us les autres tombeaux et les ins-
…
9Ue i nombre dans les cimetières, ainsi
…
side Pessinunte, d’après les con-
…
tie^Je nom et les titres des Pessinun-
…
ne trouve rien de positif dans
…
par Nicée sur les frontières de la Gallo-
…
fut choqué de l’indifférence des Pes-
…
de la mère des dieux le discours que
…
aujourd’hui une sorte de prospérité.
480
cyre (1). Les Gaulois, au moment de
…
jusqu’à ses vaisseaux ; les Gaulois em-
…
nom, le roi de Macédoine venant de
…
s’étend de l’est à l’ouest. C’est un grand
…
le sort des Romains dans les combats
…
C’est à partir de cette époque que
…
comme capitale romaine. Les trois capi-
…
guste elles reçurent plusieurs bienfaits de
…
mes ; ces ruines sont situées hors de la
…
bris de monuments antiques, des autels
481
du château servait à contenir les ma-
…
taines de mètres au-dessus du niveau de
…
ples. Si l’on en juge par les débris que
…
tables de l’architecture, les colonnes et
…
au premier rang des chefs-d'œuvre de
…
du mur de la cella. La largeur et la
…
La façade du temple était ornée de
…
généralement adoptée par les Romains
…
temple est le même que celui dont les
…
L’intérieur de l’édifice était fort sim-
482
daient des guirlandes de fruits, régnait
…
Dans le mur de la cella, à droite en
…
nant de près ces fenêtres, on voit qu’elles
…
d’enlever les colonnes qui se trouvaient
…
de la chaux, a été enlevé sans scrupule.
…
Ce teipple fut inauguré par les prin-
…
Paléographie, une copie de l’inscription
…
eut lieu aux différents anniversaires de
…
ces fêtes ont eu lieu au moment de la
…
aussi les noms de plusieurs autres prin-
…
possède sur les cérémonies des dédica-
483
de chars et de cavaliers; il a donné également
…
une mesure de cinq boisseaux de blé à chaque
…
Méirodore, iils adoptif de Ménémachus, et de
…
cession, il a donné également, un combat de
…
Séieucus, fils de Philodalius, a donné deux
…
Quintus Gallius, Iils de Marcien. a donné
…
.... ides, fils de Philon, a donné un fes-
…
Pviæmènes, fils de Menas, [a donné] un fes-
…
ples de gladiateurs ; il a fourni [l’huile pendant
…
l’ensemble de leurs cités , c’est encore
…
que les rapports entre Rome et l’Orient
…
les antiquaires, c’est qu’il nous a con-
484
dans les papiers de Daniel Cosson, mar-
…
et souvent, faute de mieux, les avides et
…
En collationnant les copies publiées avec
…
savants de l’Europe; on s’était à peine
…
pour la plupart étaient dans un état de
…
la traduction de l’inscription latine gra-
…
signalai la situation de l’édifice, et il fit
…
fait que confirmer les faits déjà mis en
…
s’établit de bonne heure dans la ville
…
moire de cet empereur, l’inscription grecque
…
A l’extérieur du temple, il existe des ins-
485
de l’épigraphie grecque, tandis qu’on y
…
curieux de comparer ce fait historique
…
à Caboul, les portes du temple deSom-
…
nouveau fondateur d’Ancvre, les Gala-
…
Les médailles et les inscriptions que
…
les Antonins. A cette époque, en Asie
…
De toutes les villes d’Asie, Ancyre
…
posé de bases de colonnes en marbre.
…
Italie, ont été les moyens les plus actifs
…
administratifs de la ville; et ces inscrip-
486
l/i plupart des grandes villes de l’ein*
…
par la pureté de ses mœurs.
…
de la métropole d’Ancyre honorent leur bien-
…
adoptive de la métropole, femme de Julius Se-
…
comme celles de Rome; mais nous ns I
…
dre que douze. Les inscriptions qui
…
Ces inscriptions ont toutes appartenu a
…
petit fragment de statue antique, quels I
…
temples, ou entre les colonnes des por-
…
pontife de la déesse Cérès, honoré plusieurs
487
mètres de la ville ; les autres ont été co-
…
Indépendamment de l’honneur d’une
…
sans doute, de la part des villes, des
…
cetium, et rendant chaque jour de nouveaux
…
monument est enclavé dans les murail-
…
préteur, proconsul de Pont et de Bithynie,
…
evre et à vingt-cinq de Gangra, près du
…
pris le nom de quelque patron romain.
…
peuple, ne fut jamais employée dans les
…
drien ; nommé légat en Asie d’après les rescrits
…
préfet du trésor du temple de Saturne, consul,
…
On peut classer ainsi, d’après les mo-
…
Le Préfet de la distribution des grains.
…
cités comme les ayant exercées plu-
…
que sortie de magistrature.
488
christianisme, de nombreuses églises
…
de jours , car il mourut avant d’arriver
…
état constant de richesse et de prospé-
…
elle eut quelques années de paix, qui
…
contrées, qui étaient devenues les ex-
…
par Key-Kawouss, qui s’empara de la
…
effrayant tableau du désastre de cette
…
emporté par les eaux. L’année sans
489
cette époque, entre les mains des croi-
…
d’Ancyre par les musulmans, fut un
…
Mineure. Les Turcs, sous la conduite
…
tendaient sur toute la côte de la Pro-
…
Broussa étaient entre les mains des
…
mandait la place, de lui ouvrir les por-
…
teresses de l’Asie à l’égal de celle de Van.
…
renfermait les casernes, les magasins et
…
temps de sa grande prospérité, on com-
…
on comptait cent quatre-vingts écoles de
…
tingués, de savants, de poêles et d’hom-
490
Âpres tant de siècles d’occupation
…
néanmoins tous les Européens qui ont
…
nombre de sujets qui ont une barbe
…
constatait que l’idiome national de la
…
effet retrouvé dans les ruines d’Angora
…
le même sort; mais les Ottomans re-
…
peuplées de l’Asie Mineure. Elle doit la
…
Mésopotamie, forme le ciment de ces
…
LA VILLE MODEllNE ET LES HABI-
…
de la terre ; une partie de ces murs a
…
armes hors d’usage. Mais les souter-
491
rains servant de prison pouvaient être
…
sont rangés de longues poutres ser-
…
les criminels.
…
plus de quinze; ils ont presque tous la
…
en grande partie prélevée sur la popu-
…
pouvait avoir quarante-six kilos de pain;
…
La dette de 85,000 piastres, objet de
…
pour cent. Les Turcs et les Grecs doi-
492
blir une manufacture ; les chutes d’eau
…
agent; on exportait alors plus de vingt-
…
plus connu sous le nom de Paliure,
…
clair-semée, les nomades ne comptent
…
de vastes provinces à visiter, nous re-
…
collines couvertes de pins et de cheU>
…
Les petits ruisseaux qui affluent o
…
craie. De temps à autre on voit s pt
…
peaux sont l’objet de la part de L
…
pente de la colline : les couverture®
…
les bœufs de travail sont ferrés c°
…
tagne de Gœuk dagh au nord d A »
493
t' Petite ville d’Istanos, elle change de
…
J"!'ce le commerce du poil de chèvres,
…
surtout parmi les bergers de
…
«t I nJant resté chez les lettrés du pays,
…
^nr°Ut bâti au bord de la rivière, et
…
Wj otine et que les arabes appellent
…
ISTANOS. — LES OPPIDA DES GALA-
…
bien des courses faites sur de vagues
…
ment sur les plateaux élevés des mon-
494
gnes ont été agrandies et disposées de
…
par de nombreuses vallées dans lesquel-
…
Istanos est bâtie à l’entrée de la vallée
…
recherches. Les habitants de la ville
…
dans une muraille de rochers fiul jt
…
s’y tenir caché, son étendue est de
…
En continuant de remonter la va L|i
…
prend naissance sur la pente nom
…
l’on donne à tous les bâtiments 0
…
tie supérieure de la vallée, à ulîe.ol|Vft
495
sous le nom de Kara Viran, les ruines
…
Les habitants d’Angora ont observé
…
de tenter cette excursion, le 26 juillet
…
au point de l’antiquité ou de la géologie ;
…
de faire avant de quitter les environs
…
r°Ute °J)Servé Par M- Hamilton sur la
…
dont les murs ont plus de trois
…
<IUj ?O'nbre de chambres ou de cellules
…
Reconnaître qu’une de ces forte-
…
’^ii|j?e\ et domine la montagne de
496
On compte six heures de marche
…
plaine de Tchibouk ova si dans laquelle
…
sous de cette ville.
…
de chameaux et conduisent les caravanes
…
l’emplacement de quelque ville antique.
…
lius F. de Domnus du bourg des Clos-
…
D’après les extraits que nous avons
…
partie crénelée forme l’enceinte ; les
…
Le château est un amas de construc-
Livre VII: Cappadoce
500
ORIGINE DU ROYAUME DE CAPPA-
…
les hypothèses que nous avons présen-
…
ceux de l’Arabie et de la Syrie supé-
…
par les anciens, et avait perpétué l’idée
…
avec celui de la déesse Anaitis. Strabon
…
mais la vénération de tout le peuple
…
noms asiatiques pour prendre ceux de
…
core lieu chez tous les peuples orien-
…
(3) César, de Bell, civil.
501
déjà parvenus à un très-haut degré de
…
tout des traces de leur action. La popu-
…
les Leuco-Syriens firent cette irruption
…
sions si souvent intervenir les phéno-
…
temps dont les annales sont perdues
…
sol,’ les terres ébranlées ont été empor-
…
phrate à la suite de ses armées. Aucun
…
vilisation. Les exploits de la grande Sé-
…
plateaux élevés de l’Arménie, où elle
…
la partie de la presqu’île qui s’étendait
502
domination sur ces provinces. En effet,
…
les Romains, mus par un pur caprice,
…
Mésopotamie et régnèrent sur la Cappa-
…
cacœna, était bien loin des limites de
…
dance. Les peuples qui avaient du sang
…
le souvenir d’aucune tentative de révolte.
503
les premiers étaient d’origine orientale.
…
été donné par un fils d’Apollon et de
…
aride et sans eau, l’autre couverte de
…
apercevait du haut de la montagne où
…
(3) Const. Porphyrogénète, de Thematibus
…
ces paradis où les rois entretenaient du
…
que dans les montagnes du Farsistan, les
…
on rencontre encore cependant tous les
…
rières d’où on le tire sous la forme, de
…
padoce (2) ; tous les vêtements du peu-
504
Sous de pareils traits, on peut se
…
dres de nature volcanique; les uns
…
chambre, et peu à peu les rochers se
…
chez les Arabes de nos jours, on en
…
le sauvage. Aussi les Romains policés,
…
cusaient les Cappadociens de tous les
…
gne de Rome, le sénat veut lui donner
…
pareil peuple, l’histoire de l’art est une
…
n’a jamais songé à écrire une ligne sur
…
Le grand nombre de langues qui se
505
la confusion de langues qui existait
…
idiomes asiatiques, dut plus d’un de ses
…
tige de la langue cappadocienne sur les
…
ROIS DE CAPPADOCE.
…
Ôn a lieu de s’étonner que Strabon,
…
bliques, soit si laconique sur un pays
…
nouveau relatif au gouvernement de
…
rois de Perse, qui les établirent sous le
…
Tout ce que nous pouvons discerner de
…
à-dire des kiosques ouverts de toutes
…
que les rois du nom d’Ariarathe choi-
506
demeure de plaisance dans file d’É-
…
de la guerre ; mais la chute de Darius
…
impôts de différente nature. Indépen-
…
doce manquait de laine. Cette contra-
…
virons de Konieh.Ne serait-il pas éton-
…
en Cappadoce par les Musulmans, car
…
plus naturel de penser qu’ils n’ont fait
…
nier, il fut mis à mort avec les princi-
…
mort, les autres généraux faisaient la
…
guerres continuelles avec les princes
…
suré à la Cappadoce de longues années
507
de tranquillité, car, pendant les deux
…
Depuis la mort de Pe^’diccas, il s’était
…
temps brillant de l’Asie Mineure. Les
…
au génie de leurs sujets, qui demeurent,
…
se soit déclarée pour les Romains; il
…
qu’Antiochus assiégea la ville de Soan-
…
vesti la citadelle de Soandus, s’empara
…
une vallée qui porte le nom de Soanli
…
commissaire chargé de faire sur Eu-
…
par les deux rois d’une manière qui de-
…
les Romains s’empressèrent d’envoyer
508
setir de son ioyaume, et eut pour suc-
…
intrigue du roi de Syrie Démétrius lui
…
Un de ses fils, ie seul qui échappa à
…
par les rois Ce Pergame, de Pont et de
…
bien plus directe sur les destinées du
…
tous les princes asiatiques : secouru
…
dire que les crimes de tout genre,
…
mais les événements trompèrent soR
…
sceptre, tous les royaumes de l’As,e
…
à la puissance de Rome. $i(
…
11 n’avait pas manqué de prête*
509
■i^in ^‘c?inède. Le fils de sa sœur, le
…
capable de résister à un autre en-
…
%.e r°i de Bithynie appela les Ro-
…
tfio. Mais tant de peines et tant d'in-
…
egalement exclu, et les Romains
…
’^rte çUn Peulde (lu' refuse le don de la
…
son orgueil, continuait les rois de Perse.
…
province distraite de son royaume (1),
…
les habitants avaient été comme les té-
…
ravalent à nos yeux la dignité de
…
porte en Perse la population de la ville
510
voyons-nous pas de nos jours des mil-
…
Ariobarzane II ne fit que monter sur le
…
Malgré toutes les épigrammes que
…
roi Ariobarzane, et usa de son in-
…
Les rapports fréquents qui s’éta-
…
main d’apprécier avec connaissance de
…
du consul, que de le comparer à ces
…
Cicéron fait ailleurs un triste tableau de
…
quatre drachmes. Voilà pourquoi les
…
que les villes étaient rares, puisqu’on
…
chez les Cappadociens. On observe en-
511
feu sacré. Le plus beau de ces pyrées a
…
près du rebord supérieur. Le centre de
…
grec de Jupiter étaient également
…
vinité avait, sous le nom de Men ou de
…
Sébaste. Elle était appelée par les Ro-
…
posée de Cataoniens sujets du roi, était
…
fluence majeure sur les affaires del’État.
…
dotal. Chez les Orientaux, tout ce qui
…
au sud de El Bostan,sur le fleuve Sarus,
…
quille du côté des Romains, le roi de
512
César, venant de terminer la guerre
…
temps de l’an 707 de Rome, 47 av. Jé-
…
héritier, ne fût pas tenté de lui susciter
…
ple de Bellone, qui est à Comana en
…
litre de grand pontife, Lycomède, Bi-
…
lieu dans le temple de Comana de Cap-
…
de Bellone en Cappadoce et non dans
…
(3) Foy. liv. XII,-p. 66, de la traduction
…
« chait du royaume de Pont et des
…
La topographie de ces lieux, mainte-
…
Strabon, qui s’est contenté de dire
…
Les auteurs de la traduction fran-
…
de Comana de Cappadoce, parce
…
ennemis, puisque les incursions de Phar-
513
core d’être étendu de cinq lieues (qua-
…
c’est d’admettre que le culte de cette
…
gouvernement de toutes les affaires re-
…
temple de Pont (1), renouveler ses in-
…
États une partie de la Cilicie et de
…
portant de nombreuses inscriptions en
…
les prétentions du fils aîné d’un grand
…
main; et l’inimitié de Marc-Antoine
…
menta encore les annexes ajoutées par
…
l’île de Rhodes. Les honneurs qu’il ren-
514
de l’empereur, Livia, qui lui avait écrit
…
pour avoir perdu l’esprit, et mourut de
…
de l’empire romain; et, pour apaiser le
…
tième payé au roi serait réduit de moitié.
…
politique. Les promesses de César s’é-
…
travaillaient sur les terres royales
…
à tant de temples, avait publié un dé-
…
tend plus parler de cette puissance sacer-
…
Juifs nombreux que les guerres de Pa-
…
déplorable à l’unité de l’Église.
…
Corbulon fit de grands changements
515
épiscopaux pour les donner aux Ariens,
…
A voir de si nombreux évêques char-
…
nisme se fut'éteint en Asie, et que les
…
démontré que les bijoux de toilette que
…
vie ; il n’en était pas de même des armes.
…
nuelles, le peuple le plus misérable de
…
saint Grégoire de Nazianze voulut met-
…
évêque s’en venge par de nombreuses
…
Le tombeau de Mausole est énorme, mais
…
vous écrirez donc sur moi, assassins des
…
la capitale a été ornée de temples plus
…
de nominations successives.
…
consul de Crète et de Cyrène, légat
516
impérial de la province (èrazp/slat,) de
…
KÈGNE DE CONSTANTIN.
…
s’étendit avec tant de rapidité que, sous
…
de filles, qui fut ruiné par Sapor. Elle
…
tombeau de la sainte s’il pourrait ex-
…
merveilleux des faits. « Lorsque les in-
…
retrouvez tous ici parlant la langue de
…
par les infidèles sur les chrétiens. Tant
…
chrétiens. Les chroniques arménien-
…
religieusement payé par les Arméniens
…
culte des dieux de Rome, avait fait sen-
517
tir aux habitants de Cesarée le poids de.
…
l’exécution de ces innombrables chapelles
…
Les chrétiens bannis et persécutés
…
ples et primitives. C’est l’origine de ces
…
il fallut que, comme à Césarée, les
…
Voilà les chrétiens dont les évêques
…
troupeau de fidèles , qui commençaient
…
métropole de Tyane. Mais tous ces soins
…
affligé les âges précédents : les peuples
…
troupeaux de chevaux célèbres à la
518
surée dans la vie de rapines qu’exer-
…
de Togrul-Bey, s’était emparé d’Erze-
…
bre de somptueux édifices.
…
ble. Un laps de sept siècles n’a pas
519
tistes les principes de Kart qu’ils de-
…
branches de tamarisc, les briques ne
…
pas changé depuis les siècles de Baby-
…
L’etablissement de la domination
…
Les fils de Malek-Schah avaient con-
…
proclamé sultan de Cappadoce, et se
…
fléaux plus redoutables que les armes
…
tale, des plaines de la Phrygie, il donna
520
et toutes leurs richesses, dans les mon-
…
de Croisés périrent dans cette dernière
…
mais reçu les honneurs d’une sépulture
…
transportés autour de la chapelle pri-
…
suré. Les émirs construisaient aans les
…
sance de ces beys des montagnes s’est
…
par les Croisés.
521
obligea Danischmend-Oglou de lever le
…
traverser la Cappadocesans éprouver de
…
considérablement de la soif pendant trois
…
Le même lieu fut, peu de temps
…
Le duc de Bavière et Guillaume,
…
est indiquée par les deux villes de Phi-
…
mettre dans cette foule de cent mille
…
crés par les Turcs, les chrétiens pé-
…
lier. Cette rivière, que les anciens
522
lac peu éloigné de la ville. Érégli, que
…
tan Ala-Eddyn le Seldjoukide , et de
…
les routes sont interceptées. Les eaux
…
Ala-Eddyn Key-Khosrou, frère de
…
encore dans les principales villes de son
…
complètement les représentations d’hom-
…
tiques de l’Asie Mineure ont été con-
…
d’un paon sur l’avant de son calque.
523
de l’adoption du croissant ascendant
…
monuments élevés par les princes seld-
…
commémoratives. Espérons que les fu-
…
(1) De Guignes, Hist. des Huns.
…
le signal de la ruine du pouvoir des
…
aux chrétiens de ces contrées quelques
…
man, fils de Nour-Sofi, avait épousé la
…
et demi sur la Cappadoce. Mais toute
…
coûta peu de monde, s’empare de ces
524
deux villes, et les réduit sous le pouvoir
…
l’orient de l’Asie Mineure nous voyons
…
Ilàlys, les traces de l’art grec sont à peu
…
Mais en revanche les monuments des
…
Le débarquement à Perga de l’a-
…
gieux de l’Asie, et pénètre hardiment
…
la pépinière des esclaves de Rome, ai* g
…
demption. Que de respect, que d
…
mandé à suivre la loi de l’empire- J,
…
les Isaures, ces implacables ennen*1^;.
…
suffit de nom» er Léon l’Isaurien- j-
…
à Lystra, les villes d’Iconium "efJr
525
LES ANACHORÈTES.
…
ti0'aPPer aux dangers de la persécu-
…
hoiries du christianisme par les grands
…
fb|f. eP°que reculée, ravagé par les feux
…
^ntqC’h'ils les’ premiers qui creusè-
…
c’est ce qu’il est difficile de décider;
…
couvrent une surface de pays qui s’é-
…
trième siècle l’objet de pieux souvenirs,
…
qui devint un but de pèlerinage pour les
…
mis parmi les emblèmes chrétiens, mais
526
huait pas moins que le désir de méditer
…
une nouveauté pour les peuples d’O-
…
seule des retraites où vivaient les céno-
…
Saint Jacques de Nisibe vivait couvert
…
les villes les chrétiens se comptaient
527
l'iammait les âmes, ceux mêmes qui
…
impossible de résister à un sentiment
…
convulsions de la nature. Les mon-
…
VOYAGE DE SAINTE HÉLÈNE.
…
rendre de Constantinople à Jérusalem,
…
le couvent de Taxiarque (ra^àp/ou ), et
…
de bâtir une église en ce lieu. En creu-
…
n’est autre chose qu’un morceau de
…
monastère de Taxiarque : les mêmes
528
observer que durant tout le temps de
…
nalogie avec notre bureau de l’enregis-
…
personnage autre que les ayant droit était
…
tres que nous venons de mentionner se
…
à-dire quand les lois de Constantin ont
…
admettre un lieu de sépulture; et si
…
et les âmes ne sont plus à la merci
…
les profondeurs de ses fondements les
529
couvert les corps d’un grand nombre de
…
jours; il rappelle les ordres donnés par
…
ne fut pour les morts aucun préjudice
…
mortelle de ceux qu’on a aimés ou ré-
…
cette idée de l’impureté des corps morts
…
Au jour de l’expiation solennelle, on en
…
(i)Lêon de Modène, Ceremonies des Juifs,
530
mer les corps ne fut jamais ni générale
…
furent aussi usitées chez les premiers
…
sage de lacérer ses vêtements et même
…
On voit aussi dans les cimetières les
…
Une coutume reçue parmi les na-
…
MODES DE SÉPULTURE.
…
d’éclat, nous voyons même pour les
…
comme un usage universel de l’anti-
531
tombeaux de ce genre que nous avons
…
sée une grotte de six me!res environ
…
et de forme circulaire dans la partie
…
quatrième, les parois de la grotte sont
…
d’Urgub sont décorés de portes et de
…
quelque doute sur l’origine chrétienne
…
tombeaux ont été exécutés par les secta-
…
mis aux chrétiens de continuer pour
…
la forme du monument n’avait rien de
…
de déposer dans le cercueil d’un guerrier
…
de repas funèbres.
…
sa descente aux enfers. Les vases de
…
nue du chrétien dans la vie et les usages
…
Nous avons dit que les amulettes
532
sur les monuments funèbres jusqu’au
…
premiers siècles, offrent des sujets de la
…
ITINERAIRE DE TAVIUM A CESARÉE.
…
couru cette route en venant de Youz-
…
Il y avait dans une de ces vallées un
…
tants sans distinction de culte, et la po-
…
parents et son frère héritèrent de son
…
gouvernement de la Porte, qui souleva
…
de Sandjak, et son territoire fut admi-
533
niais les édifices d’utilité publique, les
…
pandu de la pipe, un fils ne se permet-
…
lidjé sou, un des affluents de l’Halys,
…
ensuite dix heures de marche jusqu’à
…
à la culture des céréales. Les tribus Tur-
…
VALLÉE DE L’HALYS.
…
laissé partout des traces grandioses; les
…
Les arches à plein cintre indiquent une
…
grande partie des prismes repose sur
…
remarquable : ici les prismes paraissent
534
et en forme de fuseau : on ne peut mieux
…
tangulaires. Les salles qui sont voi-
…
Dans toutes les maisons modernes de
…
servi à des familles de troglodytes. Il
…
de nos jours, ne servent pas même de
…
celles de certains villages d’Auvergne.
…
dernières habitent les villages de Sar-
…
tale. Dans les régions où elle manque,
…
dont les flancs sont verticaux ; elles sont
…
accotés sur le flanc d'une colline, et les
…
MONASTÈRE DE SURP GARABED ,
535
d’Etchmiazin et de Sis; l’évêque a le
…
rieur contient, outre les églises et les ha-
…
ornées de glands d’argent, de pièces de
…
une large ceinture d’argent, dont les
…
DE SUSP GARABED.
…
là quepourrappeler les monuments cons-
…
La voûte de l’église est en ceintre
…
autre chapelle, qui est à peu près de la
…
sitif de ce monument que nous sommes
…
est le plus important de cette région.
536
possible de village ou de ville dans les
…
L’entrée de l’église s’annonce par un
…
environ de long sur trois mètres de
…
C’est là que se tenaient les catéchu-
…
est voûtée en berceau, les parois sont
…
de l’air plutôt que du jour à la grande
…
ingénieux moyen de ventilation, mais qui
…
existence légale, et était traversé par de
…
aussi de base pour établir que tous les
…
l’on ne saurait supposer que les disci-
…
Nous ne saurions décrire à l’appui de
537
un lit de repos que le solitaire couvrait
…
les historiens ecclésiastiques des pre-
…
tres chrétiens un lieu de sépulture dé-
…
serait possible de la contredire, mais
…
LES PRÉFECTURES DE LA CAPPADOCE,
…
lèrent le partage de l’empire d’Alexan-
…
jonction des districts de Castabala et
…
trième siècle avant notre ère, les Cili-
538
par la préfecture de Garsauritis et au
…
les anciens non-seulement par les
…
entre la Paphlagonie et les Syriens Cap-
…
les contreforts du plateau de Césarée.
…
de Nemcheher pour remonter ensuite
…
de grands blocs dans presque tous les
…
Une ville qui a été saccagée tant de
…
cela de l’intérêt; c’est que, depuis les
539
seldjoukide a été démantelé par les
…
qui, de tout temps, ont désolé la Cap-
…
là depuis les premiers siècles. Josè-
…
tion romaine. La singularité de la po-
…
sentît a faire de cette ville une des-
…
à la capitale le surnom de Césarée (1),
…
de peur que les habitants, se confiant
…
fond en est pierreux et couvert de
540
leur donner l’aspect de véritables val-
…
le nom de gouffres enflammés (1), et de
…
grate de son territoire. Le christia-
…
villes frontières contre les invasions
…
mait une population de quatre cent
…
vint avec le reste de l’armée mettre le
…
temps la ruine de la place, et les Perses
541
naient avec les ermites et les religieux
…
L’empereur prit le prétexte de la
…
qu’elle fût la métropole de la province ;
…
soutint les vrais principes de la foi chré-
…
qui pendant tout le règne de Justinien
…
tème de défense qui est décrit en ces
…
truit d’habitations ; de sorte que les mai-
…
Ce passage de Procope devient en-
…
tagne de Saint-Basile, que les Turcs ap-
…
ligne de forts détachés formait un cir-
…
tivement à la place de celle d’aujour-
542
sous la conduite de Alp-Arslan,
…
de perles; l’historien Mirkhound eD
…
les premiers temps de l’occupation 1 tt>
…
(2) Huitième siècle: les portes
…
par conséquent plus rapprochée de
…
de vue du goût des Cappadociens pour
…
l’emploi qu’ont fait les modernes d’une
…
motif de la disparition de tout ce que
…
placement de l’ancienne ville, quelques
543
MOSQUÉE ET TOMBEAU DE HOUEN.
…
bâtir donne à la ville un aspect de
…
RR cour entourée de portiques don-
…
lonnes, qui abritent les restes d’un
…
vrai, aux exigences de l’ornementation
…
même nombre de côtés. Ce style n’a
…
kides persans n’a pu les conduire à
…
des monuments de Kars, d’Ani et d’Er-
…
3°û loin de ce palais, se présente un
…
R8e, celle de confier les morts à la
…
V8 les Turcs emprunter d’anciens
…
Ntits "e caractère de ces petits monu-
544
saint du nom de Houen ; il était com-
…
Romains ; les arcades sont tant soit peu
…
surhaussé par le moyen de tangentes.
…
qui se trouve au village de Dighour,
…
chrétiens primitifs l’idée de ce mode de
…
nombre de fenêtres.
…
ou turbé est élevée sur un soubassement
…
Les huit faces du tombeau sont for-
…
couronné par une pyramide. A côté de
…
Ce qui représente une population de
…
les anciens comme la plus haute mon-
545
Les gouffres ignés que Strabon si-
…
L’Argée était couvert de forêts où
…
le pays prenaient les précautions néces-
…
ignés, mais aucun de ces soulèvements
…
de substances accumulées a formé une '
…
cela tient aux forces élastiques de l’in-
…
terribles fendent les flancs de la mon-
…
son sommet est composé de basaltes,
…
de ces volcans secondaires ont formé de
…
ignée, quoique les laves de la plaine pa-
…
surface de dix myriarnètres carrés, soit
546
Ingé sou , et trente-six kilomètres de
…
tiers supérieur est couvert de neiges
…
mont Argée est dépourvue de bois, quoi-
…
cette source de richesses. Toutes les
…
de la montagne par des escarpements
…
supérieur du monastère de Zinzidéré
…
d’Endourlouk. Mais les Grecs restaient
…
m’eût permis de tenter l’entreprise. Je
…
ville de Rome. En remontant le ruis-
…
rente, comme les trachytes et les por-
…
collines de basalte noir. Il observa de
547
porphyre. La neige qui, du côté de Cé-
…
se présente comme une suite de cônes,
…
blement de terre.
…
brité de la plaine de Césarée de nom-
…
La rivière de Sarimsak, de l’ail (1), prend
…
Un passage de Strabon relatif à cette
…
erreur qu’il importe de rectifier dans
…
dant en marais et en étangs. Les eaux
548
quelles il se livrait au plaisir de la
…
Strabon, et les observateurs qui ont visité
…
Les sources mêmes du Kara sou ou
…
verts de roseaux,s’étendent à plusieurs
…
de Césarée, on trouve une route pavée
…
Ariarathe, et parcourt un espace de seize-
…
neiges grossit les rivières ; c’est dans ce
…
La petite ville de Ingé sou est à trente-
…
par un ancien bey du nom de Sélim :
549
dans l’antiquité sous le nom de péris-
…
indices de l’art grec, la majeure partie
…
sont sans doute ces tombeaux que les
…
grottes sont les ouvrages des chrétiens.
…
La grande route de Constantinople à
…
dans les terrains vagues formant des
…
bientôt de vue les rochers de pierre
…
plutôt une vaste dépression de terrain ,
…
sevelie entre les flancs verticaux d’un
…
sorte à tant de privations, et cette petite
550
Construite dans le fond de la vallée et
…
européen; et au milieu de ces rues tra-
…
la formation de cette singulière vallée.
…
s’installèrent dans les nombreuses et
…
se voit encore en ruine au-dessus de
…
mière pensée qui vient à l’esprit est de
…
sans interruption sur tous les cônes du
…
fait dans le goût byzantin. Les quatre
…
cheval, dans le genre des arcs de la
…
qui sont ornés de peintures assez bien
551
tain de Cappadoce. Ils ont cherché , au
…
dèles, ils ont multiplié, dans les in-
…
Keurémé, distant de deux lieues en-
…
entés les uns dans les autres, et ayant
…
Les chapelles de Keurémé, éloignées
…
de la ville. La voûte de l’une d’elles
…
donne la bénédiction. On voit sur la
…
Contemplée du sommet d’une de ces
…
Un autre embranchement de ces val-
…
composé d’une trentaine de maisons,
552
enfin quelques inscriptions qui nie fe-
…
debout; elle est formée de blocs de
…
tion des eaux, qu’il est difficile de re-
…
Les seules précautions qu’avaient
…
nombre de ces sépultures : il n’est pas
…
porté une inscription tracée sur un
…
quittant le village de Martchiane, je dis
…
venais de voir. A quelle ville avaient ap-
…
distante de douze lieues en ligne droite ;
…
Un énorme rocher qui s’élève sur un
…
de grottes sépulcrales; celle qui attire
…
cuse aucune de ces deux destinations.
…
très-important de géographie ancienne.
553
plaire que j’avais reçu de l’évêque de
…
Carte chorographique de la grande sa-
…
aux frais des amis.de la race grecque,
…
contre les collines formant les contre-
…
s’accroître par l’effet de l’érosion des
…
par une plate-forme élevée sur laquelle
…
pour lui servir de magasin. La chaux
554
complète de chevaux dans l’intérieur de
…
nence du côté du nord. La base de ses
…
le genre de celle des Grecs. Tous les
…
chès. L’église, bâtie par les soins des
…
tional. Les colonnes du portique sont
…
détails de structure naturelle de eu
…
ner à réunir les sites les plus curie**
…
bitants pour un des endroits les P* f
…
de défendre le voyageur Paul
…
vrages faits de main d’homme, et
…
vient sur ce sujet pour convainc?6 e,
…
« Je n’ai rien à dire de mon voy
555
« Nous partîmes de Hadji-Bechtasch à
…
trâmes dans Avaness, village sur l’Er-
…
qui portoieut un enfant entre les bras,
…
La crainte d’une attaque de la part
…
hiÇrassadeur à la Porte, de s’en infor-
…
')0e j Uibre de ces maisons pyramidales
…
vo|ç et;,it alors de considérer comme des
…
e manifeste de la terreur ins-
556
VILLAGE DE M ARTCHI ANNE.
…
un des cachets de son livre, se retrou-
…
et demi. La nouvelle de cette décou-
…
n’étaient que le fruit de son imagina-
…
tanée de ceux qui renfermaient des *
…
Le hameau de Martchianne est u*‘ |j-
…
une idée de la connexion des den\j te
…
Les cônes du village de Martc»^ pi
…
étroite, ils sont répandus sur une
557
'iç ?-eQt ; ils étaient recouverts de dalles
…
au ve,,s le fond de la vallée est le
…
'l’a l’esprit dans les autres parties; il
…
'agents. Tous les autres ouvrages
…
f%nSeu' l’attention, et suffit pour dé-
…
. ta u,le de l’autre.
…
aruure de la colonne. Cette pla-
…
de l’abaque. Cette colonne a toujours
…
en contre-bas de la colonne est un ou-
…
un plus grand degré de dureté.
…
tion peut être expliquée de plusieurs
…
Cette cour, dont les parois sont tail-
…
sur laquelle est à peine indiquée, dans
…
bre, qui a seulement 2™50 sur 3IU4O de
…
a été renversée par les indigènes en i858.
558
de ciseau remarquable ; les formes
…
fet de mirage. Le nivellement des ter-
…
atteint le point le plus méridional de
…
noyau de population musulmane. Ce
…
de quelques beys.
…
milles de distance entre les deux places ;
…
pu donner un peu de repos à ces con-
559
de Césarée était venu pour assister l’é-
…
Tout en rendant justice à l’esprit de
…
sible du nom de Momoasson, de l’itiné-
…
d’albâtre ou de gypse. Les montagnes
…
et des petits meubles. Les Turcs comme
…
faisait des manches de couteau. La du-
…
de Nemcheher et de Sinason est de dif-
…
cours d’eau; les eaux s’épanchent et se
…
mise dans de grandes trémies percées
560
peu distant de Méléhubi, qui porte le
…
où elles sont connues sous le nom de
…
et laissent sur leurs bords des concré-
…
ment dans le nord de la Perse et dans
…
serte. Ak serai occupe la position de
…
village situé à quatre kilomètres de la
…
Les rivages du lac, que l’on côtoie
…
verse le lac de part en part dans la di-
561
Toutes les pierres qui sont au-dessus
…
sud-est a seize kilomètres environ de
…
du sel, qui se vend sur les marchés du
…
les habitants font-ils un grand usage
…
que le marais de Tatta ressemble aux
…
mont Argée. Les géologues ont reconnu
…
que les habitants n’ont d’autre res-
…
occidentale de la préfecture de Cilicie
…
car il serait au-dessus des forces de cette
…
pour les remplir. Chaque famille pos-
…
connaître l’origine de ce puits : il n’v a
562
n’est pas seulement en ce lieu que les
…
clure de ce fait sur la pente générale
…
moment du tremblement de terre de
…
Le peu de dureté des roches volca-
…
doce, de ne pas s’aventurer dans ces
…
La vallée de Soanli est à douze kilo-
…
qu’au pied de l’Argée; mais les vallées,
…
des eaux; mais la nature de la roche
…
qu’ils sont composés de plusieurs lits
…
multitude de chapelles, de chambres et
…
sait l’emplacement de l’ancienne Soan-
563
point de jonction de deux vallées arro-
…
rigeant vers la branche ouest de la val-
…
autre masse de rocher, on entre dans la
…
sur lequel les Grecs et les Perses fai-
…
viennent les columbaria romains, les
…
ser les corps, comme dans les tombeaux
…
ques-unes de ces grottes ont pu servir
…
position qui s’observe près de Césarée
564
éclairées par des fenêtres de dimension
…
disposition des lieux , il est facile de se
…
fit usage devenait un des moyens les
…
et je campai au milieu des meules de
…
de voir une troupe d’êtres cornus et ar-
…
j’appris bientôt du papas, que les habi-
…
l’imagination des sauvages de la mer
…
rement composée de deux grosses pla-
…
champs, lier les gerbes et les charger
…
petites et sans verroterie. Les femmes
…
ornés de pièces de monnaies, et allongés
…
Les monuments et les traditions man- |
565
pas le résultat d’un caprice de femme,
…
La préfecture de Garsauritis est celle
…
de ce monde qui pouvait y retenir les
…
Les deux principales villes du dis-
…
peut donner aucune indication sur leur
…
est citée en effet par les géographes an-
…
rochers conduit de la vallée de Halvar
…
Les constructeurs de Viran cheher
566
autour : c’est en effet !e genre de sé-
…
de tous ces monuments.
…
seizième siècle, reçut cependant de nou-
…
rang distingué parmi les petites villes
…
tention de l’artiste,
…
Européens, c’est une chose si insolite de
…
troi, ou du moins tant de moyens faciles
…
n’est payé que sur les rentrées qu’il se
…
dans les villes à demi nomades," sur
…
en nature, comme les salines qui sont
…
Le culte, dans les provinces, s’entre-
…
doté de quelques milliers de piastres,
…
suite de la dépréciation de la monnaie,
567
est tombée à la valeur de vingt cen-
…
temps ne reçoit plus de wakoufs nou-
…
traitement de l’État, il fallait, pour les
…
préalablement constitué une rente sur
…
une partie de l’année. Aussi un lac voi-
…
l’hiver n’a pas accumulé sur les monts
…
de la couche terrestre qui recouvre la
…
être sous le lit de l’Halys, et va se pro-
…
depuis Youzgatt jusqu'au delà de Son-
568
d’argile, les eaux souterraines n’éprou-
…
cution de travaux si simples, que de
…
de Tyanitis, lorsqu’on subdivisa le pays
…
dance. Dans tout le reste du pays, les
…
plupart de ces villages sont tout à fait
…
trouve d’ailleurs à quelques lieues de là
…
mée trois cents okes (450 kil. ) de mé-
…
exploitation. Les collines qui bornent
…
fournissent quelques ruisseaux dont les
…
apprend que le riche éleveur de che-
569
lève des chevaux exige trop de soins et
…
lement de 12 kilomètres; on compte
…
Dans l’intérieur de la ville, j’ai égale-
…
quelles je dois bien compter les fati-
…
Le médrécé est bâti sur le même
…
ou portique, avec des colonnes de mar-
…
Pacha, gouverneur de la Caramanie
…
extrémités de l’empire ne se manifeste
…
mence à soupçonner l’esprit de rébel-
570
dans les intérêts du pacha. Les guerres
…
nombre de pachas révoltés pendant plu-
…
volte de Daoud, pacha de Bagdad, en
…
issus du démembrement de l’empire
…
plus intime avec les nations européen-
…
Ce sont les oulémas qui seront toujours
…
Malgré son titre de capitale d’un dis-
…
les restes apparaissent sans doute dans
571
Taurus. Le nom de Dana lui vient, selon
…
colonel Leake avait fixé la position de
…
tout le nom de Tyane. La ville occupe
…
la source ancienne. Les arches voisines
…
(2) E11 Turquie, tous les villages nommés
…
existe aux alentours , les blocs de pierre
…
à côté de l’imposante ruine coule au-
…
tion du nord-est, qui est celle de la
…
bassin de quarante ou cinquante mètres
…
Je n’ai pas visité les grottes sépul-
572
se tait à ce sujet. J’ai lieu de supposer
…
ciproquement, dans les contrées où
…
on ne trouve que de la serpentine et
…
d’usage par les dépôts énormes formés
…
cousse de tremblement de terre. Une
…
lation de Tyane était composée de Grecs.
…
degré d’illustration, par la naissance de
…
Lors des troubles suscités par les
…
titre de colonie romaine, et celui d’Eu-
573
Les géographes modernes attachaient
…
la période des croisades et dans les
…
était éloignée de Tyane de soixante-
…
Aux environs de Tyane il existe deux
…
qui avait frappé les anciens, et que l’art
…
au territoire du temple de Jupiter
…
claré de Méhémet ali, il avait attiré à sa
574
qui prescrivaient aux nomades de bâtir
…
gouverner. On a lieu de s’étonner que
…
permette de nourrir leur bétail.
…
tricts. Il faut lire ces caractères sur les
…
l’avenir desespérancesquel’état actuel de
…
passage du Taurus qui conduit de la Ci-
…
que les anciens ont appelés les Portes
…
pour y établir des fortifications sur les
…
station antique, il suffit de rappeler que
…
déjà saturées par les pluies d'automne,
575
que les villages se trouvent pendant
…
Les communications entre Érégli et
…
de Tyane des provinces d’Isaurie et de
…
pire byzantin, elles ont reçu de nou-
…
naturelle entre les deux provinces.
…
la Cappadoce avec le royaume de Pont.
…
lliéroclès classe de la manière sui-
…
Éparchie de la Cappadoce IIe sous un
576
Éparchie de l'Arménie IIe, II villes.
…
dit d’Arménie, avec les limites des pro-
…
d’Antonin, sur la route de Tavium à Césarée,
…
ques critiques de penser que Camuliana est
…
et l’autre de ces deux villes sont aujourd’hui
…
Métropole de la seconde Arménie.
…
Grégoire de Nazianze. Anebrius, son évê-
…
tinéraire d’Antonin et dans Étienne de By-
Livre VIII: Arménie - Pont - Paphlagonie
577
Le cours de l’Euphrate, qui forme la
…
royaume de Pont (2); au sud elle s’é-
…
occupé ce pays de toute antiquité. Les
…
dans lesquels les jeunes filles des pre-
…
les Grecs un sujet constant de surprise,
…
Les Arméniens furent pendant long-
…
minèrent sur toute l'Asie jusqu’au règne
578
qu’il amenait, déploya une force de six
…
mais à la chute de ce prince ils furent
…
(de Rome; mais, accusé de trahison par
…
ses trésors. La plupart de ces forte-
…
Après les conquêtes de Trajan, la se-
…
Cucusus et Petræa, mais les itinéraires
…
comprenait les villes qui antérieurement
…
Justinien investit de ce gouvernement
579
LES PA.ULIC1ENS.
…
qui avait embrassé avec ardeur les doc-
…
proscrits par la cour de Byzance. Le
…
tion fomentée par les sectes religieuses,
…
par saint Paul. Les Manichéens d’Ar-
…
se répandit dans les provinces situées à
…
sines de celles des Manichéens pour
…
tous les jours de plus grands dévelop-
…
dition contre les Pauliciens qui occu-
…
conquête de l’Arménie et de la Géorgie ;
…
de la ville d’Édesse et fonda la première
580
les Arméniens, maîtres de petites places,
…
assise dans ces contrées, les Arméniens
…
la mer et comprirent la région de la
…
la même hospitalité sous les tentes no-
…
les hautes vallées du Taurus, et toujours
…
les heures de marche que nous avons
…
Itinéraire de Tarse à Trébizonde,
…
Yaèla de Sa-
…
calculée sur la carte
…
que font les routes
…
Le nom de cette ville nous indique
581
renseignement sur la fondation d’Ana-
…
de la plainedu Pyramus. La situation de
…
pour assurer les murailles, comme ceux
…
Les souvenirs delà domination assy-
…
règne de Justin ; l’empereur fit de gran-
…
varza, tantôt Anavarza. La table de
…
trompent de loin le voyageur, qui croit
…
carrées, espacées de trente-cinq mètres
…
L’intérieur de la ville n’est plus au-
…
ville étant entre les mains des princes
…
monumental : c’est un arc de triomphe
582
de large , mais dont l’epaisseur n’est
…
exemple est Unique dans les monuments
…
nés de pilastres conrinthiens cannelés,
…
A l’est de la ville on voit aussi quel-
…
les cheveux en désordre comme des bac-
…
côtés ; il se compose de deuxenèéinteS;
…
de l’édifice ; les peintures sont encore
…
jourd’hui. Sur la tour opposée au fossé
583
car, sauf de rares débris, on ne trouve
…
nom de Sis, mais dans le onzième siècle
…
prime celui de Césarée et qui porte le
…
dans lesquels les étrangers sont reçus
…
La ville de Sis ne renferme pas plus
…
terrasse. On voit encore parmi les restes
…
ITINÉRAIRE DE SIS A MARASCH
…
route tracée dans la montagne ; les ca-
…
donna une demi-douzaine de Crétois
584
rochers. Les montagnes sont couronnées
…
rustique avec des cabanes faites de troncs
…
Le yaëla de Samour bey est situé sur
…
On passe cette rivière sur un pont
…
sont en bon état, mais n’ont rien de ca-
…
les grandes villes. Ici la race armé-
…
Arméniens de ces montagnes ne diffère
…
ment des Turcomans de Dalar ; e’est en
585
et par vaux. Du camp de Dalar on fait
…
comme lieu d’exil de saint Jean Chry-
…
de son exil à Nicomédie, Eudoxie le
…
les pères de l’Église remplissaient leur
…
les marais environnants. Nous sommes
…
On traîna dans un coin de la cabane la
…
il fit déguerpir d’un poulailler les pou-
…
idiote, accroupie presque nue sur un
…
les familles turcomanes.
…
La route de Gœuksunn à Marasch
586
mandés par Bohémond, là ce sont les
…
et offre de magnifiques points de vue.
…
donnée par Étienne de Byzance sous le
…
territoire faisait partie de la troisième
…
Marasch est bâtie sur la pente' sud
…
haba, manteaux ou vestes de laine or-
…
inerce étendu. De beaux et riants ruis-
…
toujours au milieu du jardin ou de la
…
de marche pour arrivera Pelverch, petit
…
avec l’ancienne Perré, qui était située sur
587
les \îllûges de PaVreleii, et, remontant
…
de l’Euphrate n’est pas dans cette ré-
…
capitale. Pline lui donne le nom de Mé-
…
de Mélitène, et de laquelle sortirent
…
environs de la ville. Sous le règne de
…
ment i’aspect de là ville, et en lit, au
…
Malatia tut prise par les Arabes,
…
démantelée, et c’est de cette époque
…
dans les immenses jardins qui s’éten-
…
refuge assuré dans les montagnes. Ces
588
sur la ruine de l’empire seldjoukide. Les
…
queur des princes de Karamanie , vint
…
voir de la Porte, fut on obstacle cons-
…
environ au sud de la ville, dans une
…
tent pas l’ancienne réputation de ferti-
…
mais malgré la douceur de la tempéra-
…
au-dessus du niveau de la mer est un
…
lève au milieu d’une place; les artisans
…
Le caravanséraï désert, les bazars vides
…
lui qui ne considère pas seulement les
589
de plusieurs régiments de Nizam et
…
Les chrétiens forment à peu près le
…
l’inscription que j’ai lue sur la porte ne
…
L’an 6475 (I), indiction première, au mois de
…
de la foi à Mélitène, était chef d’une
…
bellan de l’empereur, qui le premier
…
mort le 6 septembre 252 de J. C.
…
et de saint Euthyme, archimandrite en
…
peut être atteint par les inondations :
…
royaume de Pont.
…
importantes de la contrée, se trouve
590
méniens et de Turcs en nombre à peu
…
mais il faut avouer que les lieux inter-
…
pulation fixe de ce lieu n’est pas ins-
…
d’un petit village bâti sur sa rive, coule
…
(2) Voyez les Itinéraires anciens, par le
…
ÉGUINE. LA VALLÉE DE l’eUPHBATE.
…
dans l’Euphrate, et peu de temps après,
…
Éguine est située sur un plateau qui
…
tance, 1G5 kilomètres, de Sivas et
591
ou pechkir servent aussi de voiles aux
…
souvenir de cette victoire il bâtit la ville
…
et des ravins et couverte de forêts. Ce
…
n’etait pas satisfait, Oreste continua de
…
l’Euphrate. » C’est la Comana de Cap-
…
Procope décrit le cours de l’Euphrate
…
parlé est celle de l’ouest; elle passe par
592
De Gumuch hané on rejoint la route
…
conduisaient les Halizones d’Alybé, de
…
sans doute à la suite des armées de Se-
…
entre les peuples de ces rivages et ceux
…
Égypte. La domination de Sésostris fui
…
leurs rapports avec les populations sé-
…
de la race caucasique.
…
rois d’Assyrie s’étendit sur la côte de la
…
s’emparèrent de la Leucosyrie. Ces
…
rent principalement dans la région de
593
d’imposants vestiges de leur séjour. On
…
monuments égyptiens etde ceux de F As-
…
guerre entre Cyaxare et les Lydiens (2).
…
royaume, il reçut le surnom de Ctistès.
…
nie, dans le fort de Cimiata ; c’est de la
…
tie nouvelle, à laquelle se soumirent les
…
de race syrienne. Non-seulement ils se-
…
goniens a des rois descendants de Py-
…
fils de Pharnace (1) ; ensuite ce royaume
…
de l’Arménie, et par l’iris, qui sort des
594
Polémon, fils de cette princesse (1) ;
…
ville de Thémiscyre, et dans les terres
…
Tous les écrivains qui ont parlé de
…
tier où étaient la forteresse et les palais.
…
lonie de Sinope ; elle reçut un nouveau
…
des huit mille six cents héros, reste de
…
de l’hospitalité en faisant connaître à
…
tuelle de Trébizonde tient au grand
…
réduite à l’état de simple village si elle
595
Les querelles des successeurs d’A-
…
ils lui laissèrent le titre de ville libre.
…
des rochers de Guzel serai, où est au-
…
enceinte de muraille semblait défier
…
ter à Trébizonde des travaux de défense
…
contient les noms de tous les peuples
…
/ROYAUME DE TREBIZONDE.
…
David Comnène,troisième fils de Jean,
596
et envoyé à Constantiîïople, et de là à
…
lieu de résidence d’un pacha à trois
…
au bord de la mer, il n’y a de ce côté
…
osé s’installer dans les murs de ce châ-
…
lève à l’horizon est le tombeau de Da-
…
deux établissements de bains et le pa-
…
fort intérieur au moyen de deux portes
…
Les chrétiens sont divisés en huit
…
Imaret Djami si, est construite sur le
…
centre de la ville, est une église byzantine
…
La longueur totale de l’église, y com-
597
sion de l’édifice est un peu plus petite.
…
cription de cette église, qui pour être
…
l’intérieur duquel sont de nombreux ta-
…
à quel prince est due la construction de
…
Le couvent de la Mère de Dieu, Pa-
…
surface du rocher est couverte de stuc
…
ticulièrement l’attention par les inscrip-
…
tère. Son costume est de la plus grande
…
portrait de femme portant d’une main
598
conçue : Théodora, par la grâce de
…
prouvent qu’à cette époque les arts
…
par les Grees. Il est certain que les cen-
…
noms portaient ces villes du temps de
…
bre de courtisanes, dont la plupart ap-
…
voir des Romains. Dorylaus, parent de
…
Bérose, dans le troisième livre de l’his-
599
Antiochus, obligé de payer aux Ro-
…
naïtis à Concobar, Kanguevar, près de
…
les Saces ayant fait une irruption dans le
…
de Byzance confirme ce fait au mot Zéla,
…
colonnes la figure de la déesse sous la
…
de loin; c’était la même divinité que l’A-
600
sa part. Avecune parcelle de son butin, il
…
de trois cents ans.
…
donc pas s’étonner de voir des figures
…
Anaïtis. Les Cappadociens et les peuples
…
Artaxerxe l’idée de consacrer une statue
…
culés jusqu’à celui de Justinien, qui
…
nové ; tous les dieux de l’Asie antérieure
…
lièrement honorée par les Mèdes; aussi
…
Les géographes qui ont identifié la
601
c’est tout ce qui reste de ce célèbre
…
de Guemenek est un énorme bloc de
…
époque il appartient ; les chrétiens du
…
Il n’y a pas de ville plus extraordinaire
…
tes les toitures sont en terrasses lui
…
ville s’étend sur la croupe de ces ro-
…
Les Pères de l’Église, et surtout Eusèbe,
…
de cuivre deKeban Maden : le métal est
…
de cuivre, chaudrons, braseros et vases
…
bitants de l’antique Comana.
602
L’Iris, prenant sa source dans les
…
reçoit les eaux du fleuve Scylax, Tcho-
…
le Lycus, qui vient de l’Arménie, il tra-
…
Turkal est un bourg de deux ou
…
le cachet d’une haute antiquité. Les
…
qu’il est impossible de descendre plus
…
était une ancienne résidence des rois de
…
fallu une échelle et des cordes, les ha-
…
l’ouest de Turkal ; on passe l’iris sur un
…
rappelle les grandes foires religieuses
603
vallées environnantes, les murailles sont
…
seau qui coule près de la ville et dont
…
centres les plus célébrés du culte d’A-
…
située sur un tertre naturel qui paraît
…
champ de bataille où eut lieu cette ac-
…
l’avantage de la position des troupes
…
tails sur les monuments célèbres; nous
…
Zéla était le chef-lieu de la région
604
et leur nom oublié. Sous les Comnènes de
…
écoles qui sont encore l’ornement de la
…
les habitants des campagnes massacrés.
…
d’établir une base de comparaison. On
…
grand prêtre, peut-être d’un de ces pon-
…
rattacher les murailles d’enceinte ; elles
…
faubourgs de la ville. De cette gorge aux
…
à aucune force de le franchir.
…
l’un conduit de la ville au faubourg;
…
dont l’entrée n’a pas vingt mètres de lar-
605
geur, et qui est dominé de part et d’autre
…
par les hauts rochers de l’Acropole, pa-
…
amoureux de la fille d’un prince d’A-
…
sant. Les principaux habitants n’y font
…
l’acbopole et les tombeaux des
…
traverse l’iris sur un pont de pierre
…
suivre la ligne de circonvallation et
606
pas du monument voisin; les tombeaux
…
façade est creusée avec plus de soin, et
…
est impossible de reconnaître quelle fut
…
opinion est appuyée chez lui sur l’exa-
…
plus bas, ce qui complète le nombre de
…
aussi les habitants appellent-ils ce tom-
…
ÏIIS APX1EPEÏS « grand prêtre de Cy-
…
que tous les anciens châteaux de
…
suit la direction de l’est; celle-ci n’est
…
dit à l’aide de flambeaux, et, à une pro-
…
était en partie comblé par les décom-
607
une solide maçonnerie; les murs du bas-
…
environ de longueur ou quatre-vingt-
…
expulsé les Saces de l’Asie, étendit ses
…
dans les montagnes à l’est de l’Halys,
…
pole de Babylone; il y a aussi Pteria
…
dit de Ptérium, il n’est pas étonnant
…
lage turc est devenu célèbre parmi les
…
paraît hors de discussion et le nom de
…
des ruines de cette ville telles que nous
608
ce qui a été écrit sur ces monuments,
…
de découvertes dont nul ne pouvait
…
Le village de Boghaz keuï est situé
…
milles de circuit. Différents mamelons
…
sur la croupe de la colline inférieure ;
…
i 10 mètres de large sur 140 de longueur.
…
esplanade, se trouve une disposition de
…
deux assises de ce vaste édifice, qui
…
aucune conjecture sur son ordonnance
609
leur, et de cinq à six mètres de lon-
…
qui ont de deux à trois mètres de lar-
…
de distance en distance par des trous
…
rappelle les temples construits par les
…
les pierres colossales du temple de Pté-
…
Continuant l’examen de ces lieux,
…
guide refusant obstinément de me pré-
610
tres traces de ruines , et notamment de
…
même est dans un parfait état de con-
…
de sculpture ni d’ornement.
…
En continuant de monter sur le
…
fense inférieure de la ville. Néanmoins,
…
partie supérieure étaient les habitations
…
était au sud de la ville. Toute cette par-
…
mètres de longueur et est inclinée de
…
muraille est tracé dans le glacis, de
…
deux têtes de lions qui ont quatre-vingt-
…
tie supérieure de cette porte était cou-
…
A trente mètres environ, à droite de
…
forme d’ogive, et les pierres sont posées
611
l’existence de ces ruines devint encore
…
de ces peuples.
…
salle presque rectangulaire, et sur les
…
relevée (2). Un.peu en avant de ce groupe,
…
était couvert d’une vaste croûte de li-
…
taires de la part des habitants.
…
damment de la tunique, d’un manteau
…
le même costume que les figures du
…
de la massue ; un autre porte une faux,
…
de deux figures monstrueuses . vues de
…
fond de la salle.
612
crits. Un homme barbu, coiffé de la cyr-
…
tracé à la gauche de l’enceinte ; c’est
…
costume, et qui paraissent conduire les
…
les deux processions retracées à droite
…
échange de présents avec une femme
…
de son coude, et qui paraît venir de der-
…
parmi les femmes. Quoiqu’on n'observe
…
elles s’avancent en marchant sur des
…
le même costume que les autres figu-
613
monté sur un lion, mais il est d’une
…
gieux, célèbre dans les annales de ces
…
mence que vers la seconde moitié de la
…
marchant sur un lion comme dans le
…
sujets se compose de deux figures, as-
…
de largeur, les parois en sont aplanies
…
avant-corps de lions grossièrement scul-
…
que cet ensemble barbare, composé de
…
qui partageait les autels de la déesse
…
le pontife-roi. Le bras gauche de cette
614
préside à la fécondation de la nature.
…
plusieurs têtes de petite dimension qui
…
et qui ne peuvent avoir servi de tom-
…
divinités révérées chez les peuples mèdes
…
brement de l’armée de Xerxès (1),
…
avec l’histoire de ces peuples. Hérodote
…
dans un repas où ils les enivrèrent. C’est
…
Le passage de Strabon est plus ex-
…
(3) Les Saces sont des Scythes Amyrgiens:
615
le pays de ces Cappadociens voisins du
…
une colline qu’ils entourèrent de murs
…
rent la fête annuelle dite les Sacæa,
…
dans tous les lieux où il se trouve un
…
On retrouve dans cette suite de bas-
…
porté dans ces contrées, le tableau de
…
est le même. 11 est possible que les cé-
…
est alors d’usage que les esclaves com-
…
Le sujet traité dans le bas-relief de
…
Assyrien, relatif au culte des dieux de
616
position de Ptérium et celle de Tavium,
…
puis tant de siècles n’est pas le seul
…
Les murs, qui forment une terrasse
…
comparé à celui de Persépolis.
…
doit pasnon plus s’étonner de voir des
…
lonies sur le Pont-Euxin. Les Colches
…
s’étonner de trouver chez les artistes
…
égyptien, le tombeau de Dikili tasch,
617
heures de marche au nord de Youz-
…
pulcrale taillée dans le roc ; le stvle de
…
royaume de Pont et ensuite à laGala-
…
de chèvres qui se trouvaient dans le
…
Comnène, qui venait de reconquérir
…
gère et capricieuse, et qui datent de
…
kelib, surla rivegauche de l’Halys.Dans
…
très-ruiné. Déjotare, fils de Castor, fai-
…
tuée sur le bord du Ly eus. Cette ville n’est
…
dernière ville n’a fait que changer de
…
plaine a donné de tout temps une grande
…
dans le style de l’architecture des Seld-
618
(aujourd’hui Tach ova si, la plaine de
…
tant emparé de cette ville, lui donna le
…
au pied de la roche.
…
Euxin est, pour les navires, dangereuse
…
trée de l’Asie n’est plus pauvre en
…
nous hâter de retourner dans les pro-
…
Arrien cite la place de Hermonassa,
…
dans l’antiquité une place de peu d’im-
619
maisons turques et de cent maisons
…
l’ouest de Tripolis, marque l’emplace-
…
d’hui Kerasunt ada si, à trente stades de
…
jourd’hui cet îlot est couvert de brous-
…
grand-père de Mithridate, qui lui donna
…
railles de la ville grecque; la plupart
…
les beaux temps de l’architecture an-
…
abondants aux environs de Kerasunt;
…
marque la place de l’ancienne Polémon,
…
à trente-six kilomètres à l’ouest de
…
encore aboiudant en mines de fer. et les
…
face la plus abrupte de la roche; il est
620
quand il parle de l’exploitation de l’or :
…
En vain Lucullus, maître de la place,
…
le tableau que fait Plutarque de la des-
…
nexée au royaume de Pont. Sous l'empire
…
botage de la mer Noire, aussi les ba-
…
détail les ruines de l’ancienne Amisus.
621
port qui sert de débarcadère pour la ville
…
quatre-vingt-dix stades de l’Halys et qui
…
latie (1). Les auteurs anciens ne sont
…
et au Pont : telles était les populations
…
comme alliés les États plus puissants;
…
par les colonies grecques; le reste du pays
…
Le territoire de la Paphlagonie n’est
…
min est très-praticable le long de la côte,
…
doute l’emplacement de Zalecus. Entre
622
La situation exceptionnelle de la pres-
…
la ville de Sinope » (2). La ville grecque
…
mination des rois de Pont jusqu’à la
…
vice de la mer Noire; ses environs sont
…
les éléments nécessaires à une popula-
…
de Sinope. Elle avait un port qui fut
…
quelque désœuvré. La position de cette
…
le lieu de naissance de cet imposteur,
…
de la ville moderne d’Ineboli.
…
de Lysimaque, et sous celle d’Ariobar-
623
zane, fils de Mithridate. Prise par Tria-
…
mation. Les Génois y établirent des
…
d’hui Bartoun tchaï; en général les
…
pour en tirer le chien Cerbère. Les ha-
…
les attributs étaient d’or.
…
appela Cléarque, un de ses citoyens, qui,
…
pouvoir suprême fut exercé de la sorte
…
roi de Pont, et avec les républiques de
…
après la défaite du roi de Pont, Lucul-
…
fut alors annexée à la province de Pont.
…
avait, au dire des anciens, plus de deux
Livre IX: Carie - Lycaonie - Isaurie
625
Le territoire qui s’étend de la rive gau-
…
les plus guerrières et les plus turbulentes
…
duite de Car, et se rendit maîtresse de
…
ditions helléniques, les Cariens passè-
…
couru les mers sous les ordres de ce roi,
…
étendue jusqu’au royaume de Lydie.
…
sélis de Mylasa, et pour le récompenser
…
étrangers un accueil favorable, et les
…
le fondateur d’Hydrias. Les Lyciens,
626
quée de diverses manières par les his-
…
langue avaient beaucoup de mots com-
…
lambeaux de phrases dans les commen-
…
retrouvons tant de vestiges en Lyçie (2) ;
…
Étienne de Byzance nous a conservé
…
tant de contradictions.
…
On éprouverait de grandes difficultés
…
gines de ce peuple, la plupart des au-
…
qu’ils se trouvaient au nombre de ces
…
longtemps avant laguerre.de Troie; et
…
rent les Doriens à conquérir le promon-
…
para de l’îlede Rhodes; et le troisième,
…
certaine différence entre les Cariens et
627
les Léléges proprement dits, c’est que
…
ROIS ET DYNASTES DE CARIE.
…
pes, était parvenu à soumettre les Ca-
…
s’étendait sur les îles voisines.
…
nus, qui avait commandé les armées
…
tes de la Carie, et porta la guerre chez
…
mourut la quatrième année de la 106e
…
de temps, et mourut du chagrin qu’elle
628
chercha à donner plus de force à son
…
temps à marcher contre les cantons
…
les Rhodiens en occupèrent toute la
…
ches , forment tantôt de hautes mu-
…
caps et des golfes où toutes les nations
…
de monuments dont l’origine puisse
…
Stratonicée, d’Alabande, d’Alinda et de
…
de Carie, Halicarnasse, est située au
…
d’abord partie de la confédération do-
…
dans les fêtes célébrées en l’honneur
…
port secret et du palais de Mausole,
…
situé au fond du golfe de Boudroum,
629
dit en forme de théâtre. Dans la partie
…
mains du célèbre Léocharès. Sur le som-
…
soit qu’il regardât la mer, soit que de
…
et le milieu de la courbe du port ( per
…
sont-ce les deux points auxquels s’atta-
…
dans la ville turque; car, pour les an-
…
ment sur lequel s’élève le château ac-
…
on peut sans beaucoup de difficulté ima-
…
ments de terrain; mais si l’on veut
630
des chapiteaux ioniques de différentes
…
grec qui a été décrite par M. de Choi-
…
postérieure de la frise ; ce qui n’a pas
…
s’empara de la ville, n’est pas conservée
…
aucun cas , espérer de trouver des mo-
…
tombeau comme l’objet de l’admiration
…
beau marbre et orné défigurés de guer-
…
de Mausole, roi d’Halicarnasse. 11 est
…
temps d’Auguste, décrit en peu de mots
…
en Carie est haut de cent quatre-vingts
…
permettaient bien de supposer que le
…
(4) Vibius Sequester, de Gentibus, p. 37,
631
Le passage de Pline (1) est ainsi
…
ce tombeau à la mémoire de son époux,
…
était composée de vingt-quatre gradins,
…
Quatremère de Quincy, i834, Essai de
…
cryphe') de la reine Artémise;
…
rait de quatre cent onze pieds, ce qui
…
ficulté d’ajuster trente-six colonnes sur
…
intelligence de la topographie ancienne
…
frise était ornée de combats entre les
…
Ces gradins de marbre étaient entés
…
statue de Mausole, la roue du char et
632
lancé au galop. Les jambes du cavalier
…
dans le soubassement de l’édifice. Dans
…
Les auteurs des découvertes faites
…
de terre, et que l’enlèvement des maté-
…
de la Tourette, ne dit pas, en effet, que
…
La côte de la Carie s’étend depuis
…
fut en vain cherché par les explorateurs
…
logique. Il était important de détermi-
…
sur l'emplacement de la ville, nous 11e
…
bey de Melasso; aujourd’hui ces ruines
633
ni de culture ne s’offrait à nos regards.
…
dangereux de rester de nuit dans ces
…
de viande fraîche pour l’équipage. Pour
…
parut pour dresser procès-verbal. Les
…
immense de poissons, attirés par les
…
Les habitants d’Iassus (1) tiraient la
…
que jamais coup de filet des Grecs ait
…
jour à lassus, les matelots renouvelaient
…
tion; l’air de la mer empêchant les li-
…
âge, les Vénitiens ou les Génois ayant
634
avait négligé de ménager un pomérium
…
Les tours sont massives jusqu’au
…
de deux à quatre mètres ; elle est moin-
…
et celui de l’est est encore complet. Sa
…
les deux môles est de 50 mètres. Sur la
…
analemme), les- groupes de gradins ( en latin
…
plus moderne que le reste de l’édifice.
…
Le théâtre est établi sur un terrain
…
chambres latérales. Non loin de là est
635
terrée sous des moncéaux de sable, il
…
du goudron et des étoupes dont les
…
pierres de schiste, et d’une construction
…
Sarmatique, Dioclès a dédié les deux exèdres
…
encore quelques arcades. Toutes les
…
la mer. Près de la source s’élève un
…
beau de Mausole.
…
suite non interrompue de collines qui
636
par l’invasion ionienne, les Léléges
…
Les sépultures, portant le caractère
…
le sol. 11 y en a de différentes dimen-
…
Le second genre de sépultures, qui
…
La troisième classe de monuments
…
était alors décoré de peintures. Je n’v
…
Aux environs de la Nécropole s’élè-
…
trace. La hauteur de cette muraille va-
637
du sol, elle est défendue de distance en
…
Toutes les tours sont tournées vers
…
agreste et primitive où la présence de
…
pierre taillée. Il est donc impossible de
…
pace de mille mètres, j’ai compté dix-
…
mur. A côté de la porte sont des ou-
…
duisaient sur les plates-formes, et enfin
…
mander des renseignements sur le par-
…
ville dix stades de circonférence (2).
…
Vainement j’avais cherché de quel côté
638
?iws, au fond duquel était la ville de
…
n’est pas tout à fait d’accord sur son
…
avaient été déjà reconnues dans les
…
navire une barque” grecque sortant de
…
lus me rendre à Mélasso. Je sortis de
…
pendant deux jours de marche. Elle
…
sur la côte une ville antique dont les
…
ville antique est située non loin de sa-
…
trouve encore des amarres de navires.
…
pluie (1). Près de Bargylia est le temple
…
mais à une lieue de là, dans la plaine
…
tent le bourg de Cyndie. Bargylia est
…
guerre de Carie, et son armée y passa
…
était telle, que je ne pouvais douter de
639
Son identité. Depuis ce temps les relè-
…
composée d’abord de six villes, Cnide,
…
assemblées, imitées de celles de la con-
…
vasion en Carie, les Cnidiens, se sen-
…
voulait couper était de cinq stades,
…
mais complètement composé de roches.
…
nu et rocailleux; elle ne vivait que de
…
Les murailles qui entourent la ville
…
même année les deux flottes lacédémo-
640
ment de la domination étrangère, et nous
…
chique d’Halicarnasse, les Cnidiens
…
vaient pas donner la gloire de leur ville.
…
adorée sous les noms de Dorienne,
…
teurs de cette statue :
…
Sous les épais timbrages se trouvent des
…
siés des beautés de la nature, nous en-
641
tement la forme délicate de chaque
…
extrémité (amphiprostyle ) (1), de sorte
…
de manifestera plusieurs reprises notre
…
de chose pour le rétablir d’une manière
…
de Lucien, dont j’ai cité un extrait,
…
d’Apollonius, que de son temps la
…
de Cos avec la goélette la Mésange,
…
(2) Lucien. De Amoribus, ch. XI, 18.
…
mer les avirons pour entrer dans le
…
l’isthme qui séparait les deux ports. On
…
for me d’un hexagone irrégulier ; les quais
…
d’une seule montagne calcaire, et sur
…
caractéristique de la plus haute anti-
642
genre de construction a été pratiqué sur
…
suit toutes les sinuosités de la mon-
…
crête de Pile. Le terrain, qui dans l’in-
…
Sur la deuxième terrasse du côté du
…
nes a été composée de onze assises, en y com-
…
périeure, il est percé de quatre trous qui
…
montée de son linteau de pierre. La terrasse
…
de l’enceinte du Panionium que j’ai observé
…
de la contrée, et qui conserve encore
643
de Ninoë se rapporte en effet à celui de
…
l’enceinte même de la ville. De magni-
…
seul de Vénus, de laquelle la maison
…
aussi, dans une série de plusieurs siè-
…
lesquelles les monuments d’épigraphie
…
La plupart des inscriptions qui datent
…
condition de ne pas perdre leur nom.
…
fut connue par les anciens. Lorsque la
…
matériaux, les innombrables monu-
644
rentes sur le parement des murs, nul
…
des autres ouvrages, a reconstruit les murailles,
…
Les travaux de la porte ont été renouvelés
…
La porte de Constance est bâtie en
…
d’ouverture 2m,60c, et de hauteur
…
de Rome. Les communes ne faisaient
…
que tous les autres dieux , a échappé
…
pour ces temps de barbarie, il a pris la
…
pour cela que démolir les colonnes du
645
des temps, et le temple de Vénus se
…
plus petit débris de la frise ni des fron-
…
de l’hémicycle, et du côté où fut l’en-
…
moyenne est donc de 2nl,60c; et si
…
chus, Diogène Philocæsar, et Ammias , lils de
…
les statues qui décoraient l’enceinte sa-
…
une niche décorée de pilastres. Il n’y
…
ménos. Il y a encore , en avant de cet
…
peu commune, diffère de ceux que j’ai
646
LES ÉDIFICES PUBLICS.
…
quel étaient installés les bureaux de
…
par les inscriptions conservées dans la
…
comme propriétés de mosquées.
…
temple ; nous croyons en trouver les
…
paux fragments sont couchés sur le
…
les monuments antiques, et qui cepen-
…
Les colonnes du portique ont de hau-
…
un grand rectangle de plus de 100 mè-
…
de cinq à six colonnes contiguës. Il
…
peu de chose près contemporain du
…
nement. Le fût de la colonne est can-
…
d’un groupe de maisons modernes qui
…
y voit aussi les deux murs sur lesquels
…
A la déesse Vénus, aux Dieux augustes : [les
647
lossus, ami de la gloire et de la patrie. Ayant
…
ouest de la ville : la conservation de ce
…
trense à Rome : c’est de se trouver
…
du temps de la décadence. Je ne men-
…
Quelques inscriptions mentionnent le
…
de Glycon. Le tombeau entier se com-
…
de la famille d’Adraste, d’y ensevelir
…
ensevelir ou d’exhumer les susnommés; dans
…
mérotus, et Auréliana Hédémis , la mère de
…
grand nombre de villes dont la plupart
…
Les Pedasiens furent le seul peuple de
648
soumis (1). Les Pédasiens ne restèrent
…
manifestait toutes les fois que la ville
…
Syagela, ville lélége, voisine de Peda-
…
de ces deux villes n’a pas été déter-
…
conserva toujours sa suprématie sur les
…
D’autres ruines de peu d’importance
…
On peut encore observer sur une col-
…
est ornée de deux colonnes à chapiteaux
…
simplifiée du tombeau de Mausole.
…
tée de Lydie en Carie et dédiée à ce
649
les vestiges d’un théâtre et de plusieurs
…
lui donna le nom de sa femme Strato-
…
de cette dernière ville, et non loin de la
…
Étienne de Byzance fait dériver le nom
…
Le territoire de la Carie coupé par
…
de l’empire byzantin la Carie échut à
…
ILE DE COS.
…
située à la pointe nord-est de l’île, et une
…
blissements doriens sur la côte d’Asie,
…
et cette amitié dura jusqu’à la fin de
650
au cap Termerium de Carie.
…
qui viennent du côté de la mer. L’île
…
compensation la remise d’un tribut de
…
de cet homme illustre est presque le
…
Christ : il aurait plus de deux mille
…
Hippocrate entouré de disciples, et
…
pris qu’à deux lieues de la ville il exis-
…
Un canal de 31 mètres de longueur a
651
A moitié de la hauteur de la salle est
…
de trois côtés, et séparée de la ville par
…
fort fut bâti par les chevaliers de Saint-
…
a causé l’ensablement du port, dont les
…
Il faut croire que les aborigènes de
…
moyens de défense suffisants contre un
…
Du temps de Strabon , la Lycaonie et
…
tituées de la même manière. Rornées
…
La première de ces deux provinces,
…
dépouillé de végétation, et à peine
…
bétail. Les auteurs anciens recherchent
652
qu’ils l’ont reçu de l’Arcadien Lycaon,
…
soit faite de la Lycaonie se trouve dans
…
la province nommée par les Romains
…
mène , par suite de la paix signée avec
…
deux a conservé son nom de Kéréli;
…
les villes de Derbe et Laranda, c’est-à-
…
Sanjak de Karaman. Elle a pour prin-
…
vérité, le plus dénué de ressources
…
Les Lycaoniens n’avaient pas même
…
qu’entre les mains des peuples musul-
…
Les laines grossières, mais abondan-
…
en cela, ils se distinguent encore de
653
l’intérêt de leur vengeance ou de leur
…
parenté avec les peuples de l’Asie
…
rienne qui avait envahi le nord de la
…
mentionne en détail toutes les villes et
…
Strabon (2) fait de l’Isaurieune annexe
…
rait être de souche grecque. Les an-
…
de Lycaonie, qu’il nomme Pelteni, de
…
dans les montagnes escarpées et inac-
…
mot prononcé par les Hébreux Ieschtiri et
654
de Cilicie,dans le voisinage d’Anemu-
…
liance avec les Ciliciens.
…
peuples une réaction terrible de la part
…
secours du dehors, et les combattants
…
Les longs soulèvements que suscita
…
se fut établie sur ces côtes ; quand les
…
anéantie qu’après la campagne de
…
lieu les transactions entre lesRhodiens
…
Mais depuis la base de la montagne
…
les ouvrages avancés d’une vaste cita-
655
pierres polygonales qui relient les dif-
…
cun vestige de théâtre ou de stade,
…
Toutes les montagnes environnantes
…
de la mer. 11 n’est pas douteux que
…
gage de l’autre (1) ; les usages des Cau-
…
et les flottes grecques trouvèrent sou-
…
de la ville et qui lève toute incertitude.
…
mi-côte de la montagne de l’acropole.
…
mains. Les tombeaux des Cauniens
…
à l’extérieur, les autres sont des sarco-
656
Le village moderne de Dalian se
…
La baie de Karagatch est l’ancien
…
portion de la Lycaonie et de l’Isaurie,
…
villes de la côte avaient profité de
…
forteresse commandant les sommets du
…
pas Amyntas dans ses projets de con-
…
contre Archélaüs, lorsqu’il voulut les
…
n’offrait aucune condition de durée.
657
Les villes de Pamphylie qui avaient ap-
…
changement de règne ou par quelque
…
l’Occident, marchait contre les Perses;
…
mise en bon état de défense. Elle était
…
le siège ne fit aucun progrès. Lés pro-
…
entouraient Cremna, le dessein de Ly-
…
Romains. Instruit des mouvements de
…
molie, et les vainqueurs y établirent
…
derniers jours de Rome. La porte Asi-
…
Ceci porte à croire que les Romains
…
comme appartenant à cette province les
658
les montagnes, sur les frontières de la
…
que celle de Hiéroclès L’Isaurie, dit-il,
…
de plusieurs autres villes, elle en a deux
…
attiré surl’Isaurie de justes vengeances;
…
préfet toutes les provinces qui ont ap-
…
quelques centaines de mètres au-dessus
…
ment de l’ancienne Derbé, la forteresse
…
vent dans le village de Divley situé dans »
…
tures; la position de ce village, à ia nais-
…
vert par deux places qui défendaient les
…
les deux places. Les apôtres Paul et
…
Caraman, ville de trois à quatre mille
659
âmes, se trouve au point de réunion
…
tentative faite sous le règne de Bayazid
…
une journée au nord de Caraman est
…
dont les laves trachytiques sont de cou-
…
Kilystra, voisin de Caraman, est porté
…
A l’ouest de Caraman s’étend le
…
d’Egdir du bassin des deux lacs de Bey
…
quées à minarets sont les seuls mo-
…
Au milieu de l’enceinte des ro-chers
…
avec l’enceinte sacrée de Boghaz keui ;
…
(t)Diod. de Sic., iiv. XVIII, ch. si.
660
nova, est située près du village de Zeng-
…
nord la plaine de Konieh, au sud le
…
funèbres, genre de monuments assez
…
assistait au concile de Ghalcédoine, et
…
pente est moins rapide, les tours sont
…
supportée sur des pieds-droits en
…
on pourrait retrouver les principaux
…
c’est un arc de triomphe encore presque
…
incertitude sur l’emplacement de l’an-
…
Du côté du nord le rocher sur lequel
661
de la ville. Une tour plus haute que les
…
Le versant de' plateaux qui s’appuient
…
reprenant la route de Cassaba, et se di-
…
étendue de pays, les anciens aient choisi,
…
un ruisseau qui va se perdre dans les
…
dans une contrée fertile, au nord de la
…
Les habitants de la ville claudienne d’iconium
…
que. Obligés de se retirer, ils continuè-
662
quaire que par les mosquées élevées
…
à tous les couvents ou Téké de l’em-
…
rang de simple chef-lieu de pachalick,
…
règne de Soliman le Grand jusqu’à nos
…
fut de tout temps la résidence d’un ar-
…
et qui a de sept à huit métrés de hau-
…
à ceux qui sont gravés sur les autres
…
les murailles; on remarque dans une
…
Le plan de la ville est un rectangle,
…
térieur de la ville, une enceinte parti-
…
Seldjoukides est sculpté au-dessus de la
…
barbare, qu’on serait tenté de la regar-
…
Jusqu’ici nous avons examiné les de-
Livre X: Lycie - Pamphylie - Cilicie
664
L’histoire de Lycie commence avec
…
ples. Les Phéniciens pénétrant dans
…
jrent les memes dieux, comme Ju-
…
Les Lyciens, les Crétois et les Cariens se
…
ment des autres habitants de la pres-
…
de la guerre de Troie, nous voyons la
…
Sous le nom général de Lycie, les
665
avaient passé de Pile de Rhodes en Asie ;
…
arabes qui, avec le titre de (2) Ouied
…
ples priimt le nom de Lyciens.
…
fère aussi de celles des autres peuplades
…
ganisation de son empire avait rangé
…
de part à la guerre du Péloponnèse.
…
congrès serait tenu. Les principales
…
Le premier soin des Lyciens fut de
…
rière ces remparts que de vaillants guer-
666
ges. Sur le flanc des rochers on observe
…
de bois couverte par une autre pierre
…
de répondre que c’est un caprice de l’art.
…
les historiens qui nous ont parlé de la
…
de quelques familles qui étaient absen-
…
autres que les Mèdes et les Perses. Cette
…
Il faudrait donc supposer que les
…
le nom de Tibérius Claudius ; à Auti-
…
nom de Claudia Regelia Herennia. On
…
ture ; les lois qui protégeaient les sépul-
…
de nouveaux éclaircissements à ce su jet.
…
cuments laissés par les anciens auteurs
667
1812 avait révélé l’existence de ruines
…
prises avec le secours des bâtiments de
…
villes de la Lycie. Dès la plus haute an-
…
confiait, pour connaître le secret de son
…
pas facile de dire quel est celui qui sub-
…
Sinus, aujourd’hui golfe de Macri (3),
…
tourée de fortes murailles, mais qui da-
668
sont construits en pierres de grand ap-
…
qui n’a jamais été adoptée par les Pto-
…
tenaient aux dépendances de cet édifice.
…
Quelques-unes de ces chambres sont en
…
du territoire de la ville est tellement
…
Du pied de ces rochers sort une source
669
les corps. C’est une règle invariable dans
…
Les deux autres tombeaux sont d’un
…
déterminer l’époque approximative de
…
numents sont certainement d.e l’école
…
on y voit les solives, les liemes, les pou-
…
par les détails, nous nous contenterons
…
trouve au pied de l’acropole donne une
…
Les ornements et les palmettes qui cou-
…
lui ? Questions encore indécises sur
…
l’est par les pentes abruptes de l’Anti-
…
pour attirer de nouveaux habitants, les
…
Derrière le rocher de l’acropole de
670
c’est à l’entree de cette vallée qu’était
…
aux chevaliers, est à l’entree de la baie
…
vent au-dessus de la plaine à une hau-
…
son nom (1); dans la partie inférieure de
…
nommé le Latoum lui fut élevé près de
…
panchent les eaux du Xanthus avant
…
sin des ruines de Xanthus ; on n’y trouve
…
La ville de Xanthus capitale de la
671
site et les monuments de Xanthus. mais
…
cueillir les principaux monuments de
…
sommets sont couverts de forêts de pins.
…
de dépôts de calcaire d’eau douce, res-
…
Le rocher de l’Acropolis ne manque
…
roule ses e-aux au pied de la seconde
…
Une plate-forme de roc immédiate-
…
tombeau de Mylasa. Les sculptures qui
…
duits de l’école lycienne antérieurs à la
…
tous les caractères d’une haute anti-
672
Tloës où les Solymes. C’était un de ces
…
Après la conquête de la Lycie'par les
…
époque; mais pour les sarcophages et
…
tus. La ville fut investie, et les habitants,
…
rent construits presque tous les monu-
…
L’antique cité de Tlos, bâtie par le
…
par M. Fellows au village de Deuvvar,
…
lik de Mogla.
…
jusqu’à la mer et de l’autre côté les
673
ciens sont semblables à ceux de Tel-
…
rure, et sur le côté on voit un bas-relief
…
M. Spratt a découvert un piédestal sur
…
Les anciens habitants de Tlos avaient
…
les voyageurs redoutaient de traverser
…
Les anciens écrivains ne sont pas
674
le site de l’antique Pinara est tout a
…
les indigènes, le mot turc Minara, Mi-
…
L’histoire de Pinara est des plus
…
numents publics entourés de tous côtés
…
tableau. Malgré les rapports pompeux
…
Les ruines de l'ancienne ville sont si-
…
de la Lycie n’est pas de race turque,
…
gène du massif montagneux de la Lycie
…
profond précipice, elle est couronnée de
…
tableau: les ruines de la ville s’étendent
…
des villes les plus populeuses, les plus
675
parlant ainsi au milieu de l’immensité
…
et cannelées; plus loin sont de beaux
…
ment de terre. Sur le chemin qui con-
…
déposer les corps.
…
corée de mascarons, et dans l'intérieur
…
l’aspect de simples grottes dont le som-
…
loin des routes suivies par les armées a
…
Les ruines d’une église s’élèvent au
…
La ville de Sidyma, citée par Pline (I)
…
des arbres. Ce village est distant de
676
juste raison que plusieurs villes de la
…
ïlne grande rue bordée de temples et
…
est rempli de ruines de tout genre, pié-
…
une ville de Carie voisine du golfe de
…
tière où se trouvent quelques inscrip-
…
En quittant le golfe de Macri, le 7
677
dont la largeur n’est pas moindre de
…
d’attaquer Patara. Les Phéniciens
…
nore, qui a été employé par les anciens
…
port les habitants de la Cappadoce.
…
Nous arrivâmes enfin au pied de la
…
par une assise de pierres équ.irries et
…
quel étaient encastrés des tuyaux de
…
époque reculée les lois de l’hydraulique
…
est un véritable siphon , qui prend les
678
formé par un canal a fleur de terre que
…
à sept stades de Patara, selon Etienne
…
La fondation de Patare remonte aux
…
né sur ce rivage; Latone, conduite par
…
tés dans la chaumière de la vieille
…
pour les peuples de la contrée, et la
…
propre à contenir un certain nombre de
…
fut venue déboucher dans le port de
…
tous les jours, en même temps que les
…
Le théâtre est composé de deux pré-
679
entier; la façade extérieure, dont les
…
premier étage est percé de fenêtres cein-
…
mais les divisions, qui étaient de bois,
…
trième année du consulat de l’empereur
…
luxe de matériaux. Les gradins sont sou-
…
en gros quartiers de libage, aussi en
…
diamètre est de soixante-dix mètres.
…
un pilastre carré dont les assises ont été
…
placée sur ce pilastre. Les conjectures
…
mètres environ à gauche de l’édifice, on
…
consoles soutiennent la corniche , et les
…
ment de l’édifice était sans ornements,
…
Les antes portent sur des piédestaux
680
temple est composé de blocs de pier-
…
droit est orné de deux grosses consoles
…
Ce mélangé de tous les ordres indique
…
construite par le peuple en l’honneur de
…
La nécropole était située hors de la
…
voyons plusieurs soubassements de
…
cella au milieu de laquelle est encore
…
les deux angles extrêmes du fronton,
…
au milieu de la nécropole pourrait le
…
les conditions d’un temple.
…
plusieurs campements de Yourouks
…
les buissons deviennent impénétrables,
…
avions peu avancé, nous revînmes sur
681
de nouvelles recherches faites dans
…
abrupte et la plus impraticable de toute
…
trajet : la voie de mer est infiniment
…
fitent du vent de terre pour marcher
…
les nouveaux débarqués attaquent pour
…
marchands ), situé sur le revers de la
…
Toutes ces montagnes sont de nature
…
des spéciales de monuments.
…
de la ville de Mégiste, qui déjà du temps
…
des navigateurs,sous les républiques de
…
nus, avec le brick de l’État le Dupetit-
…
nues de Castellorizo. Le bétail est abon-
682
poules et de la farine. C’est un endroit
…
ne peut y virer de bord ; il reste désert
…
contentent de nommer cette ville (1); le
…
avant de la ville de Phellus, située dans
…
d’un empereur ou de quelque magis-
…
vallée de Vathy plus de cent tombeaux
…
phithéâtre sur une longue colline re-
…
Les murailles sont fondées sur le roc;
…
les eaux du port Vathy.
…
rangs de gradins, en une seule précmc-
683
forts. Ce monument rappelle l’église de
…
presque carrée de dix mètres sur onze;
…
de porte centrale, mais deux petites
…
Les tombeaux d’Antiphellus sont sans
…
résolu, sur l’époque où la langue ly-
…
rappeler le souvenir de leurs demeures
…
tombeaux (1). Un de ces monuments, si-'
…
bien conservée; je l’avais, de plus, colla-
…
nument de piété et de souvenir. >■ Les
…
si haute piété que de déposer le corps de
…
Au-dessus de la maison de l’agha
…
(2) Voy. Planche 26, Tombeau de Clau-
684
décoré de chaque côte de deux avant-
…
centaines de sarcophages du même
…
composée de danseuses qui se donnent
…
Sévédo, et sur la côte nord, on aperçoit
…
trouvent aux alentours, les uns encore
…
rium, marqué sur le stadiasmus à cin-
…
que la route ancienne qui reliait les
…
que nous avions reçu sur toutes les
…
lus, ce contre sens du traducteur de Pline a
685
nifesta : les matelots avaient tué un
…
était atroce pour les chevaux.
…
immédiatement sur le flanc opposé.
…
jouir du coup d’œil général de la Lycie :
…
pieds, des plaines couvertes de verdure;
…
une demi-heure de route, nous nous
…
de Cyaneæ divisée en différents groupes.
…
les plus arides : le temps est couvert;
…
épais; on n’aperçoit les objets qu’à
…
milieu de laquelle s’élèvent deux édi-
…
tout à fait en dehors de ce que nous
…
sinés avec moins de recherche. L’un
…
possible d’imaginer : sur le premier
…
Les sommets des plus grands arbres
686
formaient comme un tapis de verdure,
…
d’un seul bloc cubant plus de 75 mètres,
…
cune plusieurs mètres; le sommet de
…
de ceux de Macri. En descendant plus
…
maison. Ce village se trouve sur la ligne
…
sources de la rivière de Myra.
…
La rivière change de nom, selon la
…
d’Irnési; à partir de ce point, la rivière
…
appelé par les Turcs, Dérnéri; on la
…
de Kandvva, que nous reconnûmes le
…
quelques restes de tombeaux lyciens
687
lage de Yarvou un autre centre de po-
…
ruines de tombeaux avec inscriptions.
…
de vastes ruines avec des palais et d’au-
…
une heure de marche nous faisons
…
coupole de huit mètres soixante de dia-
…
A droite et a gauche de l’église sont
…
et la marche du convoi devient de plus
…
native que présentent les voyages dans
…
et ne permettent pas de les examiner à
…
église en forme de basilique.
…
Il n’est pas difficile de déterminer le
688
de Lycie , dit Étienne de Byzance. C’est
…
dans les hauts plateaux, où se trouve la
…
de deux manières, ou par la route déjà
…
les atteindre par terre : le pays étant
…
Les difficultés que présente la con-
…
pleine mer sans faire de route; nous
…
bri de tout vent, mais qui est complète-
…
tions l’ancre sous le château de Cacamo,
…
sol est encore vierge de toute habita-
…
Les constructions de l’île Dolichiste
…
ration, que cette partie de l’île et du
…
que plusieurs de ces monumentsont dû
…
on voit dans le voisinage de ces maisons
…
de tombeaux, la nécropole était sur la
…
dans l’île de Kakava.
689
Sur le continent s’élèvent les fortifi-
…
près l’appareil très-soigné de certaines
…
taillé dans roc ; tous les sièges subsistent
…
citoyens, le sol de la mosquee est une
…
la définition de ce système de construc-
…
postérité, ils ont eu soin de dire dans
…
les fondements, et l’ont dédié à l’em-
…
font écrit Hiéroclès et Etienne de
…
pendant l’été, et les habitants se sauvent
…
creusés des tombeaux de style lycien ;
…
(1) Voyez Description de l'Asie mineure,
690
de Cyaneæ : on doit en conclure qu’en
…
allâmes examiner les ruines très-con-
…
citée par Pline et par Étienne de By-
…
Pour donner une idée de la difficulté
…
campement de Yourouks qui le con-
…
de Kandiva, Dembra au lieu Demeri :
…
pour continuer notre exploration de la
…
pour entrer dans la rivière, à cause de
…
de parcours, alimentée par des eaux
…
mouilla la flotte de Brutus et de Len-
…
était à peu de distance du golfe d’An-
…
Les ruines de Sura ont été reconnues
691
plaine de Sura, qui s’étend jusqu’à la
…
ruine sur le rivase, et établirent leur
…
de Myra, situé à trois quarts d'heure du
…
veuve était sur la porte, chantant sa
…
recommençait une sorte de danse sac-
…
le plan en est moins grand. Les cha-
…
corps de saint Nicolas ne repose plus
…
tendent aujourd’hui que le corps de
…
naissance de Nicolas n’est pas antérieure
…
Il ne paraît pas dans le concile de
692
La légende raconte de la manière
…
de saint Nicolas; mais les chrétiens,
…
de saint Nicolas resta encore à Myra
…
Enfin, par une manœuvre dont les
…
Antioche. Se trouvant dans les parages
…
à la rade de Lycie et surent de leurs
…
I église de Syon, où était déposé le
…
Les gens de Bari firent accroire à ces
…
le tombeau de marbre à grands coups
…
selon les religieux, sortait du corps
…
les os étaient pêle-mêle hors de leur
…
reliques le 20 avril de l’an 1087.
…
de pèlerins à Worms, en Palatinat.
…
l’église de Bari fut inaugurée par Je duc
693
Les Vénitiens, qui avaient été devan-
…
la collégiale de Saint-Nicolas du Lou-
…
bâtir la Sainte-Chapelle. Le chef de
…
sin ; les autres sont gisant devant la
…
née vers le sud ; la galerie de l’est est
…
laire de la seconde précinction. Toutes
…
de campagne, appartenant à l’agha de
…
de Myndus ». Généralement l’épigra-
694
La montagne de Myra s’élève à l’an-
…
f.onion de six mètres de base, dans
…
tres supportant des têtes de lion en
…
culum, cuiller pour les sacrifices; on le
…
son mariage; enfin il est couché sur son
…
D’après l’inscription placée sur le
…
montée de deux bustes.
…
neka et sépare la vallée de Myra de
…
fédération lycienne possédaient les val-
695
tion des villes anciennes de ces régions
…
mieux est de faire ce trajet par mer et
…
ville d’Olympus, sur la côte est, s’ap-
…
échelle. Les bateaux viennent charger
…
grande ville de la Lycie, a une distance
…
Le grand sarcophage sur lequel se
…
colline de la nécropole. C’est un ouvrage
…
De nombreuses sources sortant du
…
fluents de l’Arycandus.
…
parmi les villes importantes de la Ly-
696
de Tchingheneh ou Bohémiens qui exer-
…
voisinage du village moderne de Arouf,
…
temps de l’empire byzantin. On ignore
…
les rivières de ces parages , la rivière de
…
des forêts séculaires ; les ruines de leurs
…
du Yaéla du village de Karditch.
…
ruines, et la nécropole offre encore de
…
espérait peu découvrir les vestiges d’une
…
inscriptions lui révélèrent le nom de
697
appelée gagatès. Selon M. Spratt, les
…
cable pour arriver sur la côte orien-
…
naissance dans la partie supérieure de
…
de ce cap est un autre petit port que
…
tion grecque ; les monuments et surtout
…
resta au pouvoir de Rome. Un motdeCi-
…
porter devant son char triomphal les sta-
…
ville et la côte, au nord de la rivière, il
…
d’hui désertes : il n’y a sur la côte d’autre
…
les mythes dont le peuple Lycien était
…
liane des rochers. Les indigènes con-
698
pour les Guèbres un feu sacré, nous
…
d’Olympus paraît tout à fait privée de
…
cain ; un temple de ce dieu fut construit
…
ainsi appelé par les habitants, où le sol
…
fait aussi mention de la Chimère : « Au-
…
par les lions, et dont la base est infectée
…
les flammes.
…
ture, des montagnes couvertes de pins
699
de Doriens, mais de Grecs ycens.
…
de la ville, il fît mettre le feu aux prin-
…
le temple de Minerve, où l’on conservait
…
des bâtiments de trois ou quatre cents
…
(3) Lacon. ch. 3. Les souvenirs de la guerre
…
de Kemer descend du Seghir dagh, fa
…
mètres au d fsus de la plaine.D’antiques
…
Un incendie allumé par les nomades
…
Plutarque appelle les Échelles. Der-
…
dessous des ruines de Seraïdjik, que
…
de Marmora, ville qui s’est opposée au
…
santes au point de vue géographique;
700
Au nord de la Lycie habitaient les
…
principe une ville de peu d’importance ;
…
l'excellence de ses lois et par l’industrie
…
joug de Rome; elle devint cependant
…
comme les plus indomptables de la
…
ciennes villes de Lycie, mais conser-
…
environ de diamètre. La première pré-
…
est percée de cinq portes ceintrées, et
701
de la montagne au sud de la rivière.
…
au sud de Balbura ; on retrouve ses
…
Les Grecs ont donné le nom de Pam-
…
de nombreux torrents la traversent dans
…
pays et les récits des historiens anciens,
…
santes auxquelles est soumis le sol de la
…
Les Solymes, les Termiles, les Laso-
…
jamais pays mérita le nom de Pam-
…
abordèrent le nom de Pamphylie, pays
…
de Byzance fait dériver ce nom de celui
…
établis dans la contrée, Strabon cite les
702
la Pamphylie accessible de toutes parts,
…
partie de la première satrapie : elle est
…
faire le siège. (5) Les Perdes avaient, il
…
ment à la domination d’Alexandre; les
…
ment des rois de Syrie, et restèrent en
…
(5) Plutarque, vie de Cimon.
…
concile de Nicée, il n’y a qu’une seule
…
métropole de la seconde. Elles furent
…
pole et les évêques de Perga disparais-
…
proconsul de Cilicie, dont le siège était
…
Cicéron arrive en Asie désespéré de
703
pation du proconsul est de prendre
…
pays. De Synnada, il se rend à Ico-
…
la Cappadoce contre les Arméniens qui
…
les alliés, écrasés par la dureté et les in-
…
faibles contingents, toutes les qualités
…
il a combattu; il altère le nom de la
…
de fatigues et tant de genie, qu’il ne
704
s’écouler vingt-deux jours avant que les
…
Pisidiens, la rivale de Selgé, dans la
…
de Pisidie, par Étienne de Byzance et
…
des parties les plus inaccessibles du
…
de la ville. « J’attaquai ensuite Pindé-
…
haute et une quantité de machines; je
…
encore en Asie jusqu’au milieu de
…
le prier de lui en faire passer un certain
…
nombre de vous, qui pouvez en tirer
…
grande attention à la lettre de Cœlius ;
…
Le territoire de la Pamphylie com-
705
limite orientale de la province.
…
qui fonda la colonie de Corycus.
…
d’Attalia, mais avec les variations qu’a
…
Les anciens comptaient en Pam-
…
resse qui défendait l’entrée de la Pam-
…
paraît avoir été la cause de la ruine
…
au point de vue du commerce et des
…
Dès que les Seldjoukides furent
…
Les fortifications de la ville grecque
…
Les Seldjoukides se bornèrent à ces
…
dans les murailles, des fragments de
…
et j’en ai reçu tous les soins imagina-
706
approvisionnée : on ne mange que de la
…
plusieurs restes d’antiquités : un arc de
…
Les eaux du Douden ont une pro-
…
sont enveloppés les détritus végétaux
…
ment dans la mer ; c’est de celte circons-
…
d’Adalia ; mais les nombreux jardins de
…
La plaine du Douden, à l’est de la
…
virons, aussi les familles d’oiseaux aqua-
707
de l'homme. Le bassin du Douden est
…
et celui de Goulik khan,remplacent les
…
devant la ville de Lagon, qu’il trouva
…
teur ancien n’avait parlé de Lagon, dont
…
environ vers les montagnes.
…
les ruines de plusieurs églises ; mais
…
surtout un canal de deux ou trois cents
…
Termessus, une des places les plus
…
dans une nuit de quinze siècles. Nous
708
Cependant les ruines de Termessus,
…
dixième siècle. Tant de ténèbres sur
…
fortifications de Termessus qui lui pa-
…
fait d’accord avec les faits rapportés
…
sommet est de seize cents mètres en-
…
de la vallée, et dans cette enceinte s’é-
…
de nombreuses fenêtres, dont, les murs
…
amas confus de monuments divers qui
709
nom de Termessus. Plus loin est le
…
dans l’angle de l’Agora est couronné
…
église attenante sont les seuls monu-
…
de la ville par un chemin tortueux. Tous
…
verse la plaine de Pambouk ova si, qui
…
berceau de la ville; les habitants ne sont
710
semblable ; c’est le site de Syllœum, que
…
par vous : vous avez même détaché de
…
Un éditeur de Pline remarquait il y a cent
…
serait pas servi de cette expression si h
…
tous les temples du paganisme ont été
…
cette condition, jointe à la qualité de
…
ries. Les murailles existent encore ; nous
…
vis à cent quarante-trois ans de distance,
…
de Chypre (2), ils n’y séjournèrent pas
…
l’effet direct des prédications de saint
711
sentent, car dès les premiers siècles du
…
rait l’être un tremblement de terre : la
…
La montagne de Perga, où était l’a-
…
dire de style grec sont bâties en grands
…
autre grand édifice carré composé de
…
perpendiculaire de la rue des portiques;
…
édifice demi-circulaire flanqué de deux
…
ron de la basilique et dans le sud de la
712
La grande salie des mimes,sur laquelle
…
et comique; des escaliers en pierre de
…
se jouent des génies et de jeunes en-
…
La galerie supérieure est de plain pied
…
prendre toute l’importance de cet édi-
…
au règne de Titus, nous avons relevé
…
verte de buissons; toute la construction
…
tions de Strabon.
713
étendue, les hautes tours carrées bâties
…
de route à Hassar keui, village d’une
…
des colonnades ni de riches portiques :
…
détruits ; mais ils ont laissé sur le roc
…
le rocher. L’entrée de la ville paraît
…
celle de Perga; du côté du sud, la vue
…
titre d’alliées de Rome (1).
…
gués); elle conduit dans la plaine de
…
que Pednelissus n’était pas éloignée de
714
cours très-difficile; des forêts de pins et
…
Au nord court une ligne de collines
…
teau construit en grands blocs de pierre
…
face. La plaine qui les sépare est cou-
…
dans la plaine s’élèvent les ruines d’un
…
sur beaucoup de médailles de Sicile;
…
disséminés des édifices de différents sty-
…
remarque un très-petit nombre de sar-
…
dans la vallée de l’Eurymédon, au-dessus
…
nom de cette ville a été altéré par Cicéron,
715
sant d’avoir un plan topographique de
…
temps où les habitants de Baoulo ne
…
Isbarta, chef-lieu du Pachalik de Ha-
…
de la ville s’élève une grande mosquée
…
de trente : elles sont pour la plupart
…
l’instruction des enfants chrétiens. Les
…
merce de drogueries et de matières
…
sance d’une vallée au fond de laquelle
…
de la roche qui a donné lieu à un épan-
716
de trace de cratère. Toute cette région
…
la largeur de vingt; le mur de la ter-
…
de sa construction a résisté à toutes
…
et les deux portes latérales; les deux
…
rangs de gradins avec les escaliers ou
…
laissé de traces; mais il est probable
…
de l’époque romaine plusieurs églises et
…
la rudesse presque barbare de ces mo-
…
d’une grande fertilité, et les Sagalassiens
…
mais ravagea son territoire, et força les
717
de cinquante talents et vingt mille mé-
…
de très-ancien style.
…
par des familles de bergers. x
…
de Byzance fait aussi mention d’une
…
cageuses en hiver, mais au mois de juin
…
erreur de mots faite par quelque inter-
…
d’un ancien pont romain jeté sur le
…
manquera pas de répondre affirmative-
718
l’extrémité de la plaine de Perga, sur
…
vous voyez encore les ruines. Au bout
…
duquel il fit graver le portrait de Bal
…
Au premier étage est un rang de fe-
…
construit sous le règne d’Antonin et de
…
de deux ordres de colonnes accouplées
…
Chaque couple de colonnes est sur-
719
Le centre de la colonnade est sur-
…
intact, il est composé de cinquante
…
De chaque côté de l’orchestre est une
…
pour les évolutions du chœur selon la
…
par les lianes et dans un état de des-
…
de taille ; en approchant de la montagne
…
de la montagne.
…
Thrasibule ayant été chargé de faire
…
les murailles sont écroulées, et nous
…
une ancienne ville de Pamphylie ; elle
720
Cicéron rappelle le Joueur de luth d’As-
…
phvsionomie de cette côte ait été aussi
…
jouissait de la vue de la mer »; aujour-
…
oriental de la Pamphylie; mais avant
…
méridional du Taurus. D’après de va-
…
portés aux expéditions de piraterie.
…
Les routes, pourarriver à Selgé étaient
…
des Selgiens, qui vinrent l’assurer de
721
sud de l'Asie Mineure, il fut souverain
…
garder les défilés, descendit rapidement
…
temple de Jupiter, qui était dans l’acro-
…
tenter une attaque. Les Selgiens en-
…
Les ruines de l’ancienne Selgé sont
…
sur la pente d’une colline dominée par
…
sur la façade; elles ont un mètre de dia-
…
au sud de la ville est une profonde
…
turelle de la Pamphylie, du côté de
…
vale formidable; les nouveaux habitants
722
taient qu’un peuple de pirates de Ci-
…
Les ruines de Sidé, aujourd’hui com-
…
la place deux à l’est, et les deux autres
…
De chaque côté de la rue se voient en-
…
fices de ce genre; on compte quarante-
…
plusieurs fûts de colonnes. Dans le
…
que de la plus grande prospérité de cette
…
merce de la contrée. Les communica-
723
la Pisidie ; de plus elle n'était approvi-
…
cessé d’entretenir les eaux , la popula-
…
férente en tout point de la fertile Pam-
…
gouvernement de la Porte n’a jamais
…
vahi par les hautes herbes, les ronces
…
point de vue géographique ; l’état des
…
à l’est ; c’est celle qui renferme les dis-
…
pays était différente du grec, et. les mé-
…
tantes avec ce dernier peuple que les
…
ments de l’Assyrie et de Babyione, avec
…
met de laquelle Diodote Tryphon avait
…
par les autres chefs de bande dont les
724
étaient entreposés à Sidé et de là con-
…
sion que les gouverneurs romains étaient
…
tral grouncl, qui sépare de l’Espagne la
…
les bois (2). Hamaxia était à cent sta-
…
qui marque l'emplacement de l’ancienne
…
la mort de Trajan, qui vint expirer dans
…
nue sous le nom de Sélénitis.
…
dée par les Phéniciens ; elle reçut en-
…
par les habitants lorsqu’ils eurent cons-
…
reconnaît les ruines d’Holmi dans une
725
jourd’hui Agha liinan, le port de F Agha ;
…
par l’épithète de Trachæa, la rocheuse.
…
étendue de terrain considérable, mais
…
térieur est rempli de maisons écrou-
…
pose d’un grand nombre de sarco-
…
une tour de marbre avec quatre tribu-
…
Il semble que sous les Seljoukides la
…
tombeau de Karaman Oglou, émir, qui a
…
deux petites baies entourées de ruines
726
quinze kilomètres au nord de Korghos,
…
la ville de Lamus dont il ne reste plus
…
barbare, qu’on doit les regarder comme
…
d’Alexandre comme du temps de Me-
…
successivement. Le résultat de son pou-
…
lek boghaz dans les hautes vallées du
…
vapeurs pestilentielles. Le bourg de Ha-
…
roulant quelques blocs de rochers, n’eut
727
plusieurs pans de murailles byzantines
…
industrielle, suivait les écoles et pré-
…
Tarse dans l’antiquité, ce furent les
…
ployer ses voiles de pourpre sur les eaux
…
quand les Sarrasins vinrent assiéger
…
kilomètre, de Tarse au Rhegma; il
728
on trouve de nombreux débris d’anti-
…
kilomètre de la ville, était en 1810,
…
Les historiens grecs et latins qui ont
…
sont deux villes disctinctes ; tous les
…
L’histoire de Tarse phénicienne res-
…
blement de terre? c’est ce que disent
…
où les antiquaires qui entreprennent des
…
bâti sur le plan des mosquées primi-
…
marquable en marbre blanc; sur la porte
…
de l’est à l’ouest, et formée par de hautes
…
lèlement au petit côté de l’est. Ce mo-
…
a été coulé dans un moule. Mais sur les
…
édifice connu, fl est bien difficile sur
729
les observateurs. Le grand rectangle a
…
Les deux massifs cubiques ont été sondés
…
tous ceux qui ont vu les monuments
…
déposer les corps. Tous les tombeaux,
…
nous combattons les opinions. Quelle
…
sur les mœurs des tribus turcomanes
…
plusieurs années les pachas voisins
…
dans les montagnesdu Beylan, au milieu
…
Kutchuk Ali et tous les siens furent
…
du pavs est aussi sain que celui de la
730
de là mer dans un enfoncement du
…
le nom de Portes Syriennes, Syriæ pylæ ;
…
tuée près de ce lieu ; son emplacement
…
pbiloque après le siège de Troie, était à
…
core les ruines sur le cap Lara tasch
…
d’Amphiloque, a laissé moins de vesti-
…
inscriptions témoignent seulement que
…
nien le fit réparer. Les Arabes firent une
…
fut reprise par les Byzantins en 964.
…
Missis est éloignée de sept heures de
731
de l’ouest à l'est ; on compte neuf heures
…
Adana est bâtie sur la rive droite du
…
Une petite éminence sur laquelle s’é-
…
en 1836 toute l'enceinte flanquée de
…
de serrurerie du septième siècle : les
…
l’ouest de la ville.
…
assises de marbre alternativement blanc
…
de Kutchuk Ali ; aujourd’hui Adana est
…
Nous terminons ici la description de
Table des planches
733
(Le Relieur devra placer les planches dans le volume de la manière suivante.)
…
7 Le hiéron de C-nide. 642
…
19 Temple de Vénus à Apbrodisias.. 644
…
26 Tombeau de Claudia Régélia. —
…
33 Château de Boudroum. 632
…
de la page
…
42 Grande rue de Nicomédie. 67
…
de Konieh. 662
…
' Asie Mineure sous les Perses.
Table des chapitres
735
Division de l’ouvrage.
…
Divisions de l’Asie à dif¬
…
Coup d’œil sur la forme
…
Périple de l’Asie Mineure.
…
Montagnes de la Lycie.
…
Chaînes de l’intérieur.
…
Premiers colons de la Bi¬
…
Rois de Bithynie.
…
Frontières de la Bithynie.
…
virons de Nicomédie.
…
Les courriers en Orient.
…
La tour de Léandre.
…
Parages de la mer Noire.
…
Itinéraire de Nicomédie
…
Eglise de Sainte-Sophie.
736
Les murs.
…
La pyramide de Cassius
…
Route de Ghio à Broussa.’
…
Les eaux.
…
Mosquée de Mourad Ier.
…
L’Olympe de Mysie.
…
La*\ille de Dascylium et
…
Les Turcs s’établissent en
…
Syncedème de Hiéroèlès.
…
Asie. — Limites de la
…
Itinéraire de Miletopolis
…
Les sources chaudes.
…
Ruines de Cyzique.
…
Ruines de Cyzique d’après
…
Côtes de l’Hellespont.
…
Plaine de Troie.
…
Intérieur de la ville.
…
Les murs.
…
Origine du royanme de
737
Volcan de Kara Devlit.
…
Villes de Lydie an nord
…
Le cratère de marbre.
…
sur la côte d’Asie.
…
Élée. — Villes de l’Æo-
…
Topographie de Sipylus.
…
Premières migrations io¬
…
Frontières du royaume de
…
Leurs rapports avec les rois
…
de Lydie. —Avènement
…
L’Ionie sous les Perses.
…
Le temple de Cybèle.
…
Résumé de l’histoire de
…
Tombeaux des rois de
…
Itinéraire de Smyrne à Sar¬
…
Villes de Lydie au nord
…
Les murs de la ville. —
…
Route de Thyatire à Per¬
738
Les Turcs à Éphèse.
…
Tremblements de terre
…
de terre en Asie.
…
Règne de Darius.
…
Ruines de Priène.
…
•— Temple de Diane
…
de route.
…
Villes de la presqu’île
…
Route de Smyrne à Cla¬
…
Téos. — Arrivée de la co¬
…
Ruines de Téos. — Sevri
…
Golfe de Smyrne-Cla-
…
Fondation de Marseille.
…
Invasion de Sésostris. —
…
Mythe de Midas.
…
Révolte de Prooope.
…
Itinéraire de Broussa à Ku-
…
De Kutayah à Aizani.
…
Les ponts et la voie des
…
Exploitation de l’écume de
…
Vallée de Nacoléia.
…
Tombeaux de Yapul dagh.
739
Itinéraire de Kediz a Kara
…
Les carrières de marbre.
…
Laodicée sur le Lycus. —
…
Les thermes.
…
Apollonia de Phrygie. —
…
Etat de l’agriculture.
…
Marche de Manlius pen-
…
Ruines de Bala hissar. —
…
La ville moderne et les
…
Istanos. -—Les Oppidades
…
Origine du royaume de
…
Population de la Cappa¬
…
Règne de Constantin.
…
Les anachorètes.
…
Voyage de sainte Hélène.
…
Itinéraire de Tavium à
…
près de Surp Garabed.
…
Les préfectures de la Cap-
740
Mosquée et tombeau de
…
La vallée de Keurémé.
…
Préfecture de Garsauritis.
…
Préfecture de Tyanitis.
…
Table des préfectures de
…
Les Pauliciens.
…
Itinéraire de Sis à Ma-
…
Bassin de l’Euphrate. —
…
Éguine. — La vallée de
…
Royaume de Trébizonde.
…
Les grands sanctuaires d’A-
…
Villes de Pont polémonia-
…
L’acropole et les tom¬
…
Rois et dynastes de Carie.
…
Tombeau de Mausole.
…
Les murailles. — La ville.
…
La ville. — Les murs.
…
Les édifices publics.
…
Villes de la Lycie dans la
Table générale des matières
745
Bithynie (Frontières de la), 57, 2.
…
Broussa (Route de), n3, 2.
…
Cappadoce (Royaume de), 5oo, 1.
746
Cilicie (Fleuves de), 16, 1.
…
Comana de Cappadoce, 512, 2.
…
Cos (Tremblement de terre à), 33o, 1.
747
Cybèle (Statue de), 265, 1.
…
Cyrille (Carte de), 552, 2.
…
Dardanelles (Les côtes des), 20, 2.
…
Éclipse de soleil, 241, 1.
750
Kermian (Plaine de) , 451 , 1.
…
Keurémé (Vallée de), 554, 2.
…
Lac de Bafi, 355, 2.
…
Laodicée sur le Lycus, 436, 2,
…
Lions de marbre,“3g4, 2.
751
Macri (Golfe de), 22, 2.
…
Magnésie du Méandre ; temple de Diane,
…
Manlius (Marche de), 465, 1,
…
Marmara (Carrières de), 161, 2.
…
Mausole (Tombeau de), 15g, 2.
…
Melehubi (Puits de), 56i, 2.
…
Memnon (Oiseaux de), 178, 2.
…
Midas (Mythe de), 38o, 2.
…
Montagnes de Pamphilie et de Cilicie, 3o, 2.
752
Mycale (Bataille de), 296, 1.
…
Mysie (Limites de la), i52, 2.
…
Nicomédie (Juridiction de), 10, 2,
…
Olympe de Mysie, x3o, 2.
753
Pampalus (Villa de.), 568, a.
…
Pergame (Royaume de), 208, 2.
…
Pessinunte (Pierre de), 475, r.
…
Pont sur le Sangarius, 88, 1.
…
Portes de Cilicie, 726,2.
…
Priam (Royaume de), i85, r.
…
Prison de saint Paul, 3r4, 1.
754
Proconnèse (Ile de), 153, a.
…
Pyramide de Cassius, 109, t.
…
Sahat, heure de marche, 2, 2.
…
Samour Bey ( yaëla de ).
…
Sinope (Golfe de), 19, 2.
…
Smyrne (Golfe de), 21, r.
…
Solon (Tombeau de), 422, r.
755
Steunos ( Antre de), 388, 1; 444, 2.
…
Surp Garabed (Couvent de), 534, 2-
…
Séïd el Ghazi (Tombeau de), 4a5, 1.
…
Sémiramis (Chaussée de . 070, 2.
…
Sésostris (Expédition de), 5ot, 1.
…
Tantale (Port de ), 228, t.
…
Tarse (De) à Trébizonde, 58o, 2.
…
Taurus de Pamphylie et de Cilicie, 29, 2.
…
Tchok gheuze (Pont de), 533, ».
Tafel 1-64
Tafel 3-6
Tafel X-Xbis
Maßstab
LIVRE VH.
CAPPADOCE.
CHAPITRE PREMIER.
ORIGINE DU ROYAUME DE CAPPA-
DOCE.
Si l’origine des peuples qui occupaient
les provinces occidentale-s de l'Asie Mi-
neure laisse à la critique quelques points
qui ne sont pas encore complètement
éclaircis, on a du moins, pour appuyer
les hypothèses que nous avons présen-
tées , des données historiques suffisan-
tes et faciles à rassembler. 11 n’en est
pas de même des nations établies à l’o-
rient du fleuve Halys ; soumises à des
vicissitudes sans nombre, formées d’ag-
glomérations de peuples divers dont
l’origine est inconnue, nous n’avons
pas même, pour nous guider, les monu-
ments anciens, dont le caractère in-
dique les différentes phases d’une civi-
lisation. Des grottes taillées dans les
rochers, voilà les seuls vestiges que la
Cappadoce antique offre à l’observation.
Les anciens ont regardé les Cappa-
dociens comme une race composée d’un
mélange de Syriens et de peuples par-
lant un langage barbare, dernier reste
peut-être des aborigènes de la partie
occidentale, repoussés par les migra-
tions d’Europe. Le caractère de la con-
trée eut certainement une influence
notable sur la physionomie des habi-
tants. Jamais le goût des arts ne se ré-
véla chez eux; vivant dans de grandes
plaines sans arbres, occupant des villes
sans murailles, adonnés uniquement à
des travaux d’une agriculture ingrate,
on les voit seulement prospérer comme
pasteurs, et c’est l’élève du bétail de
toute espece qui fait la principale ri-
chesse de leurs princes. Ce trait les rap-
proche des Syriens du sud , et à défaut
de documents historiques qui attestent
l’introduction de la population syrienne
en Cappadoce, nous devons avouer que
500
le caractère particulier des ouvrages
des Cappadociens a plus d’analogie avec
ceux de l’Arabie et de la Syrie supé-
rieure qu’avec aucun autre peuple de la
presqu’île.
Ce fait avait sans doute été remarqué
par les anciens, et avait perpétué l’idée
de la fraternité qui avait dû exister en-
tre ces peuples. Leur culte d’ailleurs
portait une empreinte manifeste de la
théogonie orientale; et si l’on trouve les
noms des dieux de la Grèce répandus
dans le pays, c’est qu’ils étaient appli-
qués parles Grecs et les Romains à des
divinités cappadociennes (1). Le cuite
du feu, qui se perpétua en Cappadoce
longtemps après l’age romain (2), a été
introduit par des peuples étrangers,
avec celui de la déesse Anaitis. Strabon
atteste que de son temps les pyrées éle-
vés dans la plupart des provinces atti-
raient encore une foule d’adorateurs;
mais la vénération de tout le peuple
cappadocien était acquise à des divini-
tés indigènes, dont les temples effa-
çaient par leur magnificence toutes les
cérémonies du rnagisme. Ces temples de
Men, et de Mâ qu’il a plu aux Romains
de nommer Bellone (3), étaient de vé-
ritables centres de gouvernement dont
les pontifes étaient les rois. Tous ces
dieux ont été par la suite appelés dans
le panthéon romain, en quittant leurs
noms asiatiques pour prendre ceux de
Vesta , de Vénus-Uranie et de Lunus.
Le mot Men ne reparaît dans la langue
latine que pour former la racine du mot
Mensis, parce que la lune déterminait
la division des mois, comme cela a en-
core lieu chez tous les peuples orien-
taux.
Les royaumes situés à l’est de l’Eu-
(1) Strabon, XII. 535.
(2) Slrab., XV, ;33.
(3) César, de Bell, civil.
CAPPADOCE.
CHAPITRE PREMIER.
ORIGINE DU ROYAUME DE CAPPA-
DOCE.
Si l’origine des peuples qui occupaient
les provinces occidentale-s de l'Asie Mi-
neure laisse à la critique quelques points
qui ne sont pas encore complètement
éclaircis, on a du moins, pour appuyer
les hypothèses que nous avons présen-
tées , des données historiques suffisan-
tes et faciles à rassembler. 11 n’en est
pas de même des nations établies à l’o-
rient du fleuve Halys ; soumises à des
vicissitudes sans nombre, formées d’ag-
glomérations de peuples divers dont
l’origine est inconnue, nous n’avons
pas même, pour nous guider, les monu-
ments anciens, dont le caractère in-
dique les différentes phases d’une civi-
lisation. Des grottes taillées dans les
rochers, voilà les seuls vestiges que la
Cappadoce antique offre à l’observation.
Les anciens ont regardé les Cappa-
dociens comme une race composée d’un
mélange de Syriens et de peuples par-
lant un langage barbare, dernier reste
peut-être des aborigènes de la partie
occidentale, repoussés par les migra-
tions d’Europe. Le caractère de la con-
trée eut certainement une influence
notable sur la physionomie des habi-
tants. Jamais le goût des arts ne se ré-
véla chez eux; vivant dans de grandes
plaines sans arbres, occupant des villes
sans murailles, adonnés uniquement à
des travaux d’une agriculture ingrate,
on les voit seulement prospérer comme
pasteurs, et c’est l’élève du bétail de
toute espece qui fait la principale ri-
chesse de leurs princes. Ce trait les rap-
proche des Syriens du sud , et à défaut
de documents historiques qui attestent
l’introduction de la population syrienne
en Cappadoce, nous devons avouer que
500
le caractère particulier des ouvrages
des Cappadociens a plus d’analogie avec
ceux de l’Arabie et de la Syrie supé-
rieure qu’avec aucun autre peuple de la
presqu’île.
Ce fait avait sans doute été remarqué
par les anciens, et avait perpétué l’idée
de la fraternité qui avait dû exister en-
tre ces peuples. Leur culte d’ailleurs
portait une empreinte manifeste de la
théogonie orientale; et si l’on trouve les
noms des dieux de la Grèce répandus
dans le pays, c’est qu’ils étaient appli-
qués parles Grecs et les Romains à des
divinités cappadociennes (1). Le cuite
du feu, qui se perpétua en Cappadoce
longtemps après l’age romain (2), a été
introduit par des peuples étrangers,
avec celui de la déesse Anaitis. Strabon
atteste que de son temps les pyrées éle-
vés dans la plupart des provinces atti-
raient encore une foule d’adorateurs;
mais la vénération de tout le peuple
cappadocien était acquise à des divini-
tés indigènes, dont les temples effa-
çaient par leur magnificence toutes les
cérémonies du rnagisme. Ces temples de
Men, et de Mâ qu’il a plu aux Romains
de nommer Bellone (3), étaient de vé-
ritables centres de gouvernement dont
les pontifes étaient les rois. Tous ces
dieux ont été par la suite appelés dans
le panthéon romain, en quittant leurs
noms asiatiques pour prendre ceux de
Vesta , de Vénus-Uranie et de Lunus.
Le mot Men ne reparaît dans la langue
latine que pour former la racine du mot
Mensis, parce que la lune déterminait
la division des mois, comme cela a en-
core lieu chez tous les peuples orien-
taux.
Les royaumes situés à l’est de l’Eu-
(1) Strabon, XII. 535.
(2) Slrab., XV, ;33.
(3) César, de Bell, civil.