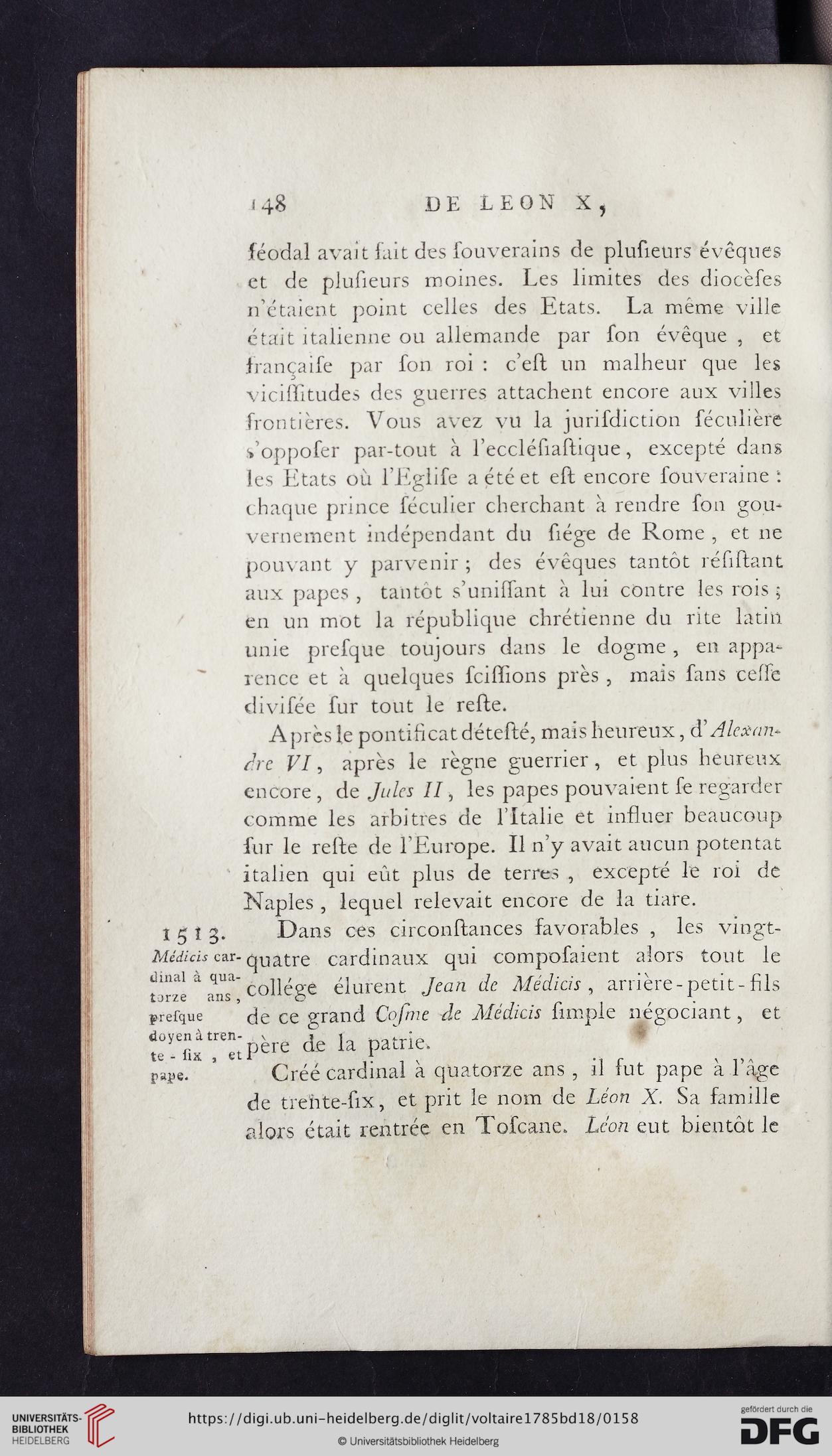148 U E 1 E 0 N X ,
féodal avait sait des souverains de plusieurs évêques
et de plusieurs moines. Les limites des diocèses
n’étaient point celles des Etats. La même ville
était italienne ou allemande par son évêque , et
française par son roi : c’est un malheur que les
vieilli tudes des guerres attachent encore aux villes
srontières. Vous avez vu la jurisdiction séculière
s’opposer par-tout à l’ecclésiastique, excepté dans
les Etats où l’Eglise a été et est encore souveraine :
chaque prince sécuher cherchant à rendre son gou-
vernement indépendant du siége de Rome , et ne
pouvant y parvenir ; des évêques tantôt résistant
aux papes , tantôt s’unisiant à lui contre les rois ;
en un mot la république chrétienne du rite latin
unie presque toujours dans le dogme , en appa-
rence et à quelques seissions près , mais sans celse
divisée sur tout le reste.
Après le pontificat détesté, mais heureux, d’^Zs^rnz-
dre VI, après le règne guerrier, et plus heureux
encore , de Jules II , les papes pouvaient se regarder
comme les arbitres de l’Italie et inssuer beaucoup
sur le reste de l’Europe. Il n’y avait aucun potentat
italien qui eût plus de terres , excepté le roi de
Naples , lequel relevait encore de la tiare.
I g î 3. Dans ces circonstances favorables , les vingt-
Médicis car- quatre cardinaux qui composaient alors tout le
tjrzè a collège élurent Jean de Médicis , arrière-petit-fils
presque de ce grand Cofme de Médicis simple négociant, et
doyenàtren- \ » 1
te - six , etPer£ de la PaLsie‘
pape. Créé cardinal à quatorze ans , il fut pape à l’âge
de trehte-six, et prit le nom de Léon X. Sa famille
alors était rentrée en Toscane. Léon eut bientôt le
féodal avait sait des souverains de plusieurs évêques
et de plusieurs moines. Les limites des diocèses
n’étaient point celles des Etats. La même ville
était italienne ou allemande par son évêque , et
française par son roi : c’est un malheur que les
vieilli tudes des guerres attachent encore aux villes
srontières. Vous avez vu la jurisdiction séculière
s’opposer par-tout à l’ecclésiastique, excepté dans
les Etats où l’Eglise a été et est encore souveraine :
chaque prince sécuher cherchant à rendre son gou-
vernement indépendant du siége de Rome , et ne
pouvant y parvenir ; des évêques tantôt résistant
aux papes , tantôt s’unisiant à lui contre les rois ;
en un mot la république chrétienne du rite latin
unie presque toujours dans le dogme , en appa-
rence et à quelques seissions près , mais sans celse
divisée sur tout le reste.
Après le pontificat détesté, mais heureux, d’^Zs^rnz-
dre VI, après le règne guerrier, et plus heureux
encore , de Jules II , les papes pouvaient se regarder
comme les arbitres de l’Italie et inssuer beaucoup
sur le reste de l’Europe. Il n’y avait aucun potentat
italien qui eût plus de terres , excepté le roi de
Naples , lequel relevait encore de la tiare.
I g î 3. Dans ces circonstances favorables , les vingt-
Médicis car- quatre cardinaux qui composaient alors tout le
tjrzè a collège élurent Jean de Médicis , arrière-petit-fils
presque de ce grand Cofme de Médicis simple négociant, et
doyenàtren- \ » 1
te - six , etPer£ de la PaLsie‘
pape. Créé cardinal à quatorze ans , il fut pape à l’âge
de trehte-six, et prit le nom de Léon X. Sa famille
alors était rentrée en Toscane. Léon eut bientôt le