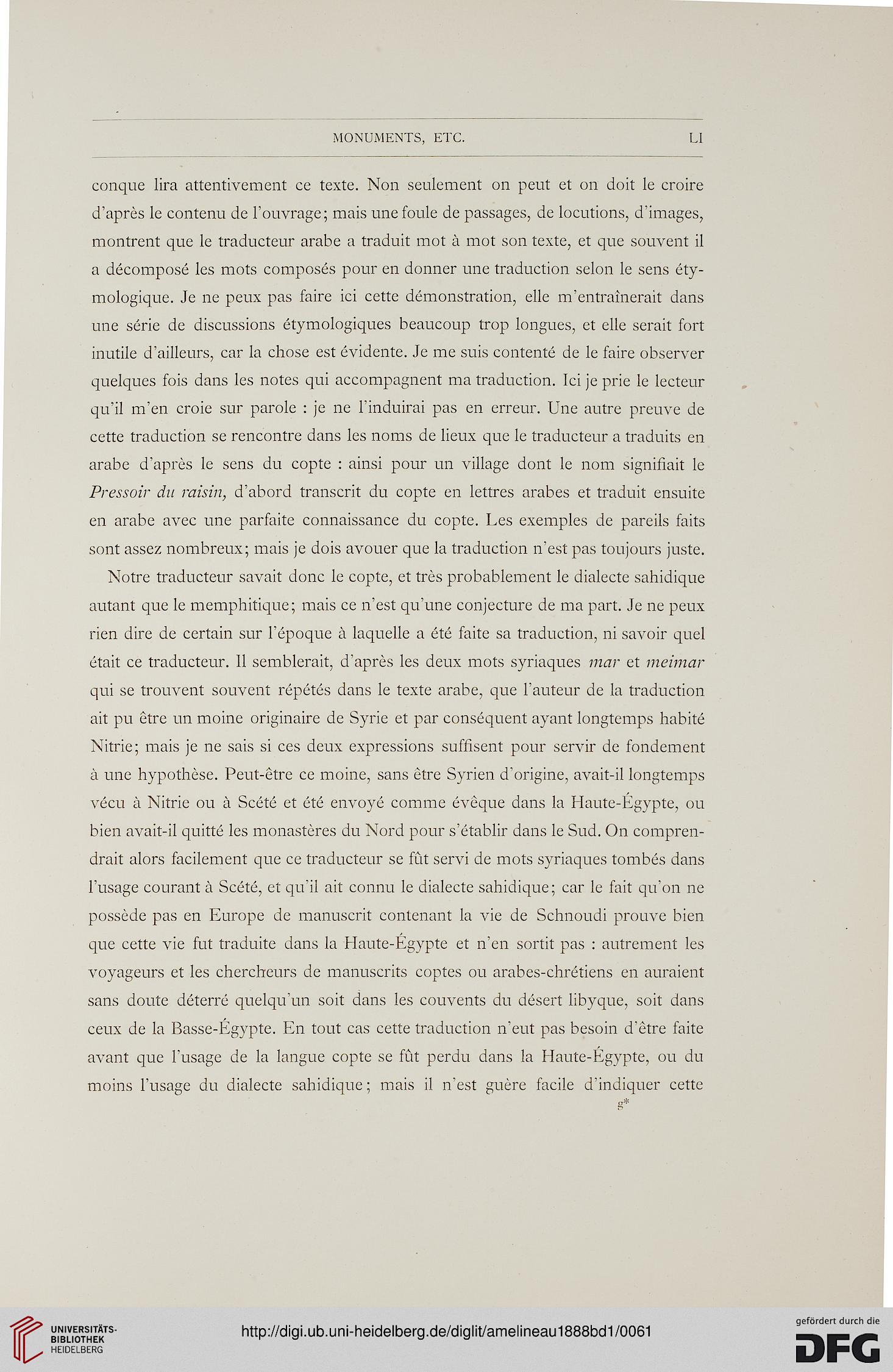MONUMENTS, ETC.
Ll
conque lira attentivement ce texte. Non seulement on peut et on doit le croire
d'après le contenu de l'ouvrage; mais une foule de passages, de locutions, d'images,
montrent que le traducteur arabe a traduit mot à mot son texte, et que souvent il
a décomposé les mots composés pour en donner une traduction selon le sens éty-
mologique. Je ne peux pas faire ici cette démonstration, elle m'entraînerait dans
une série de discussions étymologiques beaucoup trop longues, et elle serait fort
inutile d'ailleurs, car la chose est évidente. Je me suis contenté de le faire observer
quelques fois dans les notes qui accompagnent ma traduction. Ici je prie le lecteur
qu'il m'en croie sur parole : je ne l'induirai pas en erreur. Une autre preuve de
cette traduction se rencontre dans les noms de lieux que le traducteur a traduits en
arabe d'après le sens du copte : ainsi pour un village dont le nom signifiait le
Pressoir du raisin, d'abord transcrit du copte en lettres arabes et traduit ensuite
en arabe avec une parfaite connaissance du copte. Les exemples de pareils faits
sont assez nombreux; mais je dois avouer que la traduction n'est pas toujours juste.
Notre traducteur savait donc le copte, et très probablement le dialecte sahidique
autant que le memphitique; mais ce n'est qu'une conjecture de ma part. Je ne peux
rien dire de certain sur l'époque à laquelle a été faite sa traduction, ni savoir quel
était ce traducteur. Il semblerait, d'après les deux mots syriaques mar et meimar
qui se trouvent souvent répétés dans le texte arabe, que l'auteur de la traduction
ait pu être un moine originaire de Syrie et par conséquent ayant longtemps habité
Nitrie; mais je ne sais si ces deux expressions suffisent pour servir de fondement
à une hypothèse. Peut-être ce moine, sans être Syrien d'origine, avait-il longtemps
vécu à Nitrie ou à Scété et été envoyé comme évêque dans la Haute-Egypte, ou
bien avait-il quitté les monastères du Nord pour s'établir dans le Sud. On compren-
drait alors facilement que ce traducteur se fût servi de mots syriaques tombés dans
l'usage courant à Scété, et qu'il ait connu le dialecte sahidique; car le fait qu'on ne
possède pas en Europe de manuscrit contenant la vie de Schnoudi prouve bien
que cette vie fut traduite dans la Haute-Egypte et n'en sortit pas : autrement les
voyageurs et les chercheurs de manuscrits coptes ou arabes-chrétiens en auraient
sans doute déterré quelqu'un soit dans les couvents du désert libyque, soit dans
ceux de la Basse-Egypte. En tout cas cette traduction n'eut pas besoin d'être faite
avant que l'usage de la langue copte se fût perdu dans la Haute-Égypte, ou du
moins l'usage du dialecte sahidique ; mais il n'est guère facile d'indiquer cette
Ll
conque lira attentivement ce texte. Non seulement on peut et on doit le croire
d'après le contenu de l'ouvrage; mais une foule de passages, de locutions, d'images,
montrent que le traducteur arabe a traduit mot à mot son texte, et que souvent il
a décomposé les mots composés pour en donner une traduction selon le sens éty-
mologique. Je ne peux pas faire ici cette démonstration, elle m'entraînerait dans
une série de discussions étymologiques beaucoup trop longues, et elle serait fort
inutile d'ailleurs, car la chose est évidente. Je me suis contenté de le faire observer
quelques fois dans les notes qui accompagnent ma traduction. Ici je prie le lecteur
qu'il m'en croie sur parole : je ne l'induirai pas en erreur. Une autre preuve de
cette traduction se rencontre dans les noms de lieux que le traducteur a traduits en
arabe d'après le sens du copte : ainsi pour un village dont le nom signifiait le
Pressoir du raisin, d'abord transcrit du copte en lettres arabes et traduit ensuite
en arabe avec une parfaite connaissance du copte. Les exemples de pareils faits
sont assez nombreux; mais je dois avouer que la traduction n'est pas toujours juste.
Notre traducteur savait donc le copte, et très probablement le dialecte sahidique
autant que le memphitique; mais ce n'est qu'une conjecture de ma part. Je ne peux
rien dire de certain sur l'époque à laquelle a été faite sa traduction, ni savoir quel
était ce traducteur. Il semblerait, d'après les deux mots syriaques mar et meimar
qui se trouvent souvent répétés dans le texte arabe, que l'auteur de la traduction
ait pu être un moine originaire de Syrie et par conséquent ayant longtemps habité
Nitrie; mais je ne sais si ces deux expressions suffisent pour servir de fondement
à une hypothèse. Peut-être ce moine, sans être Syrien d'origine, avait-il longtemps
vécu à Nitrie ou à Scété et été envoyé comme évêque dans la Haute-Egypte, ou
bien avait-il quitté les monastères du Nord pour s'établir dans le Sud. On compren-
drait alors facilement que ce traducteur se fût servi de mots syriaques tombés dans
l'usage courant à Scété, et qu'il ait connu le dialecte sahidique; car le fait qu'on ne
possède pas en Europe de manuscrit contenant la vie de Schnoudi prouve bien
que cette vie fut traduite dans la Haute-Egypte et n'en sortit pas : autrement les
voyageurs et les chercheurs de manuscrits coptes ou arabes-chrétiens en auraient
sans doute déterré quelqu'un soit dans les couvents du désert libyque, soit dans
ceux de la Basse-Egypte. En tout cas cette traduction n'eut pas besoin d'être faite
avant que l'usage de la langue copte se fût perdu dans la Haute-Égypte, ou du
moins l'usage du dialecte sahidique ; mais il n'est guère facile d'indiquer cette