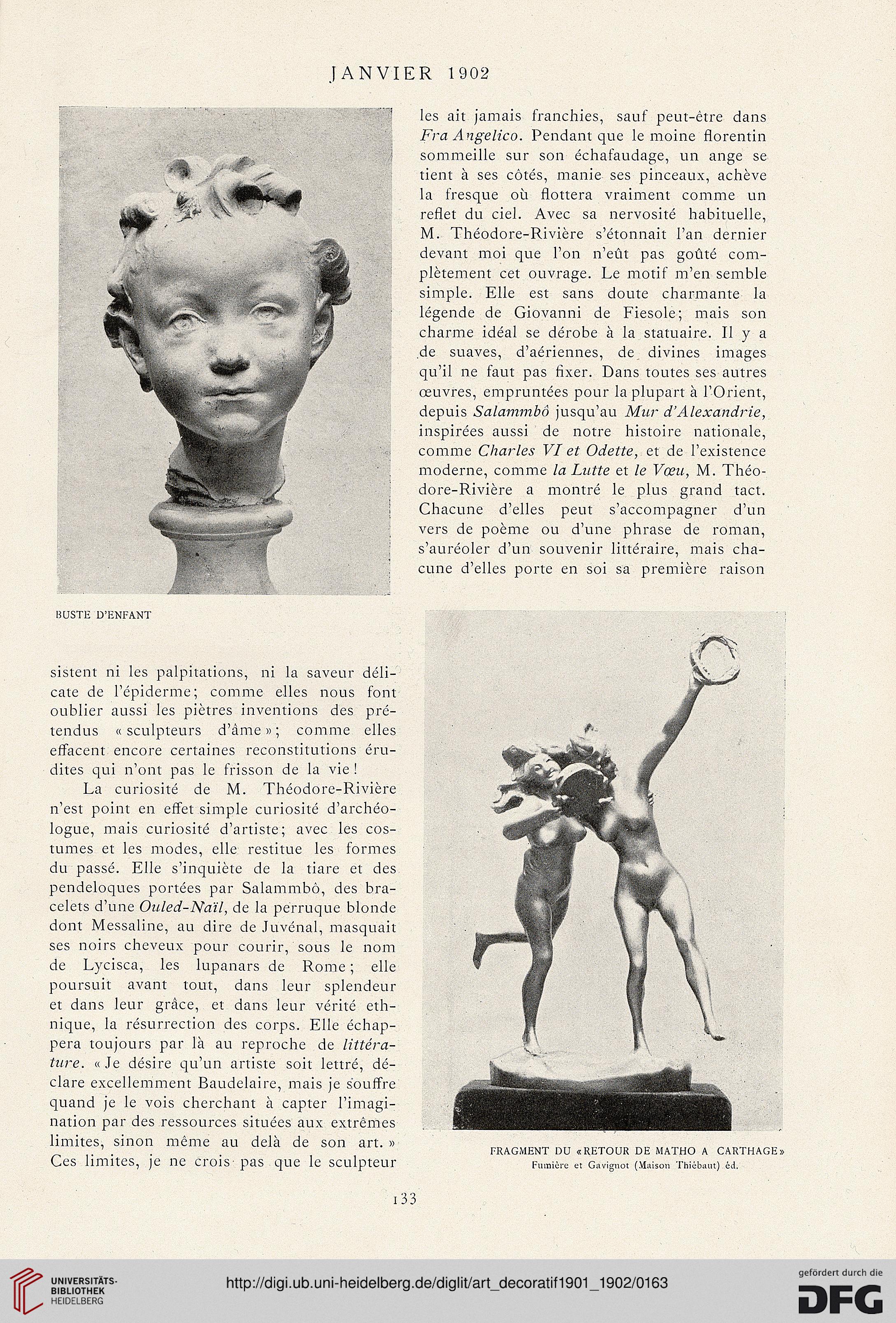JANVIER 1902
HUSTE D'ENFANT
sistcnt ni les palpitations, ni la saveur déli-
cate de l'épiderme; comme elles nous font
oublier aussi les piètres inventions des pré-
tendus «sculpteurs d'âme)); comme elles
effacent encore certaines reconstitutions éru-
dites qui n'ont pas le frisson de la vie !
La curiosité de M. Théodore-Rivière
n'est point en effet simple curiosité d'archéo-
logue, mais curiosité d'artiste; avec les cos-
tumes et les modes, elle restitue les formes
du passé. Elle s'inquiète de la tiare et des
pendeloques portées par Salammbô, des bra-
celets d'une OM/etf-AVtV, de la perruque blonde
dont Messaline, au dire de Juvénal, masquait
ses noirs cheveux pour courir, sous le nom
de Lycisca, les lupanars de Rome ; elle
poursuit avant tout, dans leur splendeur
et dans leur grâce, et dans leur vérité eth-
nique, la résurrection des corps. Elle échap-
pera toujours par là au reproche de /Rfértt-
Rtre. «Je désire qu'un artiste soit lettré, dé-
clare excellemment Baudelaire, mais je souffre
quand je le vois cherchant à capter l'imagi-
nation par des ressources situées aux extrêmes
limites, sinon même au delà de son art. ))
Ces limites, je ne crois pas que le sculpteur
les ait jamais franchies, sauf peut-être dans
Eruylng*e/;co. Pendant que le moine florentin
sommeille sur son échafaudage, un ange se
tient à ses côtés, manie ses pinceaux, achève
la fresque où flottera vraiment comme un
reflet du ciel. Avec sa nervosité habituelle,
M. Théodore-Rivière s'étonnait l'an dernier
devant moi que l'on n'eût pas goûté com-
plètement cet ouvrage. Le motif m'en semble
simple. Elle est sans doute charmante la
légende de Giovanni de Fiesole; mais son
charme idéal se dérobe à la statuaire. Il y a
de suaves, d'aériennes, de_ divines images
qu'il ne faut pas fixer. Dans toutes ses autres
œuvres, empruntées pour la plupart à l'Orient,
depuis -SVLwMMàd jusqu'au Afttr d'A/eArttntfrt'e,
inspirées aussi de notre histoire nationale,
comme C/tttr/ey Ef <R OJe/ïe, et de l'existence
moderne, comme L? Lu/ïe et /e Eœtt, M. Théo-
dore-Rivière a montré le plus grand tact.
Chacune d'elles peut s'accompagner d'un
vers de poème ou d'une phrase de roman,
s'auréoler d'un souvenir littéraire, mais cha-
cune d'elles porte en soi sa première raison
FRAGMENT DU c RETOUR DE MATHO A CARTHAGE
HUSTE D'ENFANT
sistcnt ni les palpitations, ni la saveur déli-
cate de l'épiderme; comme elles nous font
oublier aussi les piètres inventions des pré-
tendus «sculpteurs d'âme)); comme elles
effacent encore certaines reconstitutions éru-
dites qui n'ont pas le frisson de la vie !
La curiosité de M. Théodore-Rivière
n'est point en effet simple curiosité d'archéo-
logue, mais curiosité d'artiste; avec les cos-
tumes et les modes, elle restitue les formes
du passé. Elle s'inquiète de la tiare et des
pendeloques portées par Salammbô, des bra-
celets d'une OM/etf-AVtV, de la perruque blonde
dont Messaline, au dire de Juvénal, masquait
ses noirs cheveux pour courir, sous le nom
de Lycisca, les lupanars de Rome ; elle
poursuit avant tout, dans leur splendeur
et dans leur grâce, et dans leur vérité eth-
nique, la résurrection des corps. Elle échap-
pera toujours par là au reproche de /Rfértt-
Rtre. «Je désire qu'un artiste soit lettré, dé-
clare excellemment Baudelaire, mais je souffre
quand je le vois cherchant à capter l'imagi-
nation par des ressources situées aux extrêmes
limites, sinon même au delà de son art. ))
Ces limites, je ne crois pas que le sculpteur
les ait jamais franchies, sauf peut-être dans
Eruylng*e/;co. Pendant que le moine florentin
sommeille sur son échafaudage, un ange se
tient à ses côtés, manie ses pinceaux, achève
la fresque où flottera vraiment comme un
reflet du ciel. Avec sa nervosité habituelle,
M. Théodore-Rivière s'étonnait l'an dernier
devant moi que l'on n'eût pas goûté com-
plètement cet ouvrage. Le motif m'en semble
simple. Elle est sans doute charmante la
légende de Giovanni de Fiesole; mais son
charme idéal se dérobe à la statuaire. Il y a
de suaves, d'aériennes, de_ divines images
qu'il ne faut pas fixer. Dans toutes ses autres
œuvres, empruntées pour la plupart à l'Orient,
depuis -SVLwMMàd jusqu'au Afttr d'A/eArttntfrt'e,
inspirées aussi de notre histoire nationale,
comme C/tttr/ey Ef <R OJe/ïe, et de l'existence
moderne, comme L? Lu/ïe et /e Eœtt, M. Théo-
dore-Rivière a montré le plus grand tact.
Chacune d'elles peut s'accompagner d'un
vers de poème ou d'une phrase de roman,
s'auréoler d'un souvenir littéraire, mais cha-
cune d'elles porte en soi sa première raison
FRAGMENT DU c RETOUR DE MATHO A CARTHAGE