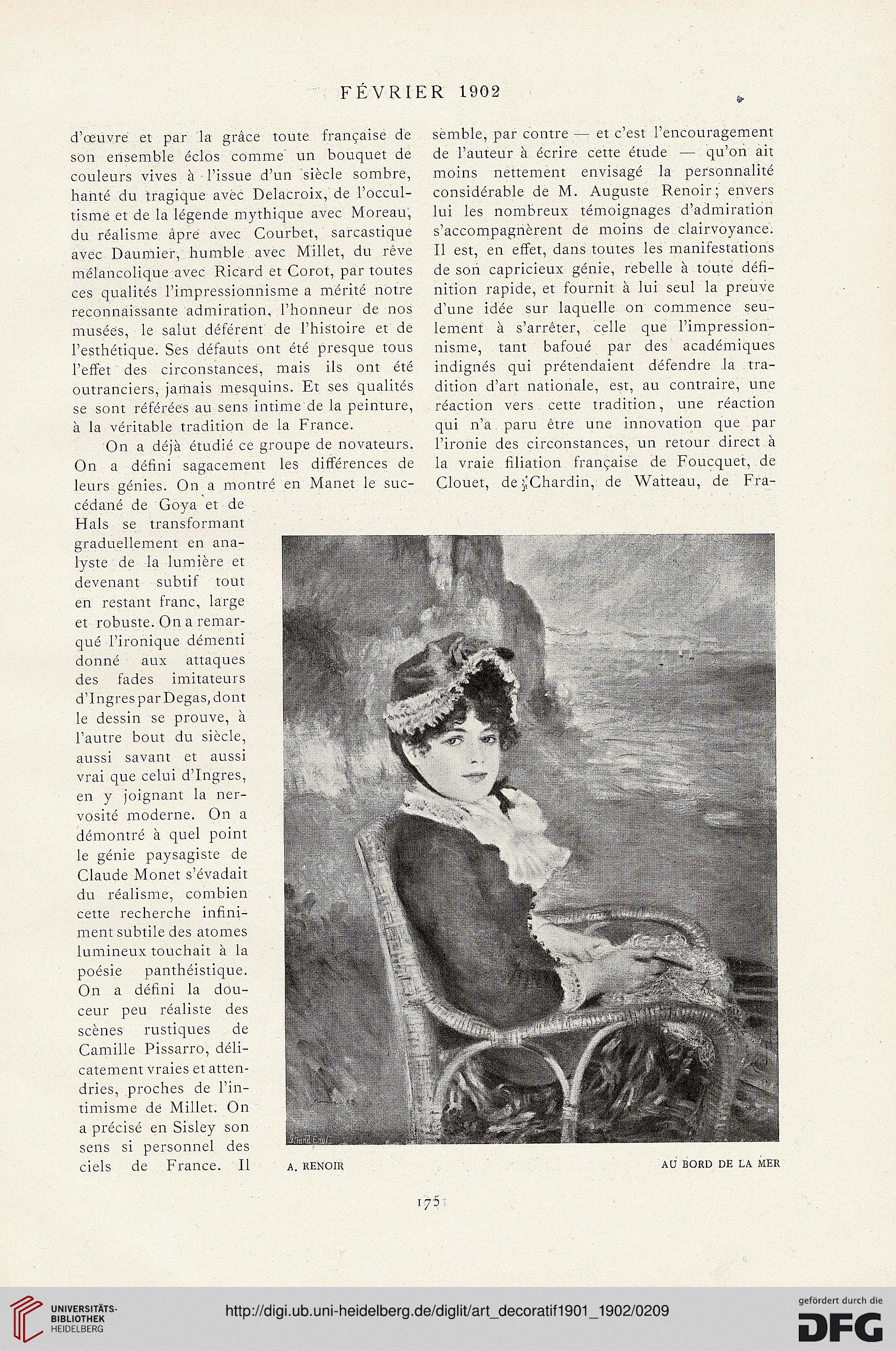FEVRIER 1902
y
d'œuvre et par la grâce toute française de
son ensemble éclos comme un bouquet de
couleurs vives à l'issue d'un siècle sombre,
hanté du tragique avec Delacroix, de l'occul-
tisme et de la légende mythique avec Moreau,
du réalisme âpre avec Courbet, sarcastique
avec Daumier, humble avec Millet, du rêve
mélancolique avec Ricard et Corot, par toutes
ces qualités l'impressionnisme a mérité notre
reconnaissante admiration, l'honneur de nos
musées, le salut déférent de l'histoire et de
l'esthétique. Ses défauts ont été presque tous
l'effet des circonstances, mais ils ont été
outranciers, jamais mesquins. Et ses qualités
se sont référées au sens intime de la peinture,
à la véritable tradition de la France.
On a déjà étudié ce groupe de novateurs.
On a défini sagacement les différences de
leurs génies. On a montré en Manet le suc-
cédané de Goya et de
Hais se transformant
graduellement en ana-
lyste de la lumière et
devenant subtil' tout
en restant franc, large
et robuste. On a remar-
qué l'ironique démenti
donné aux attaques
des fades imitateurs
d'Ingres par Degas, dont
le dessin se prouve, à
l'autre bout du siècle,
aussi savant et aussi
vrai que celui d'Ingres,
en y joignant la ner-
vosité moderne. On a
démontré à quel point
le génie paysagiste de
Claude Monet s'évadait
du réalisme, combien
cette recherche infini-
ment subtile des atomes
lumineux touchait à la
poésie panthéistique.
On a défini la dou-
ceur peu réaliste des
scènes rustiques de
Camille Pissarro, déli-
catement vraies et atten-
dries, proches de l'in-
timisme de Millet. On
a précisé en Sisley son
sens si personnel des
ciels de France. 11
semble, par contre —- et c'est l'encouragement
de l'auteur à écrire cette étude — qu'on ait
moins nettement envisagé la personnalité
considérable de M. Auguste Renoir; envers
lui les nombreux témoignages d'admiration
s'accompagnèrent de moins de clairvoyance.
Il est, en effet, dans toutes les manifestations
de son capricieux génie, rebelle à toute défi-
nition rapide, et fournit à lui seul la preuve
d'une idée sur laquelle on commence seu-
lement à s'arrêter, celle que l'impression-
nisme, tant bafoué par des académiques
indignés qui prétendaient défendre la tra-
dition d'art nationale, est, au contraire, une
réaction vers cette tradition, une réaction
qui n'a paru être une innovation que par
l'ironie des circonstances, un retour direct à
la vraie filiation française de Foucquet, de
Glouet, dejjGhardin, de Watteau, de Fra-
A. RENOIR AU BORD DE LA MER
[
/5
y
d'œuvre et par la grâce toute française de
son ensemble éclos comme un bouquet de
couleurs vives à l'issue d'un siècle sombre,
hanté du tragique avec Delacroix, de l'occul-
tisme et de la légende mythique avec Moreau,
du réalisme âpre avec Courbet, sarcastique
avec Daumier, humble avec Millet, du rêve
mélancolique avec Ricard et Corot, par toutes
ces qualités l'impressionnisme a mérité notre
reconnaissante admiration, l'honneur de nos
musées, le salut déférent de l'histoire et de
l'esthétique. Ses défauts ont été presque tous
l'effet des circonstances, mais ils ont été
outranciers, jamais mesquins. Et ses qualités
se sont référées au sens intime de la peinture,
à la véritable tradition de la France.
On a déjà étudié ce groupe de novateurs.
On a défini sagacement les différences de
leurs génies. On a montré en Manet le suc-
cédané de Goya et de
Hais se transformant
graduellement en ana-
lyste de la lumière et
devenant subtil' tout
en restant franc, large
et robuste. On a remar-
qué l'ironique démenti
donné aux attaques
des fades imitateurs
d'Ingres par Degas, dont
le dessin se prouve, à
l'autre bout du siècle,
aussi savant et aussi
vrai que celui d'Ingres,
en y joignant la ner-
vosité moderne. On a
démontré à quel point
le génie paysagiste de
Claude Monet s'évadait
du réalisme, combien
cette recherche infini-
ment subtile des atomes
lumineux touchait à la
poésie panthéistique.
On a défini la dou-
ceur peu réaliste des
scènes rustiques de
Camille Pissarro, déli-
catement vraies et atten-
dries, proches de l'in-
timisme de Millet. On
a précisé en Sisley son
sens si personnel des
ciels de France. 11
semble, par contre —- et c'est l'encouragement
de l'auteur à écrire cette étude — qu'on ait
moins nettement envisagé la personnalité
considérable de M. Auguste Renoir; envers
lui les nombreux témoignages d'admiration
s'accompagnèrent de moins de clairvoyance.
Il est, en effet, dans toutes les manifestations
de son capricieux génie, rebelle à toute défi-
nition rapide, et fournit à lui seul la preuve
d'une idée sur laquelle on commence seu-
lement à s'arrêter, celle que l'impression-
nisme, tant bafoué par des académiques
indignés qui prétendaient défendre la tra-
dition d'art nationale, est, au contraire, une
réaction vers cette tradition, une réaction
qui n'a paru être une innovation que par
l'ironie des circonstances, un retour direct à
la vraie filiation française de Foucquet, de
Glouet, dejjGhardin, de Watteau, de Fra-
A. RENOIR AU BORD DE LA MER
[
/5