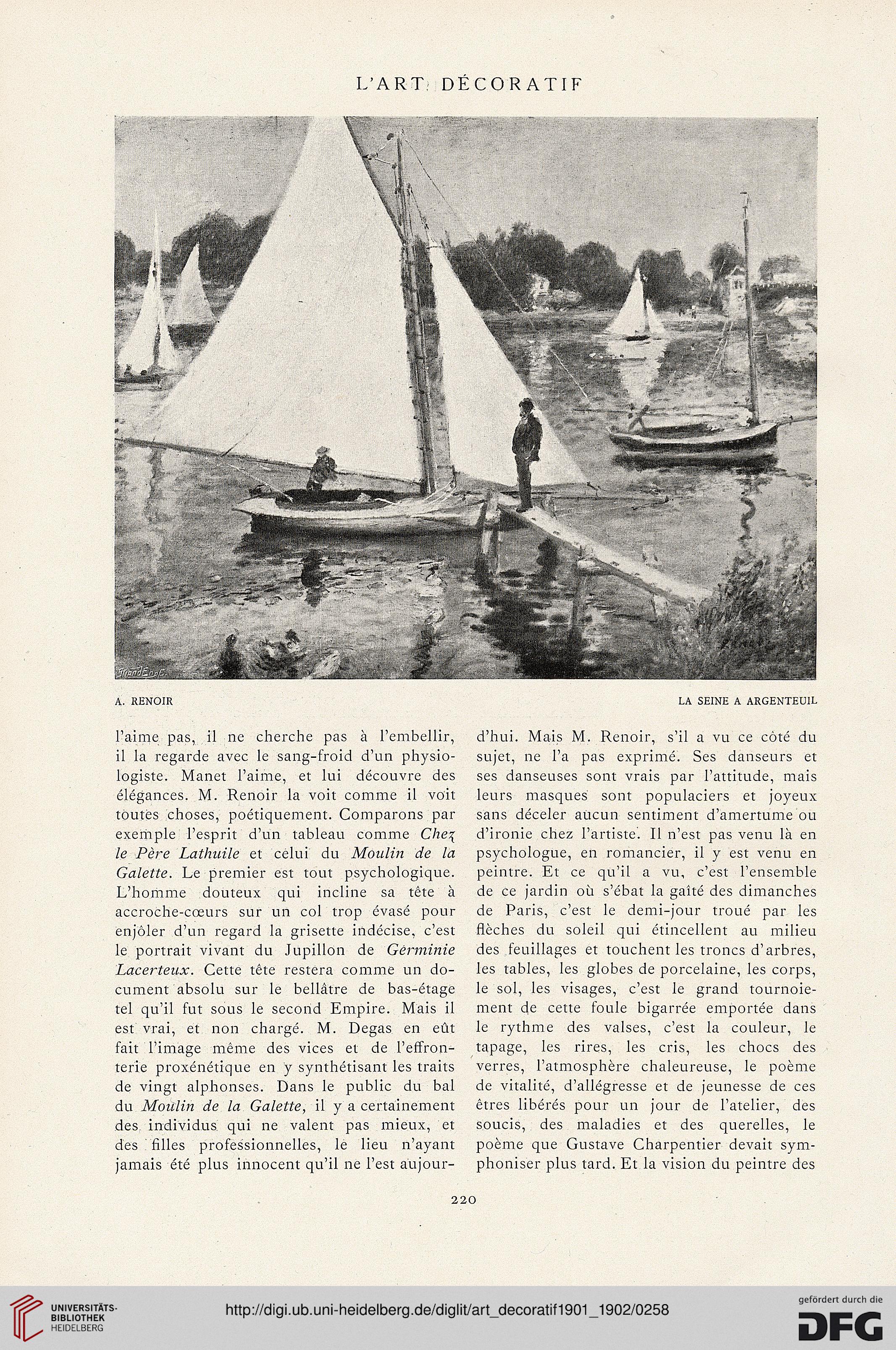L'ART DECORATIF
A. RENOIR
l'aime pas, il ne cherche pas à l'embeiiir,
ii la regarde avec le sang-froid d'un physio-
logiste. Manet l'aime, et lui découvre des
élégances. M. Renoir la voit comme il voit
toutes choses, poétiquement. Comparons par
exemple l'esprit d'un tableau comme
/<? Père Auf/iMt/e et celui du Afoiz/nz t/e /tt
Ga/etfe. Le premier est tout psychologique.
L'homme douteux qui incline sa tête à
accroche-cœurs sur un col trop évasé pour
enjôler d'un regard la grisette indécise, c'est
le portrait vivant du Jupillon de Cerzmwz'e
Lttcer^eMJc. Cette tête restera comme un do-
cument absolu sur le bellâtre de bas-étage
tel qu'il fut sous le second Empire. Mais il
est vrai, et non chargé. M. Degas en eût
fait l'image même des vices et de l'effron-
terie proxénétique en y synthétisant les traits
de vingt alphonses. Dans le public du bal
du Afozt/zn t/e /tt Gtt/eKe, il y a certainement
des individus qui ne valent pas mieux, et
des filles professionnelles, le lieu n'ayant
jamais été plus innocent qu'il ne l'est aujour-
LA SEINE A ARGENTEUIL
d'hui. Mais M. Renoir, s'il a vu ce côté du
sujet, ne l'a pas exprimé. Ses danseurs et
ses danseuses sont vrais par l'attitude, mais
leurs masques sont populaciers et joyeux
sans déceler aucun sentiment d'amertume ou
d'ironie chez l'artiste. Il n'est pas venu là en
psychologue, en romancier, il y est venu en
peintre. Et ce qu'il a vu. c'est l'ensemble
de ce jardin où s'ébat la gaité des dimanches
de Paris, c'est le demi-jour troué par les
flèches du soleil qui étincellent au milieu
des feuillages et touchent les troncs d'arbres,
les tables, les globes de porcelaine, les corps,
le sol, les visages, c'est le grand tournoie-
ment de cette foule bigarrée emportée dans
le rythme des valses, c'est la couleur, le
tapage, les rires, les cris, les chocs des
verres, l'atmosphère chaleureuse, le poème
de vitalité, d'allégresse et de jeunesse de ces
êtres libérés pour un jour de l'atelier, des
soucis, des maladies et des querelles, le
poème que Gustave Charpentier devait sym-
phoniser plus tard. Et la vision du peintre des
220
A. RENOIR
l'aime pas, il ne cherche pas à l'embeiiir,
ii la regarde avec le sang-froid d'un physio-
logiste. Manet l'aime, et lui découvre des
élégances. M. Renoir la voit comme il voit
toutes choses, poétiquement. Comparons par
exemple l'esprit d'un tableau comme
/<? Père Auf/iMt/e et celui du Afoiz/nz t/e /tt
Ga/etfe. Le premier est tout psychologique.
L'homme douteux qui incline sa tête à
accroche-cœurs sur un col trop évasé pour
enjôler d'un regard la grisette indécise, c'est
le portrait vivant du Jupillon de Cerzmwz'e
Lttcer^eMJc. Cette tête restera comme un do-
cument absolu sur le bellâtre de bas-étage
tel qu'il fut sous le second Empire. Mais il
est vrai, et non chargé. M. Degas en eût
fait l'image même des vices et de l'effron-
terie proxénétique en y synthétisant les traits
de vingt alphonses. Dans le public du bal
du Afozt/zn t/e /tt Gtt/eKe, il y a certainement
des individus qui ne valent pas mieux, et
des filles professionnelles, le lieu n'ayant
jamais été plus innocent qu'il ne l'est aujour-
LA SEINE A ARGENTEUIL
d'hui. Mais M. Renoir, s'il a vu ce côté du
sujet, ne l'a pas exprimé. Ses danseurs et
ses danseuses sont vrais par l'attitude, mais
leurs masques sont populaciers et joyeux
sans déceler aucun sentiment d'amertume ou
d'ironie chez l'artiste. Il n'est pas venu là en
psychologue, en romancier, il y est venu en
peintre. Et ce qu'il a vu. c'est l'ensemble
de ce jardin où s'ébat la gaité des dimanches
de Paris, c'est le demi-jour troué par les
flèches du soleil qui étincellent au milieu
des feuillages et touchent les troncs d'arbres,
les tables, les globes de porcelaine, les corps,
le sol, les visages, c'est le grand tournoie-
ment de cette foule bigarrée emportée dans
le rythme des valses, c'est la couleur, le
tapage, les rires, les cris, les chocs des
verres, l'atmosphère chaleureuse, le poème
de vitalité, d'allégresse et de jeunesse de ces
êtres libérés pour un jour de l'atelier, des
soucis, des maladies et des querelles, le
poème que Gustave Charpentier devait sym-
phoniser plus tard. Et la vision du peintre des
220